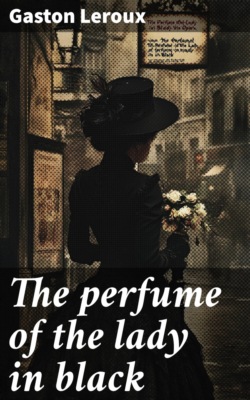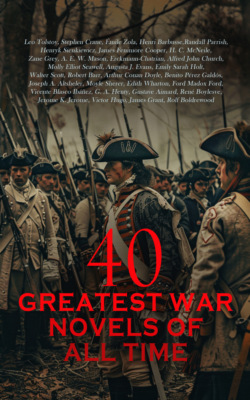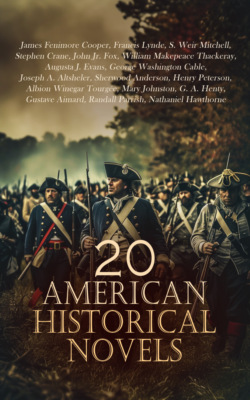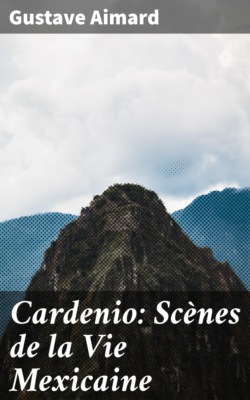Kitabı oku: «Le Montonéro», sayfa 20
XX
LE PARTISAN
Il nous faut maintenant retourner auprès des chefs guaycurús que nous avons abandonnés au moment où, à la suite de don Zéno Cabral, ils entraient dans une caverne, où le montonero, du moins d'après les paroles qu'il avait prononcées en les accostant, paraissait avoir donné rendez-vous au Cougouar.
Cette caverne dont l'entrée, à moins de bien la connaître, était impossible à distinguer du dehors à cause de la conformation du paysage dont elle formait le centre, et de la difficulté avec laquelle on y parvenait était vaste et parfaitement claire à cause d'une infinité de fissures imperceptibles presque, qui y laissaient pénétrer la lumière en y renouvelant l'air; dans le fond et sur les côtés s'ouvraient plusieurs galeries qui se perdaient sous la montagne à des distances probablement fort grandes.
L'endroit où le partisan s'arrêta, c'est-à-dire à quelques pas à peine de l'ouverture, contenait plusieurs sièges formés avec des blocs de chêne mal équarris et deux ou trois amas de feuilles sèches servant probablement de lits à ceux qui venaient chercher en ce lieu un refuge temporaire.
Au centre de la caverne, un grand feu était allumé. Sur ce feu, suspendu par une chaîne, à trois pieux placés en faisceau, bouillait une marmite de fer, tandis qu'un quartier de guanaco, enfilé dans une baguette de fusil fichée dans le sol, rôtissait tout doucement; quelques patates cuisaient sous la cendre et plusieurs cornes de bœuf contenant de l'harina tostada étaient placées près des sièges par terre. Les armes de Zéno Cabral, c'est-à-dire son fusil et son sabre, étaient appuyés contre une des parois de la caverne. Il n'avait conservé que son couteau à sa polena droite.
– Señores, dit le partisan avec un geste courtois, permettez-moi de vous offrir la mince hospitalité que les circonstances où nous nous trouvons m'obligent à vous donner. Avant tout, nous mangerons et boirons ensemble, afin de bien établir la confiance entre nous et d'éloigner tout soupçon de trahison.
Ces paroles avaient été prononcées en portugais, les capitaos répondirent dans la même langue et s'assirent à l'exemple de leur amphitryon sur les sièges préparés pour eux.
Zéno Cabral décrocha alors la marmite et servit avec une adresse et une vivacité peu communes, dans des couis qu'il présenta ensuite à ses hôtes du tocino, du chorizo et du charqui, assaisonné avec des camotes et de l'ajo, ce qui forme le plat national de ces contrées.
Le repas commença, et les chefs attaquèrent vigoureusement les mets placés devant eux, se servant de leur couteau en guise de fourchette et buvant à la ronde de l'eau légèrement coupée avec de l'aguardiente de Pisco, afin d'en enlever l'âcreté.
Les Indiens ne parlent pas en mangeant; aussi leurs repas sont-ils généralement fort courts. Après le charqui, ce fut le tour du guanaco; puis l'harina tostada fut mangée délayée avec de l'eau chaude, et enfin Zéno Cabral confectionna le maté 6, et l'offrit à ses convives.
Lorsque le maté fut bu et que nos trois personnages eurent allumé leurs cigarettes de paille de maïs; Zéno Cabral prit enfin la parole.
– Je dois m'excuser près de vous, señor capitao, dit-il en portugais à Gueyma, l'espèce de surprise au moyen de laquelle j'ai obtenu une entrevue de vous; le Cougouar, dont depuis longtemps déjà j'ai l'honneur d'être l'ami, m'avait engagé d'agir ainsi que je l'ai fait; si une faute a été commise, c'est donc sur lui que doit en retomber le blâme.
– Ce que le Cougouar fait est toujours bien, señor, répondit en souriant le chef, il est mon père, puisque c'est à lui que je dois d'être ce que je suis, je n'ai donc pas à le blâmer, convaincu que des raisons fort sérieuses et qui, sans doute, me seront plus tard expliquées, l'empêchaient de procéder autrement.
– Gueyma a bien parlé comme toujours, dit le Cougouar, la sagesse réside en lui; le chef blanc ne tardera pas à déduire les motifs de sa conduite.
– C'est ce que je vais faire à l'instant, si les capitaos veulent bien me prêter leur attention, reprit Zéno Cabral.
– Que mon père parle, nos oreilles sont ouvertes.
Le partisan se recueillit pendant deux ou trois minutes, puis il commença en ces termes:
– Mes frères les guerriers guaycurús trompés par les paroles menteuses d'un blanc, ont consenti à former une alliance avec lui et à le suivre dans cette contrée pour l'aider à combattre d'autres blancs qui jamais n'avaient fait de mal à mes frères, et dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Mais pendant que les guerriers entraient sur le sentier, de la guerre et abandonnaient leurs territoires de chasse sous la sauvegarde de l'honneur de leurs nouveaux alliés, ceux-ci, qui n'avaient d'autre but que celui de les éloigner, afin de s'emparer plus facilement de leurs riches et fertiles contrées, envahissaient au mépris de la foi jurée leurs territoires de chasse, et essayaient de s'y établir. Ce projet inique, cette infâme trahison aurait réussi probablement, vu l'éloignement des plus braves guerriers de la nation, si un ami des Guaycurús, révolté de cette action infâme, n'avait fait prévenir Tarou-Niom, le grand capitao des Guaycurús, de se mettre sur ses gardes et ne lui avait fait contracter une alliance offensive et défensive avec Emavidi-Chaïmè, le grand chef des Payagoas, afin de s'opposer aux attaques de l'ennemi commun.
Malgré l'impassibilité de commande dont les Indiens font parade dans les circonstances les plus sérieuses, Gueyma, en apprenant ces nouvelles si nettement et si froidement articulées, ne put se contenir. Ses sourcils se froncèrent, ses narines se dilatèrent comme celles d'une bête fauve; il bondit sur ses pieds, et frappant violemment ses mains l'une contre l'autre:
– Mon frère, le chef pâle a les preuves de ce qu'il avance, n'est-ce pas? s'écria-t-il avec un accent de sourde menace.
– Je les ai, répondit simplement Zéno Cabral.
– Bon, alors il me les donnera.
– Je les donnerai au capitao.
– Mais il est autre chose que je veux savoir encore.
– Que veut savoir mon frère?
– Quel est l'ami des Guaycurús qui les a avertis de l'horrible trahison qui se tramait contre eux?
– A quoi bon dire cela à mon frère?
– Parce que de même que je connais mes ennemis, je veux connaître mes amis.
Zéno Cabral s'inclina.
– C'est moi, dit-il.
Gueyma le regarda un instant avec une fixité étrange, comme s'il eût voulu lire jusqu'au fond de son cœur ses pensées les plus secrètes.
– C'est bon, dit-il enfin, ce que dit mon frère doit être vrai, Gueyma le remercie et lui offre sa main.
– Je l'accepte avec empressement, car depuis longtemps déjà j'aime le capitao, répondit le partisan, en pressant la main que lui tendait le chef.
– Maintenant, quelles sont les preuves que mon frère me donnera?
Zéno Cabral fouilla sous son poncho et en retira un quipu7 qu'il présenta sans répondre au chef.
Celui-ci le saisit vivement et se mit aussitôt à le déchiffrer, avec la même rapidité qu'un Européen lit une lettre.
Peu à peu, les traits du chef reprirent leur rigidité marmoréenne; puis, après avoir complètement déchiffré le quipu, il le tendit au Cougouar, et se tournant vers Zéno Cabral, qui suivait tous ses mouvements avec une anxiété secrète:
– Maintenant que je sais l'insulte qui m'a été faite, dit-il froidement, mon frère me donnera sans doute les moyens de me venger.
– Peut-être y parviendrai-je, répondit le partisan.
– Pourquoi avoir le doute sur les lèvres quand la certitude est dans le cœur? reprit Gueyma.
– Que veut dire le capitao?
– Je veux dire que personne dans le but unique d'être agréable à un homme qu'il ne connait pas, ne fait ce qu'a fait mon frère.
– Je connais le capitao plus qu'il ne le suppose.
– C'est possible, j'admets cela; mais il n'en reste pas moins évident pour moi que mon frère le chef pâle avait un but en agissant ainsi qu'il l'a fait; c'est ce but que Gueyma désire connaître.
– Que mon frère suppose que moi aussi j'aie à me venger de l'homme qui l'a insulté, et que, pour que cette vengeance soit plus sûre et plus éclatante j'aie besoin de l'aide de mon frère; me la refuserait-il?
– Non, certes, si le fait, au lieu d'être une supposition, était une réalité.
– Le capitao me le promet?
– Je le promets.
– Eh bien! Les prévisions du chef sont justes. Malgré la vive et sincère amitié que j'ai pour lui, obligé, en ce moment, de m'occuper d'affaires fort sérieuses peut-être aurais-je négligé de m'occuper des siennes, si je n'avais pas eu un puissant intérêt à le faire et si l'homme dont il veut se venger n'était pas depuis longtemps mon ennemi; voilà la vérité tout entière.
– Eah! Mon frère a bien parlé; sa langue n'est pas fourchue; les paroles que souffle sa poitrine sont loyales. Que fera mon frère pour assurer ma vengeance en même temps que la sienne?
– Deux choses.
– Quelle est la première?
– Je livrerai entre les mains du capitao la femme et la fille de son ennemi.
L'œil de l'lndien lança un fulgurant éclair de joie.
– Bon! s'écria-t-il; voyons la seconde maintenant.
– Je guiderai mon frère par des sentiers de bêtes fauves, connus de moi seul, et avec les riches proies que je lui aurai livrées, je lui ferai attendre, en moins de cinq jours, la frontière de ses territoires de chasse.
– Mon frère fera cela?
– Je le ferai, je le jure!
– C'est bien; quand les deux femmes pâles seront-elles mes captives?
– Avant deux jours, si le chef consent à m'aider.
– J'ai dit au chef blanc qu'il pouvait disposer de moi, qu'il parle donc sans crainte.
Zéno Cabral jeta un regard interrogateur au Cougouar qui jusqu'à ce moment, avait assisté muet et impassible à cet entretien.
– Mon frère peut parler, dit le vieux chef, la parole de Gueyma est celle d'un capitao, rien ne saurait la faire changer.
– Seulement, que mon frère prête la plus sérieuse attention à ce que je vais dire; je ne ferai ce que j'ai proposé qu'à une condition.
– J'écoute.
– Mon frère ne pourra disposer, sous aucun prétexte, des captives remises entre ses mains sans mon autorisation; sous aucun prétexte, il ne leur rendra la liberté sans que j'y consente. Pour le reste, le Cougouar connaît mes intentions, et il a promis de s'y conformer.
– Est-ce vrai? demanda Gueyma au vieux chef en se tournant vers lui.
– C'est vrai, répondit laconiquement celui-ci.
– Le Cougouar, reprit le jeune homme, est un des plus sages guerriers de ma nation; ce qu'il fait est toujours bien; il est de mon devoir de suivre son exemple; j'adhère à ce que désire le chef blanc.
Zéno Cabral inclina la tête en signe de remercîment et, malgré lui, un éclair de satisfaction illumina pour une seconde son visage austère.
Gueyma reprit:
– Le chef pâle a-t-il autre chose à ajouter à ce qu'il m'a dit?
– Rien, répondit le partisan.
– C'est bien; à moi maintenant à poser mes conditions.
– C'est trop juste, chef, je vous écoute.
– Mon père, le chef blanc, connaît les coutumes de la pampa, n'est-il pas vrai?
– Je les connais, ma vie presque entière s'est écoulée au désert.
– Connaît-il la cérémonie du pacte de vengeance en usage dans la nation des Guaycurús?
– J'en ai entendu parler, sans cependant l'avoir jamais encore pratiquée pour mon propre compte; je sais que c'est une espèce de fraternité d'armes qui lie deux hommes l'un à l'autre par un lien plus fort que la parenté la plus proche.
– Oui, c'est en effet cela; mon frère consent-il à ce que cette cérémonie soit faite par nous?
– J'y consens de grand cœur, chef, répondit le partisan sans hésiter, parce que mes intentions sont pures, que nulle pensée de trahison n'est dans mon cœur et que j'éprouve pour mon frère une vive amitié.
– Bien, reprit en souriant le jeune chef, je remercie mon frère de m'accepter pour compagnon du sang; le Cougouar nous attachera l'un à l'autre.
– Soit, répondit simplement celui-ci.
Les trois hommes se levèrent.
Le Cougouar s'avança alors entre eux, et leur faisant étendre en avant à chacun la main droite:
– Chacun de vous, dit-il, est double; il a un ami pour veiller sur lui en tous lieux et en toutes circonstances, le jour comme la nuit, le matin comme le soir; les ennemis de l'un sont les ennemis de l'autre; ce que l'un possède appartient à son ami. A l'appel de son compagnon de sang, n'importe où il se trouve, n'importe ce qu'il fasse, l'ami doit aussitôt tout abandonner pour accourir auprès de celui qui réclame sa présence. La mort même ne saurait vous désunir: dans l'autre vie, votre pacte continuera aussi fort que dans celle-ci. Vous, Zéno Cabral, pour la nation des Guaycurús, vous vous nommez maintenant Cabral Gueyma; et vous, Gueyma, pour les frères de votre ami, vous êtes Gueyma Zéno. Votre sang même doit se mêler dans votre poitrine, afin que vos pensées soient bien réellement les mêmes et que, à l'heure où vous comparaîtrez, après votre mort, devant le Maître du monde, il vous reconnaisse et vous réunisse l'un à l'autre.
Après avoir ainsi parlé, le Cougouar tira son couteau de sa gaine et piqua légèrement la poitrine du partisan juste à la place du cœur.
Zéno supporta sans trembler ni pâlir cette effrayante incision, le vieux chef recueillit le sang qui coula de la blessure dans un couis dans lequel un peu d'eau était restée; il incisa de même la poitrine du jeune chef et fit aussi couler son sang dans le couis.
Élevant alors le vase au-dessus de sa tête:
– Guerriers, s'écria-t-il d'une voix sombre et empreinte d'une majesté suprême, là est contenu votre sang, si bien mêlé qu'il ne pourrait plus être séparé; chacun de vous va boire à cette coupe que, entre vous deux, vous devez vider; à vous d'abord, ajouta-t-il en se tournant vers Zéno Cabral en tendant le vase vers lui.
– Donnez, répondit froidement le partisan et il le porta sans hésiter à ses lèvres.
Lorsqu'il eut bu la moitié à peu près de ce qu'il contenait. Il le présenta à Gueyma; celui-ci le prit sans prononcer une parole et le vida d'un trait.
– A notre prochaine rencontre, frère, dit alors le jeune chef, nous échangerons nos chevaux, car nous ne le pouvons faire en ce moment. En attendant, voici mon fusil, mon sabre, mon couteau, ma poire à poudre, mon sac à balles, mon lasso et mes bolas; acceptez-les, et veuille le Grand-Esprit qu'ils vous fassent un aussi bon service qu'ils m'en ont fait un à moi.
– Je les reçois, frère, en échange de mes armes que voici.
Puis les deux hommes s'embrassèrent, et la cérémonie fut terminée.
– Maintenant, dit le Cougouar, le moment de nous séparer est arrivé, il nous faut rejoindre nos guerriers: où nous retrouverons-nous et quand aura lieu cette rencontre?
– Le deuxième soleil après celui-ci, répondit le partisan, j'attendrai mes frères trois heures avant le coucher du soleil au cañon de yerbas verdes, les captives seront avec moi; le cri de l'aigle des cordillières, trois fois répété, avertira mes frères de ma présence, ils me répondront par celui du maukawis répété le même nombre de fois.
– Bon; mes guerriers seront exacts.
Les trois hommes se serrèrent énergiquement la main et les chefs guaycurús se retirèrent, reprenant pour s'en aller le chemin presque impraticable par lequel ils étaient venus, mais qui ne devait pas offrir de difficultés sérieuses à des hommes brisés comme eux à tous les exercices du corps et doués d'une souplesse et d'une agilité sans égale.
Zéno Cabral demeura seul dans la caverne.
Le partisan se laissa tomber sur un siège, pencha la tête sur sa poitrine et demeura ainsi pendant un laps de temps considérable plongé dans de profondes réflexions.
Lorsque les premières ombres du soir commencèrent à envahir l'entrée de la caverne, le jeune homme se redressa.
– Enfin! murmura-t-il à voix basse, je vais donc atteindre cette vengeance que depuis si longtemps je poursuis; nul désormais ne pourra me ravir ma proie; mon père tressaillira de joie dans sa tombe en voyant de quelle façon je tiens mon serment; hélas! Pourquoi me faut-il être la hache destinée à martyriser deux femmes innocentes! Le véritable coupable m'échappe encore! Dieu permettra-t-il qu'il tombe entre mes mains? Comment le contraindre à se livrer à moi?
Il garda quelques instants le silence, puis il reprit arec une énergie sauvage:
– A quoi bon m'apitoyer sur le sort de ces femmes! La loi du désert ne dit-elle pas: Œil pour œil, dent pour dent? Ce n'est pas moi qui ai commis le crime! Je venge l'insulte faite à ma famille; le sort en est jeté, Dieu me jugera!
Il se leva et fit quelques tours dans la caverne. L'obscurité était presque complète. Zéno Cabral prit une torche de bois pourri, l'alluma et la ficha en terre; puis, après une dernière hésitation, il secoua la tête à plusieurs reprises, se passa la main sur le front, comme pour chasser une idée importune, et alla se rasseoir sur un des sièges, après avoir fait disparaître les traces du repas et celles laissées par la présence des guerriers guaycurús.
– Je suis fou! murmura-t-il à demi-voix; il est trop tard maintenant pour regarder en arrière.
Et saisissant son fusil, il le déchargea en l'air.
Le bruit de la détonation, répercuté par les nombreux échos de la caverne, roula pendant un temps assez long, s'affaiblissant de plus en plus et finit par s'éteindre tout à fait.
Presque aussitôt la lueur de plusieurs torches brilla au fond d'une galerie latérale, grandit rapidement, et bientôt illumina la caverne de teintes rougeâtres qui couraient sur les parois avec des reflets fantastiques; ces torches étaient portées par des montoneros conduits par plusieurs officiers, parmi lesquels se trouvait don Silvio Quiroga.
– Nous voici, général, dit le capitaine avec un salut respectueux.
– Où sont les prisonniers? demanda Zéno Cabral, tout en rechargeant son fusil qu'il plaça à portée de sa main.
– Gardés à quelques pas par un détachement de nos hommes.
– Qu'ils viennent.
Le capitaine se retira sans répondre; quelques minutes se passèrent, au bout desquelles il reparut accompagné de trois hommes désarmés qui marchaient au milieu d'un groupe de partisans.
– C'est bien, dit le général, laissez-moi avec ces caballeros, je désire causer avec eux; seulement, soyez prêts à accourir, si besoin était, au premier signal. Allez.
Le capitaine Quiroga planta deux ou trois torches dans le sol, et s'enfonça ensuite dans la galerie de laquelle il était sorti, suivi par les montoneros.
Don Zéno demeura seul avec les trois prisonniers; ceux-ci se tenaient debout devant lui, froids, hautains, la tête fièrement rejetée en arrière et les bras croisés sur la poitrine.
Il y eut un instant de silence.
Ce fut un des prisonniers qui le rompit.
– Je suppose, seigneur général, dit-il avec un léger accent de raillerie, puisque tel est le titre qu'on vous donne, que vous nous avez appelés en votre présence afin de nous faire fusiller?
– Vous vous trompez, seigneur don Lucio Ortega, répondit froidement le partisan, quant à présent, du moins, telle n'est pas mon intention.
– Vous me connaissez? s'écria l'Espagnol avec un mouvement de surprise qu'il ne put réprimer.
– Oui, señor, je vous connais, ainsi que vos compagnons, le señor comte de Mendoza et le colonel Zinozain; je sais même dans quel but vous êtes venus ainsi vous fourvoyer dans ces montagnes. Vous voyez que je suis bien servi par mes espions.
– Caramba! fit gaiement le capitaine Ortega, j'aurais voulu être aussi bien servi par les miens.
Le partisan sourit avec ironie.
– Au fait, señor, dit le comte, que prétendez-vous nous imposer, puisque nous sommes en votre pouvoir et que vous ne voulez pas nous fusiller?
– Vous reconnaissez, n'est-ce pas, que j'aurais le droit de le faire, si tel était mon bon plaisir?
Parfaitement, reprit le capitaine; quant à nous, soyez convaincu que nous n'aurions pas manqué de vous faire sauter le crâne si le sort vous avait fait tomber entre nos mains. N'est-ce pas, señores?
Les deux officiers répondirent affirmativement.
– Touchante unanimité, dit en raillant le montonero; je vous sais gré, croyez-le bien, de vos bonnes intentions à mon égard; cependant elles ne changent rien à ma résolution.
– Alors, reprit le capitaine, il est probable que vous trouvez plus d'avantage pour vous à nous laisser vivre qu'à ordonner notre exécution?
– Cela est évident.
– Mais il est probable aussi que les conditions que vous nous poserez, dit le colonel, seront de telle sorte que nous refuserons de les accepter, préférant la mort au déshonneur.
– Eh bien, vous n'y êtes pas du tout, mon cher colonel, répondit avec bonhomie le partisan, je sais trop ce qu'on se doit entre soldats, bien qu'ennemis, pour profiter des avantages que me donne ma position, et ces conditions seront, au contraire, excessivement douces.
– Oh, oh! Voilà qui est étrange, murmura le comte.
– Fort étrange, en effet monsieur le comte, de voir un de ces misérables créoles, ces bêtes fauves, ainsi que vous les nommez, conserver des sentiments d'humanité si complètement mis en oubli par leurs ex-maîtres, les nobles Castillans.
– Je vous avoue que, pour ma part, je suis curieux de connaître ces bénignes propositions! dit en ricanant le capitaine.
– Vous allez être satisfait, señor, reprit le partisan de ce ton narquois qu'il affectait depuis le commencement de l'entretien: mais avant tout, veuillez vous asseoir: je suis chez moi, je désire vous faire les honneurs de ma demeure.
– Soit; nous vous écoutons, dit le capitaine en s'asseyant, mouvement imité par ses deux compagnons.
– Mes conditions, les voici, reprit le partisan: je vous offre de vous rendre immédiatement la liberté en vous restituant tous les bagages qui vous ont été enlevés, et en vous laissant la faculté de continuer votre voyage et d'accomplir la mission dont vous êtes chargé pour don Pablo Pincheyra.
– Hein! s'écria le capitaine, vous savez cela aussi?
– Je sais tout, ne vous l'ai-je pas dit?
– C'est juste; pardonnez-moi cette interruption, fit le capitaine; vous disiez donc que vous offriez de nous rendre la liberté, etc., etc., à la condition…
– A la condition, reprit don Zéno, que d'abord vous me donnerez votre parole d'honneur de gentilshommes et de soldats, que, quoi qu'il arrive pendant tout le temps que nous demeurerons ensemble, vous ne prononcerez jamais mon nom, et vous me garderez un secret inviolable.
– Jusqu'à présent, je ne vois rien qui s'oppose à ce que nous prenions cet engagement; ensuite, señor, car ce n'est pas tout, j'imagine?
– En effet, ce n'est pas tout. Je désire me rendre en votre compagnie au camp de Casa-Trama, afin de traiter avec don Pablo Pincheyra une affaire qui m'est personnelle. Je prendrai le nom et le costume d'un officier portugais. Vous ne me trahirez pas, et de plus vous m'aiderez à terminer l'affaire en question; je sais que vous possédez assez d'influence sur don Pablo pour me faire réussir.
– Refusez-vous de nous instruire de cette affaire? demanda le comte.
– En aucune façon. Cette susceptibilité est trop honorable pour que je ne fasse pas droit à votre demande. Il s'agit de deux dames portugaises, la marquise de Castelmelhor et sa fille, dont les Pincheyras se sont emparés contre le droit des gens et que je veux délivrer.
– Voilà tout?
– Oui, caballero. Voyez si votre honneur vous permet d'accepter ces conditions.
– Señor don Zéno Cabral, répondit le comte, l'histoire qu'il vous plaît de nous conter est fort bien imaginée, bien que nous doutions beaucoup de la réalité de votre dévouement pour ces dames; comme elles nous sont à peu près inconnues, et que, ainsi que vous nous l'avez annoncé, cette affaire vous est entièrement personnelle, nous ne nous reconnaissons pas le droit de l'approfondir; en conséquence, mes compagnons et moi, nous acceptons vos conditions, qui, nous le constatons, sont réellement fort douces. Nous vous donnons notre parole d'honneur de remplir exactement l'engagement que nous prenons vis-à-vis de vous, sans y être aucunement contraints par la force.
– Nous donnons notre parole d'honneur, ainsi que notre noble ami le comte de Mendoza, dirent ensemble le capitaine et le colonel.
– Et maintenant, ajouta don Luis Ortega, quand serons-nous libres?
– A l'instant, caballeros.
– Et nous partirons?
– Au lever du soleil, de façon à être demain, dans la matinée, à Casa-Trama; maintenant, disposez de moi, señores, je ne suis plus que votre hôte.
Nous avons rapporté plus haut de quelle façon le comte et les personnes qui l'accompagnaient avaient été reçues par les Pincheyras.