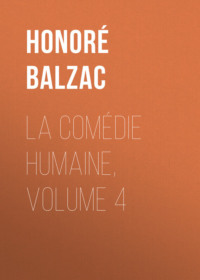Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Comédie humaine, Volume 4», sayfa 33
Un coup d'œil rapidement jeté sur la vie du comte de Sérisy et sur celle de son régisseur est ici nécessaire pour bien comprendre le petit drame qui devait se passer dans la voiture à Pierrotin.
Monsieur Hugret de Sérisy descend en ligne directe du fameux président Hugret, anobli sous François Ier. Cette famille porte parti d'or et de sable à un orle de l'un à l'autre et deux losanges de l'un en l'autre, avec: I, SEMPER MELIUS ERIS, devise qui, non moins que les deux dévidoirs pris pour supports, prouve la modestie des familles bourgeoises au temps où les Ordres se tenaient à leur place dans l'État, et la naïveté de nos anciennes mœurs par le calembour de Eris, qui, combiné avec l'I du commencement et l'S final de melius, représente le nom (Sérisy) de la terre érigée en comté. Le père du comte était Premier Président d'un Parlement avant la Révolution. Quant à lui, déjà Conseiller d'État au Grand-Conseil, en 1787, à l'âge de vingt-deux ans, il s'y fit remarquer par de très beaux rapports sur des affaires délicates. Il n'émigra point pendant la Révolution, il la passa dans sa terre de Sérisy, d'Arpajon, où le respect qu'on portait à son père le préserva de tout malheur. Après avoir passé quelques années à soigner le président de Sérisy, qu'il perdit en 1794, il fut élu vers cette époque au Conseil des Cinq-Cents, et accepta ces fonctions législatives pour distraire sa douleur. Au Dix-Huit Brumaire, monsieur de Sérisy fut, comme toutes les vieilles familles parlementaires, l'objet des coquetteries du Premier Consul, qui le plaça dans le Conseil d'État et lui donna l'une des administrations les plus désorganisées à reconstituer. Le rejeton de cette famille historique devint l'un des rouages les plus actifs de la grande et magnifique organisation due à Napoléon. Aussi le Conseiller d'État quitta-t-il bientôt son administration pour un Ministère. Créé comte et sénateur par l'Empereur, il eut successivement le proconsulat de deux différents royaumes. En 1806, à quarante ans, le sénateur épousa la sœur du ci-devant marquis de Ronquerolles, veuve à vingt ans de Gaubert, un des plus illustres généraux républicains, et son héritière. Ce mariage, convenable comme noblesse, doubla la fortune déjà considérable du comte de Sérisy qui devint beau-frère du ci-devant marquis de Rouvre, nommé comte et chambellan par l'Empereur. En 1814, fatigué de travaux constants, monsieur de Sérisy, dont la santé délabrée exigeait du repos, résigna tous ses emplois, quitta le gouvernement à la tête duquel l'Empereur l'avait mis, et vint à Paris où Napoléon, forcé par l'évidence, lui rendit justice. Ce maître infatigable, qui ne croyait pas à la fatigue chez autrui, prit d'abord la nécessité dans laquelle se trouvait le comte de Sérisy pour une défection. Quoique le sénateur ne fût point en disgrâce, il passa pour avoir eu à se plaindre de Napoléon. Aussi, quand les Bourbons revinrent, Louis XVIII, en qui monsieur de Sérisy reconnut son souverain légitime, accorda-t-il au sénateur, devenu pair de France, une grande confiance en le chargeant de ses affaires privées, et le nommant Ministre d'État. Au 20 mars, monsieur de Sérisy n'alla point à Gand, il prévint Napoléon qu'il restait fidèle à la maison de Bourbon, il n'accepta point la pairie pendant les Cent-Jours, et passa ce règne si court dans sa terre de Sérisy. Après la seconde chute de l'Empereur, il redevint naturellement membre du Conseil privé, fut nommé Vice-président du Conseil d'État et liquidateur, pour le compte de la France, dans le règlement des indemnités demandées par les puissances étrangères. Sans faste personnel, sans ambition même, il possédait une grande influence dans les affaires publiques. Rien ne se faisait d'important en politique sans qu'il fût consulté; mais il n'allait jamais à la cour et se montrait peu dans ses propres salons. Cette noble existence, vouée d'abord au travail, avait fini par devenir un travail continuel. Le comte se levait dès quatre heures du matin en toute saison, travaillait jusqu'à midi, vaquait à ses fonctions de pair de France ou de Vice-président du Conseil d'État, et se couchait à neuf heures. Pour reconnaître tant de travaux, le roi l'avait fait chevalier de ses Ordres. Monsieur de Sérisy était depuis longtemps Grand-Croix de la Légion-d'Honneur; il avait l'ordre de la Toison-d'Or, l'ordre de Saint-André de Russie, celui de l'Aigle de Prusse, enfin presque tous les ordres des cours d'Europe. Personne n'était moins aperçu ni plus utile que lui dans le monde politique. On comprend que les honneurs, le tapage de la faveur, les succès du monde, étaient indifférents à un homme de cette trempe. Mais personne, excepté les prêtres, n'arrive à une pareille vie sans de graves motifs. Cette conduite énigmatique avait son mot, un mot cruel. Amoureux de sa femme avant de l'épouser, cette passion avait résisté chez le comte à tous les malheurs intimes de son mariage avec une veuve, toujours maîtresse d'elle-même avant comme après sa seconde union, et qui jouissait d'autant plus de sa liberté, que monsieur de Sérisy avait pour elle l'indulgence d'une mère pour un enfant gâté. Ses constants travaux lui servaient de bouclier contre des chagrins de cœur ensevelis avec ce soin que savent prendre les hommes politiques pour de tels secrets. Il comprenait d'ailleurs combien eût été ridicule sa jalousie aux yeux du monde qui n'eût guère admis une passion conjugale chez un vieil administrateur. Comment, dès les premiers jours de son mariage, fut-il fasciné par sa femme? Comment souffrit-il d'abord sans se venger? Comment n'osa-t-il plus se venger? Comment laissa-t-il le temps s'écouler, abusé par l'espérance? par quels moyens une femme jeune, jolie et spirituelle l'avait-elle mis en servage? La réponse à toutes ces questions exigerait une longue histoire qui nuirait au sujet de cette scène, et que, sinon les hommes, du moins les femmes pourront entrevoir. Remarquons cependant que les immenses travaux et les chagrins du comte avaient contribué malheureusement à le priver des avantages nécessaires à un homme pour lutter contre de dangereuses comparaisons. Aussi le plus affreux des malheurs secrets du comte était-il d'avoir donné raison aux répugnances de sa femme par une maladie uniquement due à ses excès de travail. Bon, et même excellent pour la comtesse, il la laissait maîtresse chez elle; elle recevait tout Paris, elle allait à la campagne, elle en revenait, absolument comme si elle eût été veuve; il veillait à sa fortune et fournissait à son luxe, comme l'eût fait un intendant. La comtesse avait pour son mari la plus grande estime, elle aimait même sa tournure d'esprit; elle savait le rendre heureux par son approbation: aussi faisait-elle tout ce qu'elle voulait de ce pauvre homme en venant causer une heure avec lui. Comme les grands seigneurs d'autrefois, le comte protégeait si bien sa femme, que porter atteinte à sa considération eût été lui faire une injure impardonnable. Le monde admirait beaucoup ce caractère, et madame de Sérisy devait immensément à son mari. Toute autre femme, quand même elle eût appartenu à une famille aussi distinguée que celle des Ronquerolles, aurait pu se voir à jamais perdue. La comtesse était fort ingrate, mais ingrate avec charme. Elle jetait de temps en temps du baume sur les blessures du comte.
Expliquons maintenant le sujet du brusque voyage et de l'incognito du ministre.
Un riche fermier de Beaumont-sur-Oise, nommé Léger, exploitait une ferme dont toutes les pièces faisaient enclave dans les terres du comte, et qui gâtait sa magnifique propriété de Presles. Cette ferme appartenait à un bourgeois de Beaumont-sur-Oise, appelé Margueron. Le bail fait à Léger en 1799, moment où les progrès de l'agriculture ne pouvaient se prévoir, était sur le point de finir, et le propriétaire refusa les offres de Léger pour un nouveau bail. Depuis longtemps monsieur de Sérisy, qui souhaitait se débarrasser des ennuis et des contestations que causent les enclaves, avait conçu l'espoir d'acheter cette ferme en apprenant que toute l'ambition de monsieur Margueron était de faire nommer son fils unique, alors simple percepteur, receveur particulier des finances à Senlis. Moreau signalait à son patron un dangereux adversaire dans la personne du père Léger. Le fermier, qui savait combien il pouvait vendre cher en détail cette ferme au comte, était capable d'en donner assez d'argent pour surpasser l'avantage que la recette particulière offrirait à Margueron fils. Deux jours auparavant, le comte, pressé d'en finir, avait appelé son notaire, Alexandre Crottat, et Derville, son avoué, pour examiner les circonstances de cette affaire. Quoique Derville et Crottat missent en doute le zèle du régisseur, dont une lettre inquiétante avait provoqué cette consultation, le comte défendit Moreau, qui, dit-il, le servait fidèlement depuis dix-sept ans. – «Eh bien! avait répondu Derville, je conseille à Votre Seigneurie d'aller elle-même à Presles, et d'inviter à dîner ce Margueron. Crottat y enverra son premier clerc avec un acte de vente tout prêt, en laissant en blanc les pages ou les lignes nécessaires aux désignations de terrain ou aux titres. Enfin, que Votre Excellence se munisse au besoin d'une partie du prix en un bon sur la Banque, et n'oublie pas la nomination du fils à la Recette de Senlis. Si vous ne terminez pas en un moment, la ferme vous échappera! Vous ignorez, monsieur le comte, les roueries des paysans. De paysan à diplomate, le diplomate succombe.» Crottat appuya cet avis, que, d'après la confidence du valet à Pierrotin, le pair de France avait sans doute adopté. La veille, le comte avait envoyé par la diligence de Beaumont un mot à Moreau pour lui dire d'inviter à dîner Margueron, afin de terminer l'affaire des Moulineaux. Avant cette affaire, le comte avait ordonné de restaurer les appartements de Presles, et, depuis un an, monsieur Grindot, un architecte à la mode, y faisait un voyage par semaine. Or, tout en concluant son acquisition, monsieur de Sérisy voulait examiner en même temps les travaux et l'effet des nouveaux ameublements. Il comptait faire une surprise à sa femme en l'amenant à Presles, et mettait de l'amour-propre à la restauration de ce château. Quel événement était-il survenu pour que le comte, qui la veille allait ostensiblement à Presles, voulût s'y rendre incognito dans la voiture de Pierrotin?
Ici, quelques mots sur la vie du régisseur deviennent indispensables.
Moreau, le régisseur de la terre de Presles, était le fils d'un procureur de province, devenu à la Révolution procureur-syndic à Versailles. En cette qualité, Moreau père avait presque sauvé les biens et la vie de messieurs de Sérisy père et fils. Ce citoyen Moreau appartenait au parti Danton; Robespierre, implacable dans ses haines, le poursuivit, finit par le découvrir et le fit périr à Versailles. Moreau fils, héritier des doctrines et des amitiés de son père, trempa dans une des conjurations faites contre le Premier Consul à son avénement au pouvoir. En ce temps, monsieur de Sérisy, jaloux d'acquitter sa dette de reconnaissance, fit évader à temps Moreau, qui fut condamné à mort; puis il demanda sa grâce en 1804, l'obtint, lui offrit d'abord une place dans ses bureaux, et définitivement le prit pour secrétaire en lui donnant la direction de ses affaires privées. Quelque temps après le mariage de son protecteur, Moreau devint amoureux d'une femme de chambre de la comtesse et l'épousa. Pour éviter les désagréments de la fausse position où le mettait cette union, dont plus d'un exemple se rencontrait à la cour impériale, il demanda la régie de la terre de Presles où sa femme pourrait faire la dame, et où dans ce petit pays ils n'éprouveraient ni l'un ni l'autre aucune souffrance d'amour-propre. Le comte avait besoin à Presles d'un homme dévoué, car sa femme préférait l'habitation de la terre de Sérisy, qui n'est qu'à cinq lieues de Paris. Depuis trois ou quatre ans, Moreau possédait la clef de ses affaires, il était intelligent; car, avant la Révolution, il avait étudié la chicane dans l'Étude de son père; monsieur de Sérisy lui dit alors: – Vous ne ferez pas fortune, vous vous êtes cassé le cou; mais vous serez heureux, car je me charge de votre bonheur. En effet, le comte donna mille écus d'appointements fixes à Moreau; et l'habitation d'un joli pavillon au bout des communs; il lui accorda de plus tant de cordes à prendre dans les coupes de bois pour son chauffage, tant d'avoine, de paille et de foin pour deux chevaux, et des droits sur les redevances en nature. Un Sous-Préfet n'a pas de si beaux appointements. Pendant les huit premières années de sa gestion, le régisseur administra Presles consciencieusement; il s'y intéressa. Le comte, en y venant examiner le domaine, décider les acquisitions ou approuver les travaux, frappé de la loyauté de Moreau, lui témoigna sa satisfaction par d'amples gratifications. Mais lorsque Moreau se vit père d'une fille, son troisième enfant, il s'était si bien établi dans toutes ses aises à Presles, qu'il ne tint plus compte à monsieur de Sérisy de tant d'avantages exorbitants. Aussi, vers 1816, le régisseur, qui jusque-là n'avait pris que ses aises à Presles, accepta-t-il volontiers d'un marchand de bois une somme de vingt-cinq mille francs pour lui faire conclure, avec augmentation d'ailleurs, un bail d'exploitation des bois dépendants de la terre de Presles, pour douze ans. Moreau se raisonna: il n'aurait pas de retraite, il était père de famille, le comte lui devait bien cette somme pour dix ans bientôt d'administration; puis, déjà légitime possesseur de soixante mille francs d'économies, s'il y joignait cette somme, il pouvait acheter une ferme de cent vingt mille francs sur le territoire de Champagne, commune située au-dessus de l'Isle-Adam, sur la rive droite de l'Oise. Les événements politiques empêchèrent le comte et les gens du pays de remarquer ce placement fait au nom de madame Moreau, qui passa pour avoir hérité d'une vieille grand'tante, dans son pays, à Saint-Lô. Dès que le régisseur eut goûté au fruit délicieux de la Propriété, sa conduite resta toujours la plus probe du monde en apparence; mais il ne perdit plus une seule occasion d'augmenter sa fortune clandestine, et l'intérêt de ses trois enfants lui servit d'émollient pour éteindre les ardeurs de sa probité; néanmoins il faut lui rendre cette justice, que s'il accepta des pots-de-vin, s'il eut soin de lui dans les marchés, s'il poussa ses droits jusqu'à l'abus, aux termes du Code il restait honnête homme, et aucune preuve n'eût pu justifier une accusation portée contre lui. Selon la jurisprudence des moins voleuses cuisinières de Paris, il partageait entre le comte et lui les profits dus à son savoir-faire. Cette manière d'arrondir sa fortune était un cas de conscience, voilà tout. Actif, entendant bien les intérêts du comte, Moreau guettait avec d'autant plus de soin les occasions de procurer de bonnes acquisitions, qu'il y gagnait toujours un large présent. Presles rapportait soixante-douze mille francs en sac. Aussi le mot du pays, à dix lieues à la ronde, était-il: – «Monsieur de Sérisy a dans Moreau un second lui-même!» En homme prudent, Moreau plaçait, depuis 1817, chaque année ses bénéfices et ses appointements sur le Grand-Livre, en arrondissant sa pelote dans le plus profond secret. Il avait refusé des affaires en se disant sans argent, et il faisait si bien le pauvre auprès du comte, qu'il avait obtenu deux bourses entières pour ses enfants au Collége Henri IV. En ce moment, Moreau possédait cent vingt mille francs de capital placés dans le Tiers Consolidé, devenu le cinq pour cent et qui montait dès ce temps à quatre-vingts francs. Ces cent vingt mille francs inconnus, et sa ferme de Champagne augmentée par des acquisitions, lui faisaient une fortune d'environ deux cent quatre-vingt mille francs, donnant seize mille francs de rente.
Telle était la situation du régisseur au moment où le comte voulut acheter la ferme des Moulineaux dont la possession était indispensable à sa tranquillité. Cette ferme consistait en quatre-vingt-seize pièces de terre bordant, jouxtant, longeant les terres de Presles, et souvent enclavées comme des cases dans un jeu de dames, sans compter les haies mitoyennes et des fossés de séparation où naissaient les plus ennuyeuses discussions à propos d'un arbre à couper, quand la propriété s'en trouvait contestable. Tout autre qu'un ministre d'État aurait eu vingt procès par an au sujet des Moulineaux. Le père Léger ne voulait acheter la ferme que pour la revendre au comte. Afin de parvenir plus sûrement à gagner les trente ou quarante mille francs, objet de ses désirs, le fermier avait depuis longtemps essayé de s'entendre avec Moreau. Poussé par les circonstances, trois jours auparavant ce samedi critique, au milieu des champs, le père Léger avait démontré clairement au régisseur qu'il pouvait faire placer au comte de Sérisy de l'argent à deux et demi pour cent net en terres de convenance, c'est-à-dire avoir, comme toujours, l'air de servir son patron, tout en y trouvant un secret bénéfice de quarante mille francs qu'il lui offrit. – «Ma foi, avait dit le soir en se couchant le régisseur à sa femme, si je tire de l'affaire des Moulineaux cinquante mille francs, car monsieur m'en donnera bien dix mille, nous nous retirerons à l'Isle-Adam dans le pavillon de Nogent.» Ce pavillon est une charmante propriété jadis bâtie par le prince de Conti pour une dame, et où toutes les recherches avaient été prodiguées. – «Ça me plairait, lui avait répondu sa femme. Le Hollandais qui est venu s'y établir l'a très bien restauré, et il nous le laissera pour trente mille francs, puisqu'il est forcé de retourner aux Indes. – Nous serons à deux pas de Champagne, avait repris Moreau. J'ai l'espoir d'acheter pour cent mille francs la ferme et le moulin de Mours. Nous aurions ainsi dix mille livres de rente en terres, une des plus délicieuses habitations de la vallée, à deux pas de nos biens, et il nous resterait environ six mille livres de rente sur le Grand-Livre. – Mais pourquoi ne demanderais-tu pas la place de Juge de paix à l'Isle-Adam? nous y aurions de l'influence et quinze cents francs de plus. – Oh! j'y ai bien pensé.» Dans ces dispositions, en apprenant que son maître voulait venir à Presles et lui disait d'inviter Margueron à dîner pour samedi, Moreau s'était hâté d'envoyer un exprès qui remit au premier valet de chambre du comte une lettre à une heure trop avancée de la soirée pour que monsieur de Sérisy pût en prendre connaissance; mais Augustin la posa sur le bureau, selon son habitude en pareil cas. Dans cette lettre, Moreau priait le comte de ne pas se déranger et de se fier à son zèle. Or, selon lui, Margueron ne voulait plus vendre en bloc et parlait de diviser les Moulineaux en quatre-vingt-seize lots; il fallait lui faire abandonner cette idée, et peut-être, disait le régisseur, arriver à prendre un prête-nom.
Tout le monde a ses ennemis. Or, le régisseur et sa femme avaient froissé, à Presles, un officier en retraite, appelé monsieur de Reybert, et sa femme. De coups de langue en coups d'épingle, on en était arrivé aux coups de poignard. Monsieur de Reybert ne respirait que vengeance, il voulait faire perdre à Moreau sa place et devenir son successeur. Ces deux idées sont jumelles. Aussi la conduite du régisseur, épiée pendant deux ans, n'avait-elle plus de secrets pour les Reybert. En même temps que Moreau dépêchait son exprès au comte de Sérisy, Reybert envoyait sa femme à Paris. Madame de Reybert demanda si instamment à parler au comte, que, renvoyée à neuf heures du soir, moment où le comte se couchait, elle fut introduite le lendemain matin, à sept heures, chez Sa Seigneurie. – «Monseigneur, avait-elle dit au Ministre d'État, nous sommes incapables, mon mari et moi, d'écrire des lettres anonymes. Je suis madame de Reybert, née de Corroy. Mon mari n'a que six cents francs de retraite et nous vivons à Presles, où votre régisseur nous fait avanies sur avanies, quoique nous soyons des gens comme il faut. Monsieur de Reybert, qui n'est pas un intrigant, tant s'en faut! s'est retiré capitaine d'artillerie en 1816, après avoir servi pendant vingt-cinq ans, toujours loin de l'Empereur, monsieur le comte! Et vous devez savoir combien les militaires qui ne se trouvaient pas sous les yeux du maître avançaient difficilement; sans compter que la probité, la franchise de monsieur de Reybert déplaisaient à ses chefs. Mon mari n'a pas cessé, depuis trois ans, d'étudier votre intendant dans le dessein de lui faire perdre sa place. Vous le voyez, nous sommes francs. Moreau nous a rendus ses ennemis, nous l'avons surveillé. Je viens donc vous dire que vous êtes joué dans l'affaire des Moulineaux. On veut vous prendre cent mille francs qui seront partagés entre le notaire, Léger et Moreau. Vous avez dit d'inviter Margueron, vous comptez aller à Presles demain; mais Margueron fera le malade, et Léger compte si bien avoir la ferme qu'il est venu réaliser ses valeurs à Paris. Si nous vous avons éclairé, si vous voulez un régisseur probe, vous prendrez mon mari; quoique noble, il vous servira comme il a servi l'État. Votre intendant a deux cent cinquante mille francs de fortune, il ne sera pas à plaindre.» Le comte avait remercié froidement madame de Reybert, et lui avait alors donné de l'eau bénite de cour, car il méprisait la délation; mais, en se rappelant tous les soupçons de Derville, il fut intérieurement ébranlé; puis tout à coup il avait aperçu la lettre de son régisseur; il l'avait lue, et, dans les assurances de dévouement, dans les respectueux reproches qu'il recevait à propos de la défiance que supposait cette envie de traiter l'affaire par lui-même, il avait deviné la vérité sur Moreau. – La corruption est venue avec la fortune, comme toujours! se dit-il. Le comte avait alors fait à madame de Reybert des questions moins pour obtenir des détails que pour se donner le temps de l'observer, et il avait écrit à son notaire un petit mot pour lui dire de ne plus envoyer son premier clerc à Presles, mais d'y venir lui-même pour dîner. – «Si monsieur le comte, avait dit madame de Reybert en terminant, m'a jugée défavorablement sur la démarche que je me suis permise à l'insu de monsieur de Reybert, il doit être maintenant convaincu que nous avons obtenu ces renseignements sur son régisseur de la manière la plus naturelle: la conscience la plus timorée n'y saurait trouver rien à redire.» Madame de Reybert, née de Corroy, se tenait droit comme un piquet. Elle avait offert aux investigations rapides du comte une figure trouée comme une écumoire par la petite vérole, une taille plate et sèche, deux yeux ardents et clairs, des boucles blondes aplaties sur un front soucieux, une capote de taffetas vert passée, doublée de rose, une robe blanche à pois violets, des souliers de peau. Le comte avait reconnu en elle la femme du capitaine pauvre, quelque puritaine abonnée au Courrier français, ardente de vertu, mais sensible au bien-être d'une place, et l'ayant convoitée. – «Vous dites six cents francs de retraite, avait répondu le comte en se répondant à lui-même au lieu de répondre à ce que venait de raconter madame de Reybert. – Oui, monsieur le comte. – Vous êtes née de Corroy? – Oui, monsieur, une famille noble du pays Messin, le pays de mon mari. – Dans quel régiment servait monsieur de Reybert? – Dans le 7e régiment d'artillerie. – Bien!» avait répondu le comte en écrivant le numéro du régiment. Il avait pensé pouvoir donner la régie de sa terre à un ancien officier, sur le compte duquel il obtiendrait au Ministère de la Guerre les renseignements les plus exacts. – «Madame, avait-il repris en sonnant son valet de chambre, retournez à Presles avec mon notaire qui trouvera moyen d'y venir pour dîner, et à qui je vous ai recommandée; voici son adresse. Je vais moi-même en secret à Presles, et ferai dire à monsieur de Reybert de me parler…» Ainsi la nouvelle du voyage de monsieur de Sérisy par la voiture publique et la recommandation de taire le nom du comte n'alarmaient pas à faux le messager, il pressentait le danger près de fondre sur une de ses meilleures pratiques.
En sortant du café de l'Échiquier, Pierrotin aperçut à la porte du Lion d'argent la femme et le jeune homme en qui sa perspicacité lui avait fait reconnaître des chalands; car la dame, le cou tendu, le visage inquiet, le cherchait évidemment. Cette dame, vêtue d'une robe de soie noire reteinte, d'un chapeau de couleur carmélite, et d'un vieux cachemire français, chaussée en bas de filoselle et de souliers de peau de chèvre, tenait à la main un cabas de paille et un parapluie bleu de roi. Cette femme, autrefois belle, paraissait âgée d'environ quarante ans; mais ses yeux bleus, dénués de la flamme qu'y met le bonheur, annonçaient qu'elle avait depuis longtemps renoncé au monde. Aussi sa mise, autant que sa tournure, indiquait-elle une mère entièrement vouée à son ménage et à son fils. Si les brides du chapeau étaient fanées, la forme datait de plus de trois ans. Le châle tenait par une aiguille cassée, convertie en épingle au moyen d'une boule de cire à cacheter. L'inconnue attendait impatiemment Pierrotin pour lui recommander ce fils qui sans doute voyageait seul pour la première fois, et qu'elle avait accompagné jusqu'à la voiture, autant par défiance que par amour maternel. Cette mère était en quelque sorte complétée par son fils; de même que, sans la mère, le fils n'eût pas été si bien compris. Si la mère se condamnait à laisser voir des gants reprisés, le fils portait une redingote olive dont les manches un peu courtes au poignet annonçaient qu'il grandirait encore, comme les adultes de dix-huit à dix-neuf ans. Le pantalon bleu, raccommodé par la mère, offrait aux regards un fond neuf, quand la redingote avait la méchanceté de s'entr'ouvrir par derrière.
– Ne tourmente donc pas tes gants ainsi, tu les flétris d'autant, disait-elle quand Pierrotin se montra. – Vous êtes le conducteur… Ah! mais c'est vous, Pierrotin? reprit-elle en laissant son fils pour un moment et emmenant le voiturier à deux pas.
– Ça va bien, madame Clapart? répondit le messager dont la figure eut un air qui peignit à la fois du respect et de la familiarité.
– Oui, Pierrotin. Ayez bien soin de mon Oscar, il va seul pour la première fois.
– Oh! s'il va seul chez monsieur Moreau?.. s'écria le voiturier pour savoir si le jeune homme y allait effectivement.
– Oui, répondit la mère.
– Madame Moreau le veut donc bien? reprit Pierrotin d'un petit air finaud.
– Hélas! dit la mère, ce ne sera pas tout roses pour lui, pauvre enfant; mais son avenir exige impérieusement ce voyage.
Cette réponse frappa Pierrotin, qui hésitait à confier ses craintes sur le régisseur à madame Clapart, de même qu'elle n'osait nuire à son fils en faisant à Pierrotin certaines recommandations qui eussent transformé le conducteur en mentor. Pendant cette délibération mutuelle, qui se traduisit par quelques phrases sur le temps, sur la route, sur les stations du voyage, il n'est pas inutile d'expliquer quels liens rattachaient madame Pierrotin à madame Clapart, et autorisaient les deux mots confidentiels qu'ils venaient d'échanger. Souvent, c'est-à-dire trois ou quatre fois par mois, Pierrotin trouvait à La Cave, à son passage quand il allait à Paris, le régisseur qui faisait signe à un jardinier en voyant venir la voiture. Le jardinier aidait alors Pierrotin à charger un ou deux paniers pleins de fruits ou de légumes selon la saison, de poulets, d'œufs, de beurre, de gibier. Le régisseur payait toujours la commission à Pierrotin en lui donnant l'argent nécessaire pour acquitter les droits à la barrière, si l'envoi contenait des choses sujettes à l'Octroi. Jamais ces paniers, ces bourriches, ces paquets ne portaient de suscription. Une première fois, qui avait servi pour toutes, le régisseur avait indiqué de vive voix le domicile de madame Clapart au discret voiturier, en le priant de ne jamais confier à d'autres ce précieux message. Pierrotin, rêvant une intrigue entre quelque charmante fille et le régisseur, était allé rue de la Cerisaie, 7, dans le quartier de l'Arsenal, où il avait vu la madame Clapart qui vient de vous être pourtraite, au lieu de la belle et jeune créature qu'il s'attendait à y trouver. Les messagers sont appelés par leur état à pénétrer dans beaucoup d'intérieurs et dans bien des secrets; mais le hasard social, cette sous-providence, ayant voulu qu'ils fussent sans éducation ou dénués du talent d'observation, il s'ensuit qu'ils ne sont pas dangereux. Néanmoins, après quelques mois, Pierrotin ne savait comment expliquer les relations de madame Clapart et de monsieur Moreau, sur ce qu'il lui fut permis d'entrevoir dans le ménage de la rue de la Cerisaie. Quoique les loyers ne fussent pas chers à cette époque dans le quartier de l'Arsenal, madame Clapart était logée au troisième étage, au fond d'une cour, dans une maison qui jadis fut l'hôtel de quelque grand seigneur, au temps où la haute noblesse du royaume demeurait sur l'ancien emplacement du palais des Tournelles et de l'hôtel Saint-Paul. Vers la fin du seizième siècle, les grandes familles se partagèrent ces vastes espaces, autrefois occupés par les jardins du palais de nos rois, ainsi que l'indiquent les noms des rues de la Cerisaie, Beautreillis, des Lions, etc. Cet appartement, dont toutes les pièces étaient revêtues d'antiques boiseries, se composait de trois chambres en enfilade, une salle à manger, un salon et une chambre à coucher. Au-dessus se trouvaient une cuisine et la chambre d'Oscar. En face de la porte d'entrée, sur ce qui se nomme à Paris le carré, se voyait la porte d'une chambre en retour, ménagée à chaque étage dans une espèce de bâtiment qui contenait aussi la cage d'un escalier de bois, et qui formait une tour carrée, construite en grosses pierres. Cette chambre était celle de Moreau quand il couchait à Paris. Pierrotin avait vu dans la première pièce, où il déposait les bourriches, six chaises de noyer garnies de paille, une table et un buffet; aux fenêtres, de petits rideaux roux. Plus tard, quand il entra dans le salon, il y remarqua de vieux meubles du temps de l'Empire, mais passés. Il ne se trouvait d'ailleurs dans ce salon que le mobilier exigé par le propriétaire pour répondre du loyer. Pierrotin jugea de la chambre à coucher par le salon et par la salle à manger. Les boiseries, réchampies en grosse peinture à la colle et d'un blanc rouge qui empâte les moulures, les dessins, les figurines, loin d'être un ornement, attristaient le regard. Le parquet, qui ne se cirait jamais, était d'un ton gris comme les parquets des pensionnats. Quand le voiturier surprit monsieur et madame Clapart à table, leurs assiettes, leurs verres, les plus petites choses accusaient une effroyable gêne; néanmoins ils se servaient de couverts d'argent; mais les plats, la soupière, écornés et raccommodés autant que la vaisselle des plus pauvres gens, inspiraient la pitié. Monsieur Clapart, vêtu d'une méchante petite redingote, chaussé de pantoufles ignobles, ayant toujours des lunettes vertes aux yeux, lui montrait, en ôtant une affreuse casquette âgée de cinq ans, un crâne pointu du haut duquel tombaient des filaments grêles et sales auxquels un poëte aurait refusé le nom de cheveux. Cet homme au teint blafard paraissait craintif et devait être tyrannique. Dans ce triste appartement, situé au nord, sans autre vue que celle d'une vigne étalée sur le mur opposé, d'un puits dans l'encoignure de la cour, madame Clapart prenait des airs de reine et marchait en femme qui ne savait pas aller à pied. Souvent, en remerciant Pierrotin, elle lui lançait des regards qui eussent attendri un observateur; de temps en temps, elle lui glissait des pièces de douze sous dans la main. Sa voix était charmante. Pierrotin ne connaissait pas cet Oscar, par la raison que cet enfant sortait du collége et qu'il ne l'avait jamais rencontré au logis.