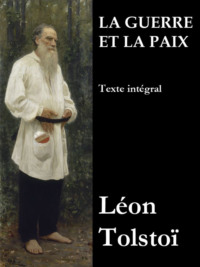Kitabı oku: «La Guerre et la Paix (Texte intégral)», sayfa 4
X
Le prince Basile n’avait point oublié la promesse qu’il avait faite à la princesse Droubetzkoï à la soirée de MlleSchérer. La requête avait été présentée à l’Empereur, et le fils de la princesse passa, par exception, en qualité de sous-lieutenant dans la garde, au régiment Séménovsky; mais cependant, malgré tous les efforts de sa mère, Boris ne fut pas nommé aide de camp de Koutouzow. Quelque temps après la soirée, la princesse retourna à Moscou auprès des Rostow, ses riches parents, chez qui elle s’arrêtait toujours; c’est là que son petit Boris adoré avait passé la plus grande partie de son enfance. La garde avait quitté Pétersbourg le 10 du mois d’août, et le jeune homme, retenu à Moscou par la nécessité de s’occuper de son équipement, devait la rejoindre à Radzivilow.
C’était jour de fête chez les Rostow. La mère et la fille cadette s’appelaient Natalie, et on les fêtait toutes les deux. Une longue suite de voitures n’avaient cessé dès le matin de déposer à l’hôtel Rostow, rue Povarskaïa, une foule de visiteurs qui apportaient leurs félicitations. La comtesse et sa fille aînée, une belle personne, les recevaient au salon, où ils se succédaient sans relâche.
La mère était une femme de quarante-cinq ans, avec un type oriental, un visage amaigri, et visiblement épuisée par les douze enfants qu’elle avait donnés à son mari. La lenteur de ses mouvements et de son parler, qui provenait de sa faiblesse, lui donnait un air imposant qui inspirait le respect. La princesse Droubetzkoï était avec elle, et, comme elle faisait partie de la famille, elle aidait de son mieux à recevoir les visiteurs et à soutenir la conversation.
Les jeunes gens, qui ne se souciaient pas de prendre part à la réception, se tenaient dans des chambres intérieures. Le comte allait à la rencontre des arrivants, et en les reconduisant les engageait tous à dîner.
«Je vous suis bien sincèrement obligé, mon cher, ou ma chère, disait-il indifféremment à chacun, aux inférieurs aussi bien qu’aux supérieurs. Merci pour celle dont nous célébrons la fête. Vous viendrez dîner sans faute, n’est-ce pas? Autrement, mon cher, vous m’offenseriez. Je vous supplie de venir avec toute votre famille, ma chère…» Il répétait exactement les mêmes paroles à tous les invités, et les accompagnait exactement de la même expression de figure, puis venait un serrement de main avec saluts réitérés. Après avoir reconduit les partants, il revenait auprès de ceux qui n’avaient pas encore fait leurs adieux, s’avançait à lui-même un fauteuil et, après avoir posé avec complaisance ses pieds à terre et ses mains sur ses genoux, il se balançait de droite et de gauche, émettant, en homme qui croit savoir vivre, des réflexions sur le temps, sur la santé, tantôt en russe, tantôt en français, bien qu’il parlât fort mal le français, mais toujours avec le même aplomb. Malgré sa fatigue, il se levait de nouveau pour reconduire les partants, comme un homme bien décidé à remplir ses devoirs jusqu’au bout, et renouvelait ses invitations, tout cela en ramenant sur son crâne chauve quelques cheveux gris et rares.
Parfois, en revenant, il traversait le vestibule et la serre et entrait dans une grande salle avec des murs de stuc, où l’on dressait les tables pour un dîner de quatre-vingts couverts. Après avoir regardé les domestiques qui portaient les porcelaines, l’argenterie, et déployaient les nappes damassées, il appelait un certain Dmitri Vassiliévitch, noble de naissance, qui dirigeait ses affaires, et lui disait:
«Écoute, Mitenka, tâche que tout soit bien; oui, c’est bien, c’est bien!…»
Et en examinant avec satisfaction une énorme table qui venait de recevoir une rallonge, il ajoutait:
«Le principal, c’est le service, c’est le service, entends-tu bien,» et là-dessus il rentrait enchanté dans le salon.
«Marie Lvovna Karaguine!» annonça d’une voix de basse le valet de pied de la comtesse en se montrant à la porte.
La comtesse réfléchit un instant, en savourant une prise de tabac qu’elle prenait dans une tabatière en or ornée du portrait de son mari.
«Dieu! Que ces visites m’ont exténuée! Allons, encore cette dernière… elle est si bégueule!… Priez-la de monter,» répondit-elle tristement au laquais, comme si elle voulait dire: «Oh! Celle-là va m’achever!»
Une dame, grande, forte, à l’air hautain, suivie d’une jeune fille au visage rond et souriant, entra au salon; elles étaient précédées toutes deux du frou-frou de leurs robes traînantes.
«Chère comtesse… il y a si longtemps… elle a été alitée, la pauvre enfant… au bal des Razoumosky et de la comtesse Apraxine… J’ai été si heureuse!»
Ces civilités à bâtons rompus se confondaient avec le frôlement des robes et le déplacement des chaises. Puis la conversation s’engageait tant bien que mal jusqu’au moment où, grâce à une première pause, on pouvait décemment se permettre de lever la séance, tout en faisant ses adieux, et, après avoir recommencé les: «Je suis bien charmée… la santé de maman… La comtesse Apraxine…» passer dans l’antichambre, mettre sa pelisse et son manteau et partir.
La maladie du vieux comte Besoukhow, l’un des plus beaux hommes du temps de Catherine, qui était en ce moment la nouvelle du jour, fit naturellement les frais de la conversation, et il fut même question de son fils naturel, Pierre, celui-là même qui avait été si peu convenable à la soirée de MlleSchérer.
«Je plains bien sincèrement le pauvre comte, dit MmeKaraguine. Sa santé est si mauvaise, et avoir un fils qui lui cause un pareil chagrin!
– Mais quel est donc le chagrin qu’il a pu lui causer?» demanda la comtesse en feignant d’ignorer l’histoire, tandis qu’elle l’avait déjà entendu conter au moins une quinzaine de fois.
«Voilà le fruit de l’éducation actuelle! Ce jeune homme s’est trouvé livré à lui-même lorsqu’il était à l’étranger, et maintenant on raconte qu’il a fait à Pétersbourg des choses si épouvantables, qu’on a dû le faire partir, par ordre de la police.
– Vraiment? Dit la comtesse.
– Il a fait de mauvaises connaissances, ajouta la princesse Droubetzkoï, et avec le fils du prince Basile et un certain Dologhow ils ont commis des horreurs… Ce dernier a été fait soldat et on a renvoyé le fils de Besoukhow à Moscou; quant à Anatole, son père a trouvé le moyen d’étouffer le scandale; on lui a pourtant enjoint de quitter Pétersbourg.
– Mais qu’ont-ils donc fait? Demanda la comtesse.
– Ce sont de véritables brigands, Dologhow surtout, reprit MmeKaraguine: il est le fils de Marie Ivanovna Dologhow, une dame si respectable… Croiriez-vous qu’à eux trois ils se sont emparés, je ne sais où, d’un ourson, qu’ils l’ont fourré avec eux en voiture et mené chez des actrices. La police a voulu les arrêter. Alors… qu’ont-ils imaginé?… Ils ont saisi l’officier de police; et, après l’avoir attaché sur le dos de l’ourson, ils l’ont lâché clans la Moïka, l’ourson nageant avec l’homme de police sur son dos.
– Ah! Ma chère, la bonne figure que devait avoir cet homme! S’écria le comte en se tordant de rire.
– Mais, c’est une horreur! Il n’y a pas là, cher comte, de quoi rire,» s’écria MmeKaraguine.
Et, malgré elle, elle pouffait de rire, comme lui.
«On a eu toutes les peines du monde à sauver le malheureux… et quand on pense que c’est le fils du comte Besoukhow qui s’amuse d’une façon aussi insensée! Il passait pourtant pour un garçon intelligent et bien élevé… Voilà le résultat d’une éducation faite à l’étranger. J’espère au moins que personne ne le recevra, malgré sa fortune. On a voulu me le présenter, mais j’ai immédiatement décliné cet honneur…! J’ai des filles!
– Où avez-vous donc appris qu’il fût si riche, demanda la comtesse en se penchant vers MmeKaraguine et en tournant le dos aux demoiselles, qui feignirent aussitôt de ne rien entendre. Le vieux comte n’a que des enfants naturels, et Pierre est un de ces bâtards, je crois!»
MmeKaraguine fit un geste de la main.
«Ils sont, je crois, une vingtaine.»
La princesse Droubetzkoï, qui brûlait du désir de faire parade de ses relations et de montrer qu’elle connaissait à fond l’existence de chacun dans le détail le plus intime, prit à son tour la parole et dit à voix basse et avec emphase:
«Voici ce que c’est…! La réputation du comte Besoukhow est bien établie: il a tant d’enfants, qu’il en a perdu le compte, mais Pierre est son favori.
– Quel beau vieillard c’était, pas plus tard que l’année dernière, dit la comtesse, je n’ai jamais vu d’homme aussi beau que lui!
– Ah! Il a beaucoup changé depuis… À propos, j’allais vous dire que l’héritier direct de toute sa fortune est le prince Basile, du chef de sa femme; mais le vieux, ayant de l’affection pour Pierre, s’est beaucoup occupé de son éducation, et a écrit à l’Empereur à son sujet. Personne ne peut donc savoir lequel des deux héritera de lui à sa mort, qu’on attend d’ailleurs d’un moment à l’autre. Lorrain est même arrivé de Pétersbourg. La fortune est colossale… quarante mille âmes et des millions en capitaux. Je le sais pour sûr, car je le tiens du prince Basile lui-même. Le vieux Besoukhow m’est aussi un peu cousin par sa mère, et il est le parrain de Boris, ajouta-t-elle, en faisant semblant de n’attacher à ce fait aucune importance. Le prince Basile est à Moscou depuis hier soir.
– N’est-il pas chargé de faire une inspection?
– Oui; mais, entre nous soit dit, reprit la princesse, l’inspection n’est qu’un prétexte: il n’est arrivé que pour voir le comte Cyrille Vladimirovitch, quand il a su qu’il était au plus mal.
– Cela n’empêche pas, ma chère, l’histoire d’être excellente, dit le comte, qui, en se voyant peu écouté par les dames, se tourna du côté des demoiselles. Oh! La bonne figure qu’il devait faire l’homme de police!…»
Et il se mit à contrefaire les gestes du policier en éclatant de rire d’une voix de basse-taille. C’était ce rire bruyant et sonore particulier aux gens qui aiment à bien manger et surtout à bien boire; tout son gros corps en trembla.
«Vous revenez dîner, n’est-ce pas, ma chère?» ajouta-t-il.
XI
Il se fit un grand silence. La comtesse regardait MmeKaraguine et souriait agréablement, sans même chercher à déguiser la satisfaction qu’elle éprouverait à la voir partir. La fille de MmeKaraguine arrangeait machinalement sa robe en interrogeant sa mère du regard, lorsqu’on entendit tout à coup comme le bruit de plusieurs personnes qui auraient traversé en courant la pièce voisine, puis la chute d’une chaise, et une fillette de treize ans, retenant d’une main le jupon retroussé de sa petite robe de mousseline dans lequel elle semblait cacher quelque chose, bondit jusqu’au milieu du salon et s’y arrêta tout court. Il était évident qu’une course désordonnée l’avait entraînée plus loin qu’elle ne voulait.
Au même moment se montrèrent à sa suite un étudiant au collet amarante, un officier de la garde, une jeune fille de quinze ans et un petit garçon en jaquette, au teint vif et coloré.
Le comte se leva en se balançant et, entourant la petite fille de ses bras:
«Ah! La voilà, s’écria-t-il, c’est sa fête aujourd’hui; ma chère, c’est sa fête!
– Il y a temps pour tout, ma chérie, dit la comtesse avec une feinte sévérité… Tu la gâtes toujours, Élie!
– Bonjour, ma chère; je vous souhaite une bonne fête!… La délicieuse enfant!» dit MmeKaraguine en s’adressant à la mère.
La petite fille, avec ses yeux noirs et sa bouche trop grande, semblait plutôt laide que jolie, mais, en revanche, elle était d’une vivacité sans pareille; le mouvement de ses épaules, qui s’agitaient encore dans son corsage décolleté, attestait qu’elle venait de courir; ses cheveux noirs, bouclés, et tout ébouriffés, retombaient en arrière; ses bras nus étaient minces et grêles; elle portait encore des pantalons garnis de dentelle, et ses petits pieds étaient chaussés de souliers. En un mot, elle était dans cet âge plein d’espérances où la petite fille n’est plus une enfant, mais où l’enfant n’est pas encore une jeune fille. Échappant à son père, elle se jeta sur sa mère, sans prêter la moindre attention à sa réprimande, et, cachant sa figure en feu dans le fouillis de dentelle qui couvrait le mantelet de la comtesse, elle éclata de rire et se mit à conter à bâtons rompus une histoire sur sa poupée, qu’elle tira aussitôt de son jupon.
«Vous voyez bien, c’est une poupée, c’est Mimi, vous voyez!…»
Et Natacha, pouvant à peine parler, glissa sur les genoux de sa mère en riant de si bon cœur, que MmeKaraguine ne put s’empêcher d’en faire autant.
«Voyons, laisse-moi, va-t’en avec ton monstre, disait la comtesse en jouant la colère et en la repoussant doucement… C’est ma cadette,» dit-elle en s’adressant à MmeKaraguine.
Natacha, relevant sa tête enfouie au milieu des dentelles de sa mère, regarda un moment la dame inconnue à travers les larmes du rire et se cacha de nouveau le visage. Obligée d’admirer ce tableau de famille, MmeKaraguine crut bien faire en y jouant son rôle:
«Dites-moi, ma petite, qui est donc Mimi? C’est votre fille sans doute?»
Natacha, mécontente du ton de condescendance de l’étrangère, ne répondit rien et se borna à la regarder d’un air sérieux.
Pendant ce temps, toute la jeunesse, c’est-à-dire Boris, l’officier, fils de la princesse Droubetzkoï, Nicolas, l’étudiant, fils aîné du comte Rostow, Sonia, sa nièce, âgée de quinze ans, et Pétroucha, son fils cadet, s’étaient groupés dans la chambre et faisaient des efforts visibles pour contenir, dans les limites de la bienséance, la vivacité et l’entrain qui perçaient dans chacun de leurs mouvements. Rien qu’à les voir, on comprenait bien vite que, dans les appartements intérieurs d’où ils s’étaient si impétueusement élancés, l’entretien avait été autrement gai qu’au salon, et qu’on y avait parlé d’autre chose que des bruits de la ville, du temps qu’il faisait et de la comtesse Apraxine. Ils échangeaient des regards furtifs et retenaient à grand’peine leur fou rire.
Les deux jeunes gens étaient des amis d’enfance, du même âge, tous deux jolis garçons, mais absolument différents l’un de l’autre. Boris était grand, blond, d’une beauté calme et régulière. Nicolas avait la tête bouclée, il était petit et son visage exprimait la franchise. Sur sa lèvre supérieure s’estompaient légèrement les premiers poils d’une moustache naissante. Tout en lui respirait l’ardeur et l’enthousiasme. Il avait fortement rougi en entrant et avait essayé en vain de dire quelque chose. Boris, au contraire, reprit tout de suite son aplomb, et raconta d’une façon plaisante qu’il avait eu l’honneur de connaître MlleMimi dans son adolescence, mais que depuis cinq ans elle avait terriblement vieilli et que sa tête était fendue!
Pendant ce récit il jeta un regard à Natacha, qui reporta aussitôt les yeux sur son petit frère: celui-ci, les paupières à moitié fermées, était comme secoué par un rire convulsif et silencieux; ne pouvant à cette vue se contenir davantage, elle se leva d’un bond et s’enfuit aussi vite que ses petits pieds pouvaient la porter. Boris resta impassible:
«Maman, ne désirez-vous pas sortir et n’avez-vous pas besoin de la voiture? Demanda-t-il en souriant.
– Oui, certainement, va la commander,» répondit sa mère.
Boris quitta le salon sans se presser et suivit les traces de Natacha, tandis que le petit bonhomme joufflu s’élançait à leur suite, tout mécontent d’avoir été abandonné par eux.
XII
De toute cette jeunesse il ne restait plus que Nicolas et Sonia, la demoiselle étrangère et la fille aînée de la comtesse, de quatre ans plus âgée que Natacha et qui comptait déjà au nombre des grandes personnes.
Sonia était une petite brune mignonne, avec des yeux doux, ombragés de longs cils. Le ton olivâtre de son visage s’accusait encore plus sur la nuque et sur ses mains fines et gracieuses, et une épaisse natte de cheveux noirs s’enroulait deux fois autour de sa tête. L’harmonie de ses mouvements, la mollesse et la souplesse de ses membres grêles, ses manières un peu réservées la faisaient comparer à un joli petit minet prêt à se métamorphoser en une délicieuse jeune chatte. Elle essayait par un sourire de prendre part à la conversation générale, mais ses yeux, sous leurs cils longs et soyeux, se portaient involontairement sur le cousin qui allait partir pour l’armée: ils exprimaient si visiblement ce sentiment d’adoration particulier aux jeunes filles, que son sourire ne pouvait tromper personne; il était évident que le petit minet ne s’était pelotonné que pour un instant, et qu’une fois hors du salon, à l’exemple de Boris et de Natacha, il sauterait et gambaderait de plus belle avec ce cher petit cousin.
«Oui, ma chère, disait le vieux comte en montrant Nicolas, son ami Boris a été nommé officier et il veut le suivre par amitié pour lui, me quitter, laisser là l’université et se faire militaire… Et dire, ma chère, que sa place aux Archives était toute prête! C’est ce que j’appelle de l’amitié!
– Mais la guerre est déclarée, dit-on?
– On le dit depuis longtemps, on le redira encore, et puis on n’en parlera plus… Oui, ma chère, voilà de l’amitié, ou je ne m’y connais pas… Il entre aux hussards!»
MmeKaraguine, ne sachant que répondre, hocha la tête.
«Ce n’est pas du tout par amitié!» s’écria Nicolas, qui devint pourpre et eut l’air de s’en défendre comme d’une action honteuse.
Il jeta un coup d’œil sur sa cousine et sur MlleKaraguine, qui semblaient toutes deux l’approuver.
«Nous avons aujourd’hui à dîner le colonel du régiment de Pavlograd; il est ici en congé et il l’emmènera. Que faire? Dit le comte en haussant les épaules et en s’efforçant de parler gaiement d’un sujet qui lui avait causé beaucoup de chagrin.
– Je vous ai déjà déclaré, papa, que si vous me défendiez de partir, je resterais. Mais je ne puis être que militaire, je le sais très bien, car, pour devenir diplomate ou fonctionnaire civil, il faut savoir cacher ses sentiments, et je ne le sais pas,» continua-t-il en regardant ces demoiselles avec toute la coquetterie de son âge.
La petite chatte, les yeux attachés sur les siens, semblait guetter la minute favorable pour recommencer ses agaceries et donner un libre cours à sa nature féline.
«C’est bon, c’est bon, dit le comte; il s’enflamme tout de suite. Bonaparte leur a tourné la cervelle à tous, et tous cherchent à savoir comment de simple lieutenant il est devenu Empereur. Après tout, je leur souhaite bonne chance,» ajouta-t-il sans remarquer le sourire moqueur de MmeKaraguine.
On se mit à parler de Napoléon, et Julie, c’était le nom de MlleKaraguine, s’adressant au jeune Rostow:
«Je regrette, lui dit-elle, que vous n’ayez pas été jeudi chez les Argharow. Je me suis ennuyée sans vous,» murmura-t-elle tendrement.
Le jeune homme, très flatté, se rapprocha d’elle, et il s’ensuivit un aparté plein de coquetterie, qui lui fit oublier la jalousie de Sonia, tandis que la pauvre petite, toute rouge et toute frémissante, s’efforçait de sourire. Au milieu de l’entretien il se tourna vers elle, et Sonia, lui répondant par un regard à la fois passionné et irrité, quitta la chambre, ayant beaucoup de peine à retenir ses larmes.
Toute la vivacité de Nicolas disparut comme par enchantement, et, profitant du premier moment favorable, il s’éloigna à sa recherche, la figure bouleversée.
«Les secrets de cette jeunesse sont cousus de fil blanc,» dit la princesse Droubetzkoï en le suivant des yeux… «cousinage, dangereux voisinage»
«Oui,» reprit la comtesse, après l’éclipse de ce rayon de soleil et de vie apporté par toute cette jeunesse…
Et répondant elle-même à une question que personne ne lui avait adressée, mais qui la préoccupait constamment:
«Que de soucis, que de souffrances avant de pouvoir en jouir!… et maintenant je tremble plus que je ne me réjouis. J’ai peur, toujours peur! C’est justement l’âge le plus dangereux pour les filles comme pour les garçons.
– Tout dépend de l’éducation!
– Vous avez parfaitement raison; j’ai été, Dieu merci, l’amie de mes enfants, et ils me donnent jusqu’à présent toute leur confiance, – répondit la comtesse; elle nourrissait à cet égard les illusions de beaucoup de parents qui s’imaginent connaître les secrets de leurs enfants. – Je sais que mes filles n’auront rien de caché pour moi, et que si Nicolas fait des folies, – un garçon y est toujours plus ou moins obligé, – il ne se conduira pas comme ces messieurs de Pétersbourg.
– Ce sont de bons enfants, – dit le comte, dont le grand moyen pour trancher les questions compliquées était de trouver tout parfait. – Que faire? Il a voulu être hussard… Que voulez-vous, ma chère?
– Quelle charmante petite créature que votre cadette, un véritable vif-argent.
– Oui, elle me ressemble, reprit naïvement le père, et quelle voix! Bien qu’elle soit ma fille, je suis forcé d’être juste; ce sera une véritable cantatrice, une seconde Salomoni! Nous avons pris un Italien pour lui donner des leçons.
– N’est-ce pas trop tôt? À son âge, cela peut lui gâter la voix.
– Mais pourquoi donc serait-ce trop tôt? Nos mères se mariaient bien à douze ou treize ans.
– Savez-vous qu’elle est déjà amoureuse de Boris! Qu’en pensez-vous?» dit la comtesse en souriant et en échangeant un regard avec son amie la princesse A. Mikhaïlovna.
Et comme si elle répondait ensuite à ses propres pensées, elle ajouta:
«Si je la tenais sévèrement, si je lui défendais de le voir, Dieu sait ce qu’il en adviendrait (elle voulait dire sans doute par là qu’ils s’embrasseraient en cachette): tandis que maintenant je sais tout ce qu’ils se disent; elle vient elle-même me le conter tous les soirs. Je la gâte, c’est possible, mais cela vaut mieux, croyez-moi… Quant à ma fille aînée, elle a été élevée très sévèrement.
– Ah! C’est bien vrai, j’ai été élevée tout autrement,» dit la jeune comtesse Véra en souriant.
Mais par malheur son sourire ne l’embellissait pas, car, au contraire de ce qui a lieu d’habitude, il donnait à sa figure une expression désagréable et affectée. Cependant elle était plutôt belle, assez intelligente, instruite, elle avait la voix agréable, et ce qu’elle venait de dire était parfaitement juste; pourtant, chose étrange, tous se regardèrent, étonnés et embarrassés.
«On tâche toujours de mieux réussir avec les aînés et d’en faire quelque chose d’extraordinaire, dit MmeKaraguine.
– Il faut avouer, reprit le comte, que la comtesse a voulu atteindre l’impossible avec Véra; mais, après tout, elle a réussi, et parfaitement réussi,» ajouta-t-il, en lançant à sa fille un coup d’œil approbateur.
MmeKaraguine se décida enfin à faire ses adieux, en promettant de revenir dîner.
«Quelle sotte! S’écria la comtesse après l’avoir reconduite, je croyais qu’elle ne s’en irait jamais!»