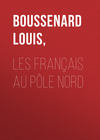Kitabı oku: «Les français au pôle Nord», sayfa 10
XI
Au point où jamais vaisseau n'est parvenu. – La mer Paléocrystique de sir Georges Nares. – Conclusions prématurées. – Vérité aujourd'hui, erreur demain. – La mer des vieilles glaces n'existe plus. – Le second pack. – La goélette arrêtée par la banquise. – En traîneau. – Pour transporter les provisions, mais non les hommes. – Bain qui eût pu être mortel. – Quitte pour la peur. – Hygiène arctique.
«Capitaine! 83° 8′ 6″!.. s'écrie tout joyeux le second qui vient de faire le point.
– Bravo! mon vieux Berchou; ton calcul est d'accord avec le mien, et la goélette se trouve effectivement par 83° 8′ 6″ de latitude.
– Et nous avons dépassé sir Georges Nares, dit à son tour le docteur accoudé à la table du carré.
– Oh! de si peu!.. pas même d'un degré!
– C'est toujours cela!
«Du moins pouvons-nous dire avec fierté que jamais navire n'est allé si loin vers le Pôle.
– Vous oubliez, docteur, que selon toutes présomptions, meinherr Pregel doit, actuellement, posséder sur nous une avance notable.
– Ah! diable!.. encore ce personnage qui m'inspire de confiance la plus franche antipathie.
– D'accord, mon ami.
«Cependant, cette antipathie ne doit pas aller jusqu'à méconnaître à l'homme une réelle valeur; car si sa chaloupe n'a pas les dimensions d'un navire, son mérite est d'autant plus grand, pour s'être avancé, sur une pareille coquille de noix, au milieu d'un tel chaos!
– Vous supposez qu'il nous précède, mais vous n'en êtes pas certain.
«Qui sait s'il n'est pas pincé au fond de quelque cul-de-sac, ou serré entre deux blocs!
– Nous avons passé en dépit de tout, donc il a pu et dû en faire autant.
«Croyez-moi, docteur, il n'est pas homme à s'être arrêté en chemin, quelque épouvantable que soit ce chemin.»
… On est au 26 juin, et les membres de l'état-major vont après l'observation rigoureuse du soleil qui leur a donné la latitude, savourer le menu élaboré par Monsieur Dumas.
Ils paraissent radieux en constatant que, en dépit des affirmations de sir Georges Nares, la Gallia est arrivée là où le marin anglais déclarait qu'il y avait impossibilité matérielle.
La conversation continue entre le capitaine, le docteur, le second et le lieutenant.
Le docteur, habitué professionnellement à ne poser de conclusions qu'après certitude absolue, critique vertement le commandant de l'Alert pour avoir affirmé, avec tant d'autorité, des faits démentis peu après par l'évidence.
«Peut-être êtes-vous un peu dur pour lui, docteur, hasarde le second presque timidement.
«Car enfin, sir Georges était de bonne foi, et tout autre eût pu se tromper à sa place.
– Mais, du moins, on ne se pose pas en arbitre impeccable et… décourageant.
«Avez-vous lu sa relation?
– J'attends l'hivernage pour l'étudier à loisir.
– Bon! laissez-moi donc vous en citer un passage, et vous jugerez combien sont imprudentes ses appréciations.
«Je cite textuellement, continue le docteur en tirant de la bibliothèque un volume qu'il ouvre à une page cornée.
«… Du haut de notre observatoire, dit sir Nares, l'interminable pack semblait consister en petits floes circonscrits chacun par sa barrière de débris entassés; dans l'extrême éloignement, il se confondait avec l'horizon.
«… C'est bien la mer Paléocrystique, ou mer des vieilles glaces…»
A ces mots, le lecteur s'interrompt.
– Moi, d'abord, je l'eusse appelée: Paléocristallique, en me conformant à l'étymologie tirée des deux mots grecs: παλαιός, ancien, et κρύσταλλος, cristal.
– Voyons, docteur, dit le capitaine, soyez plus indulgent… c'est là une vétille, que diable!
– Soit! je continue mon extrait qui condamne si bien son auteur.
«… Pas une flaque libre, pas la moindre vapeur d'eau dans notre champ de vision qui, cependant, pourrait embrasser un arc de cent vingt degrés!
«Nous sommes parfaitement convaincus qu'aucune terre élevée ne peut exister à une distance de quatre-vingts milles (cent quarante-quatre kilomètres) au Nord du cap Joseph-Henri; aucune certainement ne s'apercevait dans les cinquante milles qui formaient l'horizon de notre échauguette.»
– Cela, docteur, c'est de l'observation exacte, dit le second.
– Soit, mais la conclusion qui en découle est au moins prématurée.
«Ecoutez-la.
«… Nous tenons donc pour sûr, continue sir Georges, que depuis la côte de Grinnel, par 83° de latitude, jusqu'au quatre-vingt-quatrième parallèle, s'étend le formidable pack qu'ont eu à combattre Markham et ses compagnons.»
«Sir Georges aurait dû ajouter: à l'heure présente; puisque rien ne subsistait de ce pack, auquel il accorde de confiance un degré, soit 111 kilomètres d'épaisseur, alors que notre compatriote le docteur Pavy contemplait cinq ans après ce même horizon.
«Mais, ceci n'est rien, et vous allez voir si le commodore ne continue pas à se tromper tout comme un simple mortel.
«… A la sortie du détroit de Robeson, les rivages s'orientent à l'Ouest d'un côté, au Nord-Est de l'autre – ce qui est vrai – forment les bornes d'une étendue immense, dont toute la superficie connue jusqu'à présent consiste en floes énormes, dont l'épaisseur varie entre quatre-vingts et cent pieds (27 et 33 mètres). Ils s'exhaussent par l'addition des neiges des hivers successifs, aux couches supérieures; le poids surincombant s'accroît de plus en plus, et peu à peu change les névés en glaces.
«Nombre de raisons nous portent à assigner à cette mer de vieux glaçons– il y tient, le commodore – une superficie considérable. On n'y voit point d'oiseaux sauvages se diriger vers le Nord, comme ce serait le cas s'il existait, dans cette région, une terre de quelque étendue. En outre, un océan complètement couvert de glaces, et où les courants froids détruisent les animalcules dont se nourrissent les baleines, ne saurait servir d'habitation aux vertébrés amphibies ou marins… les faucons qui font leur proie d'espèces aquatiques ont disparu, etc.»
«Donc, au dire de notre auteur, une mer captive sous une voûte épaisse de cent pieds… des eaux inhabitées… une atmosphère déserte.
«Et comme conclusion, le morceau que j'offre à vos méditations:
«… Qu'il y ait d'ailleurs, ou n'y ait pas de terres dans l'espace compris entre la limite de notre vue et l'axe septentrional du globe, cela ne peut avoir aucune influence sur les voyages en traîneaux. Soixante milles (cent dix kilomètres) de ces glaces que nous savons maintenant s'étendre au Nord du cap Joseph-Henri, présentent une barrière qu'il sera impossible de traverser par les méthodes actuellement employées: aussi, je crois pouvoir affirmer, sans aucune hésitation, que jamais on ne pourra atteindre le Pôle Nord par la route du détroit de Smith!…
«De sorte, continue avec animation le docteur, que si notre capitaine avait cru, comme article de foi, aux affirmations si catégoriques de sir Georges, la Gallia, ici présente, n'aurait eu qu'à faire machine en arrière, et rentrer au Havre, au lieu d'embouquer le détroit de Robeson.
– Mais, reprend le second, ennuyé de voir un marin se tromper, ce marin fût-il anglais, sir Georges Nares parle seulement de l'espace compris à l'Occident du 65e degré de longitude Ouest de Greenwich.
«Si nous avons pu nous élever jusqu'ici, peut-être les vieilles glaces sont-elles toujours là-bas, pour empêcher le passage entre 65° et 70° Ouest.
– J'ai prévu l'objection, et j'y répondrai par l'extrait d'une relation qui vaut bien celle du commandant de l'Alert.
«Voici ce que vit, cinq ans après, un des lieutenants de Greely, le docteur Pavy, un Français, celui-là. Parti le 31 mars 1882, en traîneau, de Fort-Conger, par un froid de −34°, Pavy arrive le 11 mars à la baie de Floeberg où hiverna l'Alert en 1876. Il examine du haut de la falaise qui servit d'observatoire à sir Georges, le pack formé de blocs rudes, montagneux, mais ne rencontre plus traces de ces banquises paléocrystiques épaisses de 25 et 30 mètres au moins.
«Vous entendez bien: plus traces de ces formidables amoncellements de glaçons sur lesquels Markham, après des fatigues inouïes, s'éleva d'un degré vers le Nord.
– C'est prodigieux! murmure Berchou ne pouvant croire à une pareille contradiction.
– Là où sir Georges Nares concluait à l'impossibilité absolue de la vie chez les animaux, Pavy trouve le passage d'un ptarmigan, d'un lemming, d'un lièvre, d'un renard.
«Bien plus, mon collègue voulant suivre la route de Markham en pointant droit au pôle, se dirige vers le cap Joseph-Henri. Mais à peine a-t-il parcouru un kilomètre, que son compagnon, l'Esquimau Jens, s'écrie: La mer!.. la mer!..
«On voyait, en effet, distinctement, une rue d'eau qui partant du cap Joseph-Henri, s'ouvre dans la direction du cap Hécla, en traversant la baie de James-Ross. Sa largeur était d'environ un mille à l'origine, mais elle allait en s'élargissant au delà du cap où elle prenait une direction boréale. En même temps, se montraient, vers le Nord, des cumulus de forme particulière, qui, suivant l'opinion des Esquimaux, bons juges en pareille matière, indiquaient la présence de vastes étendues d'eau libre.
«La dislocation des glaces soi-disant éternelles était si complète, que la partie Est du détroit de Robeson se trouvait débarrassée à cette époque encore si rude – 18 avril!
– Voilà qui est un peu fort, s'écrie le second abasourdi.
«Et pour un peu, ne fût-ce que par curiosité, je voudrais bien voir cela.
– Ne t'entête pas, mon vieux Berchou, interrompt le capitaine, car c'est absolument inutile.
«L'erreur du commandant Nares est établie d'une façon rigoureuse, irréfutable.
«De même que la mer libre de Kane, la mer esclave de sir Georges est une conception théorique appuyée sur des observations incomplètes. La vérité semble être une moyenne entre ces deux opinions extrêmes.
«J'ajouterai, pour terminer ce débat instructif, soulevé avec tant d'à propos par le docteur, que Pavy, qui atteignit 82° 51′, eut la chance de relever un fait zoologique très important. L'Esquimau Jens ayant poursuivi un phoque de l'espèce hispidus, nous pouvons conclure que cette mer ne diffère pas sensiblement de celles qui se trouvent au-dessous du détroit de Robeson. Car, le phoca hispida ne s'y hasarderait pas, s'il n'y trouvait point des trous pour venir respirer, et des poissons pour sa nourriture.
«Mais notre situation n'en est pas moins difficile, car si nous avons pu trouver la mer hospitalière pour atteindre 83° 8′, nous éprouverons de grandes difficultés pour franchir la barrière qui se dresse devant nous.
– Vous avez raison, capitaine.
«A défaut de la mer Paléocrystique heureusement disparue, nous sommes en présence d'une jolie banquise large de trois kilomètres.
«Sacrebleu! l'éperon de la goélette, les scies, les haches et la dynamite auront fort à faire, si nous ne trouvons pas une faille.
– C'est ce passage qu'il faut chercher sans délai; et s'il n'existe pas, eh bien!.. nous le pratiquerons.»
Les termes de cet entretien indiquent suffisamment les phases de la traversée opérée par la Gallia, depuis qu'elle a quitté le «Repos de Hall», pour qu'il soit utile d'en parler plus longuement.
Malgré les affirmations catégoriques du commandant de l'expédition anglaise, la Gallia s'est élevée, à 15′ près, au point le plus éloigné atteint par l'homme sur la route polaire.
Malheureusement, elle vient d'être arrêtée dans sa marche par le pack, large de 3.000 mètres, aperçu par Pavy, et qui a survécu à la débâcle de la mer Paléocrystique.
Ce pack, en dépit de la chaleur ambiante – très relative en somme puisqu'elle ne dépasse pas +4° centigrades – fond avec une lenteur excessive. Il est du reste évident que ni la radiation solaire, ni la température de l'eau ne pourront en amener la fusion. Donc, s'il n'est pas et très prochainement disloqué par la tempête, ou lézardé par le courant, le travail de l'homme sera nécessaire.
Le capitaine fait préalablement sonder et trouve le fond à quatre cent cinquante brasses. Markham, en face du cap Joseph-Henri, l'avait rencontré seulement à soixante-douze. Le chiffre accusé par le sondage de la Gallia, réalise les prévisions de Lockwood, qui n'ayant que trois cent brasses de corde, ne put atteindre le fond.
L'épaisseur de la glace fut en outre évaluée à quatre mètres au niveau de l'anse où s'abrite la goélette.
Reste maintenant à examiner en détail le pack pour chercher une fissure transversale, ou, s'il y a lieu, un point où les glaces soient moins épaisses, dans le cas où le capitaine serait forcé de creuser un canal.
Comme la goélette est en sûreté dans son petit havre formé par une échancrure de la banquise, et comme il serait à peu près impossible, en présence des découpures nombreuses qui frangent son bord méridional, de la faire naviguer à travers toutes ces anfractuosités, le capitaine décide que l'inspection du pack aura lieu en traîneau.
L'hygiène des hommes et surtout celle des chiens exigeant de l'exercice, d'Ambrieux saisit avec empressement cette occasion pour essayer ses équipages, et s'assurer s'il peut compter, ultérieurement, sur ses auxiliaires à quatre pattes.
Ne voulant pas faire de jaloux parmi les braves matelots qui tous voudraient bien aller «à terre», c'est-à-dire sur la glace, le capitaine, bien qu'ayant le droit absolu d'ordonner, décide que les élus seront désignés par le sort.
Sept hommes, plus Oûgiouk, l'Esquimau, et lui, neuvième, feront partie de l'expédition. Encore, le docteur demandant une autorisation de faveur, six matelots seulement seront appelés à bénéficier du hasard.
Plume-au-Vent tire le premier dans le bonnet de Guénic un petit papier plié en quatre, et fait une triomphante cabriole.
Ce veinard de Parisien! il vient de lire: oui, sur son papier, et la cabriole s'accompagne d'une tyrolienne… je ne vous dis que ça! Puis, c'est Courapied, dit Marche-à-Terre, puis Nick dit Bigorneau, puis Le Guern, puis Constant Guignard, et pour compléter dignement ce groupe que l'on dirait trié volontairement, Mossieu Dumasse, avec sa bonne carabine, présent du docteur.
Les traîneaux sont approvisionnés pour quinze jours. On y entasse en outre les sacs de fourrures, pour camper sur la glace, et la tente. Les vivres comprennent: biscuit, conserves de viande, café, thé, poisson sec pour les chiens, et alcool pour alimenter les lampes spéciales servant à cuire les aliments, et à faire bouillir l'eau pour le thé ou le café. Chaque homme est pourvu en outre d'un vêtement complet de rechange, et emporte ses bottes groenlandaises imperméables à l'eau comme à la neige.
Tout ce matériel, qui serait encombrant pour d'autres voyageurs que des matelots, ces maîtres en arrimage, est emballé dans les prélarts goudronnés, puis solidement ficelé sur les traîneaux immobiles sur la banquise.
Les chiens, heureux d'être enfin soustraits à l'immobilité qui, depuis si longtemps, leur pèse, font entendre des jappements joyeux, et se laissent atteler fort docilement à leur «bricole» en cuir de phoque.
Tout est prêt. Le capitaine arbore sur le premier traîneau un petit pavillon tricolore et donne le signal du départ.
Le capitaine, le docteur et Oûgiouk marchent en tête; viennent ensuite Le Guern, Nick dit Bigorneau, et Mossieu Dumasse; puis, le Parisien, Constant Guignard et Courapied dit Marche-à-Terre, accompagnant, trois par trois, chacun des traîneaux.
Les chiens, dans le premier moment d'effervescence, donnent un furieux coup de collier et menacent de s'emballer. Mais d'un seul coup de fouet qui prend en écharpe son attelage, Oûgiouk a tôt fait de modérer cette ardeur intempestive. Le Guern et Plume-au-Vent, qui ont étudié la manœuvre du fouet, l'imitent sans plus tarder, et obtiennent un succès analogue.
Du reste les éléments se chargent bientôt d'arrêter toute velléité d'émancipation, tant la vicinalité de l'endroit, comme le fait observer plaisamment le Parisien, a montré de négligence dans l'entretien des voies de communication.
«Oh! là… là…
«J'aimerais mieux être en enfer.
– A cause de quoi? demande naïvement Courapied, toujours prêt à se laisser mystifier.
– A cause des pavés, bêta!
– Comprends pas!
– Suis bien mon raisonnement.
«On dit et on répète que l'enfer est pavé de bonnes intentions…
«Eh bien! est-ce que nos traîneaux ne glisseraient pas mieux sur ce macadam perfectionné que sur ces blocs ronds, aigus, obliques ou coupants, entremêlés de flaques d'eau et de paquets de neige à demi fondue?
– Allons! v'là que tu te moques encore de moi.»
Le docteur qui a entendu cette plaisanterie monumentale, perd son sérieux et dit au capitaine qui, de son côté, rit de bon cœur:
«Le drôle a parfois de l'esprit, et ses saillies au gros sel avec ses comparaisons baroques sont vraiment amusantes.
– C'est là, d'autre part, un état moral bien précieux pour les membres d'une expédition comme la nôtre.
– A qui le dites-vous, capitaine!
«La gaieté à jet continu, l'entrain perpétuel sont la meilleure hygiène pour combattre la morne désespérance des nuits polaires.
«Un loustic de cette trempe vaut à lui tout seul une pharmacie.»
La voirie, pour employer l'expression du Parisien, devient absolument déplorable. Sur les parties les plus élevées où la glace est sèche, on trouve une couche d'efflorescences salines qui rendent le traînage pénible. Par contre, les parties basses sont recouvertes d'eau, ou plutôt d'une épaisse bouillie de neige à demi fondue dans laquelle on enfonce, les hommes jusqu'à mi-jambes, les chiens jusqu'au ventre.
N'était l'imperméabilité absolue des chaussures esquimaudes, chaque piéton voyagerait dans un bain de pied à zéro.
Pour la première fois le Parisien et ses camarades conçoivent l'usage et l'utilité du traîneau. Ils avaient cru jusqu'alors que les équipages de chiens, devant rencontrer des surfaces planes, serviraient à convoyer, avec leur prodigieuse vitesse, les voyageurs arctiques. Mais, pas du tout. Les hommes s'en vont à pied comme de simples mortels, et les toutous emmènent seulement le matériel et les provisions.
Plume-au-Vent n'en revient pas! Le voilà devenu tringlot… de la flotte, mais tringlot à pied! Chose qui ne se voit pas, même dans l'armée de terre, pour laquelle il professe, en sa qualité de navigateur endurci, un dédain plein de commisération.
Du reste, il n'est pas besoin de s'être avancé bien loin sur le pack pour comprendre qu'une excursion même d'agrément serait impossible. Les blocs, de plus en plus irréguliers, succèdent aux blocs. Il y a des roches, des collines, des ravins en miniature, mais dénivelant, comme à plaisir, la carapace de glace. Un homme, fût-il mâtiné de clown et de singe, ne pourrait jamais se maintenir sur le traîneau sans dégringoler à chaque pas.
Le véhicule, qui cependant n'est guère chargé, monte péniblement une pente à 45°, glisse à toute vitesse de l'autre côté, penche à droite sur un morceau de glace, culbute à gauche dans une fondrière, se remet tant bien que mal d'aplomb sur les patins, oscille de nouveau pour cahoter de plus belle… bref, avance de bric et de broc sans être jamais horizontal.
Entre temps, les hommes doivent le pousser par derrière, quand les chiens, roidissant leurs pattes, tirant la langue, ne peuvent le déhaler. Ou bien il faut le maintenir sur une déclivité, pour l'empêcher de glisser trop vite, ou le soulager pour le mettre en équilibre quand il rencontre une aspérité.
Parfois, le conducteur novice prend mal ses mesures et s'étale de son long à la grande joie des camarades, bientôt victimes d'un accident semblable.
Si ces chutes sont sans danger, il n'en est pas de même des immersions partielles qu'il importe d'éviter à tout prix.
La glace est loin d'être partout homogène et de posséder une égale rigidité. Celle qui provient de la congélation de l'eau de mer est souvent couverte d'une sorte de saumure très épaisse, très riche en sel et qui ne se solidifie jamais complètement.
Elle recouvre traîtreusement les trous par lesquels viennent respirer les phoques, et si le voyageur n'y prend pas garde, il pourra être, à un moment donné, trempé jusqu'à la ceinture.
Ces fondrières glacées sont d'autant plus insidieuses, que rien ou presque rien ne les signale aux yeux des novices qui doivent peu à peu s'habituer à les reconnaître, comme les chasseurs de canards les vases molles perfidement dissimulées au milieu des marécages.
Pour ce motif surtout, les explorations en traîneau sont plus pénibles et même plus dangereuses pendant l'automne qu'au printemps. De plus, elles sont faites par des novices ignorant l'hygiène arctique, et ne sachant pas combien il importe d'éviter la transpiration.
Fort heureusement la vieille expérience du docteur supplée à tout, et des précautions, en apparence exagérées, évitent ces petits mécomptes si fréquents au début.
Néanmoins, la caravane avançait toujours en côtoyant le bord méridional du pack dont le capitaine relevait à chaque instant la configuration.
Jusqu'à présent, les accidents s'étaient bornés à des chutes et à des immersions partielles insignifiantes.
Mais, Constant Guignard, l'homme né sous l'étoile de la malchance, le Normand au nom prédestiné, devait bientôt légitimer l'influence de l'étoile et la prédestination du nom.
Le convoi s'en allait cahin-caha. Par prudence, le capitaine, sur les indications d'Oûgiouk, se retournait, et criait aux marins d'éviter tel ou tel point suspect.
Guignard, demeuré quelques pas en arrière pour renouveler l'indispensable paquet de tabac en carotte, courait sur une crête, en homme qui se joue des faux pas, quand tout à coup le pied lui manque, il glisse, et patatras! va s'asseoir au beau milieu d'une flaque.
Le bruit de la chute et le juron qui l'accompagne font retourner Plume-au-Vent et Courapied.
«Monsieur n'a pas besoin d'un fond de bain? s'écrie le Parisien en voyant son matelot barbotter en jurant.
«Ben voyons! faudrait pourtant voir à s'arracher de la limonade…
«C'est donc une passion, chez toi, le bain à zéro!
«Allons, attrape ce bout de filin… et hisse-la!..»
Constant Guignard, trempé jusqu'aux aisselles, se retire tout confus et déjà claquant des dents.
«Dis voir, t'as pas cassé le verre de ta montre?
– Mâtin! balbutie l'autre, qué lessive!
«J'ai froid jusqu'à la mœlle des os.
– Stop! commande le capitaine.
«Tu es mouillé, garçon, il faut changer.
– Oh! merci, capitaine… c'est pas la peine.
«En marchant, ça séchera.
«Sauf vot'respect, à Terre-Neuve, j'ai été pas mal de fois saucé par la lame, et en grand…
«J'y ai pas… fait… attention.»
Le docteur est arrivé en courant.
«Déshabillez-moi ce lascar-là, dit-il brièvement, et frictionnez-le ferme… à tour de bras!
«Il était en sueur au moment du plongeon, et il est dans le cas d'attraper une congestion.
«Vite!.. une lampe à esprit-de-vin… un morceau de glace dans une casserole.»
En un tour de main, Guignard, qui défaille pour tout de bon, est dépouillé de sa défroque déjà raide comme du carton.
Le capitaine, aidé de Plume-au-Vent, le frotte à lui enlever l'épiderme, puis quand, après cinq minutes d'une gymnastique enragée, le pauvre diable commence à respirer, on l'entonne dans un sac de fourrure.
Déjà l'eau bout, tant la lampe à alcool développe de calorique. Le docteur fait infuser, pour la forme, une pincée de thé, puis additionne le mélange d'une formidable dose de rhum.
«Tiens, mon gars, sirote-moi ça, dit-il au matelot dont les dents crépitent toujours comme des castagnettes.
«Tu n'en mourras pas, mais une autre fois, ne t'avise pas de faire le plongeon quand tu seras en sueur… autrement, gare à ta peau.
«Quant à vous, mes amis, écoutez-moi.
«Ne faites aucun effort violent susceptible de vous mettre en transpiration.
«Nous sommes dans une saison pire que l'hiver, surtout pour les novices qui ont des tendances à trop se couvrir pendant la marche.
«On s'échauffe sans même s'en douter, puis on se refroidit brusquement, et alors, gare aux rhumatismes et aux pleurésies.
«Et surtout, s'il vous arrive un accident comme celui-ci, pas de fausse honte… faites ce que je viens d'ordonner pour votre pauvre camarade qui pouvait très bien mourir là… sous vos yeux, sans reprendre connaissance.
– Pétard! murmure à part lui Plume-au-Vent, j'aurais jamais cru qu'un homme aurait pu être si vite «nettoyé».
«C'est pire qu'un coup de soleil sous l'équateur, et pourtant, Guignard, mon matelot, n'est pas une mauviette!»
Cet accident n'eut d'autre suite qu'un arrêt de deux heures, mis à profit pour déjeuner, mais il servit d'exemple aux matelots, imprudents comme de grands enfants et plus insoucieux qu'on ne saurait le croire.
Constant Guignard nanti d'un vêtement complet, bien sec, mangea de bon appétit, et reprit sa place à l'arrière-garde, mais évita dorénavant, avec le plus grand soin, les fondrières traîtresses.
La soir venu, c'est-à-dire l'heure à laquelle finit ordinairement la journée, puisque le soleil ne quitte plus l'horizon, la tente fut dressée sur le pack. Puis, après un solide repas auquel cette rude marche servit d'apéritif, les matelots se blottirent trois par trois dans les sacs.
Le capitaine eut le docteur pour camarade de lit, et Oûgiouk s'allongea simplement sur la glace.
On avait parcouru dix milles marins (18 kilomètres 570 mètres).