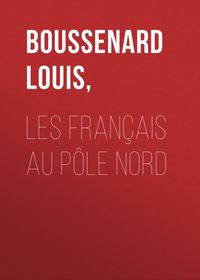Kitabı oku: «Les français au pôle Nord», sayfa 26
VII
A l'affût. – Mort d'un phoque. – Saignée. – Remède au scorbut. – Deux nouveaux malades. – Hypothèse au sujet des glaces polaires. – Voie presque impraticable. – L'état de Fritz empire. – Agonie et mort d'un patriote. – Funérailles. – Suprême résolution. – Il faut se séparer. – Matériel plus léger. – l'expédition définitive. – Choix de ceux qui doivent y participer. – Départ.
Le 24 avril, journée abominable. Froid un peu moins vif, car le thermomètre ne descend pas à −30°, mais averses de neige incessantes.
L'accès des glaces devient de plus en plus difficile et la marche en avant à peu près impraticable.
La chaloupe est restée en arrière faute de trouver un passage. Deux cents mètres plus loin, les traîneaux baleinières, après avoir failli vingt fois être culbutés dans les ravins, sont contraints de stopper.
Le capitaine part en découverte accompagné de deux hommes et d'Oûgiouk. Tous trois sont munis de longs crocs pour assurer leur marche et sonder les dépressions remplies de neige.
Ils avancent d'un kilomètre environ et constatent que la voie est absolument interdite aux traîneaux. Seuls les piétons peuvent avancer, quoique difficilement, et au prix de rudes efforts.
Un peu avant de rejoindre le campement, un des matelots manque de disparaître dans un trou plein d'eau vive et dissimulé sous une épaisse couche de neige.
C'est un «trou à phoque», une de ces ouvertures par lesquelles viennent respirer les mammifères prisonniers sous la banquise, et qui, sans ces prises d'air qui ne gèlent pas, périraient d'asphyxie.
– C'est bon, dit en son baragouin franco-groenlandais le sauvage polaire, Oûgiouk va rester là, et il tuera la bête.
Sans plus de façon il s'installe au bord du trou, pendant que l'homme mouillé rallie bien vite le campement.
Malgré le froid, le capitaine et l'autre marin demeurent avec Oûgiouk pour l'aider, en cas de capture, à retirer le phoque.
La faction dure depuis une demi-heure et les deux Français, gelés jusqu'aux moelles, n'y peuvent plus tenir.
L'Esquimau, très à l'aise, en apparence insensible à cette atroce température, fixe sur l'orifice ses petits yeux bridés, où luit un regard ardent de convoitise. Un véritable regard de chasseur et de gourmand.
Le phoque tarde toujours. Ce que voyant, Oûgiouk se met à entonner, sur un rythme très doux et très lent, une complainte aux mots baroques, comme s'il espérait charmer l'amphibie et l'amener, ivre de mélodie, à venir se faire massacrer.
Comme l'ont affirmé certains voyageurs arctiques et non des moins autorisés, notamment le lieutenant Tyson 12, du Polaris, les phoques seraient-ils réellement sensibles à la musique?..
A peine si Oûgiouk ronronne depuis cinq minutes sa mélopée barbare, qu'un clapotement insaisissable, mais cependant perçu par son oreille de primitif, se fait entendre à la base de l'orifice.
D'un geste pressant il fait signe au capitaine de demeurer immobile. Il brandit dans sa main droite son croc et se cambre dans une attitude de gladiateur, prêt à frapper.
Le chant continue, plus vif, pour s'interrompre brusquement à l'instant précis où le clapotement est remplacé par un souffle assez fort.
Le bras d'Oûgiouk se détend comme un ressort, et le croc disparaît aux trois quarts au fond du trou.
– A moi!.. à l'aide!.. il est pris!.. baragouine le chasseur.
Heureux de ce dénouement, le capitaine et le matelot, que l'immobilité a rendus rigides comme des glaçons, empoignent le manche de bois au bout duquel se débat, avec une grande force, un animal encore invisible.
Le fer a pénétré sans doute profondément dans la chair, car en dépit d'efforts nécessitant la vigueur des trois hommes, la bête ne peut s'échapper.
La lutte dure près d'un quart d'heure, au bout duquel un superbe phoque barbu, de la grande espèce, est halé, non sans peine.
Il se débat faiblement encore, contre le croc qui s'est implanté jusque dans sa gorge, et beugle plaintivement.
Aux hurlements de joie poussés par Oûgiouk, une partie de l'équipage est accourue.
Le pauvre animal est croché tout palpitant au bout d'une amarre et traîné jusqu'à la tente, par une dizaine d'hommes ravis de l'aubaine.
Mais les plus heureux sont certainement le docteur et Oûgiouk. L'homme de science et le sauvage se rencontrant et non pour la première fois, sur le domaine de l'expérience, savent tous deux que la prise du phoque peut et doit améliorer l'état des scorbutiques.
Oûgiouk a très bon estomac, on s'en souvient, ce qui ne l'empêche pas d'avoir bon cœur. D'ordinaire, il s'empresse d'aspirer le sang tout chaud des animaux capturés. Pour cette fois, il renonce généreusement à ce régal de haut goût et moitié par signes, moitié par gestes, engage vivement Fritz et Nick à coller leurs lèvres à la veine qu'il vient d'ouvrir et d'où jaillit une coulée de sang tiède et vermeil.
Le docteur insiste également, alléguant que ce sang tout chaud est un remède souverain, infaillible, bien connu des nomades arctiques, et souvent expérimenté par les baleiniers.
Puis il ajoute:
– Hâtez-vous, car l'animal agonise.
Fritz essaye et aussitôt écœuré gémit plaintivement.
– Jamais je ne pourrai… boire du sang!.. tout mon être se révolte…
– Allons!.. faites vite!.. c'est la santé… la vie!..
– Impossible!.. j'aimerais mieux mourir…
«Toi, Nick… essaye!
Le Flamand a moins de préjugés, ou peut-être plus d'indifférence.
– M'est bien égal, à moi, dit-il de sa voix sourde…
«Donnez-moi à boire eine boutelle ed' verre pilé, ou même pus pire et j'avale tout, pourvu que j'a'lle!»
Séance tenante, il empoigne à deux bras, comme un enfant sa nourrice, le phoque expirant, colle avec une avidité gloutonne ses lèvres à la jugulaire béante, et aspire à longs traits le liquide vivifiant qui ruisselle en gouttes vermillonnées jusque dans sa barbe.
– Que je voudrais donc pouvoir en faire autant! murmure le pauvre Fritz pris de syncope.
Et ses camarades, qui s'empressent autour de lui affectueusement, fraternellement, effrayés de l'atonie incroyable de l'Alsacien naguère si vigoureux, ne peuvent se défendre d'un pressentiment sinistre.
Le soir venu, l'état de Nick, chose incroyable, s'est subitement amélioré, comme si le malade avait été gorgé de cochléaria ou de cresson.
Fritz allait plus mal, et pour comble de malheur, Constant Guignard et le lieutenant Vasseur étaient pris à leur tour du scorbut!
Tous deux, après avoir vaillamment lutté, s'affalent au dernier moment, n'en pouvant plus, les membres rompus, le corps couvert de taches hémorragiques.
Ce n'est pas impunément qu'on accomplit des efforts comme ceux des jours passés, où chacun a fait plus que son devoir.
L'expédition comptant trois malades, et un moribond, car hélas! nul ne peut plus guère s'illusionner sur le sort du pauvre Fritz, et plusieurs cas d'ophtalmie en voie de guérison, le capitaine fait stopper d'urgence, et cesser tous les travaux, pour donner du repos à son monde.
La situation est grave.
Ainsi qu'il a été dit et répété plusieurs fois pendant ce récit, l'existence d'une mer libre autour du Pôle est très problématique 13; mais, d'autre part, l'expérience de plusieurs expéditions arctiques nous a appris que, sous certaines influences, la mer polaire s'ouvre parfois, même en hiver.
Vraisemblablement il n'existe pas une carapace de glace continue autour du Pôle; çà et là des vides s'y trouvent. Sous l'action des vents, les banquises doivent dériver, remplissant les eaux libres et en laissant ensuite derrière elle.
Leur mouvement ressemble à celui d'une nappe d'huile se promenant sur une couche d'eau plus large. Il en résulte qu'à certains moments quelques parties du bassin polaire sont débarrassées des glaces…
… Donc, ni mer libre, ni mer captive. Mais un océan encombré de glaces errantes, susceptibles de rester à peu près stationnaires pendant un temps plus on moins long, pour reprendre cette pérégrination lente à travers les espaces liquides enserrés par les continents.
Ces glaces, qui s'ouvraient jadis devant l'intrépide Français, vont-elles se dresser désormais en barrières infranchissables entre lui et l'axe terrestre.
Il y a urgence d'agir et une prompte détermination s'impose.
Il faut au plus vite explorer la région, savoir comment sont réparties ces alternances de glace et d'eau vive sur l'espace relativement très faible qui sépare l'expédition du Pôle.
Car, enfin, le but de tant d'efforts n'est plus éloigné que de cinquante lieues terrestres!
Cinquante lieues! pour un piéton médiocre, ce serait l'affaire de cinq jours sur une bonne route. Autant pour revenir, soit dix jours.
Mais l'idée seule d'essayer d'avancer à travers un pareil chaos n'est-elle pas la plus insigne de toutes les folies!
Le capitaine Markham a mis jadis plus d'un mois à parcourir, dans des circonstances analogues, quatre-vingts kilomètres! Au retour, son équipage était à moitié mort d'épuisement, et le scorbut terrassait les plus vigoureux parmi ses hommes.
Encore ses marins trouvèrent-ils au retour, sur leur navire l'Alert, une abondance, un confort et des soins qui les rappelèrent à la vie.
Le commandant de l'expédition française n'a aucun lieu de refuge. Il possède pour tout viatique six semaines de vivres, pour tout matériel une tente en toile à voile et quatre embarcations. Pour auxiliaires, des malades et des débilités.
Que faire?..
Rester là et attendre?.. attendre quoi?.. la débâcle?..
L'énorme banquise est entrevue à moins d'un mille, et l'amoncellement chaotique de glaces verdâtres, opaques, dures comme du cristal n'est pas de ceux que fondent les obliques rayons du soleil polaire. L'ouragan et les courants peuvent déplacer ces montagnes flottantes, vieilles de plusieurs siècles, mais non les disloquer.
Donc l'attente serait vaine.
Ne vaut-il pas mieux affronter résolument cet obstacle qui se dresse comme une dernière impossibilité, pousser une pointe audacieuse, avec les plus robustes et le minimum de bagages et de provisions?..
Sans doute. Mais, la banquise dérive toujours. Lentement, mais sans relâche. Qu'arrivera-t-il, si derrière ce rempart paléocrystique on trouve l'eau vive! Et si de glaçon flottant en glaçon flottant la petite troupe toujours pointant vers le Pôle, ne retrouve plus au retour les hommes qui seront demeurés avec les embarcations et le matériel!
Là est en effet le grand danger. Ne plus se rencontrer, après une séparation qui ne peut être inférieure à quinze jours.
D'Ambrieux est cruellement perplexe. Ne voulant pas prendre une résolution prématurée dont il sent pourtant l'urgence, il va décider d'attendre vingt-quatre heures encore.
Du reste, une catastrophe qui frappe d'épouvante ses hommes, jusqu'à présent étrangers à la pensée de la mort, suspend jusqu'à nouvel ordre sa détermination.
Le pauvre Fritz agonise. Les points rouges qui, dès le second jour, apparaissaient sous sa peau, se sont étalés en larges ecchymoses bleuâtres. Des tumeurs dures bossuent l'épiderme, et les membres possèdent par place la rigidité du marbre.
Des douleurs lancinantes, qu'exaspère le moindre contact, courent le long de ses os, redoublent aux jointures toutes déformées et lui arrachent des cris déchirants.
Incapable de mouvement, faible au delà de toute expression, perdant toutes ses dents qui se déchaussent et tombent des gencives décomposées, devenues molles comme de l'éponge, encore épuisé par une salivation abondante, et pouvant à peine respirer, le mécanicien se sent mourir au milieu de ses compagnons désespérés.
Le savoir du docteur, son dévouement ont été impuissants à conjurer l'atroce maladie.
Les minutes sont à présent comptées.
Contrairement à ce qui se passe d'ordinaire, l'intelligence est restée nette. Mais les paroles peuvent à peine sortir de la bouche du malheureux, car sa langue gonflée remplit presque entièrement la cavité fétide, d'où s'échappe, à chaque effort, une sérosité sanguinolente.
Groupés autour de lui, tout pâles et les yeux humides, les marins désolés ont peine à croire à une désorganisation aussi rapide. Comment, Fritz Hermann, ce colosse blond, ce géant si fort et si bon, est devenu en quelques jours ce moribond sans vigueur, sans voix, presque sans regard!..
Quelque intrépides qu'ils soient, ils ne peuvent se défendre d'un vague sentiment d'effroi, bien légitimé par l'aspect navrant de l'agonisant.
Autre chose est, en effet, de mourir en pleine vigueur, soit dans le tourbillon de la tempête ou l'enivrement de la bataille, et d'assister à sa propre décomposition, sentir son organisme s'en aller en lambeaux putrides, et fluer en liquides purulents!..
Fritz pourtant est calme, en homme qui a suivi tout droit le chemin de la vie, et n'a rien à se reprocher au moment où le voyage s'interrompt.
Il murmure à grand'peine des paroles sans suite, et fixe sur son capitaine qui lui tient la main un inexprimable regard d'affection et de regret.
Les mots d'Alsace et de France reviennent perpétuellement, avec celui de Wasselonne, la charmante petite ville d'Alsace où il naquit, et où sont restés ses vieux parents, fidèles au sol natal et à la mère patrie.
A cette vision d'enfance, à ce souvenir du foyer perdu s'ajoutent les mots de bataille, de revanche, proférés d'une voix rauque, vibrante, malgré tout, comme une dernière et plus indignée protestation contre l'attentat.
Puis, après une crise qui menace brusquement de l'emporter, le malade recouvre un moment la parole, grâce peut-être à une dose de vieille eau-de-vie que le docteur vient de lui faire absorber.
– Capitaine, dit-il, adieu… et vous aussi… matelots…
«Je n'assisterai pas… à votre gloire… et je… ne pourrai pas… aider à votre… succès… avec mes… camarades…
«J'ai fait tout ce que je… pouvais… n'est-ce pas…
– Oui, mon ami, répond l'officier dont la voix tremble, et dont la paupière bat; tu as fait aussi pour moi plus que tu ne devais et je t'en serai toujours reconnaissant.
– Merci!.. capitaine… et en travaillant de… tout cœur… pour vous… je travaillais aussi… pour la France…
«Camarades… matelots… si j'ai offensé quelqu'un de vous… qu'il… me… pardonne…
«Je vais mourir… fidèle à mon drapeau… en vrai fils d'Alsace… eu luttant contre l'autre… celui qui l'a volée… mon Alsace…
«Capitaine… je veux le voir encore… mon cher pavillon…
«Et toi, Parisien… chante la vieille Alsace!..
«Je mourrai heureux…»
Epuisé par cet effort, le moribond retombe lourdement sur son sac, mais l'aspect des couleurs françaises aussitôt arborées à l'entrée de la tente, et se détachant en vigueur sur la neige, le galvanise.
Tenant toujours la main du capitaine, il tend l'autre au Parisien qui a toutes les peines à retenir ses larmes.
Les marins, émus, frissonnants, étreints jusqu'aux moelles par cette scène tragique, se pressent en cercle autour du groupe qu'éclaire un soleil radieux. En dépit d'un froid toujours vif, la tente s'entr'ouvre sur l'horizon de glace, et laisse pénétrer une lumière crue, encore avivée par la neige et les facettes qui la réfléchissent.
– Chante!.. ami, reprend le mourant.
«Si je n'ai pas été… toujours… un chrétien fervent… le bon Dieu… me pardonnera… parce que j'ai aimé ma patrie… et il me tiendra… compte… des larmes… et du sang… que j'ai versés… pour elle.
«Chante!.. l'Alsace à l'Alsacien qui meurt!»
Surmontant d'un énergique effort l'émotion qui le serre à la gorge, le jeune homme entonne d'une voix sourde, voilée, la fière protestation.
Dis-moi quel est ton pays,
Est-ce la France ou l'Allemagne?..
Et Fritz, les yeux fixés avec un indicible regard d'amour et de regret au pavillon qui flamboie sous le grand soleil, semble pour un instant renaître à la vie.
Le Parisien continue d'une voix plus ferme qui retentit, à travers les amoncellements de glace, et se perd là où nul accent humain n'a encore vibré.
… C'est la vieille et loyale Alsace…
A la seconde strophe, on voit Fritz haleter. De grosses gouttes de sueur coulent sur son front, et ses yeux, hypnotisés par les couleurs nationales, s'emplissent de larmes.
Le Parisien entonne la troisième strophe.
Dis-moi quel est ton pays,
Est-ce la France ou l'Allemagne?
– C'est un pays de plaine et de montagne,
Où poussent avec les épis,
Sur les monts et dans la campagne,
La haine de tes ennemis
Et l'amour profond et vivace,
O France, de la noble race!..
… Par un effort dont on l'eût cru incapable, Fritz, cramponné à la main du capitaine et à celle du chanteur, se lève à demi, au moment où son camarade s'écrie à pleine voix:
Allemands, voilà mon pays!..
Quoi que l'on dise et quoi qu'on fasse,
On changerait plutôt le cœur de place
Que de changer la vieille Alsace!..
A ce dernier mot: Alsace! le mécanicien crie: «Présent!..» comme si une voix mystérieuse l'appelait au delà de cet horizon lointain, vers cet infini où il ne doit plus y avoir ni haines ni regrets, et retombe mort sur sa couche.
– C'en est fait! dit le capitaine sans chercher à dissimuler une larme qui roule jusque sur sa grosse moustache de guerrier gaulois.
– Pauvre Fritz! murmure le Parisien en sanglotant brusquement, à pleine gorge.
Et tous les marins se découvrent avec un respect attendri, pendant que le capitaine, détachant le pavillon, en couvre, comme d'un linceul, la dépouille de cette première victime du devoir!
Bien que le temps pressât, en raison de la pénurie de vivres, le capitaine résolut d'attendre au lendemain avant de rien entreprendre.
Il voulait présider aux funérailles de son matelot, veiller près de lui, et l'ensevelir de ses mains, comme s'il eût été un membre de sa famille.
Ce pieux devoir accompli, il s'en irait où l'appelaient les hasards et les périls de sa destinée.
La mort de Fritz Hermann constatée légalement par le docteur, il fut revêtu de sa tenue de bord avec sa médaille militaire attachée au côté gauche de la poitrine. Il resta ainsi exposé pendant six heures, éclairé par tout le luminaire dont on put disposer, puis, ce temps écoulé, il fut enveloppé dans un vaste carré de toile à voile.
Le capitaine avait fait choix, à quelques centaines de mètres, d'un emplacement, au milieu de blocs énormes disposés de telle façon que l'effort de plusieurs hommes suffirait à les faire écrouler.
On creusa dans la glace une fosse profonde au milieu de cet amoncellement, et les travailleurs retournèrent à la tente pour procéder aux funérailles.
Le cadavre fut hissé sur le plus petit traîneau, celui qui sert en temps ordinaire à porter le bateau plat. Le pavillon national recouvrit la dépouille du défunt, et deux hommes s'offrirent pour traîner le fardeau funèbre. On se mit en marche au petit jour, le capitaine conduisant le deuil, et l'on atteignit la fosse, au milieu d'un silence plein de tristesse.
Selon la coutume des gens de mer, le capitaine lut l'office des morts. Puis la fosse de glace, après avoir reçu le cadavre du brave marin, fut comblée de menus morceaux, sur lesquels on fit écrouler avec fracas les blocs, dont la masse et le poids devaient rendre cette sépulture inviolable aux ours et aux loups arctiques.
Sur la plus haute pointe, fut plantée une modeste croix, faite de deux tronçons d'espars, sur laquelle le charpentier avait, pendant la veillée funèbre, gravé ces simples mots:
FRITZ HERMANN
FRANÇAIS D'ALSACE26
avril 1888
– Adieu, Fritz Hermann, dit le capitaine d'une voix étranglée, adieu, matelot!
«Tu as vécu en homme d'honneur, tu as souffert et tu es mort sans reproche; repose en paix et que Dieu te reçoive en sa miséricorde!»
Le retour à la tente fut lugubre. Et chacun des survivants qui avait à se reprocher quelques imprudences comparables à celles que le mécanicien payait de sa vie, faisait à part lui de cruelles réflexions, se promettant bien de ne plus jamais sacrifier la sécurité du lendemain à la satisfaction du présent.
Promesses sincères autant qu'intéressées, auxquelles donnait un triste regain d'actualité la présence des trois malades immobiles sous la tente.
Ceux-là, du reste, ne vont ni mieux ni plus mal, sauf toutefois Nick, dont la maladie a été arrêtée net par l'absorption du sang de phoque avalé tout chaud.
Encore une autre dose et il serait guéri. Mais quand pareille aubaine se renouvellera-t-elle?
Qui sait si une rechute grave, peut-être mortelle ne se produira pas, avant que le sauvage pourvoyeur réussisse à opérer d'autres captures.
Cependant le capitaine a un long entretien avec le second Berchou, le docteur, et Guénic remplaçant momentanément le lieutenant Vasseur, atteint de scorbut.
La maladie d'une partie de l'équipage, la mort de Fritz, l'état de la banquise, l'impossibilité absolue de faire franchir à la chaloupe et aux baleinières un tel obstacle, tout concourt à la modification du projet primitif, consistant à ne quitter, sous aucun prétexte, ses matelots.
Mais, comme dit le proverbe: Nécessité n'a pas de loi.
Ce qu'un plus grand nombre ne peut tenter, un petit groupe a plus de facilités pour l'opérer.
Il partira donc seul de l'état-major, accompagné de quatre hommes au plus, et une demi-douzaine de chiens.
Il emmènera le bateau plat avec vingt-cinq jours de vivres, deux sacs pour dormir, quelques médicaments, un sextant, un horizon artificiel, un chronomètre, une lunette astronomique, des armes, des munitions, des pelles et des pioches, en un mot le minimum d'objets strictement indispensables.
Eu égard à la légèreté de ce matériel que les chiens pourraient seuls et très facilement traîner sur une glace plane, les hommes pourront conserver leur vigueur pour agir dans les endroits difficiles et se ménager, quand il n'y aura pas urgence absolue de donner le coup de collier.
Pour ne pas faire de jaloux, le capitaine eût bien désigné par le sort ceux qui doivent l'accompagner. Mais il y a pas mal d'éclopés parmi l'équipage, et il lui faut choisir ceux qui, jusqu'alors, sont restés indemnes de toute maladie.
Chose assez singulière, ce sont positivement des hommes du Midi, du moins sauf un, qui ont victorieusement bravé les rigueurs polaires. Jean Itourria et Michel Elimberri, les deux Basques, plus Dumas le Provençal et le Parisien Farin dit Plume-au-Vent.
Ces quatre homme sont en conséquence désignés par le capitaine pour marcher avec lui, sans qu'il leur en soit fait pour cela une obligation formelle. Ce n'est plus une affaire de service pour laquelle il n'y a pas de refus possible, mais une sorte d'enrôlement volontaire qu'ils peuvent décliner pour un motif ou pour un autre.
Bien loin d'ailleurs d'hésiter au moment d'affronter cet inconnu plus redoutable encore, les quatre matelots témoignent leur joie par un cri retentissant de: Vive le capitaine! comme si ce choix qui va encore aggraver leurs misères était la plus enviée des faveurs.
Pour la première fois, Dumas rend son tablier et offre l'insigne professionnel à Courapied dit Marche-à-Terre, qui a, paraît-il, en maintes circonstances, montré de réelles dispositions culinaires.
Le choix de Dumas dont nul ne songe même à discuter la compétence est ratifié à l'unanimité.
Courapied est promu maître coq intérimaire et entre en fonctions à l'instant même, pour préparer le repas d'adieu qui fut du reste parfaitement exécrable.
Le lendemain, la petite troupe escortée des hommes valides se mettait résolument en marche et pointait vers le Nord à travers les escarpements de la banquise.