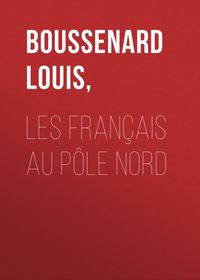Kitabı oku: «Les français au pôle Nord», sayfa 27
VIII
Recommandations dernières, puis séparation. – Rude voyage. – Splendeurs inutiles. – Toujours la ligne courbe. – Tours de force d'acrobates. – Submergés dans la neige. – Une épave au loin. – Un cairn par 89°. – Angoisses. – Document allemand. – Traces de l'expédition anglaise du commandant Nares. – L'écrit du lieutenant Markham. – La dérive de la mer Paléocrystique. – Subite élévation de température.
Le 27 avril de bon matin, la petite troupe s'était mise en marche après un relèvement très exact de la position. Le capitaine avait remis le commandement à son second, Berchou, qui agirait, en ses lieu et place, pendant son absence et le garderait au cas où lui d'Ambrieux, ne reviendrait pas.
Il lui avait remis en outre, ses dernières volontés, sous pli cacheté, avec ordre d'ouvrir l'enveloppe après une absence d'un mois.
Les hommes s'étaient serré la main en se souhaitant bonne chance, et le Parisien avait eu toutes les peines à consoler Guignard, immobilisé sous la tente par une attaque de scorbut.
Guignard, malade, mais toujours avaricieux, maudissait le scorbut qui l'empêchait de gagner la prime réservée à ceux qui atteindraient le Pôle.
Le capitaine entendant ses doléances, le rassura. La prime serait touchée par tout le monde, ce qui fit grand plaisir à chacun, même aux plus désintéressés.
En outre, le capitaine recommanda essentiellement de chasser avec le plus grand zèle les morses, les phoques ou tous autres représentants de la faune arctique, leur capture devant fournir les éléments indispensable au retour. Oûgiouk, pourvoyeur né de l'expédition, promit de faire merveilles et d'emmagasiner de véritables montagnes de victuailles.
Enfin, après un dernier serrement de main, on se sépara aux confins des glaces dites mauvaises, du moins ceux qui parmi les plus valides avaient fait la conduite au capitaine et à ses compagnons, notamment le docteur, désolé de ne pouvoir aller plus loin.
Un dernier cri de: Vive la France!.. vive le capitaine!.. et le traîneau, halé par les chiens et maintenu par les hommes, s'engage dans les défilés de l'Enfer de Glace.
La journée est belle et le ciel ensoleillé. Mais le froid est toujours d'une âpreté cruelle. C'est au point que, à certains moments, la respiration qui s'élève dans l'air en un jet blanc très dense, produit un crépitement très appréciable à l'oreille. C'est l'effet de la condensation de la vapeur sortie du poumon, en glaçons d'une excessive ténuité!
Les cinq hommes, les six chiens et le traîneau secoué, culbuté se trouvent au milieu du chaos. Partout des montagnes, des collines, des blocs, des ravins, des trous, des anfractuosités à donner le vertige, à courbaturer par leur vue seule, à désespérer par leurs escarpements.
Il faut, dès le début, et comme pour se mettre en haleine, manœuvrer la pioche et la pelle, déblayer le passage, s'atteler ensuite près des chiens, et faire monter le traîneau sur une pente où il est presque impossible de se tenir debout.
L'accès de la crête glacée est enfin obtenu, grâce à un escalier grossier taillé en plein bloc. Il s'agit maintenant de descendre. C'est encore pis, car le traîneau, sollicité par son poids, menace d'écraser les pauvres toutous qui geignent et tirent la langue.
Il faut l'alléger, transformer son contenu en ballots que chaque homme transporte sur son dos jusqu'au bas de la colline.
– Et va comme je te pousse! dit le Parisien en voyant l'appareil, d'une solidité fort heureusement éprouvée, glisser comme une flèche et s'arrêter au bas d'un nouvel et plus terrible escarpement.
«Mince de Montagnes Russes!»
Cette chaîne franchie au prix de rudes efforts, une autre surgit, plus haute, plus abrupte, plus dure à escalader.
Le contenu du traîneau est déchargé et rechargé jusqu'à cinq fois pendant la matinée!
A un certain endroit plus particulièrement dangereux, le bateau, suprême espoir si les eaux libres apparaissent, doit être transporté à dos d'homme!
On ne compte plus les chutes heureusement amorties par la neige. La soif est intense, la faim commence à se faire sentir…
– Stop!
A défaut de tente, on campe dans une anfractuosité – ce n'est pas cela qui manque – et Dumas installe, à l'abri du prélart couvrant le traîneau, sa lampe à esprit-de-vin et son digesteur à neige.
Les intrépides explorateurs sont collés au flanc d'une colline mesurant au moins quarante-cinq à cinquante mètres de hauteur, et contemplent, malgré le froid, malgré la faim, malgré la fatigue, un spectacle féerique.
Au loin, la neige s'irise des couleurs les plus vives et les plus variées, sur les déclivités des hummocks. Les glaces dénudées par endroits, se montrent sous les rayons obliques du soleil, en un semis de pierres précieuses qui scintillent, comme si la main prodigue d'un Titan les eût lancées à profusion sur un incommensurable écrin de satin blanc.
Diamants, émeraudes, turquoises, rubis, saphirs, topazes, flamboient de tous côtés avec un éclat aveuglant. Tout est lumière, tout est couleur, tout est splendeur aussi, sous ce ciel d'azur intense. L'homme seul est sordide sous sa dépouille d'animaux arctiques, avec ses yeux clignotants sous les lunettes, son nez bleui par de successives congélations, ses lèvres scarifiées par la gelure, son épiderme enfumé, crasseux même, son allure de bête fourbue, ses membres endoloris.
A voir les compagnons du capitaine d'Ambrieux et l'officier lui-même, on les prendrait, sous leur défroque, pour des Esquimaux pur sang, gorgés d'huile et de tripes de phoque.
Mais la dégradation n'est qu'apparente. De ces enveloppes grossières s'échappent des exclamations, des mots, des phrases d'admiration, montrant que ceux-là sont des civilisés, et que chez eux le sentiment du beau survit quand même à la souffrance.
Un déjeuner sommaire, composé de thé bouillant dans lequel est incorporé un morceau de pemmican empoisonnant le suif et un peu de biscuit, est lestement absorbé. Ce mélange incohérent, de consistance gluante, et rappelant la formule de Mme Gibou, semble délicieux aux hivernants, chez qui l'usage d'aliments de plus en plus grossiers et de moins en moins abondants a peu à peu perverti le goût.
La lampe éteinte et le grog avalé, nul n'a envie de faire la sieste en pareil lieu. Les chiens ont gobé leur ration de poisson sec, lappé leur eau de neige et repris la bricole.
– En avant!
Et chacun, pour obéir à ce commandement, oblique à droite ou à gauche, à la recherche de la ligne courbe qui là-bas, à travers l'interminable tohu-bohu de hummocks, d'icebergs et de floebergs, semble sinon le chemin le plus court d'un point à un autre, du moins, le seul praticable.
En avant! cela veut dire obliquez sur l'un ou l'autre flanc, tournez, virez, cherchez le passage, escaladez, glissez, allez parfois en arrière!..
Cependant, comme le fait observer le Parisien dont l'entrain et la gaieté ne désarment pas, la route se tire.
A tel point que, malgré un chemin d'enfer, le capitaine peut, le premier soir, pointer sur sa carte, treize milles dans la direction du Nord, soit vingt-quatre kilomètres, soixante-seize mètres.
C'est un succès inouï, stupéfiant, inespéré, dû exclusivement à la vigueur des hommes, à leur endurance, à leur indomptable énergie.
Les deux Basques, nés en pleine montagne, font merveille. Le Parisien, en véritable faubourien mâtiné de singe, passe partout. Chez Dumas, la vigueur musculaire supplée au manque d'habitude. Quant au capitaine, sa qualité d'ascensionniste, membre du club alpin français, dispense de tout commentaire.
Pour coucher, on improvise, d'après les conseils donnés par Oûgiouk, avant le départ, une maison de neige, un simple trou sous lequel sont enfournés les lits et le matériel.
Les chiens, attachés au traîneau, demeurent préposés à sa garde, au cas bien improbable de rencontre avec des maraudeurs à quatre pattes.
Il semble en effet qu'il n'y a aucune terre à proximité, car on ne rencontre ni mammifères, ni oiseaux. C'est la solitude absolue, troublée seulement par les craquements de la glace, craquements qu'on ne remarque même plus, tant ils sont devenus une habitude, comme l'acte de la respiration auquel on assiste sans y prendre garde.
Le lendemain matin, chacun s'éveille au signal donné par Dumas, qui repose fraternellement enfoui près du capitaine, dans le sac à fourrure.
La veille au soir, les places ont été tirées au sort, et le sort a décidé que le digne cuisinier serait le camarade de lit du capitaine.
Dumas a bien objecté le respect, le grade, la hiérarchie, et déclaré qu'il n'oserait jamais gigoter, ronfler!.. si près de son chef.
A quoi le chef a répliqué que c'était l'ordre, et que par conséquent Dumas ronflerait et gigoterait par ordre, côte à côte avec le capitaine, au cas où ces deux habitudes seraient invétérées chez lui.
Et le cuisinier, esclave du devoir et de la discipline, obtempéra.
Le 28 avril, nouvelles difficultés.
– Toujours de plus fort en plus fort, comme chez Nicolet! observe le Parisien qui est frotté de littérature.
Le temps est superbe, très sec, et un peu moins froid. 25° seulement au-dessous de zéro.
Malheureusement il faut batailler plus que jamais et à chaque instant contre le floe dont les craquelures traîtreusement dissimulées sous la neige ne se comptent plus.
Tantôt les hommes, tantôt les chiens, tantôt le traîneau s'enfoncent à tour de rôle, ou simultanément, selon que la dépression est plus ou moins grande.
Les Basques, stoïques, jurent: capédidiou! et s'arrachent, blancs du neige en cherchant leur capuchon et leurs lunettes.
Dumas épuise la série des jurons provençaux et déclare que, comparé à son pays, le pôle est un endroit idiot.
Le Parisien nargue les chutes et chante, quand cela va très mal, le refrain d'une chansonnette bébête qui fit jadis les délices des petits cafés-concerts:
Par les sentiers remplis d'ivresse
Allons ensemble à petits pas…
Insensible à tout, n'ayant en vue que l'objectif dont il se rapproche à chaque enjambée, dominé par l'unique pensée qui est sa vie, le capitaine en dehors du bien-être – oh! très relatif – de ses hommes, et de l'aide qu'il leur prodigue à chaque instant, marche comme un illuminé.
Un choc un peu plus violent, une chute plus rude, un propos ou plus drôle ou plus salé l'arrachent un moment à cette sorte d'hypnotisme.
Il donne un coup d'épaule pour déhaler le traîneau, tend la main à l'homme aux trois quarts assommé, ou sourit complaisamment à quelque bonne bourde bien épaisse, puis de nouveau se creuse entre ses sourcils le pli longitudinal indiquant la pensée intense, tenace, implacable.
A mesure qu'on avance, cette préoccupation semble plus vive.
Le 28, on a parcouru vingt-cinq kilomètres, et le 30 vingt-neuf!.. Total, depuis le départ, quatre-vingts kilomètres!..
Celui qui verrait l'état du chemin parcouru crierait à l'impossibilité, tant ce tour de force paraît incompatible avec la faiblesse des moyens humains.
Et pourtant, cela est!.. Pourquoi?.. Pardieu! parce que cela est!
Donc, malgré ce résultat stupéfiant, le capitaine est visiblement préoccupé, inquiet, même.
Chose étrange, bien faite pour légitimer cette inquiétude, des traces d'abord presque invisibles viennent de lui apparaître à plusieurs reprises.
Des érosions profondes, qui, semble-t-il, ne peuvent avoir été faites que de main d'homme, se montrent çà et là, comme pour attester le passage de voyageurs venus antérieurement.
A cette pensée d'Ambrieux se sent frémir.
Eh! quoi, tant de travaux, de misères, de souffrances deviendraient inutiles. Le pauvre Fritz serait mort à la peine, ses compagnons endureraient là-bas les angoisses de l'attente aujourd'hui, et demain les tortures de la faim… Les quatre enfants perdus qui s'avancent, au prix de quelles fatigues écrasantes, seraient frustrés, au dernier moment, de l'espoir d'une découverte dont ils n'envisagent peut-être pas toutes les conséquences, mais à laquelle ils concourent intrépidement, de confiance… Cette gloire unique dans les fastes de la civilisation serait enlevée au chef qui a conçu et mis en œuvre ce plan grandiose, et en touche du doigt la réalisation!..
Car, il n'y a pas à en douter d'autres hommes sont passés par là, avant les marins de la Gallia.
L'époque de ce passage est indécise, car la glace peut rester inaltérée pendant de longues années, comme aussi subir des modifications résultant d'écrasements ou de pressions qui la déforment instantanément.
C'est miracle, vraiment, que les hommes n'aient point aperçu jusqu'alors ces vestiges qui, comme on dit vulgairement, crèvent les yeux, tant ils portent l'empreinte non seulement du passage brutal, mais encore et surtout de l'industrie humaine.
Une pente abrupte se présente tout à coup en face de la petite troupe éreintée.
– Va rien falloir turbiner! dit de sa voix railleuse le Parisien.
– Pécaïré! encore tailler là dedans «une» escalier…
– Y s'passera quéques heures avant de pouvoir chanter:
«Madame à sa tour monte…
«Cré pétard?
– Quésaco?..
– Mais, y en a «une» d'escalier… proprement ficelée, encore, et par des lascars qui n'avaient pas les mains en beurre…
Le traîneau s'arrête et le capitaine plus préoccupé que jamais examine un escalier à larges marches, taillées hardiment, de faible hauteur, en plan très incliné, sur lequel il n'est pas trop difficile de haler un traîneau.
– Vivadioux! s'écrie Michel Elimberri, c'est à croire qu'on rêve.
– Ou que de bonnes fées sont venues travailler pour nous, dit le Parisien avec sa naïveté goguenarde qui ne demande pas mieux que de croire au surnaturel.
– A moins que y en ait parmi nous de somnambules, dit à son tour Dumas…
«J'ai connu sur le Colbert un cuisinier qui se relevait la nuit pour mettre cuire des fayots au lard, et se fiçait dans une colère bleue quand il trouvait, au branle-bas, sa cuisine parée, avec sa camelote en train de mizôter!..
Jean Itourria émet à son tour une opinion qui amène sur le visage du capitaine une brusque et passagère contraction.
– Eh!.. Caramba… si cet Allemand de malheur était venu dans ces parages…
«Si c'était lui qui a taillé cette montagne de glace…
«Demande pardon, excuse, capitaine, de supposer que ce monsieur Pregel ait pu arriver jusqu'ici, par la raison qu'il n'est pas de la flotte…
– Tout est possible! interrompt brusquement le capitaine en passant la bricole du traîneau sur son épaule.
«En avant! mes enfants… qui vivra verra!»
Grâce à ce plan incliné supérieurement coupé de marches régulières, dont l'arête se trouve à peine érodée, le passage du monticule s'opère en un quart d'heure, alors qu'il eût exigé au moins deux heures d'efforts et de travail.
Les dernières paroles du charpentier ont fait froncer le sourcil au capitaine, tant elles répondent bien à l'idée secrète et tenace qui obsède sa pensée, depuis l'apparition des premiers vestiges.
Contre toute possibilité, contre toute vraisemblance, Pregel aurait-il réussi à pousser jusque-là!
Et qui sait, plus loin encore peut-être, puisque les traces, au lieu de disparaître et de s'atténuer, augmentent encore, à mesure que s'accroissent les difficultés!
La voie suivie devient de plus en plus affreuse. Elle serait franchement impraticable, sans la présence de ces étranges travaux d'accès qui en facilitent singulièrement le parcours.
Enfin, chose plus extraordinaire encore, le chemin ainsi préparé se dirige imperturbablement vers le Nord, dont le pôle se rapproche de plus en plus.
La journée du 29 accuse ainsi une distance parcourue de vingt-six kilomètres, en dépit d'obstacles effrayants.
Le 30 avril, à 9 heures, par un froid toujours très vif, le capitaine constate que, après les circonvolutions opérées à la recherche de la ligne droite, cette ligne droite prolongée depuis le campement, atteint cent onze kilomètres, soit un degré.
L'expédition française est par 89° de latitude Nord, c'est-à-dire à vingt-cinq lieues terrestres seulement du Pôle!
Cette bonne nouvelle redonne du nerf à chacun et l'étape, après une nuit glaciale, est commencée avec un entrain superbe.
Ah! si la damnée trace qui monte inflexiblement vers le Nord n'accusait pas le passage antérieur d'inconnus venus on ne sait d'où, quelle joie exubérante, pour ces pauvres marins, qui, malgré leur vaillance, n'en peuvent plus, et ne marchent que soutenus par l'idée du devoir accompli, et par l'affection qu'ils portent à leur chef.
D'Ambrieux, de plus en plus sombre, garde un silence farouche et cherche si cette voie qui pourtant facilite singulièrement sa marche, cessera enfin.
Ce qu'il lui faut, c'est l'inviolée solitude avec ses glaces inaccessibles, son grand silence de région inexplorée, où ne se rencontrent même ni quadrupèdes ni oiseaux.
Mais, à propos, quels sont ces ossements épars sur la glace d'où la neige a été balayée par la tourmente! Cette tête busquée, ces mâchoires plantées de dents aiguës, ces pattes de plantigrades ont appartenu à un ours. Les os creux ont été éclatés à la chaleur, comme faisaient jadis les primitifs pour en extraire la moelle.
Mais ce ne sont pas des sauvages qui ont fait cette curée, car un peu plus loin se trouvent deux cartouches vides, en laiton, avec ces deux mots estampés sur le fond: «Maxwell Birmingham».
L'ours a été tué, puis dévoré par des hommes portant des armes approvisionnées de cartouches anglaises.
Renseignement bien vague et n'apprenant pas grand'chose.
L'expédition allemande est munie de fusils Mauser. Mais qui sait si parmi ses membres ne se trouve pas quelqu'un armé d'une carabine anglaise.
D'Ambrieux n'a point d'autre idée en tête que celle de l'expédition allemande et de son chef le devançant à travers la sinistre étendue de floes et de hummocks, à travers l'épouvantable Enfer de Glaces.
Et qui donc aurait pu s'avancer aussi loin, puisque depuis des années, nulle campagne polaire n'a été entreprise, sauf celles de la Jeannette et de Greely, si déplorablement terminées!
Les traces laissées sur les glaces, les débris abandonnés semblent du reste contemporains…
… A deux heures, le capitaine, de plus en plus obsédé, va commander la halte pour le goûter, quand Dumas, dont l'œil de chasseur voit juste et loin, lui fait apercevoir quelque chose de long et de mince, implanté en plein banc de glace, à une distance assez notable.
– On dirait, capitaine, sauf votre respect, un manche à balai, si dans la marine il y avait des balais, ou si les fauberts ils auraient des manches.
Incapable de subordonner son allure à la marche lente du traîneau, le capitaine s'élance en courant vers la mystérieuse épave, et se trouve en effet devant un morceau de bois qui paraît, à première vue, être la hampe d'un croc.
Il est dans un état de conservation parfaite, grâce peut-être à des onctions d'huile de lin qui l'ont saturé. Sa pointe disparaît dans un monticule de la grosseur d'une barrique, formé de glaçons agglomérés avec des boîtes à conserves réunies entre elles et attachées au morceau de bois par un fil de fer.
Il y a donc, dans cette disposition, l'idée manifeste d'attirer l'attention. C'est bien là un cairn ou signal édifié non pas avec des pierres, puisque la matière première fait défaut, mais avec les éléments dont disposaient les mystérieux visiteurs.
Il doit y avoir là-dessous quelque document dont il importe de prendre au plus tôt connaissance.
Dans sa précipitation, le capitaine est accouru les mains vides, sans même apporter un couteau à neige.
Il essaye néanmoins d'arracher le morceau de bois et d'ébranler à coup de pieds le grossier édifice.
Vains efforts! La glace, quand le froid est très vif, est le meilleur de tous les ciments.
Il faut, à d'Ambrieux, modérer son impatience, retourner au traîneau et revenir avec un homme et deux pioches pour démolir le «signal».
Sous leurs coups, la glace vole en éclats et les boîtes à conserve s'éparpillent avec un grand bruit de ferraille.
L'amoncellement destiné à attirer l'attention des voyageurs étant dispersé, le capitaine d'Ambrieux aperçoit, profondément implanté dans la glace, un gros ballot de toile qu'il extrait avec précautions, et déroule avec des peines infinies.
Au milieu du ballot, il trouve enfin un flacon de verre solidement bouché et cacheté avec du brai.
Dans son impatience il va briser le flacon dans lequel il distingue parfaitement un rouleau de papier. Mais, honteux de cette précipitation, il commande à ses nerfs, arrête le tremblement qui agite ses mains et débouche posément le récipient.
Plusieurs feuilles s'en échappent. Il saisit la première venue et la parcourt d'un avide regard.
Elle est couverte de caractères allemands.
– Pardieu! J'en étais presque sûr, s'écrie amèrement l'officier.
Il relit une seconde fois et plus attentivement, et ne peut retenir un geste d'étonnement, à la vue d'un nom, d'une date, d'une latitude et d'une longitude: Markham… 12 mai 1876… 83° 20′ 26″ lat. N… 65° 24′ 22″ long. O.
Un long soupir de soulagement lui échappe alors, puis un bruyant éclat de rire.
L'homme qui l'accompagne et le regarde interdit, est Michel Elimberri, le matelot basque, l'ancien baleinier-pilote des glaces, fort intelligent, et capable de comprendre.
– Tu te demandes si j'ai perdu la tête, n'est-ce pas, Michel? dit le capitaine dont la voix est légèrement altérée.
– Mais, capitaine, vous êtes bien libre d'avoir l'air chaviré, puis de rire dans la même minute, si bon vous semble…
«Vous êtes le maître…
– C'est que, vois-tu, je viens d'avoir une fière peur.
– Pas possible!..
«Un autre que vous me le dirait que je répondrais que c'est pas vrai.
– C'est pourtant l'exacte vérité, va, matelot.
«J'ai eu peur d'avoir été devancé, et de ne pas arriver le premier là-bas… où nous serons dans quatre ou cinq jours, et où nul n'est jamais allé…
Michel esquisse une pantomime qui dans tous les pays du monde signifie: «Je ne comprends pas,» et que son accoutrement d'ours polaire rend singulièrement expressive et caricaturale.
– Je vais te traduire ce document, et tu sauras…
«… Mais il en a un second, en anglais…
«… Et un troisième en français.
«Ecoute plutôt la lecture de ce dernier:
«Aujourd'hui, 12 mai 1876, s'est arrêtée ici, par 83° 20′ 26″ de latitude Nord, et 65° 24′ 12″ de longitude ouest, l'expédition à la mer polaire, commandée par le capitaine G. Nares, de la marine britannique, et comprenant les deux navires: Alert et Discovery.
«De l'hivernage de l'Alert, par 82° 24′, sont partis deux traîneaux sous les ordres du lieutenant Markham, qui a pu les conduire à travers les floebergs de la mer Paléocrystique jusqu'à ce point, le plus élevé vers le pôle où l'homme ait atteint.
«Signé: Capitaine Albert H. Markham.«Lieutenant de l'Alert.»
– Mais, capitaine, s'empresse de dire le Basque, après la lecture de ce papier dont les caractères sont à peine altérés, le capitaine Markham, dont j'ai lu l'expédition pendant l'hivernage, parle de sa latitude qui est de 83° 20′ 26″…
«Nous sommes, nous, par 89°!.. c'est-à-dire 6° plus au nord… et notre latitude est la bonne, puisque c'est vous qui l'avez prise…
– Celle de Markham était bonne également, mon brave Michel, ajoute en souriant le capitaine.
– Caramba! je ne comprends plus…
– C'est bien simple pourtant, continue l'officier en réintégrant, du bout de ses doigts gourds, les trois papiers dans leur enveloppe de verre.
«Tu te rappelles ce que le commandant Nares disait de la mer Paléocrystique?
– Oui, capitaine.
«Une mer couverte de glaces censément éternelles, qui ne fondaient point, ne bougeaient pas de place, et empêchaient, à tout jamais, d'approcher du Pôle ceux qui auraient voulu tenter l'aventure.
«A preuve que, six ans plus tard, M. Pavy, le docteur français attaché à l'expédition Greely, ne trouve plus les soi-disant glaces éternelles, et manque de se noyer là où le commandant Nares croyait la mer prisonnière pour toujours.
– Le commandant Nares avait eu à la fois tort et raison, continue le capitaine en ralliant le campement son flacon de verre à la main.
«Tort en jugeant immobile ce redoutable amas de glaçons; raison, en pensant qu'il était extrêmement vieux, et à peu près indestructible.
«Il y a, vois-tu, quelque chose de plus fort que le poids et les adhérences de ces montagnes de glaces…
«C'est l'action combinée des vents et des courants.
«Un beau jour, la banquise paléocrystique a quitté les rives où l'a rencontrée le commandant Nares, et s'est mise à dériver au caprice de l'ouragan et suivant l'orientation des courants…
– Mais, capitaine, il y a onze ans de cela!..
– Qui nous dit qu'elle n'a pas tourné plusieurs fois autour de l'axe terrestre, qu'elle ne s'est pas promenée d'un pôle du froid à l'autre… qu'elle n'a pas été accrochée des mois, des années peut-être à quelque côte ignorée, pour repartir à travers les espaces circumpolaires?
– Vous devez avoir raison, capitaine.
«Car de telles masses une fois prises ne dégèlent plus, du moins sous pareille latitude, où l'été n'a même pas la chaleur de nos hivers.
Les deux hommes ralliaient à ces mots le campement où Dumas, Itourria et le Parisien attendaient, avec impatience, le résultat de la découverte.
On devine sans peine les exclamations et les commentaires qui suivirent cette étrange aventure, les réflexions que suggérèrent la longue existence de ces monstrueux amas de glaces errantes, et la surprise qu'éprouverait le brave officier anglais, en apprenant à quel vagabondage effréné s'était livré son document.
A propos de ce document, le capitaine d'Ambrieux le réintégra dans son enveloppe, et y ajouta un papier avec ces mots:
«Trouvé le 30 avril 1888 par le capitaine d'Ambrieux, chef d'une mission française partie en 1887 pour explorer les régions arctiques. Longitude observée: 9° 12′ ouest de Paris, latitude 89°. A cette date du 30 avril 1888, le commandant de la mission française, après avoir perdu son navire, n'avait plus que pour un mois à peine de vivres et se proposait, après être passé au Pôle, de rallier les terres moscovites. Quelques cas de scorbut se sont déclarés dans l'équipage frappé d'une perte cruelle, en la personne du mécanicien Fritz Hermann, qui succomba le 26 avril de la présente année.
«Ont signé: Jean Itourria, Dumas, Michel Elimberri, matelots; Farin, chauffeur; d'Ambrieux, capitaine.»
Le flacon fut rebouché, puis cacheté avec du brai, et replacé dans le cairn, qui fut réédifié avec soin et surmonté de sa hampe de bois.