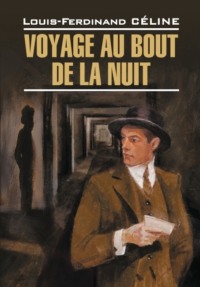Kitabı oku: «Voyage au bout de la nuit / Путешествие на край ночи. Книга для чтения на французском языке», sayfa 7
– Certes, Maître, ces questions me passionnent…
– Eh bien, sachez, en résumé, Bardamu, que j’y défends cette thèse: qu’avant la guerre, l’homme restait pour le psychiatre un inconnu clos et les ressources de son esprit une énigme…
– C’est bien aussi mon très modeste avis, Maître…
– La guerre, voyez-vous, Bardamu, par les moyens incomparables qu’elle nous donne pour éprouver les systèmes nerveux, agit à la manière d’un formidable révélateur de l’Esprit humain! Nous en avons pour des siècles à nous pencher, méditatifs, sur ces révélations pathologiques récentes, des siècles d’études passionnées… Avouons-le franchement… Nous ne faisions que soupçonner jusqu’ici les richesses émotives et spirituelles de l’homme! Mais à présent, grâce à la guerre, c’est fait… Nous pénétrons, par suite d’une effraction, douloureuse certes, mais pour la science, décisive et providentielle, dans leur intimité! Dès les premières révélations, le devoir du psychologue et du moraliste modernes ne fit, pour moi Bestombes, plus aucun doute! Une réforme totale de nos conceptions psychologiques s’imposait! »
C’était bien mon avis aussi, à moi, Bardamu. « Je crois, en effet, Maître, qu’on ferait bien…
– Ah! vous le pensez aussi, Bardamu, je ne vous le fais pas dire! Chez l’homme, voyez-vous, le bon et le mauvais s’équili-brent, égoïsme d’une part, altruisme de l’autre… Chez les sujets d’élite, plus d’altruisme que d’égoïsme. Est‐ce exact? Est‐ce bien cela?
– C’est exact, Maître, c’est cela même…
– Et chez le sujet d’élite quel peut être, je vous le demande Bardamu, la plus haute entité connue qui puisse exciter son altruisme et l’obliger à se manifester incontestablement, cet altruisme?
– Le patriotisme, Maître!
– Ah! Voyez-vous, je ne vous le fais pas dire! Vous me comprenez tout à fait bien… Bardamu! Le patriotisme et son corollaire, la gloire, tout simplement, sa preuve!
– C’est vrai!
– Ah! nos petits soldats, remarquez-le, et dès les premières épreuves du feu ont su se libérer spontanément de tous les sophismes et concepts accessoires, et particulièrement des sophismes de la conservation. Ils sont allés d’instinct et d’emblée se fondre avec notre véritable raison d’être, notre Patrie. Pour accéder à cette vérité, non seulement l’intelligence est superflue, Bardamu, mais elle gêne! C’est une vérité du cœur, la Patrie, comme toutes les vérités essentielles, le peuple ne s’y trompe pas! Là précisément où le mauvais savant s’égare…
– Cela est beau, Maître! Trop beau! C’est de l’Antique! »
Il me serra les deux mains presque affectueusement, Bestombes.
D’une voix devenue paternelle, il voulut bien ajouter encore à mon profit: « C’est ainsi que j’entends traiter mes malades, Bardamu, par l’électricité pour le corps et pour l’esprit, par de vigoureuses doses d’éthique patriotique, par les véritables injections de la morale reconstituante!
– Je vous comprends, Maître! »
Je comprenais en effet de mieux en mieux.
En le quittant, je me rendis sans tarder à la messe avec mes compagnons reconstitués dans la chapelle battant neuf, j’aperçus Branledore qui manifestait de son haut moral derrière la grande porte où il donnait justement des leçons d’entrain à la petite fille de la concierge. J’allai de suite l’y rejoindre, comme il m’y conviait.
L’après-midi, des parents vinrent de Paris pour la première fois depuis que nous étions là et puis ensuite chaque semaine.
J’avais écrit enfin à ma mère. Elle était heureuse de me retrouver ma mère, et pleurnichait comme une chienne à laquelle on a rendu enfin son petit. Elle croyait aussi sans doute m’aider beaucoup en m’embrassant, mais elle demeurait cependant inférieure à la chienne parce qu’elle croyait aux mots elle qu’on lui disait pour m’enlever. La chienne au moins, ne croit que ce qu’elle sent. Avec ma mère, nous fîmes un grand tour dans les rues proches de l’hôpital, une après-midi, à marcher en traînant dans les ébauches des rues qu’il y a par là, des rues aux lampadaires pas encore peints, entre les longues façades suintantes, aux fenêtres bariolées des cent petits chiffons pendants, les chemises des pauvres, à entendre le petit bruit du graillon qui crépite à midi, orage des mauvaises graisses. Dans le grand abandon mou qui entoure la ville, là où le mensonge de son luxe vient suinter et finir en pourriture, la ville montre à qui veut le voir son grand derrière en boîtes à ordures. Il y a des usines qu’on évite en promenant, qui sentent toutes les odeurs, les unes à peine croyables et où l’air d’alentour se refuse à puer davantage. Tout près, moisit la petite fête foraine, entre deux hautes cheminées inégales, ses chevaux de bois dépeint sont trop coûteux pour ceux qui les désirent, pendant des semaines entières souvent, petits morveux rachitiques, attirés, repoussés et retenus à la fois, tous les doigts dans le nez, par leur abandon, la pauvreté et la musique.
Tout se passe en efforts pour éloigner la vérité de ces lieux qui revient pleurer sans cesse sur tout le monde; on a beau faire, on a beau boire, et du rouge encore, épais comme de l’encre, le ciel reste ce qu’il est là-bas, bien refermé dessus, comme une grande mare pour les fumées de la banlieue.
Par terre, la boue vous tire sur la fatigue et les côtés de l’existence sont fermés aussi, bien clos par des hôtels et des usines encore. C’est déjà des cercueils les murs de ce côté-là. Lola, bien partie, Musyne aussi, je n’avais plus personne. C’est pour ça que j’avais fini par écrire à ma mère, question de voir quelqu’un. À vingt ans je n’avais déjà plus que du passé. Nous parcourûmes ensemble avec ma mère des rues et des rues du dimanche. Elle me racontait les choses menues de son commerce, ce qu’on disait autour d’elle de la guerre, en ville, que c’était triste, la guerre, « épouvantable » même, mais qu’avec beaucoup de courage, nous finirions tous par en sortir, les tués pour elle c’était rien que des accidents, comme aux courses, y n’ont qu’à bien se tenir, on ne tombait pas. En ce qui la concernait, elle n’y découvrait dans la guerre qu’un grand chagrin nouveau qu’elle essayait de ne pas trop remuer; il lui faisait comme peur ce chagrin; il était comblé de choses redoutables qu’elle ne comprenait pas. Elle croyait au fond que les petites gens de sa sorte étaient faits pour souffrir de tout, que c’était leur rôle sur la terre, et que si les choses allaient récemment aussi mal, ça devait tenir encore, en grande partie à ce qu’ils avaient commis bien des fautes accumulées, les petites gens… Ils avaient dû faire des sottises, sans s’en rendre compte, bien sûr, mais tout de même ils étaient coupables et c’était déjà bien gentil qu’on leur donne ainsi en souffrant l’occasion d’expier leurs indignités… C’était une « intouchable » ma mère.
Cet optimisme résigné et tragique lui servait de foi et formait le fond de sa nature.
Nous suivions tous les deux les rues à lotir, sous la pluie;
les trottoirs par là enfoncent et se dérobent, les petits frênes en bordure gardent longtemps leurs gouttes aux branches, en hiver, tremblantes dans le vent, mince féerie. Le chemin de l’hôpital passait devant de nombreux hôtels récents, certains avaient des noms, d’autres n’avaient même pas pris ce mal. « À la semaine » qu’ils étaient, tout simplement. La guerre les avait vidés brutalement de leur contenu de tâcherons et d’ouvriers. Ils n’y rentreraient même plus pour mourir les locataires. C’est un travail aussi ça mourir, mais ils s’en acquitteraient dehors.
Ma mère me reconduisait à l’hôpital en pleurnichant, elle acceptait l’accident de ma mort, non seulement elle consentait, mais elle se demandait si j’avais autant de résignation qu’ele-même. Elle croyait à la fatalité autant qu’au beau mètre des Arts et Métiers, dont elle m’avait toujours parlé avec respect, parce qu’elle avait appris étant jeune, que celui dont elle se servait dans son commerce de mercerie était la copie scrupuleuse de ce superbe étalon officiel.
Entre les lotissements de cette campagne déchue existaient encore quelques champs et cultures de-ci de-là, et même accrochés à ces bribes quelques vieux paysans coincés entre les maisons nouvelles. Quand il nous restait du temps avant la rentrée du soir, nous allions les regarder avec ma mère, ces drôles de paysans s’acharner à fouiller avec du fer cette chose molle et grenue qu’est la terre, où on met à pourrir les morts et d’où vient le pain quand même. « Ça doit être bien dur la terre! » qu’elle remarquait chaque fois en les regardant ma mère bien perplexe. Elle ne connaissait en fait de misères que celles qui ressemblaient à la sienne, celles des villes, elle essayait de s’imaginer ce que pouvaient être celles de la campagne. C’est la seule curiosité que je lui aie jamais connue, à ma mère, et ça lui suffisait comme distraction pour un dimanche. Elle rentrait avec ça en ville.
Je ne recevais plus du tout de nouvelles de Lola, ni de Musyne non plus. Elles demeuraient décidément les garces du bon côté de la situation où régnait une consigne souriante mais implacable d’élimination envers nous autres, nous les viandes destinées aux sacrifices. À deux reprises ainsi on m’avait déjà reconduit vers les endroits où se parquent les otages. Question de temps et d’attente seulement. Les jeux étaient faits.
Branledore mon voisin d’hôpital, le sergent, jouissait, je l’ai raconté, d’une persistante popularité parmi les infirmières, il était recouvert de pansements et ruisselait d’optimisme. Tout le monde à l’hôpital l’enviait et copiait ses manières. Devenus présentables et pas dégoûtants du tout moralement nous nous mîmes à notre tour à recevoir les visites de gens bien placés dans le monde et haut situés dans l’administration parisienne. On se le répéta dans les salons, que le centre neuro-médical du professeur Bestombes devenait le véritable lieu de l’intense ferveur patriotique, le foyer, pour ainsi dire. Nous eûmes désormais à nos jours non seulement des évêques, mais une duchesse italienne, un grand munitionnaire, et bientôt l’Opéra lui-même et les pensionnaires du Théâtre‐Français. On venait nous admirer sur place. Une belle subventionnée de la Comédie qui récitait les vers comme pas une revint même à mon chevet pour m’en déclamer de particulièrement héroïques. Sa rousse et perverse chevelure (la peau allant avec) était parcourue pendant ce temps-là d’ondes étonnantes qui m’arrivaient droit par vibrations jusqu’au périnée. Comme elle m’interrogeait cette divine sur mes actions de guerre, je lui donnai tant de détails et des si excités et des si poignants, qu’elle ne me quitta désormais plus des yeux. Émue durablement, elle manda licence de faire frapper en vers, par un poète de ses admirateurs, les plus intenses passages de mes récits. J’y consentis d’emblée. Le professeur Bestombes, mis au courant de ce projet, s’y déclara particulièrement favorable. Il donna même une interview à cette occasion et le même jour aux envoyés d’un grand « Illustré national » qui nous photographia tous ensemble sur le perron de! hôpital aux côtés de la belle sociétaire. « C’est le plus haut devoir des poètes, pendant les heures tragiques que nous traversons, déclara le professeur Bestombes, qui n’en ratait pas une, de nous redonner le goût de l’Épopée! Les temps ne sont plus aux petites combinaisons mesquines! Sus aux littératures racornies! Une âme nouvelle nous est éclose au milieu du grand et noble fracas des batailles! L’essor du grand renouveau patriotique l’exige désormais! Les hautes cimes promises à notre Gloire!.. Nous exigeons le souffle grandiose du poème épique!.. Pour ma part, je déclare admirable que dans cet hôpital que je dirige, il vienne à se former sous nos yeux, inoubliablement, une de ces sublimes collaborations créatrices entre le Poète et l’un de nos héros! »
Branledore, mon compagnon de chambre, dont l’imagination avait un peu de retard sur la mienne dans la circonstance et qui ne figurait pas non plus sur la photo en conçut une vive et tenace jalousie. Il se mit dès lors à me disputer sauvagement la palme de l’héroïsme. Il inventait de nouvelles histoires, il se surpassait, on ne pouvait plus l’arrêter, ses exploits tenaient du délire.
Il m’était difficile de trouver plus fort, d’ajouter quelque chose encore à de telles outrances, et cependant personne à l’hôpital ne se résignait, c’était à qui parmi nous, saisi d’émulation, inventerait à qui mieux mieux d’autres « belles pages guerrières » où figurer sublimement. Nous vivions un grand roman de geste, dans la peau de personnages fantastiques, au fond desquels, dérisoires, nous tremblions de tout le contenu de nos viandes et de nos âmes. On en aurait bavé si on nous avait surpris au vrai. La guerre était mûre.
Notre grand Bestombes recevait encore les visites de nombreux notables étrangers, messieurs scientifiques, neutres, sceptiques et curieux. Les Inspecteurs généraux du Ministère passaient sabrés et pimpants à travers nos salles, leur vie militaire prolongée à ceux‐là, rajeunis donc c’est‐à‐dire, et gonflés d’indemnités nouvelles. Aussi n’étaient-ils point chiches de distinctions et d’éloges les Inspecteurs. Tout allait bien. Bestombes et ses blessés superbes devinrent l’honneur du service de Santé.
Ma belle protectrice du « Français » revint elle-même bientôt une fois encore pour me rendre visite, en particulier, cependant que son poète familier achevait, rimé, le récit de mes exploits. Ce jeune homme, je le rencontrai finalement, pâle, anxieux, quelque part au détour d’un couloir. La fragilité des fibres de son cœur, me confia‐t‐il, de l’avis même des médecins, tenait du miracle. Aussi le retenaient-ils, ces médecins soucieux des êtres fragiles, loin des armées. En compensation, il avait entrepris, ce petit barde, au péril de sa santé même et de toutes ses suprêmes forces spirituelles, de forger, pour nous, l’« Airain Moral de notre Victoire ». Un bel outil par conséquent, en vers inoubliables, bien entendu, comme tout le reste.
Je n’allais pas m’en plaindre, puisqu’il m’avait choisi entre tant d’autres braves indéniables pour être son héros! Je fus d’ailleurs, avouons‐le, royalement servi. Ce fut magnifique à vrai dire. L’événement du récital eut lieu à la Comédie-Française même, au cours d’une après-midi, dite poétique. Tout l’hôpital fut invité. Lorsque sur la scène apparut ma rousse, frémissante récitante, le geste grandiose, la taille longuement moulée dans les plis devenus enfin voluptueux du tricolore, ce fut le signal dans la salle entière, debout, désireuse, d’une de ces ovations qui n’en finissent plus. J’étais préparé certes, mais mon étonnement fut réel néanmoins, je ne pus celer ma stupéfaction à mes voisins en l’entendant vibrer, exhorter de la sorte, cette superbe amie, gémir même, pour rendre mieux sensible tout le drame inclus dans l’épisode que j’avais inventé à son usage. Son poète décidément me rendait des points pour l’imaginative, il avait encore monstrueusement magnifié la mienne, aidé de ses rimes flamboyantes, d’adjectifs formidables qui venaient retomber solennels dans l’admiratif et capital silence. Parvenue dans l’essor d’une période, la plus chaleureuse du morceau, s’adressant à la loge où nous étions placés, Branledore et moi-même, et quelques autres blessés, l’artiste, ses deux bras splendides tendus, sembla s’offrir au plus héroïque d’entre nous. Le poète illustrait pieusement à ce moment-là un fantastique trait de bravoure que je m’étais attribué. Je ne sais plus très bien ce qui se passait, mais ça n’était pas de la piquette. Heureusement, rien n’est incroyable en matière d’héroïsme. Le public devina le sens de l’offrande artistique et la salle entière tournée alors vers nous, hurlante de joie, transportée, trépignante, réclamait le héros.
Branledore accaparait tout le devant de la loge et nous dépassait tous, puisqu’il pouvait nous dissimuler presque complètement derrière ses pansements. Il le faisait exprès le salaud.
Mais deux de nos camarades, eux grimpés sur des chaises derrière lui, se firent quand même admirer par la foule par‐dessus ses épaules et sa tête. On les applaudit à tout rompre.
« Mais, c’est de moi qu’il s’agit! ai-je failli crier à ce moment. De moi seul! » Je connaissais mon Branledore, on se serait engueulés devant tout le monde et peut-être même battus. Finalement ce fut lui qui gagna la soucoupe. Il s’imposa. Triomphant, il demeura seul, comme il le désirait, pour recueillir l’énorme hommage. Vaincus, il ne nous restait plus qu’à nous ruer, nous, vers les coulisses, ce que nous fîmes et là nous fûmes heureusement refêtés. Consolation. Cependant notre actrice-inspiratrice n’était point seule dans sa loge. À ses côtés se tenait le poète, son poète, notre poète. Il aimait aussi comme elle, les jeunes soldats, bien gentiment. Ils me le firent comprendre artistement. Une affaire. On me le répéta, mais je n’en tins aucun compte de leurs gentilles indications. Tant pis pour moi, parce que les choses auraient pu très bien s’arranger. Ils avaient beaucoup d’influence. Je pris congé brusquement, et sottement vexé. J’étais jeune.
Récapitulons: les aviateurs m’avaient ravi Lola, les Argentins pris Musyne et cet harmonieux inverti, enfin, venait de me souffler ma superbe comédienne. Désemparé, je quittai la Comédie pendant qu’on éteignait les derniers flambeaux des couloirs et rejoignis seul, par la nuit, sans tramway, notre hôpital, souricière au fond des boues tenaces et des banlieues insoumises.
Sans chiqué, je dois bien convenir que ma tête n’a jamais été très solide. Mais pour un oui, pour un non, à présent, des étourdissements me prenaient, à en passer sous les voitures. Je titubais dans la guerre. En fait d’argent de poche, je ne pouvais compter pendant mon séjour à l’hôpital, que sur les quelques francs donnés par ma mère chaque semaine bien péniblement. Aussi, me mis-je dès que cela me fut possible à la recherche de petits suppléments, par-ci par-là, où je pouvais en escompter. L’un de mes anciens patrons, d’abord, me sembla propice à cet égard et reçut ma visite aussitôt.
Il me souvenait bien opportunément d’avoir besogné quelques temps obscurs chez ce Roger Puta, le bijoutier de la Madeleine, en qualité d’employé supplémentaire, un peu avant la déclaration de la guerre. Mon ouvrage chez ce dégueulasse bijoutier consistait en « extras », à nettoyer son argenterie du magasin, nombreuse, variée, et pendant les fêtes à cadeaux, à cause des tripotages continuels, d’entretien difficile.
Dès la fermeture de la Faculté, où je poursuivais de rigoureuses et interminables études (à cause des examens que je ratais), je rejoignais au galop l’arrière-boutique de M. Puta et m’escrimais pendant deux ou trois heures sur ses chocolatières, « au blanc d’Espagne » jusqu’au moment du dîner.
Pour prix de mon travail j’étais nourri, abondamment d’ailleurs, à la cuisine. Mon boulot consistait encore, d’autre part, avant l’heure des cours, à faire promener et pisser les chiens de garde du magasin.
Le tout ensemble pour 40 francs par mois. La bijouterie Puta scintillait de mille diamants à l’angle de la rue Vignon, et chacun de ces diamants coûtait autant que plusieurs décades de mon salaire. Ils y scintillent d’ailleurs toujours ces joyaux. Versé dans l’auxiliaire à la mobilisation, ce patron Puta se mit à servir particulièrement un Ministre, dont il conduisait de temps à autre l’automobile. Mais d’autre part, et cette fois de façon tout à fait officieuse, il se rendait Puta, des plus utiles, en fournissant les bijoux du Ministère. Le haut personnel spéculait fort heureusement sur les marchés conclus et à conclure. Plus on avançait dans la guerre et plus on avait besoin de bijoux. M. Puta avait même quelquefois de la peine à faire face aux commandes tellement il en recevait.
Quand il était surmené, M. Puta arrivait à prendre un petit air d’intelligence, à cause de la fatigue qui le tourmentait, et uniquement dans ces moments-là. Mais reposé, son visage, malgré la finesse incontestable de ses traits, formait une harmonie de placidité sotte dont il est difficile de ne pas garder pour toujours un souvenir désespérant.
Sa femme Mme Puta, ne faisait qu’un avec la caisse de la maison, qu’elle ne quittait pour ainsi dire jamais. On l’avait élevée pour qu’elle devienne la femme d’un bijoutier. Ambition de parents. Elle connaissait son devoir, tout son devoir. Le ménage était heureux en même temps que la caisse était prospère. Ce n’est point qu’elle fût laide, Mme Puta, non, elle aurait même pu être assez jolie, comme tant d’autres, seulement elle était si prudente, si méfiante qu’elle s’arrêtait au bord de la beauté, comme au bord de la vie, avec ses cheveux un peu trop peignés, son sourire un peu trop facile et soudain, des gestes un peu trop rapides ou un peu trop furtifs. On s’agaçait à démêler ce qu’il y avait de trop calculé dans cet être et les raisons de la gêne qu’on éprouvait en dépit de tout, à son approche. Cette répulsion instinctive qu’inspirent les commerçants à ceux qui les approchent et qui savent, est une des très rares consolations qu’éprouvent d’être aussi miteux qu’ils le sont ceux qui ne vendent tien à personne.
Les soucis étriqués du commerce la possédaient donc tout entière Mme Puta, tout comme Mme Herote, mais dans un autre genre et comme Dieu possède ses religieuses, corps et âme.
De temps en temps, cependant, elle éprouvait, notre patronne, comme un petit souci de circonstance. Ainsi lui arrivait-il de se laisser aller à penser aux parents de la guerre. « Quel malheur cette guerre tout de même pour les gens qui ont de grands enfants!
– Réfléchis donc avant de parler! la reprenait aussitôt son mari, que ces sensibleries trouvaient, lui, prêt et résolu. Ne faut-il pas que la France soit défendue? »
Ainsi bons cœurs. mais bons patriotes par-dessus tout, stoïques en somme, ils s’endormaient chaque soir de la guerre au-dessus des millions de leur boutique, fortune française.
Dans les bordels qu’il fréquentait de temps en temps, M. Puta se montrait exigeant et désireux de n’être point pris pour un prodigue. « Je ne suis pas un Anglais moi, mignonne, prévenait-il dès l’abord. Je connais le travail! Je suis un petit soldat français pas pressé! » Telle était sa déclaration préambulaire. Les femmes l’estimaient beaucoup pour cette façon sage de prendre son plaisir. Jouisseur mais pas dupe, un homme. Il profitait de ce qu’il connaissait son monde pour effectuer quelques transactions de bijoux avec la sous-maîtresse, qui elle ne croyait pas aux placements en Bourse. M. Puta progressait de façon surprenante au point de vue militaire, de réformes temporaires en sursis définitifs. Bientôt il fut tout à fait libéré après on ne sait combien de visites médicales opportunes. Il comptait pour l’une des plus hautes joies de son existence la contemplation et si possible la palpation de beaux mollets. C’était au moins un plaisir par lequel il dépassait sa femme, elle uniquement vouée au commerce. À qualités égales, on trouve toujours, semble-t-il, un peu plus d’inquiétude chez l’homme que chez la femme, si borné, si croupissant qu’il puisse être. C’était un petit début d’artiste en somme ce Puta. Beaucoup d’hommes, en fait d’art, s’en tiennent toujours comme lui à la manie des beaux mollets. Mme Puta était bien heureuse de ne pas avoir d’enfants. Elle manifestait si souvent sa satisfaction d’être stérile que son mari à son tour, finit par communiquer leur contentement à la sous‐maîtresse. « Il faut cependant bien que les enfants de quelqu’un y aillent, répondait celle-ci à son tour, puisque c’est un devoir! » C’est vrai que la guerre comportait des devoirs.
Le Ministre que servait Puta en automobile n’avait pas non plus d’enfants, les Ministres n’ont pas d’enfants.
Un autre employé accessoire travaillait en même temps que moi aux petites besognes du magasin vers 1913: c’était Jean Voireuse, un peu « figurant » pendant la soirée dans les petits théâtres et l’après‐midi livreur chez Puta. Il se contentait lui aussi de très minimes appointements. Mais il se débrouillait grâce au métro. Il allait presque aussi vite à pied qu’en métro, pour faire ses courses. Alors il mettait le prix du billet dans sa poche. Tout rabiot. Il sentait un peu des pieds, c’est vrai, et même beaucoup, mais il le savait et me demandait de l’avertir quand il n’y avait pas de clients au magasin pour qu’il puisse y pénétrer sans dommage et faire ses comptes en douce avec Mme Puta. Une fois l’argent encaissé, on le renvoyait instantanément me rejoindre dans l’arrière-boutique. Ses pieds lui servirent encore beaucoup pendant la guerre. Il passait pour l’agent de liaison le plus rapide de son régiment. En convalescence il vint me voir au fort de Bicêtre et c’est même à l’occasion de cette visite que nous décidâmes d’aller ensemble taper notre ancien patron. Qui fut dit, fut fait. Au moment où nous arrivions boulevard de la Madeleine, on finissait l’étalage…
« Tiens! Ah! vous voilà vous autres! s’étonna un peu de nous voir M. Puta. Je suis bien content quand même! Entrez! Vous, Voireuse, vous avez bonne mine! Ça va bien! Mais vous, Bardamu, vous avez l’air malade, mon garçon! Enfin! vous êtes jeune! Ça reviendra! Vous en avez de la veine, malgré tout, vous autres! on peut dire ce que l’on voudra, vous vivez des heures magnifiques, hein? là‐haut? Et à l’air! C’est de l’Histoire ça mes amis, ou je m’y connais pas! Et quelle Histoire! »
On ne répondait rien à M. Puta, on le laissait dire tout ce qu’il voulait avant de le taper… Alors, il continuait:
« Ah! c’est dur, j’en conviens, les tranchées!.. C’est vrai! Mais c’est joliment dur ici aussi, vous savez!.. Vous avez été blessés, hein vous autres? Moi, je suis éreinté! J’en ai fait du service de nuit en ville depuis deux ans! Vous vous rendez compte? Pensez donc! Absolument éreinté! Crevé! Ah! les rues de Paris pendant la nuit! Sans lumière, mes petits amis… Y conduire une auto et souvent avec le Ministre dedans! Et en vitesse encore! Vous pouvez pas vous imaginer!.. C’est à se tuer dix fois par nuit!..
– Oui, ponctua Mme Puta, et quelquefois il conduit la femme du Ministre aussi…
– Ah oui! et c’est pas fini…
– C’est terrible! reprîmes-nous ensemble.
– Et les chiens? demanda Voireuse pour être poli. Qu’en a-t-on fait? Va-t-on encore les promener aux Tuileries?
– Je les ai fait abattre! Ils me faisaient du tort! Ça ne faisait pas bien au magasin!.. Des bergers allemands!
– C’est malheureux! regretta sa femme. Mais les nouveaux chiens qu’on a maintenant sont bien gentils, c’est des écossais… Ils sentent un peu… Tandis que nos bergers allemands, vous vous souvenez Voireuse?.. Ils ne sentaient jamais pour ainsi dire. On pouvait les garder dans le magasin enfermés, même après la pluie…
– Ah oui! ajouta M. Puta. C’est pas comme ce sacré Voireuse, avec ses pieds! Est-ce qu’ils sentent toujours, vos pieds, Jean? Sacré Voireuse va!
– Je crois encore un peu », qu’il a répondu Voireuse.
À ce moment des clients entrèrent.
« Je ne vous retiens plus, mes amis, nous fit M. Puta soucieux d’éliminer Jean au plus tôt du magasin. Et bonne santé surtout! Je ne vous demande pas d’où vous venez! Eh non! Défense Nationale avant tout, c’est mon avis! »
À ces mots de Défense Nationale, il se fit tout à fait sérieux, Puta, comme lorsqu’il rendait la monnaie… Ainsi on nous congédiait.
Mme Puta nous remit vingt francs à chacun en partant. Le magasin astiqué et luisant comme un yacht, on n’osait plus le retraverser à cause de nos chaussures qui sur le fin tapis paraissaient monstrueuses.
« Ah! regarde-les donc, Roger, tous les deux! Comme ils sont drôles!.. Ils n’ont plus l’habitude! On dirait qu’ils ont marché dans quelque chose! s’exclamait Mme Puta.
– Ça leur reviendra! » fit M. Puta, cordial et bonhomme, et bien content d’être débarrassé aussi promptement à si peu de frais.
Une fois dans la rue, nous réfléchîmes qu’on irait pas très loin avec nos vingt francs chacun, mais Voireuse lui, avait une idée supplémentaire.
« Viens, qu’il me dit, chez la mère d’un copain qui est mort pendant qu’on était dans la Meuse, j’y vais moi tous les huit jours, chez ses parents, pour leur raconter comment qu’il est mort leur fieu… C’est des gens riches… Elle me donne dans les cent francs à chaque fois, sa mère… Ça leur fait plaisir qu’ils disent… Alors tu comprends…
– Qu’est-ce que j’irai y faire moi, chez eux? Qu’est-ce que je dirai moi à la mère?
– Eh bien tu lui diras que tu l’as vu, toi aussi… Elle te donnera cent francs à toi aussi… C’est des vrais gens riches ça! Je te dis! Et qui sont pas comme ce mufle de Puta… Y regardent pas eux…
– Je veux bien, mais elle va pas me demander des détails, t’es sûr?.. Parce que je l’ai pas connu moi, son fils hein… Je nagerais moi si elle en demandait…
– Non, non, ça fait rien, tu diras tout comme moi… Tu feras: Oui, oui… T’en fais pas! Elle a du chagrin, tu comprends, cette femme‐là, et du moment alors qu’on lui parle de son fils, elle est contente… C’est rien que ça qu’elle demande… N’importe quoi… C’est pas durillon… »
Je parvenais mal à me décider, mais j’avais bien envie des cent francs qui me paraissaient exceptionnellement faciles à obtenir et comme providentiels.
« Bon, que je me décidai à la fin… Mais alors faut que j’invente rien, hein je te préviens! Tu me promets? Je dirai comme toi, c’est tout… Comment qu’il est mort d’abord le gars?
– Il a pris un obus en pleine poire, mon vieux, et puis pas un petit, à Garance que ça s’appelait… dans la Meuse sur le bord d’une rivière… On en a pas retrouvé “ça” du gars, mon vieux! C’était plus qu’un souvenir, quoi… Et pourtant, tu sais, il était grand, et bien balancé, le gars, et fort, et sportif, mais contre un obus hein? Pas de résistance!
– C’est vrai!
– Nettoyé, je te dis qu’il a été… Sa mère, elle a encore du mal à croire ça au jour d’aujourd’hui! J’ai beau y dire et y redire… Elle veut qu’il soye seulement disparu… C’est idiot une idée comme ça… Disparu!.. C’est pas de sa faute, elle en a jamais vu, elle, d’obus, elle peut pas comprendre qu’on foute le camp dans l’air comme ça, comme un pet, et puis que ça soye fini, surtout que c’est son fils…