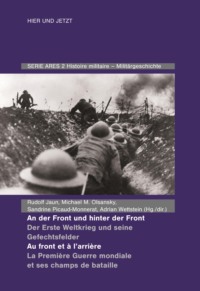Kitabı oku: «An der Front und Hinter der Front - Au front et à l'arrière», sayfa 3
À travers la contribution de Martin Schmitz, on voit qu’en Autriche, les officiers les plus haut placés surtout, à l’égal du commandement allemand, n’attribuèrent pas la responsabilité de la défaite à leur action au front, mais aux acteurs politiques et au dernier empereur d’Autriche-Hongrie. Des généraux brutaux, en particulier, tel le « Lion d’Isonzo », Svetozar Boroevic, considéraient leurs propres actions militaires comme irréprochables et ne pouvaient supporter, non seulement d’être en fin de compte les perdants, mais d’être spoliés par surcroît de la patrie pour laquelle ils avaient combattu. Avec la désagrégation de l’Etat multinational en effet, beaucoup d’anciens officiers du royaume de Hongrie se retrouvèrent sans patrie, car les nouveaux Etats constitués après la guerre refusèrent pour partie de les considérer comme leurs ressortissants ; or la république autrichienne, de son côté, n’avait pas d’emploi pour eux.
La Suisse, quant à elle, n’eut pas à se préoccuper de quelconques questions de mémoire de victoire ou de défaite, ni de soldats morts au combat victorieux ou vaincus. Le long service de protection de la neutralité, qui poussa l’armée de milice jusqu’aux limites de ses possibilités d’action, et qui fut caractérisé par de dures luttes politico-médiatiques autour des insuffisances dans le fonctionnement du service, devait aussi marquer ensuite la mémoire et les commémorations. Béatrice Ziegler montre que, immédiatement après la guerre, des monuments commémoratifs furent érigés également pour des soldats morts lors d’accidents ou suite à la grippe pendant le service actif. Ces monuments cristallisèrent la querelle entre la gauche et la droite sur le rôle du déclenchement de la grève générale au niveau national en novembre 1918, et de la façon dont elle fut surmontée. Après 1933, à la faveur de la « défense nationale spirituelle » contre le nazisme et le fascisme, ces disputes s’apaisèrent, et l’armée fut présentée, dans la littérature et les films, comme garante de l’intégrité de la Suisse et de la marche en avant commune. On fut convaincu que l’on pourrait remédier, lors de la prochaine période de service actif, aux problèmes criants que l’on avait connus durant cette guerre – problèmes sociaux des familles, et lacunes caractérisées dans la formation des troupes comme dans le fonctionnement du service. Ces récits à caractère culturel et historique eurent aussi leur part dans le fait qu’après la Seconde Guerre mondiale, la recherche scientifique en histoire se désintéressa de la Première Guerre mondiale et que cette guerre devint, dans les médias comme dans la recherche, une « guerre oubliée ». Pour revenir à la période même de la guerre, Roman Rossfeld nous permet de comprendre, par l’exemple de la production de pièces de munitions, combien la Suisse fut impliquée dans la guerre économique, en arrière des fronts ; il remet par-là à l’ordre du jour tout un pan négligé de l’histoire de la Suisse de la Première Guerre mondiale. La production de pièces de munitions, qui, tirant parti de l’expérience de l’horlogerie et de la branche industrielle des métaux non ferreux, connut une croissance fulgurante, dépendait entièrement de la livraison de matières premières de la part des puissances alliées ; celles-ci achetaient en retour 90 % des exportations suisses de pièces de munitions. La volonté d’assurer des places de travail et des perspectives de profit fit mettre de côté les considérations sur la neutralité et la morale. Fortement sous-dotée en munitions, l’armée suisse pouvait seulement espérer, en cas de menace imminente à l’encontre du pays, recevoir les nécessaires matières premières de la part de celui qui serait alors « l’ennemi de son ennemi », et pouvoir utiliser ses capacités de production pour ses propres besoins. Ces faits sont une des multiples facettes de l’histoire de la Suisse et de l’armée suisse pendant la Première Guerre mondiale, qui jusqu’à présent n’avaient presque pas été prises en compte dans la culture historique suisse.
Le colloque « Au front et à l’arrière » n’a pas seulement mis en lumière les dynamiques liées aux combats et aux ressources au cours des années de guerre, mais il a aussi intégré dans la réflexion les évolutions antérieures et postérieures à la guerre. Autant l’intensité meurtrière des armes était-elle connue avant 1914, autant les expériences de ces années de guerre ne restèrent pas inutiles pour l’évolution de la manière de faire la guerre, et pour l’élaboration des plans d’une exploitation militaire encore plus intensive du potentiel socio-économique.
Rudolf Jaun, Michael Olsansky, Adrian Wettstein
Traduit de l’allemand par Sandrine Picaud-Monnerat
Dynamik und Globalität der Kriegführung
La guerre devait être très rapide : une guerre de mouvement visant la destruction des forces de l’adversaire ; ce serait l’aboutissement d’un siècle de réflexions sur les guerres napoléoniennes, ce serait le sommet de l’art opératif européen. Mais l’échec des trois offensives initiales (française, russe, allemande) conduisit à la guerre de tranchée, version moderne de la guerre de siège. En fait, la technique militaire de 1914 pouvait nourrir une guerre de tranchée longue, elle ne permettait pas d’équiper une armée opérationnelle capable de réaliser et d’exploiter la « percée ».
En conséquence, on vit l’essai de trois stratégies alternatives : périphérique (Gallipoli-Salonique), d’attrition (Verdun et le blocus), de guerre totale (Ludendorff). Mais le plus décisif fut l’apparition de deux innovations opératives destinées à rétablir le mouvement : la méthode de pénétration tactique allemande (inaugurée à Riga et à Caporetto à l’automne 1917) et la méthode moto-mécanique (par la combinaison chars-camions-avions) des Alliés. La fusion de ces deux innovations déboucherait sur le Blitzkrieg de 1939 à 1940, tandis que s’affirmait de plus en plus tout au long du conflit un nouveau niveau, le niveau opératif, intermédiaire entre la stratégie et la tactique.
Le début de la guerre : un remake amélioré de 1870 ?
À première vue, on pourrait le penser. On se situait au début du conflit encore dans la tradition de Frédéric II, Napoléon, Moltke. Pour l’essentiel, un officier de 1870 n’aurait pas été dépaysé. Les points communs des différents plans (celui de Schlieffen, qui reposait sur le modèle oblique de Leuthen, modifié par Moltke le Jeune, qui s’inspirait, lui, de Cannes, c’està-dire de l’enveloppement par les ailes, celui de Joffre, qui reprenait le paradigme d’Austerlitz d’attaque au centre, le plan d’offensive russe en Prusse) étaient nombreux et importants. Tout le monde était d’accord pour donner la priorité à la destruction des armées ennemies par une offensive immédiate. Tout le monde était convaincu de la supériorité du mouvement, seul à même de produire des effets stratégiques décisifs.
Tous les protagonistes avaient préparé minutieusement l’organisation des trois phases successives de l’entrée en guerre : mobilisation, concentration, offensive. Tous étaient à la recherche d’une victoire décisive. Si Moltke l’Ancien, après la conclusion de l’Alliance franco-russe en 1891, avait, dans ses derniers plans, prévu une défensive initiale sur les deux fronts, il n’était plus question de se contenter d’une stratégie aussi prudente.
Mais un certain nombre d’innovations par rapport à 1870 étaient apparues dès l’avant-guerre :
1) Des armées de masse (Millionenheere) : d’où des fronts beaucoup plus étendus.
2) Les armes à tir rapide et l’artillerie lourde mobile.
3) Une mobilisation humaine, matérielle et morale déjà beaucoup plus forte en 1914 qu’en 1870.
4) Un début d’amélioration des communications (voitures automobiles d’état-major, radio) et de la reconnaissance (les avions, qui jouèrent un rôle décisif du côté français lors des batailles de Lorraine et de la Marne).
5) L’utilisation des chemins de fer en courants de rocade pendant les combats et non plus seulement de façon radiale au moment de la concentration initiale (manœuvres ferroviaires in bello, plus seulement ad bellum)1.
Et d’autre part, la leçon de 1870/71 était ambiguë : à la période de la guerre de mouvement décisive aboutissant à Sedan avait succédé la période beaucoup plus lente et complexe pour les Prussiens de la « Défense nationale », le gouvernement provisoire parvenant à lever et équiper de nouvelles armées et à prolonger la lutte. La conviction générale était que la guerre serait courte pour des raisons économiques (Norman Angell avait défendu cette thèse dans un livre fameux, La grande illusion, paru en 1910) et militaires (on prévoyait des offensives stratégiques décisives) ; mais il existait une opinion minoritaire opposée : l’économiste Jean de Bloch avait prédit que l’économie moderne permettrait la prolongation du conflit2, et Joffre déclara peu avant la guerre à Maurice Paléologue, directeur politique au Quai d’Orsay, qu’après la première phase offensive, une fois l’adversaire ramené chez lui (les Allemands repoussés au-delà du Rhin, ou les Français refoulés jusqu’au Morvan), commencerait une phase de « défense nationale », à la durée imprévisible3.
Une innovation de grande portée : l’apparition du niveau opératif
Les termes « opération » et « opératif » apparaissent dans la littérature militaire allemande dès le début du XIXe siècle. Mais ils sont encore employés de façon assez floue, et ni dans les doctrines, ni dans l’organisation, ni dans la chaîne de commandement le niveau opératif n’apparaît clairement, alors que le niveau stratégique (la conduite de la guerre) et le niveau tactique (la conduite de la bataille) sont bien identifiés.
Une exception : les Russes, qui ont à l’Ouest trois groupes d’armées, organisation qui leur permet de varianter les axes d’effort en fonction de la situation (guerre contre l’Autriche seule, contre l’Allemagne et l’Autriche, changement d’axe principal en cours d’opération, etc.). On voit clairement se dessiner les linéaments d’un concept opératif4.
En fait, ailleurs on commença la guerre avec la distinction classique entre le niveau stratégique et le niveau tactique. Mais dès le début des opérations, l’échec de la conduite très décentralisée, pour ne pas dire l’absence de conduite, par le grand état-major allemand et Moltke, des sept armées allemandes engagées à l’Ouest montra que les méthodes qui avaient réussi sous Napoléon (le commandant en chef dirige directement l’ensemble des opérations) ou sous Moltke l’Ancien (le commandant en chef donne des directives, les subordonnés les appliquent en fonction de leur jugement, conformément à l’Auftragstaktik et en vertu de la Preussische Freiheit) ne suffisaient plus. Entre le niveau tactique et le niveau stratégique, un niveau intermédiaire apparaissait, non plus en théorie mais dans la pratique, celui du théâtre, et de l’action combinée et coordonnée de l’ensemble des forces sur ce théâtre : le niveau opératif.
On eut deux contre-épreuves : la conduite très ferme de la bataille sur le front français, à la hauteur de l’ensemble du théâtre du « Nord-Est », tranchant sur le désordre et l’absence de coordination de 1870/71. « La victoire de la Marne a été une victoire du commandement », on connaît la formule5. Et la VIIIe armée allemande, celle qui se battit à l’Est et remporta avec Hindenburg et Ludendorff la victoire de Tannenberg, étant la seule sur ce théâtre, fut bien obligée de se placer au niveau opératif, le grand quartier général étant en outre incapable de lui donner la moindre impulsion6.
A partir de là, Ludendorff maintint résolument le principe opératif à l’Est. Certes, en septembre, la Direction suprême de la guerre (OHL) décida de créer à l’Est une IXe armée, dont le commandement échappait à Hindenburg-Ludendorff, l’OHL prétendant se réserver la coordination des VIIIe et IXe armées, alors que son GQG était toujours à l’Ouest. La sanction immédiate fut une série d’échecs lors de l’offensive allemande en Pologne. Finalement, Hindenburg obtint de commander les deux armées, ainsi que toutes les garnisons et régions militaires limitrophes : ce fut l’établissement d’un échelon de commandement suprême à l’Est, Oberost, qui n’eut pas son équivalent à l’Ouest. Et ce, jusqu’à ce que Hindenburg et Ludendorff remplacent Falkenhayn au grand état-major en août 1916, et mettent en place à partir de ce moment-là une coordination beaucoup plus « opérative » qu’auparavant des armées du front Ouest, d’ailleurs regroupées en « groupes d’armées ». Malgré tout, certains défauts subsistaient dans l’organisation allemande, du fait de la fiction de l’empereur commandant en chef, et de la double subordination des chefs d’état-major des différentes armées, qui relevaient à la fois de leur commandant en chef sur place et du chef de l’état-major général ; et aussi du fait que ni les Autrichiens ni les Bulgares ne furent jamais placés sous commandement unique.
Malgré tout, grâce à la forte personnalité de Ludendorff, le niveau opératif se fit jour clairement. Il permettait d’embrasser de façon coordonnée un théâtre entier, et il permettait aussi d’éloigner les ingérences éventuelles des autorités civiles : il n’était pas possible d’écarter celles-ci totalement pour les grandes options de stratégie générale (rapports avec l’Autriche-Hongrie, avec les Etats-Unis, guerre sous-marine à outrance, conditions des traités de Brest-Litovsk et de Bucarest en 1918, etc.) mais pour la conduite des opérations, le commandement occupait tout l’espace du niveau opératif. Los von Berlin !
On ne revit plus, par exemple, des initiatives comme celles du Kronprinz de Bavière, Ruprecht, qui, en prenant l’offensive trop tôt en août 1914 en Lorraine, contribua largement à l’échec du plan Moltke d’offensive sur Nancy. Mais il est vrai que la VIe armée était bavaroise, que ses arrières étaient le Palatinat, à l’époque bavarois, et que par son offensive le Kronprinz espérait bien prendre des gages pour réaliser les buts de guerre particuliers de la Bavière : rattachement du Reichsland (agrandi en Lorraine) au royaume de Bavière. L’affaire était tellement politique que, pour essayer de calmer le Kronprinz, Moltke lui envoya d’abord l’officier chef du département politique de l’état-major général, et ensuite le colonel Bauer, qui fut pendant toute la guerre l’interface entre l’état-major et les civils7.
Du côté allié, ce fut lent. Cependant, en juin 1915, Joffre regroupa les armées en trois « groupes d’armées » et expliqua à sa façon l’importance désormais du niveau opératif, intermédiaire entre celui de la stratégie et celui de la tactique, en soulignant « l’utilité qu’il y avait à entreprendre des opérations simultanées de plusieurs armées pour empêcher l’ennemi de déplacer ses réserves, et l’obliger d’accepter la bataille avec des moyens limités, là où nous voulions la lui imposer8. »
Mais on alla plus loin. En mars 1918, Foch, que l’on a parfois qualifié de premier SACEUR de l’Histoire, réalisa une unité de commandement des Alliés que Berlin n’obtint jamais pour les Puissances centrales9. Il se plaça très nettement au niveau opératif.
Ce fut donc le point de départ de l’« art opératif », art de commander l’ensemble des forces sur un théâtre, qui fut développé bien sûr en Allemagne mais également repris par les Soviétiques10.
L’échec de la guerre de mouvement : phase I, la guerre de tranchée
L’échec des trois offensives (française, russe, allemande) conduisit à la « course à la mer », à l’établissement d’un front continu (une absolue nouveauté, négation en soi de toute réelle stratégie) puis à la guerre de tranchée, version moderne de la guerre de siège.
Le problème était double : d’abord la supériorité défensive de troupes enterrées, munies d’armes à tir rapide (on l’avait déjà observée en 1904 en Mandchourie et en 1912/13 dans les Balkans). Mais le problème de la « percée » d’un front fixe pour l’exploiter ensuite vers les arrières profonds de l’adversaire n’était pas non plus résolu. Ou bien on commençait par une grande préparation d’artillerie pour affaiblir les défenses, et l’ennemi, averti, mettait en place des tirs de contrebatterie : on en eut l’exemple en Champagne en 1915. Lors de l’offensive de la Somme en 1916, on pensait refaire la préparation d’artillerie, cette fois-ci avec beaucoup plus de moyens. Mais les Allemands eurent quand même le temps, et de contrebattre, et de rameuter des réserves. En outre, du fait du long bombardement, le terrain était bouleversé, ce qui gênait considérablement la progression, les Allemands démontrant d’autre part que l’on pouvait très bien se défendre dans des trous d’obus. En conséquence, en 1917 (offensive Nivelle), on se contenta d’une préparation plus courte, pour réaliser la surprise et ne pas trop bouleverser le terrain. Mais, cette fois, la préparation fut insuffisante ; après des succès initiaux les pertes devinrent vite considérables, et les Allemands eurent quand même le temps de colmater les brèches11.
Stratégies alternatives pour sortir de l’impasse
Il fallait recourir de toute évidence à des stratégies alternatives. Certaines n’étaient pas nouvelles : le blocus et la stratégie périphérique existaient depuis toujours, et les Britanniques les avaient abondamment utilisés contre Napoléon. En fait, on va le voir, il n’y eut pas de grande innovation au niveau stratégique, sauf la « guerre totale ». D’autre part, la grande stratégie diplomatico-militaire, celle des sondages, des négociations au cours du conflit, afin de profiter d’un succès sur le terrain pour amener l’adversaire à la table de négociation, dans la grande tradition européenne, et qui avait été utilisée même lors des guerres de la Révolution et de l’Empire, resta à peu près absente. La seule tentative, d’ailleurs conduite de façon fort maladroite, pour coordonner opérations militaires et démarches de paix, fut celle de Berlin et Vienne, par leur note du 12 décembre 1916, juste après l’entrée de leurs troupes à Bucarest le 612. Français et Britanniques se contentèrent de sondages de paix secrets, fort peu en phase avec leurs plans d’opérations13.
1) Stratégie périphérique
Une stratégie périphérique paraissait s’imposer aux Alliés avec évidence : porter la guerre dans les Balkans et sur les Détroits turcs. En effet, il fallait d’abord essayer d’empêcher la Bulgarie de se joindre aux Puissances centrales, car, outre son importance militaire propre, son territoire permettrait d’assurer la continuité des communications entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Turquie. Son entrée en guerre aux côtés des Puissances centrales en octobre 1915 rendait évidemment cet objectif vain.
Mais une stratégie vers ces régions avait deux autres objectifs possibles : relier la Russie aux Alliés occidentaux plus commodément que par Mourmansk, et atteindre le « ventre mou » (l’expression est de Churchill) des Empires centraux par la vallée du Vardar.
Cette stratégie fut tentée, mais ne fut poussée à fond que tout à la fin de la guerre. En mars 1915, les Britanniques et les Français tentèrent de forcer les Dardanelles par voie maritime, mais ce fut un échec. Ils débarquèrent le mois suivant à Gallipoli, mais ce fut aussi un échec. En octobre 1915, ils débarquèrent à Salonique, mais jusqu’en 1918 ce fut à peu près inutile, sauf en tant qu’abcès de fixation pour les forces bulgares et en tant qu’arme politique, pour forcer la Grèce à se tourner vers les Alliés et maintenir la Serbie dans la guerre.
En effet le Front d’Orient ne fut pas poussé à fond : les Russes n’y participèrent pas, estimant que les Alliés feraient le travail pour eux, et ils se contentèrent de se faire garantir par eux, dès mars 1915, la possession de Constantinople et des Détroits14. Les Britanniques pensaient surtout à l’Irak et au Moyen-Orient, où ils massèrent jusqu’à un million de soldats. Joffre estimait que cela le détournait du front essentiel, celui du Nord-Est.
En fait, le pouvoir politique (du moins Churchill et Briand, les plus imaginatifs des dirigeants alliés) était plus intéressé que les militaires : ceux-ci restaient fidèles au principe de la concentration des forces, à l’objectif de battre d’abord l’ennemi principal. Peut-être avions-nous affaire à un excès de « clausewitzisme » mal compris ?
De plus, le Front d’Orient connut des problèmes d’ordre opératif : Sarrail eut du mal à établir un commandement unique ou même simplement efficace. Ce ne fut qu’après le règlement de ce problème par ses successeurs Guillaumat et Franchet d’Espèrey que le front d’Orient devint un vrai théâtre au sens opératif du terme, et qu’il put participer de façon décisive aux offensives alliées finales de 191815. Mais ce fut alors très réussi : ce fut l’Armée de Salonique qui provoqua la chute de la Bulgarie et de l’Autriche-Hongrie. En fait, pour les Allemands, la décision de demander l’armistice vint de là autant que du « Jour noir » (8 août 1918)16.
2) Stratégies d’attrition, 1915/1916
Plus que par la stratégie périphérique, les années 1915/16 furent marquées par le développement de diverses stratégies d’attrition, visant non plus l’anéantissement des forces adverses (Vernichtungskrieg) mais leur affaiblissement, pour permettre l’ouverture de négociations dans de bonnes conditions (Ermattungsstrategie), selon les catégories développées dès cette époque par Hans Delbrück, historien mais aussi stratégiste notoire17.
La première de ces stratégies fut celle du blocus de l’Allemagne par les Alliés. En fait, ce fut lent, elle ne se mit vraiment en place qu’à partir de 1915, car il fallait établir aussi un contrôle commercial des pays neutres voisins de l’Allemagne (par exemple la Société Suisse de Surveillance), pour éviter réexportations et contournements. Certes, les effets sur la population et l’économie allemandes furent considérables, mais lents et non décisifs18.
Notons également la stratégie de Falkenhayn, successeur de Moltke à la tête du grand état-major impérial : il se maintint sur la défensive à l’Est, mais prit l’offensive à Verdun ; la percée ayant échoué, il poursuivit cependant l’opération, pour faire « saigner » l’armée française (car elle ne pouvait pas reculer, non seulement pour des raisons de prestige, comme on dit toujours, mais parce que, du fait de la topographie du Bassin parisien, si elle lâchait Verdun et la Côte de Meuse, elle aurait du mal à se rétablir et à reconstituer un front avant le Morvan !). En fait, ce fut un échec, car l’armée allemande « saigna » tout autant19.
De même, la Somme à partir de juillet 1916 relève de la stratégie d’attrition, même si les Alliés espéraient la « percée » (mais, malgré tout, l’industrie allemande dut avouer qu’elle avait atteint là ses limites : l’attrition fonctionnait tout de même dans une certaine mesure)20.
Sur le plan de la stratégie générale, on constate que l’industrie moderne peut nourrir sans limite une guerre d’attrition statique, c’est-à-dire le soutien des troupes, la production des armements et des munitions nécessaires, y compris les gaz, l’équipement des fronts (abris, voies de communication de toute nature, etc.) et qu’elle peut (grâce aux Ersätze) faire échec au blocus pendant longtemps. Au fond, la grande stratégie en 1916/17 reposait sur l’intégration de l’économie (y compris le blocus de l’adversaire) et de l’industrie à la stratégie. Il est important de le noter, parce que c’est la stratégie que Français et Britanniques prétendirent opposer à Hitler en 1939/4021.
3) Stratégie de guerre totale : 1917/18
Mais en 1917, à la suite de la bataille de la Somme, la stratégie d’attrition connut un renforcement tel que, la quantité devenant qualité, l’on passa à quelque chose de nouveau : la stratégie de guerre totale. En effet, en août 1916, Hindenburg et Ludendorff remplacèrent Falkenhayn, à cause de l’échec de celui-ci sur la Somme. On vit alors une nouvelle conduite de la guerre, une stratégie générale qui se situait théoriquement au-dessus du niveau du grand état-major, mais qui fut imposée en fait par les chefs militaires aux dirigeants civils : ce fut la « guerre totale » (titre d’un livre de Ludendorff de 1935, mais utilisé déjà par Léon Daudet en 1916). Les instruments en seraient :
– La mobilisation industrielle, c’est-à-dire la mise totale de l’économie allemande sur le pied de guerre (« Programme Hindenburg »)22.
– La mobilisation politique (contrôle du pays par les gouverneurs militaires et création en 1917 de la Vaterlandspartei, organisation politique ayant pour objet de soutenir l’état-major)23.
– La mobilisation de la société (loi sur le « service auxiliaire » – en fait, il s’agissait de la mise en place du travail obligatoire pour les non mobilisés – et entente avec les syndicats pour sa mise en œuvre)24.
– La mainmise politique sur le Reich (l’état-major provoque la chute de Bethmann Hollweg en juillet 1917 car il est considéré comme trop modéré)25.
– La guerre sous-marine à outrance.
– Pour la première fois, la guerre fut faite systématiquement aux civils, par des bombardements divers (navires de guerre bombardant les villes côtières, zeppelins, avions)26.
– Pour la première fois, une véritable guerre politique, dans le sens moderne du terme, fut menée à fond par le Reich (soutien aux minorités de l’Empire russe et à Lénine)27.
Les Alliés s’engagèrent beaucoup moins nettement sur cette voie, mais ils abandonnèrent le libéralisme, encore si fort en Grande-Bretagne en 1916. Et ils préparèrent une guerre économique totale, y compris avec sa prolongation après la guerre (contrôle du ravitaillement de l’Allemagne en matières premières, discrimination permanente contre le commerce allemand …)28.
Cependant la stratégie de Berlin échoua ; elle ne fut d’ailleurs pas menée de façon cohérente : la défaite de la Russie ne fut pas vraiment exploitée pour ramener des troupes à l’Ouest, et la guerre sous-marine à outrance provoqua l’entrée en guerre des Etats-Unis.