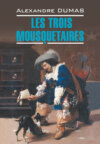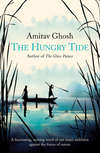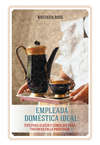Kitabı oku: «La prononciation du français langue étrangère», sayfa 6
L’intonation en français L3 chez des apprenant.e.s bilingues allemand-turc : production et perception
Christoph Gabriel, Jonas Grünke (Mayence)
1 Introduction
« Phonology is the Cinderella of bilingual studies » – c’est ainsi qu’Ian Watson (1991 : 25) a caractérisé à juste titre la phonologie dans le contexte des recherches sur le bilinguisme. Alors qu’elle végétait, à l’époque, dans l’ombre d’autres disciplines linguistiques, l’étude des capacités de prononciation de locuteurs qui parlent régulièrement plusieurs langues constitue aujourd’hui un domaine de recherche bien établi (cf. Archibald 1998 ; Bohn/Munro 2007 ; Trouvain/Gut 2008 ; Mennen/De Leeuw 2014 ; Gabriel/Kireva 2014 ; Avanzi et al. 2015). Dès le tournant du millénaire, la recherche a accordé de plus en plus son attention à la parole non native, et ce, en prenant en considération toute la gamme de potentielles influences translinguistiques et en établissant la distinction entre l’apprentissage phonologique d’une seconde langue (L2) et celui d’une troisième (L3 ; cf. Marx/Mehlhorn 2010). En d’autres mots : on a commencé à distinguer entre l’apprentissage « classique » d’une langue étrangère, où les effets de transfert qu’on retrouve dans la parole non native sont dus à une seule source, c’est-à-dire à la L1 des apprenant.e.s, et les contextes dans lesquels une langue donnée est apprise (ou acquise) comme une langue étrangère supplémentaire après l’apprentissage d’une première langue étrangère. Jusqu’à nos jours, la plupart des études conduites dans le domaine de la phonologie L3 se concentrent sur l’apprentissage consécutif de différentes langues étrangères (cf. Cabrelli Amaro et al. 2015 ; Cabrelli Amaro/Wrembel 2016). C’est ainsi que Llama et al. (2010) ont analysé la production d’occlusives sourdes initiales en espagnol comme L3 chez des apprenant.e.s anglophones qui avaient appris auparavant le français (L2) ainsi que la condition inverse avec l’espagnol étant la L2 et le français la L3. Les auteur.e.s ont trouvé une influence de la L2 sur la L3, ce qui plaide en faveur du statut prépondérant de la L2 (angl. L2 status factor ; cf. Bardel/Falk 2007). Ce point de vue a été étayé par Wrembel (2010) qui a trouvé une influence de l’allemand (L2) sur l’anglais (L3) chez des apprenant.e.s polonais.es. Dans un travail ultérieur, cependant, la même auteure (Wrembel 2014) a étudié le délai d’établissement du voisement (angl. voice onset time (VOT)) chez des jeunes polonais.es apprenant l’anglais comme L2 et l’allemand ou le français comme L3 et a trouvé des valeurs intermédiaires entre celles de la L1 et de la L2 dans les deux langues étrangères (soit l’anglais et l’allemand, soit l’anglais et le français). Notons que de tels résultats remettent en cause le statut prédominant de la L2.
Les scénarios d’acquisition autres que l’apprentissage consécutif de plusieurs langues étrangères ont longtemps été ignorés dans la recherche phonologique : les premières études empiriques qui portent sur l’acquisition d’une L3 dans des contextes plurilingues et qui incluent expressément les langues de migration ou d’origine (angl. heritage languages, HL ; cf. Valdés 2000 ; Montrul 2018) n’ont été publiées qu’à partir du milieu des années 2010.
La présente contribution vise à compléter le tableau en abordant la question de savoir si les apprenant.e.s germano-turc/que.s du FLE (L3) sont avantagé.e.s par rapport aux monolingues allemand.e.s, non seulement au niveau segmental, mais aussi au niveau prosodique. Comme nous le soulignerons, le turc est prosodiquement plus proche du français que de l’allemand, ce qui pourrait se traduire par un avantage pour les apprenant.e.s qui parlent le turc comme langue d’origine en même temps que l’allemand. Outre cette raison purement linguistique, on ne saurait trop insister sur la pertinence sociétale de l’étude de l’apprentissage du français langue étrangère (FLE) chez les bilingues germano-turc/que.s : le recensement de 2018 a documenté plus de 2,7 millions d’Allemand.e.s d’origine turque (3,4 % de la population totale) et, dans la tranche d’âge concernée de 10 à 20 ans, 440 000 personnes ont déclaré avoir un passé migratoire respectif (5,8 % de cette partie de la population ; cf. Statistisches Bundesamt 2018 : 63). Les compétences linguistiques de la population germano-turque ne sont pas précisément documentées, mais selon le dernier recensement, le turc est la langue prédominante dans 1,4 % des ménages allemands (cf. Statistisches Bundesamt 2018 : 485).
Notre contribution s’organise comme suit. Dans la section 2, nous résumerons les résultats d’études récentes sur l’apprentissage de la prononciation du FLE dans le contexte plurilingue en Allemagne. Ensuite, la section 3 sera consacrée à la description des langues de notre échantillon, c’est-à-dire l’allemand, le français et le turc, d’un point de vue intonatif. La section 4 exposera notre étude empirique portant sur des données de productions et de perception. Après en avoir présenté la méthodologie (4.1), nous exposerons les résultats obtenus (4.2). Dans un premier temps, nous présenterons les résultats de l’analyse intonative d’un petit corpus de parole lue (4.2.1). Dans un deuxième temps, nous aborderons la perception des mêmes données au moyen d’une tâche d’évaluation du degré d’accent étranger mise en œuvre avec (i) des juges natifs issus de divers pays francophones et (ii) de (futur.e.s) professeur.e.s du FLE allemand.e.s. La section 5, enfin, propose une brève discussion des résultats et indique quelques directions pour la recherche future.
2 L’apprentissage de la prononciation française par des apprenant.e.s plurilingues
Dans leurs études sur les propriétés temporelles de l’anglais, du français et de l’espagnol comme langues étrangères chez des apprenant.e.s bilingues allemand-chinois et allemand-turc, Gabriel/Rusca-Ruths (2015) et Gabriel et al. (2015) ont constaté de légers indices d’un avantage bilingue. Leurs mesures du rythme prosodique ont révélé que les apprenant.e.s plurilingues qui font preuve d’un degré élevé de conscience phonologique et interlinguistique et qui affichent une attitude positive à l’égard de leur langue d’origine et de la langue étrangère respective ont obtenu des résultats plus proches de la cible que leurs pairs monolingues. Ceci, à son tour, suggère que certains facteurs extralinguistiques peuvent faciliter le transfert positif de la langue d’origine vers la L3. Enfin, les mesures de VOT faites par Gabriel et al. (2016) suggèrent qu’en plus de la conscience phonologique et des attitudes des apprenant.e.s, l’enseignement de la prononciation en classe de FLE joue un rôle important : ni les apprenant.e.s bilingues (allemand.e.s-chinois.es) ni les apprenant.e.s allemand.e.s monolingues n’atteignent des valeurs cibles pour les occlusives en FLE, tandis que la majorité des apprenant.e.s monolingues chinois.es (enregistré.e.s à Pékin) à qui les enseignants chinois ont explicitement signalé d’éviter l’aspiration des occlusives /p t k/ en français, produisent des valeurs de VOT similaires à celles du groupe de contrôle monolingue français. La production d’occlusives en termes de VOT a également été abordée par Llama/López-Morelo (2016). Les auteures ont analysé des données recueillies auprès de locuteurs bilingues espagnol-anglais qui avaient participé à un programme d’immersion en français au Canada anglophone et ont montré que les valeurs de VOT produites par les bilingues en français L3 étaient influencées par l’anglais, bien que leur langue d’origine, l’espagnol, ne montre pas cette influence. Ce résultat suggère que la langue environnante (l’anglais), qui est aussi la langue de l’enseignement scolaire, surpasse la langue d’origine (l’espagnol) comme base de transfert positif vers la langue étrangère (le français). Cette opinion est appuyée par les travaux de Gabriel et al. (2018a) et de Dittmers et al. (2018) qui étudient la production des occlusives sourdes et sonores anglais, français et russe comme langues étrangères produites par de jeunes bilingues turc-allemand et russe-allemand : alors que pour /p t k/, les multilingues produisent en français L3 des valeurs de VOT plus proches de la langue cible que les apprenant.e.s monolingues allemand.e.s, ils/elles ne réussissent pas à pré-voiser /b d ɡ/. Pourtant, leurs langues d’origine respectives (le turc et le russe) ont conservé ce trait qui aurait donc pu être positivement transféré vers le français. Un effet positif du turc sur l’apprentissage de l’anglais et du français a également été constaté par Ösazlan/Gabriel (2019). Les auteur.e.s ont montré que les apprenant.e.s bilingues allemand-turc réussissaient mieux à éviter le transfert négatif du dévoisement final (all. Auslautverhärtung) vers les langues étrangères que les apprenant.e.s allemand.e.s monolingues. Ce processus, qui neutralise le contraste de voisement entre occlusives et fricatives sourdes et sonores en position de coda syllabique (p. ex., Kind [kɪnt] ‘enfant’ vs Kinder [ˈkɪn.dɐ] ‘enfants’), mène couramment à des erreurs de segmentation dans l’anglais et le français des apprenant.e.s monolingues telles que angl. bad ‘mauvais’, prononcé avec un /d/ final dévoisé (donnant *[bæt]) ou fr. gaz, prononcé avec une réalisation sonore du /z/ final (*[ɡas]). L’étude de Gabriel et al. (2021), finalement, a mis en évidence que les apprenant.e.s bilingues allemand-turc arrivent également à éviter, dans la plupart des cas, le transfert négatif d’une autre règle phonologique de l’allemand vers le FLE : lorsque les monolingues tendent à vocaliser le /ʁ/ français en position de coda syllabique selon le modèle de l’allemand (ce qui donne des productions comme [kʏlˈtyɐ̯] (culture), calquées sur l’allemand Kultur [kʊlˈtuɐ̯]), les plurilingues semblent se pencher plutôt sur le turc (où le r maintient son caractère consonantique en position finale : kültür [kyltyɾ̥]) et, par conséquent, tendent à prononcer correctement culture [kyltyʁ].1 Reste à souligner, pour finir, que la présence ou l’absence du transfert négatif de la vocalisation du r a un impact sur le rythme prosodique, c’est-à-dire sur la distribution des intervalles vocaliques et consonantiques (cf. Abercrombie 1967 ; Pike 1945 ; Auer/Uhmann 1988 ; Ramus et al. 1999 ; White/Mattys 2007 ; Kinoshita/Sheppard 2011). C’est ainsi que dans l’étude de Gabriel et al. (2021) les données produites par les apprenant.e.s plurilingues sont caractérisées par une variabilité vocalique moins élevée (et plus conforme à celle du français natif) que celles des apprenant.e.s monolingues. Cela signifie que le rythme des données du premier groupe est également plus conforme à celui de la langue cible.
En résumé, les recherches sur l’apprentissage de la prononciation du FLE dans le contexte plurilingue ont mis en évidence certains signes d’un avantage bilingue au niveau de la phonologie segmentale. De tels résultats vont au-delà non seulement d’un « avantage bilingue » général souvent mentionné dans la littérature2, mais aussi au-delà des propriétés générales de la parole non native telles qu’un débit de parole plus lent (cf. Gut et al. 2008 : 10–11), un registre tonal réduit (cf. Jenner 1976 ; Mennen 2008 : 55) et une utilisation moins variable de la fréquence fondamentale (cf. Zimmerer et al. 2014).
3 Les systèmes intonatifs du français, du turc et de l’allemand : similarités et différences
En ce qui concerne l’intonation, c’est-à-dire l’utilisation systématique de la fréquence fondamentale (F0) mesurée en hertz (Hz), le français et le turc sont assez semblables, tandis que l’allemand diffère considérablement de ces deux langues. En tant que « langue de mots » typique (cf. Caro Reina/Szczepaniak 2014), l’allemand présente un système intonatif essentiellement basé sur la position des syllabes métriquement fortes du mot lexical (Jun 2014). Ainsi les contours de F0 allemands sont-ils déterminés de manière décisive par les deux caractéristiques suivantes :
1 Les syllabes toniques (spécifiées comme telles au niveau lexical) sont marquées par des mouvements tonals locaux (accents de hauteur ou tonals ; angl. pitch accents). Ceci permet des paires minimales comme Tenor ‘ténor’ vs Tenor ‘teneur (d’un texte)’.
2 Différents signifiés pragmatiques (comme, par exemple, l’évidence ou l’étonnement) et la modalité de la phrase sont exprimés par des mouvements tonals associées aux limites des phrases prosodiques (tons de frontière ; angl. boundary tones).1
Contrairement à cela, l’accentuation lexicale des mots manque en français, ce qui a mené Rossi (1980) à le qualifier de « langue sans accent ». Au lieu de cela, le français présente un système intonatif basé sur le phrasé prosodique qui dépend essentiellement de la répartition de la parole en unités plus petites. Le fait que l’intonation française s’appuie entièrement sur la distribution de frontières prosodiques dans la chaîne parlée a également été reflété dans la terminologie scientifique : c’est ainsi que le français s’est vu attribuer, dans la terminologie de Jun (2014), la dénomination d’une « langue basée sur les confins » (angl. edge-based language). Les contours intonatifs du français sont réalisés par des excursions de F0 qui se produisent (obligatoirement) à la fin et (facultativement) au début des groupes rythmiques, appelés « phrases accentuelles » (PA, angl. accent phrase, cf. Jun/Fougeron 2000 ; Delais-Roussarie et al. 2015) ou « syntagmes accentuels », d’après la terminologie proposée par Kaminskaïa (2009). Le schéma (ou : gabarit) sous-jacent et ses possibles réalisations de surface sont illustrés par les syntagmes présentés au Tableau 1 : la montée finale obligatoire, symbolisée « LH* » (angl. low tone and high pitch accent), est ancrée à la frontière droite de la phrase accentuelle et réalisée sur la dernière syllabe de celle-ci. Plus la phrase accentuelle est longue, plus il est probable que s’y produit, en sus du contour F0 ascendant final, une montée initiale (facultative), symbolisée « aLHi » (angl. (left-)aligned low tone plus initial high tone).
 Tab. 1 :
Tab. 1 :
Réalisations de surface du gabarit sous-jacent /aLHiLH*/ dans la phrase accentuelle française d’après Delais-Roussarie et al. (2015 : 70). Les syllabes accentuées (finales et initiales) sont marquées par des tons hauts (H) indiqués en caractères gras.
Le turc, enfin, occupe une position intermédiaire entre l’allemand et le français. Ceci se manifeste dans le fait que dans le cas non-marqué les mots turcs portent un accent tonal haut sur la dernière syllabe. Göksel/Kerslake (2005 : 26) appellent ce type de mots, qui constituent la plus grande partie du vocabulaire turc, les « racines régulières » (angl. regular roots). Si celles-ci sont complétées, conformément à la structure agglutinante de la langue turque, par des suffixes (accentués), l’accent tonique se déplace régulièrement vers la dernière syllabe, comme l’illustrent les exemples suivants :
| müdür ‘directeur’ | [my | ˈdyɾ̥] |
| müdürlük ‘direction’ | [mydyɾ | ˈlyk] |
| müdürlüğümüz ‘notre direction’ | [mydyɾlyː | ˈmyz] |
| müdürlüğümüzden ‘de notre direction’ | [mydyɾlyːmyz | ˈdæn] |
Tab. 2 :
Réalisation de surface du mot phonologique turc. L’accent final est marqué en caractères gras.
De plus, la première syllabe de ces mots prosodiques (composés de racines et d’éventuels suffixes) est normalement marquée par un ton initial bas (L) (Özge/Bozsahin 2010 : 140–144 ; Kamalı 2011 ; İpek/Jun 2013). Cela constitue un parallèle frappant avec le ton bas initial (aL) et le mouvement ascendant final, (L)H*, de la phrase accentuelle française, comme nous l’avons décrite ci-dessus. Pourtant, le turc présente également un nombre bien défini d’exceptions à ce schéma général, qui suivent plutôt le modèle de l’intonation allemande, basé sur les mots : notamment, ce que Göksel/Kerslake (2005 : 27) appellent les « racines irrégulières » (angl. irregular roots), c’est-à-dire, quelques toponymes tels que Ankara, accentué sur la syllabe initiale, et İstanbul (accentué sur la pénultime) ou certains emprunts lexicaux tels que lokanta ‘café, restaurant’ (< italien locanda) ainsi que les suffixes inaccentuables, comme, par exemple, l’affixe négatif ‑m(A)- qui bloque le déplacement de l’accent vers la droite et produit, en revanche, des formes verbales telles que gel[NÉGm]iyorsunuz ‘vous ne venez pas’ ou kal[NÉGma]dınız ‘vous n’êtes pas resté.e.s’. Par contre, les formes positives correspondantes présentent une proéminence finale régulière, c’est-à-dire geliyorsunuz ‘vous venez’, kaldınız ‘vous êtes resté.e.s’). Ainsi ces exceptions peuvent-elles même donner lieu à des contrastes sémantiques exprimées uniquement à travers la position de l’accent tonique, p. ex., dans benim ‘mon’ (ben ‘moi’ + suffixe possessif) vs benim ‘c’est moi’ (ben ‘moi’ + suffixe copulatif) ou bien dans ordu ‘armée’ vs Ordu (toponyme, ville située aux bords de la mer Noire), ce qui est illicite en français.
4 Étude empirique
Il est raisonnable de supposer que les similarités entre le turc et le français dans le domaine prosodique ébauchées ci-dessus – absence (partielle) d’un accent lexical et système intonatif basé sur le phrasé – devraient faciliter l’apprentissage de l’intonation du FLE par des apprenant.e.s bilingues allemand-turc. Contrairement aux apprenant.e.s monolingues allemand.e.s, les bilingues devraient profiter des parallèles existants entre l’une de leurs langues natives et la langue cible. Ainsi devraient-ils, à travers le transfert positif des caractéristiques mélodiques du turc vers le français, obtenir des rendements plus proches de la cible française que leurs condisciples monolingues. Nous visons donc à vérifier l’hypothèse suivante :
Hypothèse : Les apprenant.e.s bilingues allemand-turc profitent des ressemblances des systèmes intonatifs français et turc et produisent l’intonation du FLE d’une manière plus conforme à la langue cible (transfert positif du turc sur le français).
Pour corroborer cette hypothèse, nous analysons un petit corpus de parole lue sous un angle intonatif ; les mesures sur lesquelles se base notre analyse sont exposées dans la section 4.1.1, ci-dessous. Un deuxième objectif de notre enquête est de déterminer si les « meilleures » réalisations produites par les apprenant.e.s, c’est-à-dire celles qui sont le plus proches du modèle mélodique du français, sont reconnues comme telles par les auditeur/trice.s. En d’autres mots : nous sommes intéressés à savoir si l’effort indéniable d’acquérir la prosodie du FLE d’une manière conforme à la langue cible vaut vraiment la peine. À cette fin, nous incluons dans notre étude aussi la perception, que nous abordons au moyen d’une tâche d’évaluation du degré d’accent étranger mise en œuvre avec des juges natif/ve.s et non natif/ve.s. Dans ce qui suit, nous exposons, dans un premier temps, la méthodologie de notre étude empirique (cf. section 4.1), avant de présenter, dans un deuxième temps, les résultats des mesures phonétiques et de la tâche d’évaluation effectuées (cf. section 4.2).
4.1 Méthodologie
Dans ce qui suit, nous allons expliquer d’abord le déroulement de la collecte et de l’analyse des données de production (cf. section 4.1.1), avant d’aborder, dans un deuxième temps, la procédure de l’expérimentation réalisée pour le côté perceptif, ses participant.e.s et l’analyse des évaluations recueillies (cf. section 4.1.2).
4.1.1 Production
Collecte de données. Pour vérifier notre hypothèse, nous avons analysé un petit corpus de données lues par deux groupes d’apprenant.e.s du FLE :
8 apprenant.e.s allemand.e.s monolingues (dont 4 locuteurs masculins ; groupe M)
6 apprenant.e.s bilingues allemand-turc (dont 3 locuteurs masculins ; groupe B).
Tous les participant.e.s sont né.e.s en Allemagne. Parmi le groupe B, quatre personnes avaient au moins un parent né en Allemagne ; il s’agit donc d’immigré.e.s de seconde ou troisième génération qui parlent le turc en tant que langue d’origine. Au moment des enregistrements, tous les participant.e.s de notre échantillon fréquentaient le Gymnasium1 en Allemagne, étaient âgés de 15 à 17 ans et en étaient à leur troisième année d’études en FLE. Le groupe de contrôle monolingue français (F-L1) était composé de trois locutrices originaires du nord de la France (âgées de 21 à 23 ans). Au moment de la collecte des données, elles étaient étudiantes en échange à l’université de Mayence (Allemagne). Elles avaient suivi des cours d’anglais pendant huit ans à l’école, mais n’avaient pas de connaissances avancées d’autres langues étrangères. Leur maîtrise de l’allemand étant très faible, les instructions pendant la session d’enregistrement ont été données en français.
Les données des deux groupes d’apprenant.e.s ont été recueillies en Allemagne du Nord en 2016 dans le cadre du projet MEZ (Mehrsprachigkeitsentwicklung im Zeitverlauf ‘Une perspective longitudinale sur le développement multilingue’ ; cf. www.mez.uni-hamburg.de et Brandt et al. 2017) ; les données de contrôle françaises (F-L1) ont été enregistrées en 2018 à l’université de Mayence. Les participant.e.s ont lu à haute voix un récit bref, tiré d’un manuel scolaire : « Amandine fait du sport » (147 mots ; cf. Jouvet 2006). Les enregistrements ont été transcrits sur les niveaux orthographique et segmental en utilisant les logiciels EasyAlign (Goldman 2011) et Praat (Boersma/Weenink 2018). Les erreurs commises par l’outil de segmentation automatique ont été corrigées manuellement. Après avoir écarté tout passage caractérisé par de fortes disfluences verbales, le corpus à analyser consistait en 5 phrases par participant.e se prêtant à des analyses plus approfondies.
Analyse des données. Pour l’analyse intonative, nous nous sommes servis du logiciel ANALOR (Avanzi et al. 2008a ; Avanzi et al. 2008b ; Delais-Roussarie/Feldhausen 2014 ; Martin 2015 : 41–43), qui attribue à chaque syllabe des valeurs de proéminence comprises entre 0 (« non proéminent ») et 10 (« proéminence la plus élevée possible ») en fonction des paramètres considérés comme pertinents pour le marquage de proéminences en français : notamment, (1) la durée relative des syllabes, (2) la moyenne de F0 relative, (3) l’amplitude du contour F0 et (4) la présence ou absence de pauses silencieuses adjacentes. Plus la valeur de proéminence attribuée par ANALOR à une syllabe finale d’un mot est élevée, plus forte est considérée la frontière de la phrase respective. Sur la base des valeurs assignées à chaque syllabe par ANALOR, nous avons déterminé des scores de déviation pour chaque apprenant en soustrayant celles-ci de la valeur moyenne atteinte par le groupe de contrôle français (F-L1). Ensuite, nous avons calculé la moyenne de ces écarts pour obtenir un score de déviation par chaque phrase et chaque participant.e. Plus le score de déviation obtenu par un.e apprenant.e était faible, plus son intonation était proche de la cible native.