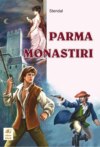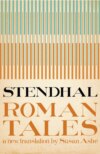Kitabı oku: «La vie de Rossini, tome I», sayfa 11
CHAPITRE XI
ROSSINI VA A NAPLES
Vers 1814, la gloire de Rossini parvint jusqu'à Naples, qui s'étonna qu'il pût y avoir au monde un grand compositeur qui ne fût pas Napolitain. Le directeur des théâtres à Naples était un M. Barbaja de Milan, garçon de café qui à force de jouer, et surtout de tailler au pharaon, et de donner à jouer, s'est fait une fortune de plusieurs millions. M. Barbaja, formé aux affaires à Milan, au milieu des fournisseurs français, faisant et défaisant leur fortune tous les six mois, à la suite de l'armée, ne manque pas d'un certain coup d'œil. Il vit sur-le-champ, à la manière dont la réputation de Rossini prenait dans le monde, que ce jeune compositeur, bon ou mauvais, à tort ou à raison, allait être l'homme du jour en musique; il prit la poste, et vint le chercher à Bologne. Rossini, accoutumé à avoir affaire à de pauvres diables d'impresari, toujours en état de banqueroute flagrante, fut étonné de voir entrer chez lui un millionnaire qui, probablement, trouverait au-dessous de sa dignité de lui escamoter vingt sequins. Ce millionnaire lui offrit un engagement qui fut accepté sur-le-champ. Plus tard à Naples, Rossini signa une scrittura de plusieurs années. Il s'engagea à composer, pour M. Barbaja, deux opéras nouveaux tous les ans; il devait, de plus, arranger la musique de tous les opéras que le Barbaja jugerait à propos de donner soit au grand théâtre de San-Carlo à Naples, soit au théâtre secondaire, nommé del Fondo. Pour tout cela, Rossini avait douze mille francs par an, et un intérêt dans les jeux tenus à ferme par M. Barbaja, intérêt qui a valu au jeune compositeur quelque trente ou quarante louis chaque année.
La direction musicale de San-Carlo et du théâtre del Fondo, dont Rossini se chargea si légèrement, est une besogne immense, un travail de manœuvre, qui l'a obligé à transposer et à rajuster, selon la portée des voix des cantatrices ou selon le crédit de leurs protecteurs, une quantité de musique incroyable. Cela seul eût suffi pour flétrir un talent mélancolique, tendre, tenant à un système nerveux en état d'exaltation; Mozart en eût été éteint. Le caractère hardi et gai de Rossini le met au-dessus de tous les obstacles comme de toutes les critiques. Il ne voit jamais dans un ennemi, qu'une occasion nouvelle de se moquer et de faire des farces, si l'on me permet pour un instant un style au niveau de ce que je raconte.
Rossini se chargea de l'immense travail qui lui était dévolu, comme Figaro, dans son Barbier, se charge des commissions qui lui pleuvent de tous les côtés. Il s'en acquittait en riant, et surtout en se moquant de tout le monde; ce qui lui a valu une foule d'ennemis, dont le plus acharné, en 1823, est M. Barbaja, auquel il a joué le mauvais tour d'épouser sa maîtresse. Cet engagement signé par Rossini, n'a fini qu'en 1822, et a eu l'influence la plus marquée sur son talent, sur son bonheur, et sur l'économie de toute sa vie.
Toujours heureux, Rossini débuta à Naples, de la manière la plus brillante, ce fut par Elisabetta regina d'Inghilterra, opera seria (fin de 1815).
Mais pour comprendre les succès de notre jeune compositeur, et surtout les inquiétudes dont il fut assiégé à son arrivée dans l'aimable Parthénope, il faut remonter très haut.
Le personnage influent à Naples est grand chasseur, grand joueur de ballon, cavalier infatigable, pêcheur intrépide; c'est un homme tout physique; il n'a peut-être qu'un seul sentiment, qui tient probablement encore à ses habitudes physiques, c'est l'amour des entreprises hardies. Du reste, également privé de cœur pour le mal comme pour le bien, c'est un être absolument sans aucune sensibilité morale d'aucune espèce, ainsi qu'il convient au vrai chasseur. On l'a dit avare, c'est une exagération; il abhorre de donner de l'argent de la main à la main, mais signe tant qu'on veut des bons sur son trésorier.
Le roi Ferdinand avait langui neuf ans en Sicile, comme emprisonné au milieu de gens qui lui parlaient parlement, finances, balance des pouvoirs et autre fatras inintelligible et contrariant. Il arrive à Naples, et voilà que l'une des plus belles choses de sa Naples chérie, une de celles qui, de loin, lui faisaient le plus regretter son séjour, le magnifique théâtre de San-Carlo, est anéanti en une nuit par le feu. Ce coup fut, dit-on, plus sensible à ce prince, que la perte d'un royaume ou celle de dix batailles. Au milieu de son désespoir, il se présente un homme qui lui dit: «Sire, cet immense théâtre que la flamme achève de dévorer, je vous le referai en neuf mois, et plus beau qu'il n'était hier.» M. Barbaja a tenu parole. En entrant dans le nouveau Saint-Charles (12 janvier 1817), le roi de Naples, pour la première fois depuis douze ans, se sentit vraiment roi. A partir de ce moment, M. Barbaja a été le premier homme du royaume. Ce premier homme du royaume, directeur des théâtres, et entrepreneur des jeux, protégeait mademoiselle Colbrand, sa première chanteuse, qui se moquait de lui toute la journée, et par conséquent le menait parfaitement. Mademoiselle Colbrand, aujourd'hui madame Rossini, a été de 1806 à 1815, une des premières chanteuses de l'Europe. En 1815, elle a commencé à avoir souvent la voix fatiguée; c'est ce que chez les chanteurs du second ordre, on appelle vulgairement chanter faux. De 1816 à 1822, mademoiselle Colbrand a ordinairement chanté au-dessus ou au-dessous du ton, et a été ce qu'on appelle partout exécrable; mais c'est ce qu'il ne fallait pas dire à Naples. Malgré ce petit inconvénient, mademoiselle Colbrand n'est pas moins restée première chanteuse du théâtre de San-Carlo, et a été constamment applaudie. Voilà, suivant moi, un des triomphes les plus flatteurs pour le despotisme. S'il est un goût dominant chez le peuple napolitain, le plus vif et le plus sensible de l'univers, c'est sans contredit celui de la musique. Hé bien, durant cinq petites années, de 1816 à 1821, ce peuple tout de feu a été vexé de la manière la plus abominable dans le plus cher de ses plaisirs. M. Barbaja était mené par sa maîtresse, qui protégeait Rossini; il payait, autour du roi, qui il fallait payer (c'est la phrase napolitaine); il était aimé de ce prince, il a fallu supporter sa maîtresse.
Vingt fois je me suis trouvé à San-Carlo. Mademoiselle Colbrand commençait un air; elle chantait tellement faux, qu'il était impossible d'y tenir. Je voyais mes voisins déserter le parterre, les nerfs agacés, mais sans mot dire. Qu'on nie après cela que la terreur est le principe du gouvernement despotique! et que ce principe ne fait pas des miracles! obtenir du silence de la part de Napolitains en colère! Je suivais mes voisins, nous allions faire un tour au Largo di Castello, et revenions au bout de vingt minutes voir si nous pourrions accrocher quelque duetto ou quelque morceau d'ensemble où la fatale protégée de M. Barbaja et du roi ne fît pas entendre sa superbe voix en décadence. Pendant la durée éphémère du gouvernement constitutionnel de 1821, mademoiselle Colbrand n'a osé reparaître sur la scène qu'en se faisant précéder par les plus humbles excuses; et le public, pour lui faire pièce, s'est amusé à faire une réputation à mademoiselle Chomel qui, à Naples, s'appelle Comelli, et qu'on savait sa rivale de toute manière.
CHAPITRE XII
L'ELISABETTA
Lorsque, vers la fin de 1815, Rossini arriva à Naples, et donna son Élisabeth, les choses n'en étaient pas à ce point; le public était bien loin d'abhorrer mademoiselle Colbrand; jamais peut-être cette chanteuse célèbre ne fut si belle. C'était une beauté du genre le plus imposant: de grands traits, qui, à la scène, sont superbes, une taille magnifique, un œil de feu à la circassienne, une forêt de cheveux du plus beau noir-jais, enfin l'instinct de la tragédie. Cette femme, qui, hors de la scène, a toute la dignité d'une marchande de modes, dès qu'elle paraît le front chargé du diadème, frappe d'un respect involontaire, même les gens qui viennent de la quitter au foyer.
Le château de Kenilworth, roman de sir Walter Scott, n'a paru qu'en 1820; il me dispense toutefois de donner une analyse suivie de l'Elisabetta jouée à Naples en 1815. Quel lecteur ne se rappellera pas d'abord le caractère de cette reine illustre, chez qui les faiblesses d'une jolie femme que la jeunesse quitte, viennent obscurcir de temps en temps les qualités d'un grand roi? Dans le libretto comme dans le roman, Leicester, favori d'Élisabeth, est sur le point d'être élevé au trône, et de recevoir la main de cette princesse; mais, amoureux lui-même d'une femme moins impérieuse et plus aimable, qu'il a osé épouser en secret, il espère pouvoir tromper les yeux de l'amour jaloux et armé du souverain pouvoir. Dans l'opéra, l'épouse de Leicester ne s'appelle pas Amy Robsart, mais Mathilde. Le libretto fut traduit d'un mélodrame français, par un M. Smith, Toscan établi à Naples.
Le premier duetto en mineur, entre Leicester et sa jeune épouse, est magnifique et fort original. Elisabetta était la première musique de Rossini que l'on entendait à Naples; sa grande réputation, acquise dans le nord de l'Italie, avait disposé le public napolitain à le juger avec sévérité; on peut dire que ce premier duetto
Incauta! che festi?
décida le succès de l'opéra et du maestro.
Un courtisan nommé Norfolk, jaloux du haut degré de faveur où le sentiment de la reine a placé Leicester, révèle à cette princesse le secret mariage de l'homme que son orgueil lui reproche d'aimer. Il lui apprend que son favori, qui revient victorieux de la guerre d'Écosse, et dont l'arrivée triomphale forme le commencement du premier acte, ramène avec lui sa nouvelle épouse, parmi les jeunes otages que l'Écosse envoie à Élisabeth, et que la reine vient d'admettre au nombre de ses pages. Elle vient ainsi d'attacher à sa cour sa rivale, cachée sous les vêtements d'un jeune homme. Ce moment de fureur et de malheur profond est superbe pour la musique. L'orgueil et l'amour, les deux passions qui déchirent le cœur de la reine, sont aux prises de la manière la plus cruelle. Le duetto
Con qual fulmine improviso
Mi percosse irato il cielo!
entre la reine et Norfolk, a eu autant de succès à Paris qu'à Naples. Il y a beaucoup de magnificence et de feu, ce qui est fort bien pour l'orgueil; mais l'amour n'y paraît que furieux.
La reine, hors d'elle-même, prescrit au grand-maréchal de sa cour de faire rassembler ses gardes, et de les préparer à la prompte exécution de ses ordres, quels qu'ils puissent être. Elle lui ordonne en même temps de faire paraître devant elle tous les otages écossais, et enfin d'appeler Leicester, qu'elle veut voir à l'instant. Après ces ordres rapides, donnés en peu de mots, Élisabeth reste seule. Il faut avouer que mademoiselle Colbrand était superbe en cet instant; elle ne se permettait aucun geste, elle se promenait, ne pouvant rester sans mouvement, en attendant la scène qui se prépare et l'homme qui l'a trahie; mais on voyait dans ses yeux qu'un mot allait envoyer à la mort cet amant perfide. Voilà les situations que la musique réclame.
Enfin Leicester paraît, mais les otages écossais s'avancent en même temps que lui. L'œil furieux d'Élisabeth cherche parmi ces pages l'être qu'elle doit haïr; elle a bientôt deviné Mathilde à son trouble. La passion des personnages se trahit par des mots entrecoupés. Enfin le chant commence, c'est le finale du premier acte. La reine, qui se voit trahie par tout ce qui l'entoure, parle en secret à un garde, qui bientôt reparaît avec un coussin recouvert d'un voile. Élisabeth, après un dernier regard jeté rapidement sur Mathilde et sur Leicester, écarte ce voile d'un mouvement furieux. La couronne d'Angleterre paraît sur le coussin; elle l'offre à Leicester en même temps que sa main.
Ce moment est superbe. Ce moyen, déplacé peut-être dans la tragédie, est magnifique et du plus grand effet dans l'opéra, qui réclame les choses qui parlent aux yeux.
Élisabeth, qui se complaît dans sa fureur, se dit à elle-même:
Leicester ne reçoit pas comme il le doit l'offre de la reine; celle-ci, furieuse, saisit le jeune page et l'entraîne sur le devant de la scène; elle dit à son amant: «Voilà la perfide qui fait de toi un traître.» Mathilde et son époux se voient découverts; dans leur trouble, ils ne répondent que par des mots entrecoupés. La reine appelle ses gardes. Toute la cour suit les gardes, et se trouve assister ainsi à tous les détails de ce grand événement, et à l'éclatante disgrâce de Leicester, auquel les gardes demandent son épée.
Il était impossible d'offrir un plus beau finale à la musique; cet art divin ne peut pas peindre les fureurs de la politique; malgré lui, lorsqu'il exprime des fureurs, ce sont bientôt celles de l'amour. Ici la jalousie poussée jusqu'à la rage chez Élisabeth, le désespoir le plus profond chez Leicester, l'amour tendre et éploré dans sa jeune épouse, tout sert à souhait la musique. Il serait peu exact de dire que cette situation contribua beaucoup au succès de Rossini. A la première représentation, les Napolitains étaient ivres de bonheur. Je me souviendrai toujours de cette première soirée. C'était un jour de gala à la cour. Je remarquai que la loge de la princesse de Belmonte, dans laquelle j'assistais à la première représentation d'Élisabeth, était d'abord fort disposée à la sévérité envers ce maestro, né loin de Naples, et qui avait acquis ailleurs sa célébrité.
Comme je l'ai dit, le premier duetto en mineur, entre l'ambitieux Leicester (Nozzari) et sa jeune épouse déguisée en page (mademoiselle Dardanelli), désarma tous les cœurs. Le charmant style de Rossini acheva bien vite la séduction. On trouvait les grandes émotions de l'opéra seria, et elles n'étaient achetées par aucun moment de langueur et d'ennui.
La circonstance d'un jour de gala servit aussi le maestro. Rien ne dispose à goûter la splendeur, rien n'éloigne l'idée des chagrins solitaires et des peines de l'amour, comme les cérémonies brillantes d'un jour de fête à la cour. Or, il faut avouer que la musique d'Élisabeth est beaucoup plus magnifique que pathétique; à chaque instant les voix exécutent des batteries de clarinette, et les plus beaux morceaux ne sont souvent que de la musique de concert.
Mais que nous étions loin de toutes ces froides critiques à la première représentation! nous étions ravis: c'est le mot propre.
Arrivé à ce superbe finale du premier acte, je m'aperçois que j'ai oublié l'ouverture. Elle commença le succès de la pièce. Je me souviens que M. M***, excellent connaisseur, vint nous dire dans la loge de la princesse de Belmonte: «Cette ouverture n'est que celle de l'Aureliano in Palmira, renforcée d'harmonie.» Il s'est trouvé dans la suite que rien n'était plus exact. Lorsqu'un an plus tard, Rossini alla à Rome pour écrire le Barbier de Séville, sa paresse reprit cette même ouverture pour la troisième fois. Elle se trouve ainsi avoir à exprimer les combats de l'amour et de l'orgueil dans une des âmes les plus hautes dont l'histoire ait gardé la mémoire, et les folies du barbier Figaro. Le plus petit changement de temps suffit souvent pour donner l'accent de la plus profonde mélancolie à l'air le plus gai. Essayez de chanter en ralentissant le mouvement, l'air de Mozart: Non più andrai farfallone amoroso.
Les principaux motifs de cette ouverture, si souvent employée par Rossini, forment la péroraison du premier finale de l'Elisabetta.
CHAPITRE XIII
SUITE DE L'ELISABETH
Le second acte s'ouvre par une scène superbe. La terrible Élisabeth fait amener devant elle, par ses gardes, la tremblante Mathilde. C'est pour lui adresser ces paroles fatales:
T'inoltra, in me tu vedi
Il tuo giudice, o donna.
«La politique condamne à une mort ignominieuse une femme ennemie qui a osé s'introduire dans ma cour sous un déguisement perfide. Un reste de pitié parle encore dans mon âme. Écris, renonce aux prétendus droits que tu peux te croire sur le cœur de l'ambitieux Leicester. Reviens de ton erreur.»
Ce récitatif obligé est magnifique. A la première représentation, il serra tous les cœurs.
Il faut avoir vu mademoiselle Colbrand dans cette scène, pour comprendre le succès d'enthousiasme qu'elle eut à Naples, et toutes les folies qu'elle faisait faire à cette époque.
Un Anglais, l'un des rivaux de Barbaja, avait fait venir d'Angleterre des dessins fort soignés, au moyen desquels on pût reproduire, avec la dernière exactitude, le costume de la sévère Élisabeth. Ces habits du seizième siècle se trouvèrent convenir admirablement à la taille et aux traits de la belle Colbrand. Tous les spectateurs connaissaient l'anecdote de la vérité du costume; cette idée consacrant, par le prestige des souvenirs, l'aspect imposant de mademoiselle Colbrand, augmentait encore l'effet de son étonnante beauté. Jamais l'imagination la plus exaltée par le roman de Kenilworth n'a pu se figurer une Élisabeth plus belle, et surtout plus majestueuse. Dans l'immense salle San-Carlo, il n'y avait peut-être pas un seul homme qui ne sentît qu'on devait voler à la mort avec plaisir pour obtenir un regard de cette belle reine.
Mademoiselle Colbrand, dans Élisabeth, n'avait point de gestes, rien de théâtral, rien de ce que le vulgaire appelle des poses ou des mouvements tragiques. Son pouvoir immense, les événements importants qu'un mot de sa bouche pouvait faire naître, tout se peignait dans ses yeux espagnols si beaux, et dans certains moments si terribles. C'était le regard d'une reine dont la fureur n'est retenue que par un reste d'orgueil: c'était la manière d'être d'une femme belle encore, qui dès longtemps est accoutumée à voir la moindre apparence de volonté suivie de la plus prompte obéissance75. En voyant mademoiselle Colbrand parler à Mathilde, il était impossible de ne pas sentir que, depuis vingt ans, cette femme superbe était reine absolue. C'est cette ancienneté des habitudes que le pouvoir suprême fait contracter, c'est l'évidence de l'absence de toute espèce de doute sur le dévouement que ses moindres fantaisies vont rencontrer, qui formait le trait principal du jeu de cette grande actrice: toutes ces choses se lisaient dans la tranquillité des mouvements de la reine. Le peu de mouvements qu'elle faisait lui étaient arrachés par la violence des combats de passions qui déchiraient son âme, aucun par l'intention de se faire obéir. Nos plus grands acteurs tragiques, Talma lui-même, ne sont pas exempts de gestes forts et impérieux, dans les rôles de tyrans. Peut-être ces gestes impérieux, ces espèces de gasconnades tragiques, sont-elles une des exigences d'un parterre de mauvais goût, tel que celui qui décide du sort de nos tragédies; mais ces gestes, pour être applaudis, n'en sont pas moins absurdes. Un roi absolu est l'homme du monde qui fait le moins de gestes76; ils lui sont inutiles: il est depuis longtemps accoutumé à voir ses moindres signes suivis, avec la rapidité de l'éclair, de l'exécution de ses volontés.
La scène superbe dans laquelle mademoiselle Colbrand était si grande tragédienne, se termine par un duetto entre la reine et Mathilde,
Pensa che sol per poco
Sospendo l'ira mia,
qui se change bientôt en terzetto, par l'arrivée de Leicester.
On nous dit que c'était Rossini qui avait eu l'idée de l'arrivée de Leicester entre ces deux femmes, l'une ne retenant qu'à peine les éclats de sa fureur, l'autre élevée jusqu'à la haute énergie par le désespoir de l'amour sincère dans un cœur de seize ans. On peut dire que dans le genre du libretto d'opéra, cette idée est de génie.
Après ce terzetto magnifique, nous eûmes deux airs chantés, l'un par Norfolk (Garcia), l'autre par Leicester (Nozzari): ils sont bien composés. On peut juger s'ils furent bien chantés par deux ténors rivaux paraissant dans une occasion solennelle, devant tout ce que Naples avait de plus grands personnages et de connaisseurs les plus difficiles. Cependant, pour la composition, ils parurent tomber un peu dans le lieu commun, et n'être pas à la hauteur du reste de l'opéra.
Leicester est mis en prison et condamné à mort par les cours de justice du pays. Quelques moments avant l'exécution, Élisabeth ne peut résister à l'idée de ne plus revoir le seul homme qui ait pu faire pénétrer un sentiment tendre dans un cœur dévoué à l'ambition et aux sombres jouissances du pouvoir. Elle paraît dans la prison de Leicester. Le traître Norfolk y était avant elle, et à son arrivée se cache derrière un pilier de la prison. Les deux amants ont une explication. Ils reconnaissent que Norfolk a voulu perdre Leicester. Norfolk, qui se voit découvert et sans espoir de pardon, se précipite sur Élisabeth, un poignard à la main. Mathilde, la jeune épouse de Leicester, qui venait lui dire un dernier adieu, est assez heureuse pour sauver la reine par un cri qui l'avertit du danger.
Élisabeth, déjà à demi vaincue par sa conversation avec Leicester, pardonne aux amants, et Rossini prend sa revanche des deux airs, peut-être un peu faibles, qui précèdent, par l'un des plus magnifiques finale qu'il ait peut-être jamais écrits.
Le cri de la reine,
Bell'alme generose,
porta jusqu'à la folie l'enthousiasme du public. Nous fûmes plus de quinze représentations avant de pouvoir porter un œil critique sur ce morceau superbe.
Élisabeth pardonne à Leicester et à Mathilde; voici ses paroles:
Quand enfin nous eûmes assez de sang-froid pour examiner, nous trouvâmes que ce chant était doux et tranquille comme le calme après la tempête. Du reste, Rossini a réuni, je crois, tous les défauts de son style dans ces vingt ou trente mesures. Le chant principal est étouffé sous un déluge d'ornements déplacés et de roulades qui ont l'air d'être écrites pour des instruments à vent, et non pour une voix humaine.
Mais il faut être juste, Rossini arrivait à Naples; il voulait réussir, il dut s'attacher à plaire à la prima donna qui gouvernait entièrement le directeur Barbaja. Or, mademoiselle Colbrand n'a jamais eu de pathétique dans son talent; il a été magnifique comme sa personne; c'était une reine, c'était Élisabeth, mais c'était Élisabeth donnant des ordres du haut d'un trône, et non pas pardonnant avec générosité.
Quand le génie de Rossini l'eût porté au pathétique, ce que je suis loin d'accorder, il eût dû s'en abstenir à cause de la voix de la célèbre cantatrice à laquelle il confiait le rôle d'Élisabeth.
Dans le morceau bell'alme generose, Rossini, par un artifice fort simple rassembla tous les agréments, de quelque espèce qu'ils fussent, que mademoiselle Colbrand exécutait bien. Nous eûmes comme un inventaire en nature de tous les moyens quelconques de cette belle voix, et l'on va juger de ce que peut en musique la perfection de l'exécution. Ces agréments étaient faits avec une telle supériorité, que, malgré l'absurdité flagrante, il ne nous fallut pas moins de quinze ou vingt représentations pour que nous pussions nous apercevoir qu'ils étaient déplacés.
Rossini, qui ne reste jamais court, répondait à nos critiques:
«Élisabeth est reine même en pardonnant. Dans un cœur si altier, le pardon le plus généreux en apparence n'est encore qu'un acte de politique. Quelle est la femme, même sans être reine, qui puisse pardonner l'injure de se voir préférer une autre femme?»
Alors les vieux dilettanti se fâchaient: «Toute votre musique pèche par l'absence du pathétique, disaient-ils; elle n'est que magnifique, comme le talent de votre première chanteuse. Elle devait être profondément tendre dans le rôle de Mathilde, et vous n'avez que le commencement du terzetto
Pensa che sol per poco,
qui encore est plutôt simple comme un nocturne, que tendre comme un air de passion; mais il repose l'âme de la magnificence de tout ce qui l'entoure, et il doit au contraste les quatre cinquièmes du plaisir qu'il nous fait. Avouez franchement que vous avez toujours sacrifié l'expression et la situation dramatique aux broderies de la Colbrand.» —J'ai sacrifié au succès, répondit Rossini avec une sorte de fierté qui lui allait à merveille. L'aimable archevêque de T… vint à son secours. A Rome, s'écria-t-il, Scipion, accusé devant le peuple, dit pour toute réponse à ses ennemis: «Romains, il y a dix ans qu'à pareil jour je détruisis Carthage; allons au Capitole rendre grâces aux dieux immortels.»
Il est sûr que l'effet d'Élisabeth fut prodigieux. Quoique fort inférieur à Otello, par exemple, il y a dans cet opéra bien des choses d'une fraîcheur délicieuse et entraînante.
Aujourd'hui, de sang-froid, j'y blâmerais l'emploi de deux ténors pour les rôles de Norfolk et de Leicester. Rossini aurait répondu à ce reproche: «J'avais ces deux ténors, et je n'avais pas de voix de basse pour le rôle du traître Norfolk.» La vérité est qu'avant Rossini on ne donnait jamais des rôles importants aux voix de basse dans l'opéra séria. Ce maestro est le premier qui ait écrit, pour ces sortes de voix, des parties difficiles dans les opéras de mezzo carattere, tels que la Cenerentola, la Gazza ladra, Torvaldo e Dorliska, etc.; et l'on peut dire que c'est sa musique qui a fait naître les Lablache, les Zuchelli, les Galli, les Remorini, les Ambrosi.
Il celere obbedir.
M. Manzoni, dans son Ode sur la mort de Napoléon. Ce sont les seuls vers, à ma connaissance, dignes du sujet.
Ei fû; siccome immobile,Dato il mortal sospiro,Stette la spoglia immemoreOrba di un tanto spiro,Cosi percossa e attonitaLa Terra al nunzio sta.Muta pensando all'ultimaOra dell'uom fatale,Ne sa quando una simileOrma di piè mortaleLa sua cruenta polvereA calpestar verrà.Dall'Alpi alle Piramidi,Dal Manzanarrè al Reno,Di quel securo in fulmine,Tenea dietro al baleno,Scoppiô da Scilla al Tanai,Dall'uno all'altro mar.Fù vera gloria? ai posteriL'ardus sentenza; noiChiniam la fronte al MassimoFattor che volle in LuiDel Creator suo spiritoPiù vasta orma stampar.....Ei sparve, e i di nell'ozioChiuse in si breve sponda,Segno d'immensa invidia,E di pietà profonda,D'inestinguibil odio,Et d'indomato amor.....Oh! quante volte al tacitoMorir di un giorno inerte,Chinati i rai fulminei,Le braccia al sen conserte,Stette, e dei di che furonoL'assalse li sovvenir!Ei ripenso le mobiliTende, i percossi valli,E il lampo de i manipoli,E l'onda de cavalli,E il concitato imperio,........
[Закрыть]