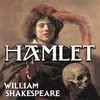Kitabı oku: «Henri V», sayfa 6
SCÈNE II
Le camp des Français
LE DAUPHIN, LE DUC D'ORLÉANS, RAMBURE, et autres
LE DUC D'ORLÉANS. – Le soleil dore notre armure; allons, mes pairs.
LE DAUPHIN. -Montez à cheval.-Mon cheval! Holà, valets, laquais.
LE DUC D'ORLÉANS. – O noble courage!
LE DAUPHIN. -Via! 29-Les eaux et la terre…
LE DUC D'ORLÉANS. -Rien puis? L'air et le feu?..
LE DAUPHIN. -Ciel! Cousin Orléans!.. (Entre le connétable.) Allons, seigneur connétable.
LE CONNÉTABLE. – Ecoutez comme nos coursiers hennissent et appellent leurs cavaliers.
LE DAUPHIN. – Montez-les, creusez dans leurs flancs de profondes plaies; que leur sang bouillant jaillisse jusqu'aux yeux des Anglais, et les épouvante de l'excès de leur courage. Allons!
RAMBURE. – Quoi, voulez-vous leur faire pleurer le sang à nos chevaux? Comment distinguerons-nous alors leurs larmes naturelles?
(Arrive un messager.)
LE MESSAGER. – Pairs de France, les Anglais sont rangés en bataille.
LE CONNÉTABLE. – A cheval, vaillants princes! à cheval sans délai. Jetez seulement un regard sur cette troupe chétive et affamée, et la seule présence de votre belle armée va sucer le reste de leur courage, et ne laisser d'eux que des squelettes et des cadavres de soldats. Il n'y a pas de quoi employer tous nos bras. A peine reste-t-il dans leurs veines épuisées assez de sang pour teindre d'une marque d'honneur chacune de nos haches; il faudra que nous les renfermions aussitôt faute de victimes. Le souffle de votre valeur les renversera. Non, n'en doutez pas, mes nobles seigneurs, le superflu de nos valets et nos paysans, peuple inutile qui s'attroupe en tumulte autour de nos escadrons de bataille, suffirait pour purger la plaine de cet ennemi méprisable; et nous pourrions rester au pied de la montagne, spectateurs oisifs. Mais l'honneur nous le défend. Que dirai-je de plus? Nous n'avons que peu à faire, et tout sera fini. Ainsi, que les trompettes sonnent la chasse et le signal du combat; car notre approche doit répandre une si grande terreur sur le champ de bataille, que les Anglais vont se coucher à terre et se rendre.
(Entre Grandpré.)
GRANDPRÉ. – Pourquoi tardez-vous si longtemps, nobles seigneurs de France? Là-bas ces cadavres insulaires, presque réduits à leurs os, figurent bien mal, aux clartés du matin, sur un champ de bataille. Leurs enseignes délabrées flottent en déplorables lambeaux, et notre souffle les agite en passant avec mépris. Le farouche Mars semble sans ressource dans leur armée ruinée, et ne jette sur cette plaine qu'un regard indifférent au travers de la visière de son casque rouillé. Leurs cavaliers semblent autant de candélabres immobiles 30 qui portent leurs torches; et leurs pauvres montures, dont les flancs et la peau sont pendants, laissent tomber la tête; elles ouvrent à demi des yeux pâles et éteints, et la bride, souillée d'herbes remâchées, reste sans mouvement dans leur bouche inanimée: déjà leurs derniers exécuteurs, les funestes corbeaux, volent au-dessus de leurs têtes, impatients d'entendre sonner leur heure. Il n'y a point de mots qui puissent rendre la vie d'une telle bataille dans une créature aussi inanimée que cette armée.
LE CONNÉTABLE. – Ils ont récité leurs dernières prières, et n'attendent plus que la mort.
LE DAUPHIN. – Voulez-vous que nous envoyions de la nourriture et des habits neufs aux soldats, et des fourrages à leurs chevaux affamés, et que nous les combattions ensuite?
LE CONNÉTABLE. – Je n'attends que mon guidon: allons, au champ de bataille! Je vais prendre pour étendard la banderole d'une trompette, afin de prévenir tout retard. Allons, partons: le soleil est déjà haut, et nous dépensons le jour dans l'inaction.
(Ils sortent.)
SCÈNE III
Le camp anglais
L'armée anglaise, GLOCESTER, BEDFORD, EXETER, ERPINGHAM, SALISBURY ET WESTMORELAND
GLOCESTER. – Où est le roi?
BEDFORD. – Il est monté à cheval pour aller reconnaître leur armée.
WESTMORELAND. – Ils ont soixante mille combattants.
EXETER. – C'est cinq contre un! et des troupes toutes fraîches.
SALISBURY. – Que le bras de Dieu combatte avec nous! c'est une périlleuse partie! Dieu soit avec vous tous, princes! Je vais à mon poste. Si nous ne devons plus nous revoir que dans les cieux, nous nous reverrons alors dans la joie. Mon noble lord Bedford, mon cher lord Glocester; – et vous, mon digne lord Exeter, et toi, mon tendre parent: – braves guerriers, adieu tous.
BEDFORD. – Adieu, brave Salisbury; que le bonheur t'accompagne!
EXETER. – Adieu, cher lord: combats vaillamment aujourd'hui; mais je te fais injure en t'y exhortant: tu es pétri de valeur.
BEDFORD. – Sa valeur égale sa bonté: ce sont la valeur et la bonté d'un prince.
WESTMORELAND. – Oh! que nous eussions seulement ici dix mille de ces hommes qui se reposent aujourd'hui en Angleterre!
(Entre le roi.)
LE ROI. – Quel est celui qui fait ce voeu? Vous, cousin Westmoreland? Non, mon beau cousin: si nous sommes destinés à mourir, nous sommes assez nombreux, et notre patrie perd assez en nous perdant: si nous sommes destinés à vivre, moins nous serons de combattants, plus notre part de gloire sera riche. Que la volonté de Dieu soit faite! je te prie de ne pas souhaiter un seul homme de plus. Par Jupiter, je ne convoite point l'or, ni ne m'inquiète qui vit et prospère à mes dépens: peu m'importe si d'autres usent mes vêtements: tous ces biens extérieurs ne touchent point mes désirs; mais si c'est un crime de convoiter l'honneur, je suis le plus coupable de tous les hommes qui respirent. Non, non, mon cousin, ne souhaitez pas un Anglais de plus. Par la paix de Dieu, je ne voudrais pas, dans l'espérance dont mon coeur est plein, perdre de cette gloire, ce qu'il en faudrait seulement partager avec un homme de plus. Oh! n'en souhaitez pas un de plus! Allez plutôt, Westmoreland, publier, au milieu de mon camp, que celui qui ne se sent pas d'humeur d'être de ce combat, ait à partir: son passe-port sera signé, et sa bourse remplie d'écus pour le reconduire chez lui. Je ne voudrais pas mourir dans la compagnie d'un soldat qui craindrait de mourir de société avec nous. Ce jour est appelé la fête de Saint-Crépin 31. Celui qui survivra à cette journée, et retournera dans son pays, sautera de joie, quand on nommera cette fête, et s'enorgueillira au nom de Crépin. S'il voit un long âge, il fêtera tous les ans ses amis, la veille de ce grand jour, et il dira: C'est demain la Saint-Crépin: et alors il ôtera sa manche, et montrera ses cicatrices. Les vieillards oublient; mais quand ils oublieraient tout le reste, ils se souviendront toujours avec orgueil, et se vanteront avec emphase, des exploits qu'ils auront faits en cette journée; et alors nos noms seront aussi familiers dans leur bouche que ceux de leur propre famille. Le roi Henri, Bedford, Exeter, Warwick et Talbot, Salisbury et Glocester seront toujours rappelés de nouveau, et salués à pleines coupes. Le bon vieillard racontera cette histoire à son fils; et d'aujourd'hui à la fin des siècles, ce jour solennel ne passera jamais, qu'il n'y soit fait mention de nous; de nous, petit nombre d'heureux, troupe de frères: car celui qui verse aujourd'hui son sang avec moi sera mon frère. Fût-il né dans la condition la plus vile, ce jour va l'anoblir: et les gentilshommes d'Angleterre, qui reposent en ce moment dans leur lit se croiront maudits de ne s'être pas trouvés ici. Comme ils se verront petits dans leur estime, quand ils entendront parler l'un de ceux qui auront combattu avec nous le jour de Saint-Crépin!
(Entre Salisbury.)
SALISBURY. – Mon souverain, hâtez-vous de vous préparer: les Français sont rangés dans un bel ordre de bataille, et vont nous charger avec impétuosité.
LE ROI. – Tout est prêt, si nos coeurs le sont.
WESTMORELAND. – Périsse l'homme dont le coeur recule en ce moment!
LE ROI. – Quoi, cousin, tu ne souhaites donc pas à présent de nouveaux secours d'Angleterre?
WESTMORELAND. – Par l'esprit de Dieu, mon prince, je voudrais que vous et moi tout seuls, sans autre secours, pussions expédier ce combat!
LE ROI. – Allons, tu viens de rétracter ton voeu et de retrancher cinq mille hommes, et cela me plaît bien plus que de nous en souhaiter un seul de plus. (A tous les chefs.) Vous connaissez tous vos postes: Dieu soit avec vous!
(Fanfares. Entre Montjoie.)
MONTJOIE. – Une seconde fois, je viens savoir de toi, roi Henri, si tu veux à présent composer pour ta rançon, avant ta ruine certaine: car, tu n'en peux douter, tu es si près de l'abîme, que tu ne peux éviter d'y être englouti. De plus, par pitié, le connétable te prie d'avertir ceux qui te suivent de songer à se repentir de leurs fautes, afin que leurs âmes puissent, dans une douce et paisible retraite, sortir de ces plaines, où les corps de ces infortunés doivent rester gisants et pourrir.
LE ROI. – Qui t'a envoyé cette fois?
MONTJOIE. – Le connétable de France.
LE ROI. – Je te prie, reporte-lui ma première réponse: dis-leur qu'ils achèvent ma ruine, et qu'alors ils vendent mes ossements. Grand Dieu! pourquoi prennent-ils à tâche d'insulter ainsi des hommes infortunés? Celui qui jadis vendit la peau du lion, tandis que l'animal vivait encore, fut tué en le chassant. Nombre de nos corps, je n'en doute point, trouveront leur tombeau dans le sein de leur patrie; et je me flatte qu'au-dessus d'eux, le bronze attestera aux siècles futurs l'ouvrage de cette journée; et ceux qui laisseront leurs honorables ossements dans la France, mourant en hommes courageux, quoique ensevelis dans votre fange, y trouveront la gloire: le soleil viendra les y saluer de ses rayons, et exaltera leur honneur jusqu'aux cieux: il ne vous restera que les parties terrestres pour infecter votre climat et enfanter une peste sur la France 32. Songe bien à la bouillante valeur de nos Anglais: quoique mourante, comme un boulet amorti qui ne fait plus que glisser sur le sable, elle se relève et détruit encore dans son nouveau cours; ses derniers bonds donnent une mort aussi fatale. Laisse-moi te parler fièrement. – Dis au connétable que nous sommes des guerriers mal vêtus comme en un jour de travail; que notre éclat et notre dorure sont ternis par une marche pénible, pendant la pluie, dans vos sillons. Il ne reste pas dans notre armée, et c'est, je pense, une assez bonne preuve que nous ne fuirons pas, une seule plume aux panaches, et le temps et l'action ont usé notre parure guerrière. Mais, par la messe, nos coeurs sont parés, et mes pauvres soldats me promettent qu'avant que la nuit vienne, ils seront vêtus de robes fraîches et nouvelles, ou qu'ils arracheront ces panaches neufs et brillants qui ornent la tête des Français, et qu'ils les mettront hors d'état de servir. S'ils tiennent leur parole, comme ils la tiendront, s'il plaît à Dieu, ma rançon alors sera facile à recueillir. Héraut, épargne tes peines. Officieux héraut, ne viens plus me parler de rançon: ils n'en auront point d'autre, je le jure, que ces membres; et s'ils les ont dans l'état où je compte les laisser, ils n'en retireront pas grande valeur: annonce-le au connétable.
MONTJOIE. – Je le ferai, roi Henri; et je prends congé de toi: tu n'entendras plus la voix du héraut.
(Il sort.)
LE ROI. – Et moi, j'ai bien peur que tu ne reviennes encore parler de rançon.
(Entre le duc d'York.)
YORK. – Mon souverain, je vous demande à genoux la grâce de conduire l'avant-garde.
LE ROI. – Conduis-la, brave York. Allons, soldats, marchons en avant. – Et toi, grand Dieu, dispose à ta volonté de cette journée!
(Ils sortent.)
SCÈNE IV
Le champ de bataille. Bruits de guerre, combats, etc
Arrivent PISTOL, UN SOLDAT FRANÇAIS, ET l'ancien PAGE de Falstaff
PISTOL. – Rends-toi, canaille!
LE SOLDAT FRANÇAIS. -Je pense que vous êtes le gentilhomme de bonne qualité.
PISTOL. -Qualité, dis-tu? – Es-tu gentilhomme? Comment t'appelles-tu? Réponds-moi?
LE SOLDAT FRANÇAIS. -O Seigneur Dieu!
PISTOL. -O Seigneur Diou doit être un gentilhomme! Fais bien attention à ce que je te vais dire, ô Seigneur Diou, et observe-le. Tu meurs par l'épée, à moins, ô Seigneur Diou, que tu ne me donnes une grosse rançon.
LE SOLDAT FRANÇAIS. -Oh! prenez miséricorde.-Ayez pitié de moi.
PISTOL. -Moy ne fera pas mon affaire; il m'en faut quarante moys 33, ou bien je t'arracherai les entrailles sanglantes.
LE SOLDAT FRANÇAIS. -Est-il impossible d'échapper à la force de ton bras?
PISTOL. -Brass! Roquet! Quoi, du cuivre? Tu m'offres du cuivre à présent, maudit bouc des montagnes?
LE SOLDAT FRANÇAIS. – Oh! pardonnez-moi!
PISTOL. – Ah! est-ce là ce que tu veux dire? Est-ce là une tonne de moys? Écoute un peu ici, page, demande pour moi à ce vil Français comment il s'appelle.
LE PAGE, au Français. -Écoutez: comment êtes-vous appelé?
LE SOLDAT FRANÇAIS. – Monsieur le Fer.
LE PAGE. – Il dit qu'il s'appelle Monsieur Fer.
PISTOL. – Monsieur Fer! Ah! par Dieu, je le ferrerai, je le ferlherai, je le ferrèterai. Rends-lui cela en français.
LE PAGE. – Je ne sais pas ce que c'est que ferrer, ferreter et ferlher en français.
PISTOL. – Dis-lui qu'il se prépare; car je vais lui couper le cou.
LE SOLDAT FRANÇAIS, au page. -Que dit-il, Monsieur?
LE PAGE. -Il me commande de vous dire que vous faites-vous prêt: car ce soldat-ci est disposé, tout à cette heure, à couper votre gorge.
PISTOL. – i, couper gorge, par ma foi, paysan, à moins que tu ne me donnes des écus, et de bons écus, ou je te mets en pièces avec cette épée que voilà.
LE SOLDAT FRANÇAIS. – Oh! je vous supplie, pour l'amour de Dieu, de me pardonner. Je suis un gentilhomme de bonne maison: gardez ma vie, et je vous donnerai deux cents écus.
PISTOL. – Qu'est-ce qu'il dit?
LE PAGE. -Il vous prie d'épargner sa vie, parce qu'il est un homme de bonne famille, et qu'il vous donnera, pour sa rançon, deux cents écus.
PISTOL. – Dis-lui que ma fureur s'apaisera, et que je prendrai ses écus.
LE SOLDAT FRANÇAIS. -Petit monsieur, que dit-il?
LE PAGE. -Encore qu'il est contre son jurement de pardonner aucun prisonnier: néanmoins, pour les écus que vous promettez, il est content de vous donner la liberté et le franchissement.
LE SOLDAT FRANÇAIS. -Sur mes genoux, je vous donne mille remercîments, et je m'estime heureux d'être tombé entre les mains d'un chevalier, je pense, le plus brave, et le plus distingué seigneur de l'Angleterre.
PISTOL. – Interprète-moi cela, page.
LE PAGE. – Il dit qu'il vous fait à genoux mille remercîments, et qu'il s'estime très-heureux d'être tombé entre les mains d'un seigneur, à ce qu'il croit, le plus brave, le plus généreux et le plus distingué de toute l'Angleterre.
PISTOL. – Comme il est vrai que je respire, je veux montrer quelque clémence. Allons, suis-moi!
LE PAGE. -Suivez, vous, le grand capitaine. (Le soldat et Pistol s'en vont.) Je n'ai, ma foi, encore jamais vu une voix aussi bruyante sortir d'un coeur aussi vide: aussi cela vérifie bien le proverbe qui dit: Que les tonneaux vides sont les plus sonores. Bardolph et Nym avaient cent fois plus de courage que ce diable de hurleur qui, comme celui de nos antiques farces, se rogne les ongles avec un poignard de bois. Tout le monde en peut faire autant. Ils sont pourtant tous deux pendus: et il y a longtemps que celui-ci aurait été leur tenir compagnie, s'il osait voler quelque chose sans regarder derrière lui. Il faut donc que je reste, moi, avec les goujats qui ont la garde du bagage de notre camp. Les Français feraient un beau butin sur nous, s'ils le savaient; car il n'y a personne pour le garder que des enfants.
(Il sort.)
SCÈNE V
Autre partie du champ de bataille. Bruits de guerre
LE CONNÉTABLE, LE DUC D'ORLÉANS, BOURBON LE DAUPHIN ET RAMBURE
LE CONNÉTABLE. – O diable!
LE DUC D'ORLÉANS. -Ah! seigneur! le jour est perdu, tout est perdu!
LE DAUPHIN. -Mort de ma vie! tout est détruit: tout! La honte se pose avec un rire moqueur sur nos panaches, et nous couvre d'un opprobre éternel. O méchante fortune!-Ne nous abandonne pas.
(Bruit de guerre d'un moment.)
LE CONNÉTABLE. – Allons, tous nos rangs sont rompus.
LE DAUPHIN. – O honte qui ne passera point! Poignardons-nous nous-mêmes. Sont-ce là ces misérables soldats dont nous avons joué le sort aux dés?
LE DUC D'ORLÉANS. – Est-ce là le roi à qui nous avons envoyé demander sa rançon?
BOURBON. – Opprobre! éternel opprobre! Partout la honte! – Mourons à l'instant. – Retournons encore à la charge; et que celui qui ne voudra pas suivre Bourbon se sépare de nous, et aille, son bonnet à la main comme un lâche entremetteur, se tenir à la porte pendant qu'un esclave aussi grossier que mon chien souille de ses embrassements la plus belle de ses filles.
LE CONNÉTABLE. – Que le désordre, qui nous a perdus, nous sauve maintenant! Allons par pelotons offrir notre vie à ces Anglais.
LE DUC D'ORLÉANS. – Nous sommes encore assez d'hommes vivants dans cette plaine pour étouffer les Anglais dans la presse, au milieu de nous, s'il est possible encore de rétablir un peu d'ordre.
BOURBON. – Au diable l'ordre, à présent! – Je vais me jeter dans le fort de la mêlée. Abrégeons la vie: autrement notre honte durera trop longtemps.
(Ils sortent.)
SCÈNE VI
Autre partie du champ de bataille
Bruits de guerre. LE ROI HENRI entre avec ses soldats, puis EXETER et suite
LE ROI. – Nous nous sommes conduits à merveille, braves compatriotes: mais tout n'est pas fait; les Français tiennent encore la plaine.
EXETER. – Le duc d'York se recommande à Votre Majesté.
LE ROI. – Vit-il, ce cher oncle? Trois fois, dans l'espace d'une heure, je l'ai vu terrassé, et trois fois se relever et combattre. De son casque à son éperon, il n'était que sang.
EXETER. – C'est en cet état, le brave guerrier, qu'il est couché, engraissant la plaine; et à ses côtés sanglants est aussi gisant le noble Suffolk, compagnon fidèle de ses honorables blessures! Suffolk a expiré le premier et York, tout mutilé, se traîne auprès de son ami, se plonge dans le sang figé où baigne son corps, et soulevant sa tête par sa chevelure, il baise les blessures ouvertes et sanglantes de son visage, et lui crie: «Arrête encore, cher Suffolk, mon âme veut accompagner la tienne dans son vol vers les cieux. Chère âme, attends la mienne; elles voleront unies ensemble, comme dans cette plaine glorieuse et dans ce beau combat, nous sommes restés unis en chevaliers.» Au moment où il disait ces mots, je me suis approché et je l'ai consolé. Il m'a souri, m'a tendu sa main, et serrant faiblement la mienne, il m'a dit: – Cher lord, recommande mes services à mon souverain. Ensuite il s'est retourné, et il a jeté son bras blessé autour du cou de Suffolk, et a baisé ses lèvres; et ainsi marié à la mort, il a scellé de son sang le testament de sa tendre amitié, qui a si glorieusement fini. Cette noble et tendre scène m'a arraché ces pleurs que j'aurais voulu étouffer; mais j'ai perdu le mâle courage d'un homme; toute la faiblesse d'une femme a amolli mon âme, et a fait couler de mes yeux un torrent de larmes.
LE ROI. – Je ne blâme point vos armes; car, à votre seul récit, il me faut un effort pour contenir ces yeux couverts d'un nuage, et prêts à en verser aussi. (Un bruit de guerre.) Mais écoutons! Quelle est cette nouvelle alarme? Les Français ont rallié leurs soldats épars! Allons, que chaque soldat tue ses prisonniers. Donnez-en l'ordre dans les rangs.
(Ils sortent.)
SCÈNE VII
Autre partie du champ de bataille
On voit entrer FLUELLEN ET GOWER
FLUELLEN. – Comment! on a tué les enfants et le bagage! C'est contre les lois expresses de la guerre; c'est un trait de bassesse aussi grand, voyez-vous, qu'on en puisse offrir dans le monde. En votre conscience, là, n'est-ce pas?
GOWER. – Il est certain qu'il n'est pas resté un seul de ces jeunes enfants en vie; et ce sont ces infâmes poltrons qui se sauvent de la bataille qui ont fait ce carnage: ils ont encore, outre cela, brûlé ou emporté tout ce qui était dans la tente du roi; aussi le roi a-t-il, très à propos, ordonné à chaque soldat d'égorger chacun leurs prisonniers. Oh! c'est un brave roi!
FLUELLEN. – Il est né à Monmouth, capitaine Gower. Comment appelez-vous la ville où Alexandre le gros est né?
GOWER. – Alexandre le Grand, vous voulez dire?
FLUELLEN. – Quoi, je vous prie, est-ce que le gros et le grand ne sont pas la même chose? Le gros, ou le grand, ou le puissant, ou le magnanime, reviennent toujours au même, sinon que la phrase varie un peu.
GOWER. – Je crois qu'Alexandre le Grand est né en Macédoine. Son père s'appelait… Philippe de Macédoine, à ce que je crois.
FLUELLEN. – Je crois aussi que c'est en Macédoine qu'Alexandre est né. Je vous dirai, capitaine, si vous cherchez dans les cartes du monde, je vous assure que vous trouverez, en comparant Macédoine avec Monmouth, que leur situation, voyez-vous, sont toutes deux les mêmes. Il y a une rivière en Macédoine, il y en a une aussi à Monmouth. Celle de Monmouth s'appelle Wye; mais pour le nom de l'autre rivière, cela m'a passé de la cervelle; mais ça n'y fait rien; c'est aussi semblable l'un à l'autre, comme mes doigts sont avec mes doigts, et elles ont toutes deux du saumon. Si vous faites bien attention à la vie d'Alexandre, la vie de Henri de Monmouth lui ressemble passablement bien aussi, dans ses rages et dans ses furies, et dans ses emportements et dans ses colères, et dans ses humeurs et dans ses chagrins, et dans ses indignations; et aussi étant un peu enivré dans sa cervelle, il a, dans son vin et sa fureur, tué son meilleur ami Clitus.
GOWER. – Notre roi ne lui ressemble pas en ce cas-là; car il n'a jamais tué aucun de ses amis.
FLUELLEN. – Cela n'est pas bien de votre part, voyez-vous, de m'arracher la parole de la bouche avant que mon conte soit fait et fini. Je ne parle qu'en figures et en comparaisons de l'histoire: de même qu'Alexandre tua son ami Clitus étant dans son vin et à boire, de même aussi Henri Monmouth, étant dans son bon sens et sain de jugement, a chassé le gros et gras baron, qui avait ce gros ventre, celui qui était si plein de bons mots, de plaisanteries, de bons tours et de bouffonneries… j'ai oublié son nom…
GOWER. – Quoi! le chevalier Falstaff?
FLUELLEN. – Précisément, c'est lui-même. Je vous dis qu'il y a de braves gens nés à Monmouth.
GOWER. – Voilà Sa Majesté.
(Bruit de guerre. Entrent le roi Henri, Warwick, Glocester, Exeter, Fluellen, etc. Fanfare.)
LE ROI. – Depuis que j'ai posé le pied en France, je ne me suis senti en colère que dans cet instant. Prends ta trompette, héraut: vole à ces cavaliers que tu vois là-bas sur la colline. S'ils veulent combattre, dis leur de descendre, sinon qu'ils évacuent la plaine: leur vue nous offense. S'ils ne veulent prendre ni l'un ni l'autre parti, nous irons les trouver, et nous les précipiterons de cette colline, aussi rapidement que la pierre lancée par les frondes de l'antique Assyrie. En outre, nous couperons la gorge de ceux que nous avons ici, et pas un de ceux que nous prendrons ne trouvera miséricorde. – Va le leur dire.
(Entre Montjoie.)
EXETER. – Voici le héraut de France, mon prince, qui vient vers nous.
GLOCESTER. – Son regard est plus humble que de coutume.
LE ROI. – Quoi donc! Que veut dire ceci, héraut? Ne sais-tu pas que j'ai dévoué ces ossements au payement de ma rançon? Viens-tu encore me parler de rançon?
MONTJOIE. – Non, grand roi. Je viens te demander, au nom de l'humanité, la permission de parcourir cette plaine sanglante, d'y compter nos morts pour les ensevelir, et séparer les nobles des morts vulgaires. Car les vils paysans baignent leurs membres dans le sang des princes; et nombre de princes, ô malédiction sur cette journée! sont noyés dans un sang vil et mercenaire, tandis que leurs coursiers, blessés et enfoncés jusqu'au poitrail dans le sang, s'indignent, et dans leur fureur, foulent sous leurs pieds armés de fer leurs maîtres déjà morts, et les tuent deux fois. O permets-nous, grand roi, d'errer en sûreté dans la plaine, et de disposer de leurs cadavres!
LE ROI. – Je te dirai franchement, héraut, que je ne sais pas si la victoire est à nous, ou non; car je vois encore de nombreux escadrons de vos cavaliers galoper sur la plaine.
MONTJOIE. – La victoire est à vous.
LE ROI. – Louanges en soient rendues à Dieu, et non pas à notre force! – Comment appelle-t-on ce château, qui est tout près d'ici?
MONTJOIE. – On l'appelle Azincourt.
LE ROI. – Nous nommerons donc ce combat la bataille d'Azincourt, donnée le jour des saints Crépin et Crépinien.
FLUELLEN. – Plaise à Votre Majesté, votre grand-père, de fameuse mémoire, et votre grand-oncle, Edouard le Noir, prince de Galles, à ce que j'ai lu dans les chroniques, ont soutenu une bien brave bataille ici en France.
LE ROI. – Il est vrai, Fluellen.
FLUELLEN. – Votre Majesté dit bien vrai. Si Votre Majesté s'en souvient, les Gallois ont été bien utiles dans un jardin où il y avait des poireaux, en portant des poireaux à leurs bonnets à la Monmouth; ce que Votre Majesté sait bien être encore aujourd'hui une marque honorable de ce service-là; et je crois bien aussi que Votre Majesté ne dédaigne pas, sans doute, de porter aussi le poireau à la Saint-David.
LE ROI. – Je le porte, sans doute, en signe d'un honneur mémorable; car je suis Gallois aussi moi-même, vous le savez, mon cher compatriote.
FLUELLEN. – Toute l'eau de la rivière Wye ne laverait pas le sang gallois qui coule dans les veines de Votre Majesté; je peux vous dire cela. Dieu vous bénisse, et vous conserve autant qu'il plaira à Sa Grâce et à Sa Majesté aussi.
LE ROI. – Je te rends grâces, mon cher compatriote.
FLUELLEN. – Par mon Jésus! je suis le compatriote de Votre Majesté, le sache qui voudra; je l'avouerai à toute la terre, je n'ai pas lieu de rougir de Votre Majesté. Dieu soit loué, tant que Votre Majesté sera un honnête homme.
LE ROI. – Dieu veuille me conserver tel. (Montrant le héraut de France.) Que nos hérauts l'accompagnent. Rapportez-moi au juste le nombre des morts de l'une et l'autre armée. (Le roi montrant Williams.) Qu'on m'appelle ce soldat que voilà.
EXETER. – Soldat, venez parler au roi.
LE ROI. – Soldat, pourquoi portes-tu ce gant à ton chapeau?
WILLIAMS. – Sous le bon plaisir de Votre Majesté, c'est le gage d'un homme avec lequel je dois me battre, s'il est encore en vie.
LE ROI. – Est-ce un Anglais?
WILLIAMS. – Sous le bon plaisir de Votre Majesté, c'est un drôle avec qui j'ai eu dispute la nuit dernière, et à qui, s'il est en vie et si jamais il ose réclamer ce gant-là, j'ai juré d'appliquer un soufflet; ou bien, si je puis apercevoir mon gant à son bonnet, comme il a juré foi de soldat qu'il l'y porterait (s'il est en vie), je le lui ferai sauter de la tête d'une belle manière.
LE ROI. – Que pensez-vous de ceci, capitaine Fluellen? – Est-il à propos que ce soldat tienne son serment?
FLUELLEN. – C'est un fanfaron et un lâche s'il ne le fait pas; plaise à Votre Majesté, en conscience.
LE ROI. – Peut-être que son ennemi est un homme d'un rang supérieur, qui n'est pas dans le cas de lui faire raison.
FLUELLEN. – Quand il serait aussi bon gentilhomme que le diable, que Lucifer et Belzébuth lui-même, il est nécessaire, voyez-vous, sire, qu'il tienne son voeu et son serment. S'il se parjurait, voyez-vous, sa réputation serait celle d'un insigne poltron, comme il est vrai que son soulier noir a foulé la terre de Dieu, sur mon âme et conscience.
LE ROI. – Cela étant, tiens ton serment, soldat, quand tu rencontreras ce drôle-là.
WILLIAMS. – Aussi ferai-je, sire, comme il est vrai que je vis.
LE ROI. – Sous qui sers-tu?
WILLIAMS. – Sous le capitaine Gower, sire.
FLUELLEN. – Gower est un bon capitaine, et qui a son bon savoir et une bonne littérature dans la guerre.
LE ROI. – Va le chercher, soldat, et me l'amène.
WILLIAMS. – J'y vais, sire.
(Williams sort.)
LE ROI. – Tiens, Fluellen, porte cette faveur pour moi, et mets-la à ton chapeau. Tandis qu'Alençon et moi nous étions par terre, j'ai arraché ce gant de son casque. Si quelqu'un le réclame, il faut que ce soit un ami d'Alençon, et notre ennemi par conséquent: ainsi, si tu le rencontres, arrête-le si tu m'aimes.
FLUELLEN. – Votre Grâce me fait un aussi grand honneur que puisse en désirer le coeur de ses sujets. Je voudrais, de toute mon âme, trouver l'homme planté sur deux jambes qui se trouvera offensé à la vue de ce gant: voilà tout; mais je voudrais bien le voir une fois. Dieu veuille, de sa grâce, que je le voie!
LE ROI. – Connais-tu Gower?
FLUELLEN. – C'est mon cher ami, sous le bon plaisir de Votre Majesté.
LE ROI. – Je t'en prie, va donc le chercher, et amène-le à ma tente.
FLUELLEN. – Je pars.
LE ROI. – Lord Warwick, et vous, mon frère Glocester, suivez de près Fluellen: le gant que je lui ai donné comme une faveur pourrait bien lui attirer un affront. C'est le gant d'un soldat que je devrais, d'après la convention, porter moi-même. Suivez-le, cousin Warwick. Si le soldat le frappait, comme je présume à son maintien brutal qu'il tiendra sa parole, il pourrait en arriver quelque malheur soudain; car je connais Fluellen pour un homme courageux et, quand on l'irrite, vif comme le salpêtre: il sera prompt à lui rendre injure pour injure. Suivez-le, et veillez à ce qu'il n'arrive aucun malheur entre eux deux. Venez avec moi, vous, mon oncle Exeter.
Quid fugis hanc cladem? quid olentes deseris agros?Has trahe, Cæsar, aquas; hoc, si potes, utere coelo.Sed tibi tabentes populi Pharsalica ruraEripiunt, camposque tenent victore fugato. Corneille a imité ce passage dans Pompée:
..................de charsSur ses champs empestés confusément épars;Ces montagnes de morts, privés d'honneurs suprêmes,Que la nature force à se venger eux-mêmes;Et de leurs troncs pourris exhalent dans les ventsDe quoi faire la guerre au reste des vivants. Voltaire, dans sa lettre à l'Académie française, oppose les vers qui précèdent à un passage de Shakspeare, mais il s'est prudemment arrêté à ce vers que nous venons de citer. (Steevens.) ]