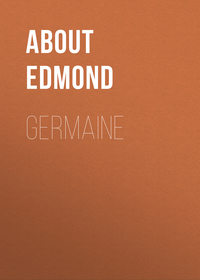Kitabı oku: «Germaine», sayfa 5
«Moi, monsieur, dit-il, j'étais malade, il y a deux ans, comme la jeune dame que nous avons vue passer. Les médecins de Londres et de Paris m'avaient signé mon passe-port, et je cherchais un terrain. Je l'ai choisi aux îles Ioniennes, dans la partie méridionale de Corfou. Je m'y suis installé en attendant mon heure, et je m'y suis trouvé si bien que l'heure a passé.»
Le docteur prit la parole avec ce sans façon qui règne dans les tables d'hôte d'Italie: «Vous avez été phthisique, monsieur?
–Au troisième degré, si toutefois la Faculté ne s'est pas moquée de moi.» Il cita les noms des médecins qui l'avaient traité et condamné. Il raconta comment il avait fini par se soigner lui-même, sans remèdes nouveaux, à la campagne, loin du bruit, dans l'attente de la mort, et sous le ciel de Corfou.
M. Le Bris lui demanda la permission de l'ausculter. Il s'y refusa avec une terreur comique. On lui avait conté l'histoire du médecin qui tua son malade pour savoir comment il avait guéri.
Une heure après, le comte était assis au chevet de Germaine. La malade avait la figure rouge, la parole haletante. «Venez ici, dit-elle à son mari. J'ai à vous parler sérieusement. Remarquez-vous que je vais mieux ce soir? Je suis peut-être en voie de guérison. Voilà votre avenir compromis. Si j'allais vivre! Je vous ai déjà fait perdre trois mois; personne ne s'y attendait. Nous avons la vie dure dans ma famille: il faudra me tuer. Vous en auriez le droit, je le sais; vous avez payé pour cela. Mais laissez-moi encore quelques jours: la lumière est si belle! Il me semble que l'air devient plus doux à respirer.»
Don Diego lui prit la main: elle était brûlante. «Germaine, lui dit-il, je viens de dîner avec un jeune Anglais que je vous montrerai demain. Il était plus malade que vous, à ce qu'il assure; le ciel de Corfou l'a guéri. Voulez-vous que nous allions à Corfou?»
Elle se leva sur son séant, le regarda dans les yeux, et lui dit avec une émotion qui tenait du délire:
«Dis-tu vrai?… Je pourrais vivre?… Je reverrais ma mère? Ah! si tu me sauvais, toute ma vie serait trop peu pour payer tant de reconnaissance. Je te servirais en esclave; j'élèverais ton fils; j'en ferais un grand homme!… Malheureuse! ce n'est pas pour cela que tu m'as choisie. Tu aimes cette femme, tu la regrettes, tu lui écris, tu aspires au moment de la revoir, et toutes les heures de ma vie sont des vols que je te fais!»
Elle fut au plus mal pendant deux jours, dans cette chambre d'auberge, et l'on crut qu'elle mourrait sur les ruines de Pompeï. Cependant elle put se lever dans la première semaine d'avril. On la conduisit à Naples; on l'embarqua sur un paquebot qui partait pour Malte, et de là un vapeur du Lloyd autrichien la transporta jusqu'au port de Corfou.
V
LE DUC
M. et Mme de La Tour d'Embleuse avaient dit adieu à leur fille dans la sacristie de Saint-Thomas d'Aquin. La duchesse avait beaucoup pleuré; le duc avait pris la séparation plus gaiement, pour rassurer sa femme et sa fille; peut-être aussi parce qu'il n'avait pas trouvé de larmes dans ses yeux. Au fond du coeur, il ne s'attendait pas à la mort de Germaine. Lui seul, avec la vieille comtesse de Villanera, croyait au miracle de la guérison. Ce chevalier servant de la fortune était fermement convaincu qu'un bonheur ne vient jamais seul. Tout lui semblait possible, depuis qu'il avait repris le dessus et que la veine lui était revenue. Il commença par prédire le rétablissement de sa femme, et l'événement lui donna raison.
La duchesse était d'une constitution robuste, comme toute sa famille. Les fatigues, les veilles et les privations avaient eu grande part à la maladie critique que l'âge lui avait apportée. Ajoutez les angoisses quotidiennes d'une mère qui attend le dernier soupir de sa fille. Mme de La Tour d'Embleuse souffrait autant et plus des douleurs de Germaine que des siennes. Lorsqu'elle fut séparée de sa chère malade, elle se remit peu à peu, et elle partagea moins péniblement des maux qu'elle ne voyait plus. L'imagination nous fait souffrir aussi bien que les sens, mais un malheur éloigné de nos yeux perd quelque chose de sa crudité. Si nous voyons écraser un homme dans la rue, nous éprouvons une douleur physique, comme si la voiture nous avait blessés nous-mêmes; le récit de cet événement dans les Faits divers d'un journal nous effleure assez légèrement. La duchesse ne pouvait être ni heureuse ni tranquille, mais du moins elle échappa à l'action directe du danger sur son système nerveux. Elle ne fut jamais rassurée, mais elle ne vécut pas dans l'attente du dernier soupir de sa fille. Elle n'ouvrit jamais sans trembler une lettre d'Italie; mais, dans l'intervalle de chaque courrier, elle eut des instants de répit. Aux vives angoisses qui la torturaient, succéda une douleur sourde, que l'accoutumance lui rendit familière. Elle éprouva le triste soulagement d'un malade qui est passé de l'état aigu à l'état chronique.
Un ami du jeune docteur lui donnait ses soins deux ou trois fois par semaine; mais son vrai médecin était toujours M. Le Bris. Il lui écrivait régulièrement, ainsi qu'à Mme Chermidy, et, quoiqu'il s'étudiât à ne jamais mentir, les deux correspondances ne se ressemblaient guère. Il répétait à la pauvre mère que Germaine vivait, que la maladie s'était arrêtée en chemin, et que cette heureuse suspension d'une marche fatale pouvait faire espérer un miracle. Il ne se vantait pas de la guérir, et il disait à Mme Chermidy que Dieu seul pouvait ajourner indéfiniment le veuvage de don Diego. La science était impuissante à sauver la jeune comtesse de Villanera. Elle vivait encore, et la maladie semblait s'être arrêtée en route, mais comme un voyageur se repose dans une auberge, pour mieux marcher le lendemain. Germaine était toujours faible pendant le jour, fiévreuse et agitée aux approches de la nuit. Le sommeil lui refusait ses consolations; l'appétit lui venait par caprices, et elle repoussait les mets avec dégoût dès qu'elle les avait effleurés. Sa maigreur était effrayante, et Mme Chermidy aurait eu plaisir à la voir. Cette peau limpide et transparente accusait chaque saillie osseuse et chaque pli musculaire; les pommettes des joues semblaient sortir de la figure. Il fallait, en vérité, que Mme Chermidy fût bien impatiente pour demander quelque chose de mieux!
Le duc n'en savait pas si long, et il célébrait déjà par des réjouissances variées la guérison de sa fille. Dans l'âge de la sagesse, ce vieillard, dont on eût respecté les cheveux blancs s'il n'avait pris soin de les teindre, résistait mieux qu'un jeune homme à toutes les fatigues du plaisir. On devinait aisément qu'il serait plus tôt au bout de ses écus qu'au bout de ses besoins et de ses forces. Les hommes qui sont entrés tard dans la vie trouvent des réserves extraordinaires pour leurs dernières années.
Il avait peu d'argent comptant, tout millionnaire qu'il était. Le premier semestre de ses rentes devait échoir au 22 juillet; en attendant, il fallait vivre sur les 20 000 fr. de la corbeille. C'était assez pour le ménage et pour les petites dettes, qui attendent moins patiemment que les grosses. Si la duchesse avait eu la disposition de cette modeste fortune, elle aurait mis la maison sur un pied honorable; mais le duc avait toujours tenu l'argent sous sa clef, lorsqu'il y avait eu de l'argent au logis. Il satisfit peu de créanciers; il refusa poliment d'acheter des meubles, et garda, en dépit de la duchesse et de la raison, un appartement de 12 000 francs, où il n'était presque jamais. De temps en temps il donnait un louis à Sémiramis pour les dépenses de la cuisine, mais il ne songea pas à demander combien on lui devait pour ses gages. Il acheta deux ou trois robes magnifiques à la duchesse, qui manquait du linge le plus nécessaire. Ce qu'il employait chaque jour à ses dépenses personnelles était un secret entre son tiroir et lui.
Ne croyez pas cependant qu'il affichât l'égoïsme odieux de certains maris qui jettent l'argent sans compter et veulent connaître à un centime près les déboursés de leurs femmes. Il accordait à la duchesse autant de liberté pour les petites dépenses qu'il s'en réservait pour les grandes. Il était toujours cet homme poli, prévenant et tendre que la pauvre femme adorait jusque dans ses fautes. Il s'informait de sa santé avec une attention presque filiale. Il lui répétait au moins une fois par jour: «Vous êtes mon ange gardien.» Il lui donnait des noms si doux que, sans le témoignage des miroirs, elle aurait pu se croire à vingt ans. C'est quelque chose, cela; et le plus mauvais mari n'est méprisable qu'à moitié lorsqu'il laisse une douce illusion à sa victime. Un grand artiste qui a vu notre société avec les yeux de Balzac, et qui l'a mieux dessinée, M. Gavarni, a mis ce singulier jugement dans la bouche d'une femme du peuple: «Mon homme, un chien fini; mais le roi des hommes!» Traduisez la phrase en style noble, et vous comprendrez l'amour obstiné de la duchesse pour son mari.
Cependant le vieillard descendait rapidement tous les échelons qu'un homme bien né peut descendre. Lorsque le bruit de sa nouvelle fortune se fut répandu dans Paris, il retrouva au Bois un certain nombre d'anciennes connaissances qui avaient pris l'habitude de détourner la tête à sa rencontre. On l'invita dans quelques-uns de ces salons du faubourg Montmartre, où les hommes les plus élégants et les plus honorables vont quelquefois porter la bonne compagnie et chercher la mauvaise. Il retrouva ça et là des meubles qu'il avait achetés de son argent; il regarda l'heure à des pendules dont il avait payé la facture. La rage du jeu, qui sommeillait en lui depuis plusieurs années, se réveilla plus ardente qu'autrefois; mais il joua en dupe, autour de ces tapis suspecte où la police vient de temps en temps balayer les enjeux. Ce monde dangereux, qui excelle à flatter tous les vices dont il vit, ménagea une rentrée triomphale au duc de La Tour d'Embleuse. On applaudit en lui cette jeunesse posthume qui sortait de la misère comme Lazare de son tombeau. On lui prouva qu'il avait vingt ans; il essaya de se le prouver à lui-même. Il se remit à souper, au grand détriment de son estomac; il but du vin de Champagne, fuma des cigares et casse des bouteilles. Dans ces sortes de réunions, la dignité reste au vestiaire. Cependant les nouveaux débarqués de la province, les étrangers égarés à Paris ou les fils de famille échappés de tutelle, admirèrent les grandes façons et la tournure aristocratique de ce gentilhomme déchu. Les hommes le respectaient plus qu'il ne se respectait lui-même; les femmes contemplaient en lui une ruine qu'elles avaient faite et qui tenait bon, malgré tout. Dans un certain recoin de la société, on fait plus de cas d'un vétéran qui a mangé cent vingt mille livres de rente que d'un soldat qui a perdu deux bras sur le champ de bataille.
Il suivit cette société sur tous les terrains où elle se transporte. Il fut assidu aux premières représentations des petits théâtres; on le remarqua aux avant-scènes des Folies-Dramatiques. Le respect de son nom, qui l'avait accompagné dans la première moitié de sa carrière, parut l'abandonner sans retour. Il devint en deux mois le vieillard le plus affiché de Paris. Peut-être aurait-il mis plus de retenue dans sa conduite si le bruit de ses actions avait pu arriver jusqu'à sa famille. Mais Germaine était en Italie; la duchesse était cloîtrée au faubourg; il n'avait rien à ménager.
Le contraste de son nom et de sa conduite lui fit en peu de temps une popularité de bas étage dont il se laissa enivrer. On le vit, à la sortie du spectacle, dans un café du boulevard du Temple, entouré de figurants au menton bleu et de comédiens infimes qui buvaient du punch en son honneur, le contemplaient de tous leurs yeux éraillés, et se disputaient la gloire de serrer la main à un duc qui n'était pas fier. Il tomba plus bas encore, s'il est possible. Dans un temps où les Porcherons sont bien passés de mode, il franchit les barrières avec sa compagnie, et s'assit plus d'une fois devant un saladier de vin rouge, à la table d'un cabaret. Il est bien difficile, au XIXe siècle, de s'encanailler avec élégance. C'est un tour de force que la cour de Louis XV a tenté avec quelque succès. Deux ou trois grands seigneurs français et étrangers ont essayé de faire revivre ces traditions du bon temps, mais en pure perte. L'âme la plus hautaine croule avec une rapidité incroyable dans les divertissements malsains et les fêtes nauséabondes des faubourgs. Les seules débauches auxquelles on résiste quelque temps sont celles qui coûtent fort cher. Le contentement de peu, qui est une vertu chez les hommes de travail, est le dernier degré de l'abaissement chez les hommes de plaisir.
Le pauvre duc était au plus bas quand deux personnes lui tendirent la main par des motifs bien différents. Ses sauveurs furent le baron de Sanglié et Mme Chermidy.
M. de Sanglié venait de temps en temps sonner chez les La Tour d'Embleuse. Il était leur ancien propriétaire, le témoin du mariage de Germaine, et l'ami de la famille. Il trouvait toujours la duchesse, jamais le duc; mais tout Paris lui donnait des nouvelles de son déplorable ami. Il résolut de le sauver comme il l'avait logé autrefois, pour l'honneur du faubourg.
Le baron est ce qu'on appelle encore aujourd'hui un parfait gentilhomme. Il n'est pas beau, et il a quelque peu la physionomie de son nom. Sa grosse figure colorée se cache dans un buisson de barbe rousse. Il est robuste comme un chasseur, avec une pointe de ventre, et vous ne lui donneriez pas plus de quarante ans, quoiqu'il en ait cinquante. Les barons de Sanglié datent d'une époque où l'on bâtissait solidement. Assez riche pour mener grand train sans rien faire, il se traite en ami, prend soin de sa personne, et vit pour vivre bien. Son costume et sa tournure sont également aristocratiques. On le rencontre le matin dans des vêtements larges, solides, confortables et d'une élégance coquettement négligée. Le soir, il est irréprochable sans avoir l'air habillé. Il est de ces hommes fort rares dont la tenue ne frappe jamais les yeux: on dirait que leurs habits ont poussé sur eux et sont le feuillage naturel de leur personne. Ses redingotes se font à Londres et ses habits à Paris. Il a soin de son corps, cet autre vêtement de l'homme. Il monte à cheval tous les jours et fréquente le jeu de paume; le soir il est abonné aux deux opéras, et il fait le whist à son club. Beau joueur, bon convive et buveur magnifique; grand connaisseur en cigares, grand amateur de tableaux, assez bon cavalier pour gagner un steeple-chase, trop sage pour faire courir et jeter sa fortune dans une écurie d'entraînement; indifférent aux livres nouveaux, insouciant des choses politiques, prêteur facile à ceux qui peuvent rendre, généreux à l'occasion pour ceux qui n'ont rien, très-rond avec les hommes, d'une politesse cavalière avec les femmes, il est aimable et bon comme tous les égoïstes intelligents. Faire le bien sans s'incommoder, c'est encore de l'égoïsme.
Le sauvetage du pauvre duc n'était pas une opération facile. Le baron n'en serait jamais venu à bout sans un auxiliaire puissant, la vanité. Elle surnageait encore un peu, dans ce triste naufrage de toutes les vertus aristocratiques; M. de Sanglié le prit par là, comme on arrête un noyé par les cheveux.
Il s'en alla le chercher jusque dans les bouges où il traînait son nom et sa caste. Il lui frappa rudement sur l'épaule et lui dit, avec cette franchise qui cache si bien la flatterie: «Que faites-vous ici, mon cher duc? Vous n'êtes pas à votre place. Tout le monde vous désire au faubourg, hommes et femmes; m'entendez-vous bien? Tous les La Tour d'Embleuse y ont tenu leur rang depuis Charlemagne: je ne vous reconnais pas le droit de faire banqueroute à vos ancêtres. Nous avons tous besoin de vous. Eh, morbleu! si vous vous enterrez ici, à la fleur de l'âge mûr, qui est-ce qui nous donnera des leçons d'élégance? qui est-ce qui nous apprendra la grande vie, l'art de manger proprement une fortune et l'art de plaire aux femmes, qui va se perdant tous les jours?»
Le duc répondit en grommelant, comme un buveur réveillé mal à propos. Il cuvait en paix sa nouvelle fortune; il ne se souciait pas de reprendre les habitudes gênantes que le monde impose à ses esclaves; une paresse invincible l'enchaînait aux plaisirs faciles qui n'exigent aucuns frais de toilette, de décence ou d'intelligence. Il prétendit qu'il était bien, qu'il ne voulait rien de mieux, et que chacun prend son plaisir où il le trouve.
«Venez avec moi, reprit le baron, et je jure de vous faire trouver des divertissements plus dignes de vous. Ne craignez pas de perdre au change: on vit bien dans notre monde, et vous le savez mieux que personne. Vous ne supposez pas que je sois venu ici pour vous ramener dans votre ménage: je vous aurais envoyé un missionnaire. Que diable! je suis un peu de votre école. Je ne méprise ni le vin, ni le jeu, ni l'amour; mais je maintiendrai contre tout le monde et contre vous-même qu'un duc de La Tour d'Embleuse ne doit s'enivrer, se ruiner ou se damner que dans la compagnie de ses pairs!»
C'est par des arguments de cette sorte que le vieillard se laissa convertir. Il revint, non pas à la vertu, la route était trop longue pour ses vieilles jambes, mais au vice élégant. M. de Sanglié le mena chez un grand tailleur du boulevard, comme on conduit un réfractaire chez le capitaine d'habillement. On le força d'endosser la livrée des gens du monde. Ce singulier malade était toujours idolâtre de sa vieille personne, mais il économisait depuis longtemps sur les frais du culte. Il avait gardé l'habitude de se teindre et de se peindre, et il ne négligeait aucune des pratiques qui pouvaient lui rendre une apparence de jeunesse; mais il ne détestait pas de paraître plus neuf que son habit. On lui prouva, par quelques mètres de drap fin, qu'un habit neuf rajeunit la tournure, et il confessa de lui-même que les tailleurs n'étaient pas gens à mépriser. C'était un grand pas en avant: un homme habillé est à moitié sauvé. Les pères de famille le savent bien: lorsqu'ils viennent à Paris arracher un enfant prodigue à la mauvaise compagnie, leur premier soin est de le conduire chez un tailleur.
Le baron se chargea de lancer son élève. Il le fit admettre à son club. On y dînait bien, et M. de La Tour d'Embleuse ne perdit pas à changer de cuisine. Avant sa conversion, la nourriture épicée des cabarets et l'usage des boissons frelatées irritaient son estomac, rougissaient sa langue et le condamnaient à une soif inextinguible. Il la trompait en buvant de plus belle, et le pauvre homme était dans un cercle vicieux dont il n'aurait pu sortir que par la mort. La duchesse s'effrayait quelquefois de son haleine ardente. Elle n'osait lui avouer ses terreurs, mais elle plaçait discrètement auprès de son lit quelque tisane fraîche et parfumée qu'il laissait perdre. La table d'hôte le rétablit insensiblement, quoiqu'il ne s'y privât de rien. L'appât du jeu le retint sous la férule de son sauveur. Les abonnés du club jouaient le whist et l'écarté avec une certaine hardiesse, mais sans intempérance. Les plus fortes parties du whist coûtaient rarement plus d'un louis la fiche: c'est une distraction sans danger pour un millionnaire. S'il aventurait un fort pari autour d'une table d'écarté, personne n'avait le droit de le rappeler à la raison; mais du moins on s'entendit pour ménager sa bourse. On le connaissait, et l'on s'intéressait à lui comme à un convalescent. Un joueur se comporte comme un sage ou comme un fou, selon qu'il est poussé ou retenu par ceux qui l'entourent. On le retint, et d'une main si délicate, qu'il ne sentit pas la bride.
Les salons les plus honorables lui ouvrirent leurs portes à deux battants. Toute aristocratie est naturellement franc-maçonne; et un duc, quoi qu'il ait fait, a des droits imprescriptibles à l'indulgence de ses égaux. Le faubourg Saint-Germain, comme le fils respectueux de Noé, couvrit d'un manteau de pourpre les anciens égarements du vieillard. Les hommes le traitèrent avec considération; les femmes, avec bienveillance. Dans quel pays ont-elles manqué d'indulgence pour les mauvais sujets? On le regarda comme un voyageur qui avait traversé des pays inconnus. Cependant, aucune femme n'osa lui demander ses impressions de voyage. Il se remit sans embarras au ton de la bonne compagnie, car il unissait à tous les défauts de la jeunesse cette flexibilité d'esprit qui en est la plus belle parure. On trouva en lui un homme digne de son nom et de sa fortune, et l'on comprit le choix de M. de Villanera, qui l'avait accepté pour beau-père.
Le baron lui avait promis des plaisirs plus vifs: il tint parole. Il ne l'enferma pas dans le faubourg comme dans une forteresse; il lui fit voir un peuple moins collet-monté. Il le conduisit sur la lisière du grand monde, dans quelques-uns de ces salons dont on médit sans preuves, mais non sans raison. Il le présenta à des veuves dont le mari n'était jamais venu à Paris, à des femmes légitimement mariées, mais brouillées avec leur famille, à des marquises exilées du faubourg à la suite d'une action d'éclat, à des personnes honorables qui menaient grand train sans fortune connue. Cette société mitoyenne touche par un côté au monde et par l'autre au demi-monde. Je ne conseillerai pas à une mère d'y conduire sa fille, mais bien des fils y vont avec leur père, et en sortent comme ils y sont entrés. On n'y trouve pas cette austérité de moeurs, cette vie patriarcale, ce ton parfait, ce langage digne et soutenu qui règne dans les vieux salons du faubourg, mais on y danse convenablement, on y joue sans tricher, et l'on n'y vole pas les paletots dans l'antichambre. C'est dans une de ces maisons que le duc tomba en présence de Mme Chermidy.
Elle le reconnut au premier coup d'oeil, pour l'avoir vu le jour du mariage. Elle savait qu'il était grand-père de son fils, père de Germaine et millionnaire aux dépens de don Diego. Une femme de l'étoffe de Mme Chermidy n'oublie jamais la figure d'un homme à qui elle a donné un million. Elle n'aurait pas été fâchée de le connaître de plus près, mais elle était trop fine pour risquer un pas en avant. Le duc lui épargna les trois quarts du chemin. Dès qu'il sut qui elle était, il se présenta lui-même, avec une impertinence dont le spectacle eût réjoui toutes les honnêtes femmes de Paris. Rien ne flatte plus profondément les femmes vertueuses que de voir traiter sans façon celles qui ne le sont pas.
Le duc n'avait pas l'intention d'offenser une jolie femme et de renier en un seul jour la religion de toute sa vie; mais il parlait aux gens dans leur langage, et il croyait savoir la nationalité de Mme Chermidy. Il s'assit familièrement auprès d'elle et lui dit:
«Madame, permettez-moi de vous présenter un de vos vieux admirateurs, le duc de La Tour d'Embleuse. J'ai déjà eu le plaisir de vous voir à Saint-Thomas d'Aquin. Nous sommes un peu de la même famille: alliés par les enfants. Permettez donc qu'en bon parent je vous tende la main gauche.»
Mme Chermidy, qui raisonnait avec la promptitude de l'éclair, comprit au premier mot la position qui lui était faite. Quelque réponse qu'elle imaginât, le duc avait le dessus. Au lieu d'accepter la main qu'il lui tendait, elle se leva par un mouvement de douleur et de dignité qui fit valoir toute la richesse de sa taille, et elle s'avança vers la porte sans retourner la tête, comme une reine outragée par le dernier de ses sujets.
Le vieillard fut pris au piège. Il courut à elle, et balbutia quelques paroles d'excuse. La belle Arlésienne jeta sur lui un regard si brillant, qu'il crut y voir glisser une larme. Elle lui dit à demi-voix, avec une émotion bien contenue ou bien jouée: «Monsieur le duc, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Venez demain à deux heures; je serai seule, nous causerons.»
Là-dessus elle s'éloigna, en femme qui ne veut plus rien entendre, et cinq minutes plus tard la voiture roulait sur le sable de la cour.
Le pauvre duc avait été prévenu; il savait sa dame par coeur, et M. Le Bris la lui avait dépeinte sous ses couleurs naturelles. Mais il se reprocha ce qu'il avait fait, et il vécut jusqu'au lendemain dans un étonnement qui n'était pas exempt de remords. On dit cependant qu'un homme averti en vaut deux.
Il fut exact au rendez-vous, et se trouva face à face avec une femme qui avait pleuré.
«Monsieur le duc, lui dit-elle, j'ai fait tout mon possible pour oublier les paroles cruelles par lesquelles vous m'avez abordée hier soir. Je ne suis pas encore bien remise, mais cela viendra: n'en parlons plus.»
Le duc voulut réitérer ses excuses; il était dans une admiration profonde. Mme Chermidy avait employé sa matinée à faire une toilette irrésistible. Assurément elle paraissait encore plus belle que la veille au bal. Une femme est dans son boudoir comme un tableau dans son cadre. Elle profita du trouble où ses grâces avaient jeté M. de La Tour d'Embleuse, pour l'envelopper dans les plis d'une rhétorique irrésistible. Elle employa d'abord le respect timide qui convenait à une femme dans sa position. Elle témoigna une vénération exagérée pour l'illustre famille où elle avait introduit son fils; elle s'attribua l'honneur d'avoir choisi les La Tour d'Embleuse entre vingt grandes maisons du faubourg, et d'avoir relevé par la fortune un des plus beaux noms de l'Europe. Les mouvements moelleux, et la langueur mélancolique dont cet exorde fut accompagné persuadèrent le vieillard beaucoup mieux que les paroles, et il ne douta presque plus qu'il n'eût insulté sa bienfaitrice.
«Je comprends, reprit-elle, que vous n'ayez pas grande estime pour moi. Vous me plaindriez cependant, car vous avez uns belle âme, si vous saviez l'histoire de ma vie.»
Elle avait cette pantomime expressive des habitants du midi, qui ajoute tant de vraisemblance aux plus gros mensonges. Ses yeux, ses mains, son petit pied remuant, parlaient en même temps que ses lèvres et semblaient déposer en faveur de sa véracité. Lorsqu'on l'avait entendue une fois, on était aussi fermement convaincu que si l'on avait ouvert une enquête et interrogé des témoins.
Elle raconta sa naissance bourgeoise dans une riche propriété de la Provence. Ses parents, gros manufacturiers, destinaient à un négociant leur fille et leur fortune. Mais l'amour, ce maître inflexible de la vie humaine, l'avait jetée aux bras d'un simple officier. Sa famille s'était retirée d'elle, jusqu'au moment où les brutalités de M. Chermidy l'avaient chassée de la maison conjugale Pauvre Chermidy! une femme a toujours beau jeu contre un mari qui est en Chine!
Une fois veuve, ou à peu près, elle était venue à Paris, et elle y avait vécu modestement jusqu'à la mort de son père. Un héritage plus considérable qu'on ne l'espérait lui avait permis de tenir un certain rang. Quelques spéculations heureuses avaient accru son capital; elle était riche. L'ennui l'avait prise: on supporte mal la solitude à trente ans. Elle avait aimé le comte de Villanera dès la première vue, sans le connaître, au balcon des Italiens.
Le duc ne put s'empêcher de dire en lui-même que don Diego était un heureux gaillard.
Elle prouva ensuite par des regards où brillait une candeur sans réplique que M. de Villanera ne lui avait jamais rien donné que son amour. Non qu'il manquât de générosité; mais elle n'était pas femme à confondre les affaires de coeur et les affaires d'intérêt. Elle avait poussé le désintéressement jusqu'au sacrifice; elle avait cédé son enfant à la vieille comtesse de Villanera; elle avait fini par l'abandonner à une autre mère. Elle avait rendu la liberté à son amant. Le comte était marié; il voyageait pour rétablir la santé de sa jeune femme, et il n'écrivait même pas à la pauvre délaissée pour lui donner des nouvelles du petit Gomez!
Elle finit son discours en laissant tomber ses deux bras vers la terre avec un abandon plein d'élégance. «Enfin, dit-elle, me voici, plus seule que jamais, dans ce désoeuvrement du coeur qui m'a déjà perdue une fois. Des consolations, je n'en ai pas; des distractions, j'en trouverais assez; mais je n'ai pas le coeur au plaisir. Je connais quelques hommes du monde; ils viennent ici, tous les mardis soir, ressusciter l'esprit de conversation autour de mon feu. Je n'ose pas inviter M. le duc de La Tour d'Embleuse à ces réunions mélancoliques; je serais trop humiliée et trop malheureuse de son refus.»
Certes, la cloche de Mme Chermidy sonnait moins juste que celle du docteur Le Bris; mais le timbre en était si doux, que le duc se laissa tromper comme un enfant. Il plaignit la jolie femme, et promit de venir de temps en temps lui apporter des nouvelles de son fils.
Le salon de Mme Chermidy était, en effet, le rendez-vous d'un certain nombre d'hommes distingués. Elle savait les attirer et les retenir autour d'elle par un moyen moins héroïque que celui de Mme de Warens: elle s'en faisait aimer à moins de frais. Les uns connaissaient sa position, les autres croyaient à sa vertu; tous étaient persuadés que son coeur était libre, et que le dernier possesseur, qu'il s'appelât Villanera ou Chermidy, avait laissé une succession ouverte. Elle usait du bénéfice de sa position pour exploiter tous ses admirateurs au profit de sa fortune. Artistes, écrivains, hommes d'affaires, hommes du monde, la servaient simultanément dans la mesure de leurs moyens. C'étaient autant d'employés qu'elle payait en espérances. Un agent de change de ses amis lui faisait pour 20 000 francs de reports tous les mois; un peintre lui marchandait des tableaux, un spéculateur enrichi lui procurait des terrains. Services gratuits s'il en fut; mais aucun ne se lassait de lui être utile, parce qu'aucun ne désespérait de lui être cher. Aux impatients qui la serraient de trop près, elle montrait sa maison: une maison de verre. Elle mettait ses moindres actions au grand jour, pour rassurer la susceptibilité de don Diego; peut-être aussi pour opposer une barrière à ceux qui voudraient le prendre trop haut avec sa vertu.
Le duc profita des grandes entrées qui lui étaient offertes, et sa présence dans le salon de la rue du Cirque ne fut pas inutile à la réputation de Mme Chermidy. Elle arrêta certains bruits qui circulaient sur le mariage du comte; elle prouva à quelques âmes crédules qu'il n'y avait jamais rien eu entre la petite dame et M. de Villanera. Comment supposer que Mme Chermidy inviterait le beau-père de son amant, et qu'il viendrait chez elle?