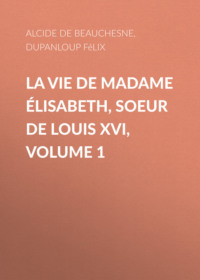Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Vie de Madame Élisabeth, soeur de Louis XVI, Volume 1», sayfa 10
Maintenant que l'heure de la jeunesse a sonné pour Madame Élisabeth, dois-je essayer de crayonner ici son portrait, quand elle-même avait une invincible répugnance à permettre la reproduction de ses traits? Dirai-je que sa taille n'était pas élevée, que son port était privé de cette majesté qu'on admirait dans la Reine, et que son nez avait la forme qui caractérisait la physionomie bourbonienne? Je le veux bien; mais j'ajouterai, pour être juste, que son front, dont les lignes pleines de pureté imprimaient à sa physionomie un cachet de noblesse et de candeur, ses yeux bleus avec leur douceur pénétrante, sa bouche, dont le sourire laissait apercevoir des dents d'ivoire, et enfin l'expression d'esprit et de bonté répandue sur toute sa personne, formaient un ensemble charmant et sympathique.
«La vigilance de son ange gardien, dit M. de Falloux dans son beau livre de Louis XVI, ne la surprit jamais sans trouver le zèle de la religion dans ses actions ou dans ses pensées. Pleine d'attraits devant Dieu, elle était parée aussi de tous les dons qui séduisent le monde… Le reflet de l'âme brillait dans ses yeux comme dans ses paroles; intime complément de son frère, dont elle vécut et mourut inséparable, elle était la bonne grâce de toutes ses vertus.»
Telle était Madame Élisabeth à quinze ans lorsque, sortie des mains de mesdames de Guéménée et de Mackau, elle prit à la cour son rang de fille de France et de sœur du Roi.
Son appartement dans le palais de Versailles était situé à l'extrémité de la façade de l'aile du midi, ayant vue sur la pièce d'eau des Suisses. Le gouvernement de Juillet a fait disparaître les cloisons qui formaient les différentes chambres de cet appartement, et en a formé une seule et même salle destinée à recevoir les tableaux représentant les événements de 1830, et qui fait suite à la galerie des Batailles. Le visiteur qui s'arrête devant les scènes de la révolution de juillet ne se doute pas que le lieu où il les contemple a été sanctifié par la plus innocente victime d'une autre révolution.
Le samedi 19 décembre, vers minuit et demi, Marie-Antoinette ayant ressenti les premières douleurs de l'enfantement, la princesse de Chimay, sa dame d'honneur, alla avertir le Roi, qui se rendit chez la Reine. Toute la famille royale fut également avertie et se trouva bientôt réunie dans le grand cabinet de Sa Majesté, où arrivèrent aussi le garde des sceaux de France, les ministres et secrétaires d'État, tous les officiers et dames de la cour. Les douleurs de la Reine durèrent toute la nuit. Avertis dès six heures du matin par l'arrivée d'un page du duc de Cossé, gouverneur de la capitale, le prévôt des marchands et échevins, procureur du Roi, greffier et receveur, composant le bureau de la ville de Paris, s'étaient rendus sur-le-champ à l'hôtel de ville. À une heure, le marquis de Béon, sous-lieutenant des gardes du corps, y arriva et annonça de la part du Roi que la Reine était accouchée d'une princesse à onze heures trente-cinq minutes du matin.
«Cette nouvelle, dit la Gazette de France du mardi 22 décembre 1778, fut annoncée sur-le-champ au peuple par une décharge de l'artillerie de la ville, dont le bureau députa les deux premiers échevins, qui se transportèrent dans les prisons et firent sortir tous les prisonniers qui y étoient détenus pour mois de nourrice, après les avoir acquittés à cet égard. – Le soir, il fut allumé sur la place, devant l'hôtel de ville, un feu en cérémonie par le gouverneur et le prévôt des marchands et échevins, procureur du Roi, greffier et receveur; il y a eu distribution de pain et de vin à deux buffets, dans la même place, et à côté de chacun de ces buffets étoit un orchestre garni de musiciens; il fut aussi tiré des fusées volantes. – L'hôtel de ville, les hôtels et maisons des gouverneur, prévôt des marchands et échevins, procureur du Roi, greffier et receveur, furent illuminés. – On apprend par le bulletin du 20 de ce mois, signé Lassonne, que l'état de la Reine est aussi satisfaisant qu'on peut le désirer.»
La princesse qui venait de naître fut nommée Marie-Thérèse-Charlotte et titrée Madame, fille du Roi. Elle fut baptisée le même jour par le cardinal prince Louis de Rohan-Guéménée, grand aumônier de France, en présence du sieur Broquevielle, curé de la paroisse Notre-Dame, et tenue sur les fonts de baptême par Monsieur80, au nom du roi d'Espagne, et par Madame, au nom de l'Impératrice-Reine, le Roi étant présent, ainsi que tous les princes et princesses du sang.
La correspondance de madame de Bombelles avec son mari, ministre du Roi près de la diète germanique, que nous aurons souvent l'occasion de citer, nous apprend, à la date du 20 mars 1779, que Madame Élisabeth se trouva fort incommodée l'avant-veille. «Elle eut, dit-elle, une très-forte fièvre pendant la nuit, et hier à trois heures et demie la rougeole a paru. Tu imagines bien que je ne l'ai pas quittée. Cette nuit a été très-bonne; elle a peu de fièvre ce soir, et les médecins assurent qu'il n'y a pas la plus petite inquiétude à avoir. Tu ne peux pas imaginer le chagrin que j'avois. Je suis parfaitement tranquille actuellement.»
C'est vers cette époque que la Reine commença à apprécier sa belle-sœur. Madame de Bombelles écrivait le 22 avril: «Madame Élisabeth est venue nous voir aujourd'hui; elle est revenue hier de Trianon. La Reine en est enchantée; elle dit à tout le monde qu'il n'y a rien de si aimable, qu'elle ne la connoissoit pas encore bien, mais qu'elle en avoit fait son amie, et que ce seroit pour toute sa vie.»
Madame Élisabeth n'avait point encore été vaccinée. Elle regarda comme un devoir de suivre l'exemple que ses tantes et ses frères avaient donné81. Elle se rendit le 23 octobre à Choisy, où devait avoir lieu l'inoculation82. Elle demanda que douze enfants pauvres du pays y fussent associés et reçussent les mêmes soins qu'elle-même. Son vœu fut écouté. Ce fut encore M. Goetz qui fit l'opération, et sur les sept filles et les cinq garçons que l'habile chirurgien y avait préparés, aucune n'eut à regretter d'avoir couru les mêmes chances que la sœur du Roi et d'avoir montré la même confiance qu'elle. Le succès fut complet83, et plus d'une de ces jeunes filles lui demeura reconnaissante. C'était par son exemple en effet qu'elles avaient été encouragées à se soumettre à l'inoculation, et ce fut ainsi qu'elles furent placées à l'abri d'un fléau qui, lorsqu'il ne prend pas la vie, altère ou détruit la santé.
L'année suivante, un grand malheur atteignit la Reine et par contre-coup toute la famille royale.
Dans la soirée du mercredi 6 décembre 1780, on apprit à Versailles la nouvelle de la mort de l'Impératrice-Reine.
Louis XVI, par l'entremise de M. de Chamilly, son premier valet de chambre, chargea l'abbé de Vermond d'apprendre avec ménagement ce triste événement à la Reine, le lendemain matin, et de l'avertir du moment où il entrerait chez elle, ayant l'intention de s'y rendre lui-même un quart d'heure après. Louis XVI s'y présenta à l'heure indiquée; on l'annonça; l'abbé sortit, et comme il se rangeait sur le passage du Roi, celui-ci lui dit ces mots, les seuls que pendant l'espace de dix-neuf ans il lui ait adressés de vive voix: «Je vous remercie, monsieur l'abbé, du service que vous venez de me rendre.»
La douleur de la Reine fut telle que Louis XVI avait pu la prévoir et la redouter. La cour prit spontanément, le jeudi 7, le deuil de respect, n'attendant pas que le Roi eût fixé le jour auquel le grand deuil de cour serait pris. Marie-Antoinette demeura enfermée pendant plusieurs jours dans ses cabinets, où elle ne laissa accès qu'aux membres de la famille royale, à la princesse de Lamballe et à madame de Polignac.
L'Impératrice-Reine de Hongrie et de Bohême avait cessé de vivre le 29 novembre, à l'âge de soixante-trois ans. Les détails qui arrivèrent bientôt de Vienne augmentèrent encore l'émotion qu'avait causée la première nouvelle de sa mort. Marie-Thérèse avait voulu connaître au juste le moment de sa fin. L'Empereur, son fils, s'évanouit en entendant l'arrêt prononcé par le premier médecin. L'Impératrice, avec une fermeté héroïque, le soutint, lui prodigua ses consolations, ses conseils, et lui dicta même des lettres destinées à tout régler dans l'Empire et à faciliter les débuts d'un règne. «Je meurs, dit-elle, avec le regret de n'avoir pu faire à mes peuples tout le bien que j'aurais désiré et de n'avoir pu détourner tout le mal qu'on leur a fait à mon insu84.» Au milieu des événements divers qui avaient illustré son règne, cette grande princesse n'avait jamais abandonné les sentiments de l'humilité chrétienne. Le linceul et les vêtements qui devaient servir à l'ensevelir, faits entièrement de sa royale main, attendaient dans l'armoire d'un de ses cabinets cette heure inévitable, qu'elle avait toujours envisagée avec un esprit calme et résigné.
Ses obsèques eurent lieu à Vienne le dimanche 3 décembre. Son cercueil, après les cérémonies funèbres accomplies avec une pompe solennelle, fut descendu dans l'église des Capucins, auprès de celui de feu l'Empereur François Ier, en présence du grand maître de la cour impériale. Son cœur, renfermé dans une urne, fut déposé au couvent des Augustins déchaussés de Vienne85; ses entrailles furent déposées dans l'église métropolitaine de Saint-Étienne86.
La coutume en Allemagne est de prier pour les morts le lendemain de leurs funérailles, et devant un catafalque d'où leur dépouille est absente.
Le lundi 4 décembre, un superbe cénotaphe fut élevé par la piété filiale à l'auguste défunte et environné des hommages de tout un peuple. La postérité qui commençait pour Marie-Thérèse lui décernait le titre glorieux de mère de la patrie.
Deux jours après, l'Empereur écrivait à son premier ministre le prince de Kaunitz:
«Jusqu'à présent je n'ai su qu'être fils obéissant, et voilà à peu près tout ce que je savois. Par le coup le plus mortel, je me trouve à la tête de mes États et chargé d'un fardeau que je reconnois être beaucoup au-dessus de mes forces. Ce qui me rassure, c'est la persuasion, mon prince, qu'en me continuant vos sages conseils et vos bons avis, je me trouverai essentiellement soulagé dans cette tâche difficile et importante; c'est pour vous en requérir de mon mieux que je vous adresse cette lettre.
»À Vienne, le 6 décembre 1780.»
La Reine ayant reçu de Vienne communication de cette lettre, dit au Roi: «En vérité, mon frère en agit avec le prince de Kaunitz absolument comme vous en avez agi envers M. de Maurepas. Sans doute il est bon que les souverains demandent le concours des hommes dévoués et capables, mais il ne faut pas qu'ils se défient entièrement d'eux-mêmes.»
Marie-Thérèse, par testament fait conjointement avec feu l'Empereur son époux, avait légué à chacun de ses enfants un revenu annuel de quarante mille florins. Indépendamment de ce legs, le grand-duc de Toscane avait la seigneurie de Golsing et Holitsch, et le coadjuteur de Cologne et de Munster, le château de Schlofshoff et la jouissance de trois seigneuries qui devaient retourner à la couronne dès que l'archiduc serait parvenu à la dignité d'électeur de Cologne. Une clause de ce testament assignait par forme de legs un mois d'appointements à tous les militaires, depuis le feld-maréchal jusqu'au dernier soldat.
L'Empereur voulut que ces legs ne coûtassent rien au trésor de l'État; il les acquitta lui-même, «ne pouvant, disait-il, mieux employer un argent qui m'appartient personnellement et qui provient de la succession de mon père». Puis, pour honorer encore la mémoire de sa glorieuse mère, il ordonna qu'une des deux nouvelles forteresses qu'on élevait en Bohême, près de Leutmeritz, porterait le nom de Theresienstadt.
La perte de cette illustre princesse était partout ressentie. Frédéric II écrivait à d'Alembert: «J'ai donné des larmes bien sincères à sa mort; elle a fait honneur à son sexe et au trône. Je lui ai fait la guerre, et je n'ai jamais été son ennemi.»
S'il est beau de voir les grandes âmes toujours bien jugées par les grands hommes, il est touchant aussi de voir les vertus des mères passer comme un héritage aux enfants et devenir leur entretien le plus aimé. Marie-Antoinette se plaisait à parler de la bonté de sa mère (la bonté, dont Bossuet a dit que c'était le trait qui rapprochait le plus les souverains de Dieu), à citer des actes de charité dont elle avait été elle-même témoin. «Combien ma mère valait mieux que nous! dit-elle un jour; ma mère, qui trouvait que le spectacle d'un seul pauvre suffisait pour déshonorer son règne!» Une autre fois, s'étant attardée au lit plus longtemps que de coutume, elle s'écria: «Et ma mère qui se reprochait le temps qu'elle donnait au sommeil, disant que c'était autant de dérobé à ses peuples!»
Le dimanche 22 avril 1781, après avoir assisté aux vêpres et au salut dans la chapelle du château, la cour avait quitté Versailles à sept heures pour aller souper et coucher à Marly. Elle demeura dans cette résidence jusqu'au 20 mai.
Madame Élisabeth, accompagnée de la comtesse Diane, vint à Versailles le 14, conduite surtout par le désir de voir madame de Bombelles. Celle-ci, prévenue de l'arrivée de sa princesse, vole aussitôt vers elle. Je vais laisser la parole à cette charmante femme. Comme personne ne connut mieux Madame Élisabeth, personne ne l'aima plus, personne ne sut mieux en parler. Qu'est-ce que le récit du passé, toujours un peu froid dans la bouche de l'historien, auprès de cette correspondance qui fait reparaître le passé lui-même avec les fraîches couleurs de la vie? Quelle femme, quelle mère, quelle amie que madame de Bombelles! Sa plume, tour à tour enjouée, attendrie, spirituelle, sérieuse, va évoquer pour nous la société des dernières années du dix-huitième siècle, société qui ne fut point sans reproche sans doute, mais qu'on a calomniée en généralisant le blâme porté sur ses idées et sur ses mœurs, ce qui est un déni de justice à tant de femmes aussi vertueuses que charmantes, en tête desquelles je placerai les amies de Madame Élisabeth.
Voici les lettres de madame de Bombelles à son mari: – «J'ai été, écrit-elle, le 15 mai, la trouver dans son appartement. Elle m'a dit que la Reine vouloit absolument que j'allasse demain à Marly, où il y auroit un grand déjeuner et une partie de barres. Je voudrois bien y aller, parce que ce seroit un moyen d'y faire ma cour; mais la visite du comte d'Esterhazy pourroit bien m'en empêcher. Je me préparerai pour partir; si le comte vient me voir de bonne heure, j'irai; s'il arrive tard, je n'irai pas, et j'ai prié Madame Élisabeth de dire dans ce cas à la Reine que je ne pense pas y aller, que mon fils étoit malade (j'espère que cela ne lui portera pas malheur, à ce pauvre petit chou!)»
Madame de Bombelles put aller à Marly, et après avoir exprimé à son mari, dans une lettre datée du 17, tout le regret qu'elle eut de quitter son fils, toutes les inquiétudes qui assiégèrent son esprit pendant cette courte absence, tout le bonheur qu'elle eut en le trouvant au retour calme et endormi, elle ajoute: «Tu te fais une idée de ma joie: j'étois transportée et fort aise d'avoir été à Marly, parce que j'y ai été reçue à merveille. La Reine n'a pas cessé d'être occupée de moi, de me parler de mon fils, combien elle l'avoit trouvé beau, de me plaisanter sur la peur que j'avois eue d'entrer dans le salon; enfin elle m'a traitée comme si elle m'aimoit beaucoup. Elle a été hier matin à la petite maison et a dit à madame de Guéménée et à ma sœur qu'elle étoit fort aise de mon retour, qu'elle m'avoit trouvée blanchie, parlant beaucoup mieux, et un maintien charmant.» Eh bien, si flatteurs que fussent ces succès, madame de Bombelles préférait à la vie de cour la vie tranquille et retirée qu'elle avait menée à Ratisbonne. Les succès de son fils bien-aimé, de Bombon, comme elle l'appelait, la flattaient infiniment plus que les siens. Cette humble et simple femme était une orgueilleuse mère; elle comptait bien, quand les roses de la santé auraient refleuri sur les joues de son enfant, le montrer dans tout l'éclat de sa beauté. En attendant, elle jouissait délicieusement de l'intérêt que Madame Élisabeth témoignait à Bombon d'abord, à elle ensuite. «Madame Élisabeth, continue-t-elle, a eu la bonté de m'envoyer tout à l'heure un courrier pour avoir de ses nouvelles. Mon Dieu, qu'elle est aimable! d'honneur, je l'aime à la folie. Si tu avois vu combien elle étoit contente de mes petits succès d'avant-hier, comme elle est venue tout doucement m'arranger mon fichu, afin qu'il eût meilleure grâce, me dire la manière dont il falloit que je remerciasse la Reine de ce qu'elle m'avoit invitée à cette partie, réellement j'étois attendrie de son intérêt pour moi, et je voudrois avoir mille manières de lui montrer ma reconnoissance.»
Le 29 mai, de Villiers, habitation d'été de M. et madame de Travanet, ses beau-frère et belle-sœur, madame de Bombelles écrivait à son mari: «… Conçois-tu qu'il n'y ait que vingt jours que nous sommes séparés? Il me semble, en vérité, qu'il y a vingt mois. Comment ferai-je pour être un an sans le voir? Mon Dieu, que cela m'ennuie! Mais il faut du courage: je vais bien m'occuper de tes affaires, de mon petit Bombon, et le temps se passera, car enfin tout passe. Je regarde cette année-ci comme un temps de pénitence, et celle où je te verrai, je serai aussi heureuse que je le suis peu actuellement. Il faut avouer que j'ai bien des dédommagements par Madame Élisabeth, qui me comble de bontés. J'en sens tout le prix, mais j'en jouirai davantage lorsque tu seras avec moi. J'ai toujours oublié de te dire qu'elle m'a priée d'aller voir M. d'Harvelay et de l'engager à lui prêter deux mille louis pour pouvoir se liquider vis-à-vis de M. de Travanet, de la comtesse Diane à qui elle doit cinq cents louis, des marchands; enfin, avec cette somme, elle ne devra plus rien. J'ai cru ne pas devoir lui refuser ce service, et j'irai pour cette raison à Paris jeudi; pourvu que M. d'Harvelay n'aille pas imaginer que cet argent soit pour nous, comme avoit fait M. de Travanet; j'espère que non, et qu'il ne refusera pas cette somme à Madame Élisabeth. Je t'avouerai que j'aimerois autant n'être pas chargée de cette commission; mais comment faire? Madame Élisabeth m'auroit su fort mauvais gré de mon peu de complaisance, et j'aurois manqué à la reconnoissance et à l'attachement que je lui dois…»
«À Versailles, ce 7 juin 1781.
»Je quitte Madame Élisabeth pour te dire un petit mot. Elle ne vouloit pas me laisser aller; mais lorsque je lui ai dit que j'avois envie de t'écrire parce que le courrier partoit demain de Paris, et que sans cela tu serois cinq jours sans avoir de mes nouvelles, elle m'a répondu: «Va-t'en, dis-lui bien des choses de ma part, et, quoiqu'il me prive ce soir de toi, que je l'aime de tout mon cœur.» Elle a toujours pour moi des bontés charmantes; il n'y a sortes d'amitiés qu'elle ne me témoigne, et je lui suis réellement bien tendrement attachée…
»J'ai dîné aujourd'hui chez maman, et nous nous sommes amusées ensemble comme des reines; nous avons causé… nous avons joué avec Bombon, qui entend la plaisanterie à merveille, et qui a d'autant bien teté. De là nous avons été chez Madame Élisabeth, où j'ai passé trois quarts d'heure. Madame de Canillac y étoit, avec laquelle je suis fort honnêtement, et je suis revenue te souhaiter le bonsoir avant d'endormir Bombon. Huit heures sonnent: je te quitte pour ce petit marmot; sa nuit commence tous les jours à cette heure-ci…»
«À Versailles, ce 10 juin 1781.
»… M. de Maurepas a pensé être brûlé à l'Opéra avant-hier. Un moment après qu'il en étoit sorti, la toile s'est allumée par un lampion: le feu a gagné aux décorations et au reste du théâtre avec une si grande promptitude, qu'au bout de vingt-cinq minutes la voûte est tombée avec un fracas épouvantable. Heureusement l'opéra étoit fini… Cependant neuf personnes ont été brûlées. Le feu dure encore. On a bien vite coupé toute communication; de sorte que tout ce qui environne l'Opéra n'est pas endommagé. Le feu étoit si fort que mes gens l'ont vu d'ici en soupant: on pouvoit lire sur le pont de Sèvres; ainsi tu peux juger de la clarté que cela donnoit à tout Paris. On frémit quand on pense que si le feu avoit pris un peu plus tôt, il y auroit eu des milliers de personnes brûlées…»
Sans cesse le nom, les bontés charmantes de Madame Élisabeth reviennent sous la plume de madame de Bombelles, heureuse de devoir à son amie le vif intérêt de la Reine et ces prévenances qui ont tant de prix quand elles descendent de si haut. La lettre suivante est datée de
«Versailles, le 13 juin 1781.
»… J'ai été avant-hier au soir au concert de la Reine avec Madame Élisabeth. La Reine m'a demandé comment je me portois ainsi que mon enfant, et si cela ne le dérangeoit pas que je vinsse au concert. Je lui ai dit qu'il venoit de teter. Elle a repris: «Mais, si vous vouliez, on pourroit l'amener ici.» J'ai paru confondue de ses bontés, et lui ai répondu que je craindrois d'en abuser; qu'il attendroit fort bien mon retour. Effectivement cela ne lui a pas fait de mal. Je suis rentrée à neuf heures chez moi; il a teté et s'est endormi tout de suite. Il s'endort ordinairement à huit heures, huit heures et demie; mais ce petit retard ne lui a rien fait. Ce pauvre petit chat ne me gêne pas du tout: il boit et mange parfaitement, et se passeroit fort bien de teter toute la journée; mais aussi il ne peut pas, la nuit, se passer de moi. Il est accoutumé à s'endormir, le soir, à mon sein, à teter toutes les fois qu'il se réveille, et ce régime lui réussit si bien et me gêne si peu, que je ne suis pas pressée de le sevrer…»
Tous les incidents, tous les événements, les rumeurs même de chaque jour viennent retentir dans cette correspondance, sorte de journal par lequel madame de Bombelles tient son mari au courant de tout ce qui peut l'intéresser.
«Versailles, ce 14 juin 1781.
»On vient de me dire que l'Empereur étoit arrivé hier soir à Paris. Je suis étonnée qu'il ne soit pas tout de suite venu à Versailles. J'imagine que la Reine l'attend avec beaucoup d'impatience.
»La procession du Saint-Sacrement, qui s'est faite ce matin, étoit superbe: il faisoit le plus beau temps du monde. J'ai été la voir passer d'une fenêtre: Madame Élisabeth m'a dispensée de l'accompagner, ce qui m'a fait grand plaisir, car par la chaleur qu'il faisoit j'aurois fait du mal à mon lait…
»Le feu de l'Opéra dure toujours. Madame la duchesse de Chartres a quitté prudemment le Palais-Royal, et s'est établie à Saint-Cloud…»
«À Versailles, ce 17 juin 1781.
»Madame de Clermont est dans le chagrin, de son côté, parce que son fils va entrer au service et qu'elle n'a pas de quoi l'y soutenir. M. de Castries ne veut rien faire pour elle. Madame Élisabeth m'a promis de lui parler en sa faveur. Cette pauvre femme est presque dans le désespoir, et sera obligée de quitter Versailles si elle n'obtient rien, parce qu'elle n'y peut plus vivre. Cela me fait réellement de la peine: je trouve qu'il est impossible de ne pas être malheureux soi-même de l'infortune des autres, et le tableau continuel des maux de l'humanité seroit bien fait pour détacher de la vie…
»L'Empereur n'étoit pas à Paris: je t'avois mandé une fausse nouvelle; mais il viendra bientôt, passera quelques jours ici dans le plus grand incognito, et ne verra personne…»
Dans ces lettres de madame de Bombelles, on peut saisir pour ainsi dire jour par jour la vie de Madame Élisabeth, car ces deux inséparables amies ne se quittent guère, et la Reine prend soin elle-même de les rapprocher. Les lettres suivantes furent écrites à Versailles: les gloires de ce règne, qui compte tant de malheurs, y jettent un reflet.
«À Versailles, ce 23 juin 1781.
»Madame Élisabeth va s'établir après-demain à Trianon avec la Reine. Elles y resteront six jours. La Reine a dit à Madame Élisabeth qu'il falloit que je l'allasse voir tous les matins; qu'elle étoit désolée de ne pouvoir m'offrir à dîner et à souper; mais que, comme elle n'avoit pas de dames de palais avec elle, qu'il n'y auroit que la duchesse de Polignac, elle craignoit que cela ne causât trop de jalousie. – J'aurois trouvé fort simple que la Reine ne pensât pas à moi; ainsi je ne suis pas choquée qu'elle ne veuille pas me donner à dîner, mais très-sensible à la permission qu'elle veut bien me donner d'aller le matin à Trianon, permission que personne n'a: j'ai prié Madame Élisabeth de lui en faire ce soir mes remercîments…»
«À Versailles, ce 27 juin 1781.
»J'ai été à Trianon ce matin voir Madame Élisabeth avec quelque curiosité, parce que tout Paris disoit que l'Empereur y étoit et qu'il alloit l'épouser. Il n'en est pas un mot; il est toujours à Bruxelles, et il n'est pas même certain qu'il vienne ici. Ainsi ma tête a bien trotté inutilement…
»J'allois oublier de te dire la nouvelle que M. de Castries est venu annoncer ce matin à la Reine: il y a eu un combat entre l'amiral Rodney et M. de Grasse. L'amiral a eu cinq de ses vaisseaux coulés à fond, deux autres mis en fort mauvais état. Le convoi est arrivé sans le plus petit accident, et M. de Grasse a perdu fort peu de monde. Mon regret est qu'il n'ait pas pu prendre l'amiral, cela auroit mis le comble à ses exploits. Je voudrois bien que quelques affaires de ce genre forçassent les Anglois à faire la paix…
»Ce mariage de Madame Élisabeth m'a bien occupée. Car enfin, si elle étoit heureuse, quel bonheur ce seroit pour moi de la savoir contente, et de ne plus te quitter! Quant à ta fortune, elle pourroit y aider encore davantage étant impératrice; et ne plus te quitter, ne comptes-tu cela pour rien? Mon Dieu! cela n'arrivera jamais, ma destinée est de ne te pas voir la moitié de ma vie: cela est affreux; cette perspective me cause un chagrin que je ne puis te rendre. Il y a des moments où la maladie du pays me prend, où je pleure, je me désespère, où je suis tentée de laisser ma place, tout ce que je puis espérer, pour m'en aller avec toi. La raison, la reconnoissance que je dois à Madame Élisabeth, me font revenir de cette espèce de délire; mais la raison empêche de faire des sottises, et ne rend pas plus heureux pour cela ceux qui l'écoutent. C'est l'effet qu'elle produit sur moi; je m'ennuie prodigieusement, je ne te le dissimule pas, et si le bon Dieu et toi ne m'avoient donné Bombon, je t'assure que je ne resterois pas ici.»
«À Versailles, ce 2 juillet 1781, à neuf heures du soir.
»Je me suis bien amusée ce soir: j'ai été avec ma petite belle-sœur et madame de Clermont à la Comédie, où Madame Élisabeth étoit avec la Reine. On a donné Tom Jones et l'Amitié à l'épreuve. Madame Saint-Huberti, une fameuse de l'Opéra, a fait les deux principaux rôles. Je me suis en allée au commencement de la seconde pièce endormir mon petit Bombon, qui est actuellement paisiblement endormi dans son berceau. J'avoue que si la crainte que Bombon n'eût trop envie de dormir ne m'avoit distraite du plaisir que j'avois au spectacle, rien dans le monde n'eût pu m'en arracher, car le commencement de l'Amitié à l'épreuve, que je ne connois pas, m'a paru charmant; mais j'ai été bien dédommagée en voyant mon petit enfant qui étoit fort content de mon retour…»
«À Versailles, ce 14 juillet 1781.
»Sais-tu les grandes nouvelles? On dit que M. de Grasse a repris Sainte-Lucie; qu'il a coulé à fond deux vaisseaux de l'escadre de Hodges, et qu'il en a pris deux. Cela est si beau que je ne le croirai que lorsque nous le saurons par M. de Grasse lui-même. Jusqu'à présent nous ne le croyons que sur le rapport de papiers anglois, qui s'amusent peut-être à écrire de mauvaises nouvelles pour eux afin de nous causer de fausses joies…
»C'est demain soir que la Reine et Madame Élisabeth partent pour Trianon…»
Les lettres qui suivent sont animées par le sentiment si touchant et si vrai de l'amour maternel, qui de génération en génération recommence son doux et immortel poëme auprès de tous les berceaux; en même temps, on y voit s'éclipser l'espoir d'un mariage de Madame Élisabeth avec l'Empereur, qui avait un moment lui aux regards de son incomparable amie.
«De Versailles, ce 28 juillet 1781.
»C'est demain le grand jour, celui où vont commencer mes inquiétudes. L'enfant se porte à merveille, mais je ne suis pas tranquille. Je crains que d'être sevré ne le rende malade, et si j'eusse été absolument maîtresse, je ne m'y serois pas encore résolue; mais maman le désire si fort, craint tant que cela n'attaque ma santé, que je n'ai pas osé reculer… Je ne sais ce que je donn erois pour ne pas le sevrer, et quand une fois ce temps-là sera passé, je serai bien contente…»
«À Versailles, ce 4 août 1781.
»Bombon se porte à merveille, il a parfaitement bien dormi l'autre nuit et celle-ci; mais celle d'auparavant, qui étoit la seconde après notre séparation, ce pauvre petit avoit bien du chagrin. Il vouloit absolument teter; il pleuroit, il appeloit: Maman! maman! me cherchoit partout, et ensuite faisoit de grands soupirs et se remettoit à pleurer. Cela n'est-il pas touchant au possible? À présent, il n'a plus de chagrin; mais, malgré cela, il parle de moi toute la journée, me cherche et fait signe avec son petit doigt qu'il faut aller à la porte du jardin, que j'y suis. J'ai pleuré d'attendrissement lorsqu'on m'a donné ces détails. J'adore cet enfant, et les marques d'attachement qu'il m'a montrées dans cette occasion ne s'effaceront jamais de mon cœur ni de ma mémoire. J'irai aujourd'hui à Montreuil: le cœur m'en bat d'avance. Je verrai mon bijou, mais il ne me verra pas, il est trop occupé de moi; cela renouvelleroit tous ses chagrins, et je l'aime trop pour désirer des jouissances aux dépens de sa tranquillité. Ainsi j'attendrai encore quelques jours pour l'embrasser. Je te réponds bien que, cette besogne faite, rien dans ce monde ne pourra plus m'en séparer que le moment où tu t'en empareras…
»… Je n'espère plus que Madame Élisabeth épouse l'Empereur. Il part aujourd'hui, et si on avoit eu quelques idées, on auroit cherché à les faire causer, à les rapprocher. Au lieu de cela, la Reine a paru peu occupée de Madame Élisabeth pendant le séjour de son frère ici, et ne lui a jamais rien dit qui eût le moindre rapport à ce sujet. Ainsi cela sûrement ne sera pas.
»Madame Élisabeth m'a témoigné tout plein de bontés depuis que j'ai sevré Bombon. Elle est venue me voir tous les jours, ainsi que madame de Sérent, qui me témoigne infiniment d'amitiés…»
«À Versailles, ce 6 août 1781.
»Nous avons des raisons pour avoir actuellement la certitude que l'Empereur n'épousera pas Madame Élisabeth. J'en suis bien aise et fâchée: c'est peut-être fort heureux pour elle, cela ne l'est pas tant pour moi, puisque j'aurois toujours été avec toi si ce mariage s'étoit fait; mais je lui suis si attachée qu'il m'auroit été impossible de jouir tranquillement de ma liberté, si cela n'avoit pas fait son bonheur…»
Les prévenances et les bontés de Madame Élisabeth pour madame de Bombelles continuent. Celle-ci envoie-t-elle à son mari une bourse brodée de ses mains, la princesse trouve bon que les coulants qu'elle a donnés à son amie complètent ce présent.
Puis voici le nom des Polignac, qui paraît dans ces lettres comme un point noir à l'horizon. Les calomnies commencent. Quand on veut détruire l'effet qu'elles peuvent produire sur l'esprit de Madame Élisabeth, c'est à madame de Bombelles qu'on s'adresse, comme pour obtenir une grâce de la princesse.
«À Versailles, ce 12 août 1781.
»Je t'enverrai [prochainement] cette certaine bourse que je t'ai mandé que je faisois. Je me flatte que tu seras content des coulants; ils sont des plus à la mode, et ils te seront encore plus précieux lorsque tu sauras que c'est Madame Élisabeth qui me les a donnés et qu'elle trouve très-bien que je te les envoye…
»Tu auras été désolé d'apprendre la mort de l'abbé de Breteuil. Le baron ne peut s'en consoler, et je crois que de sa vie il n'a éprouvé une peine aussi forte. Cette mort-là m'a fait faire bien des réflexions: cet abbé a vécu comme s'il n'eût dû jamais mourir; ses plaisirs sont passés; le voilà mort: Dieu seul sait à quoi il étoit réservé, et ce qu'il est devenu. En vérité, quand on calcule bien la courte durée de cette vie et la longueur de l'éternité, on apprécie bien à sa juste valeur les objets de son ambition, et on prend une grande indifférence pour tous les événements de ce monde…
»J'ai soupé hier soir chez madame la princesse de Lamballe. La Reine y est venue avec Madame Élisabeth, et m'a fort bien traitée…»
«À Paris, ce 24 août 1781.
»Je te dirai que j'ai été hier à Passy voir la comtesse Diane; la conversation s'est tournée sur la santé. Elle m'a dit que malgré l'extrême besoin qu'elle auroit eu d'aller aux eaux, les propos infâmes qu'on avoit tenus sur son compte l'en avoient empêchée, et qu'elle auroit mieux aimé mourir que de faire aucune démarche qui eût donné la moindre vraisemblance aux torts qu'on lui prêtoit; que tous ces propos lui avoient causé la peine la plus sensible. Je lui ai répondu qu'ils étoient si dénués de bon sens que je trouvois qu'elle avoit tort d'y attacher un si grand prix, que toutes les personnes honnêtes n'avoient pas douté un instant de leur fausseté. «Je me flatte, a-t-elle ajouté, que Madame Élisabeth ne les aura pas sus.» Je crois qu'elle les ignore, ai-je répondu (elle les savoit déjà à mon arrivée à Versailles); d'ailleurs elle a une si belle âme et vous rend trop de justice pour jamais les croire si on les lui apprenoit.
»Là-dessus, je me suis fort étendue sur les qualités de ma princesse. «Elle en a une, m'a-t-elle dit, qui me fait le plus grand plaisir, c'est sa constance, et l'amitié qu'elle a pour vous fait son éloge; elle ne pouvoit faire un meilleur choix. La Reine, qui vous aime beaucoup, me le disoit encore dernièrement.» Je lui ai dit à cela que je savois bien ce qu'elle avoit eu la bonté de lui dire de moi ce jour-là, et que j'en étois extrêmement reconnoissante (c'est le comte d'Esterhazy, qui y étoit, qui me l'a dit). Ensuite, elle m'a dit que pendant mon absence Madame Élisabeth l'avoit traitée avec un froid qui l'avoit fort affligée. Alors mon embarras a commencé: je ne savois plus que dire. Elle m'a demandé si je n'en savois pas les raisons. Je lui ai répondu que je croyois qu'on avoit fait dire à Madame Élisabeth beaucoup de choses auxquelles elle n'avoit jamais pensé, qu'elle ne s'étoit jamais plainte d'elle, et qu'il m'avoit paru au contraire qu'elle rendoit justice dans toutes les occasions à ses procédés et à ses attentions pour elle. Heureusement madame de Clermont est arrivée et nous a interrompues. J'en ai été enchantée. La comtesse D. m'a fort engagée à la revenir voir, m'a demandé de tes nouvelles, de celles de Bombon, et m'a répété plusieurs fois à quel point elle étoit sensible à ma visite…»
«À Viarmes, ce 27 août 1781.
»En arrivant ici, j'ai trouvé une lettre charmante de Madame Élisabeth. Cela n'est-il pas fort aimable à elle? Le surlendemain, j'en ai reçu une autre qui étoit une réponse à celle que je lui avois écrite. Elle me mande qu'elle l'avoit reçue à la comédie, et que, comme elle avoit été longtemps à la lire, la Reine lui avoit demandé avec le plus grand intérêt s'il ne m'étoit arrivé aucun accident, et qu'elle lui avoit répondu qu'elle étoit trop bonne, que je me portois fort bien. «J'ai été bien fâchée, m'ajouta-t-elle, que ceci se soit passé à la comédie; car, sans cela, le moment eût été bien favorable pour lui rappeler notre affaire; mais tu peux être sûre que la première occasion où je le pourrai, je ne l'échapperai pas.» J'ai été d'autant plus sensible au regret que Madame Élisabeth m'a marqué que je ne lui avois pas dit un mot d'affaires, car j'aurois été trop affligée qu'elle eût pu imaginer que je ne lui écrivois que par intérêt…»
«À la Muette, le 8 septembre 1781.
»J'ai quitté hier mon petit Bombon à une heure de l'après-dînée; il dormoit paisiblement. Je n'ai pu m'empêcher de verser quelques larmes au moment de notre séparation. C'est bête, mais je ne puis te rendre ce qui s'est passé en moi: j'étois oppressée, et, malgré tous les efforts que je faisois pour être gaie, je ne pouvois en venir à bout. Madame Élisabeth m'avoit fait chercher pour pêcher, de sorte que j'ai été obligée de le quitter une heure plus tôt que je ne devois. J'avoue que cela m'a contrariée à mort; il faisoit à cette triste pêche un vent et un soleil terribles; nous y sommes restées jusqu'à deux heures trois quarts, et j'étois transie jusqu'aux os. Nous ne sommes sorties de table qu'à quatre heures. J'ai vitement été chez moi, espérant revoir encore un petit moment mon pauvre enfant; point du tout: il étoit déjà parti pour Montreuil. Tu avoueras que j'ai dû être bien contrariée toute la journée. Je suis revenue chez Madame Élisabeth, où je n'ai pas voulu être maussade, de façon que je m'efforçois de rire de tout ce qu'on disoit, ce qui me donnoit sûrement un air fort spirituel. Nous sommes parties à cinq heures, arrivées ici à six heures et demie, avons fait nos toilettes pour être rendues au salon à huit heures et demie. Là, j'ai été fort bien traitée par tout le monde. Le Roi m'a parlé, Monsieur m'a prise à côté de lui à souper, et a beaucoup causé avec moi pendant ce temps-là, m'a questionnée sur Ratisbonne, sur toi, etc. J'ai fait après souper une partie de truc avec Madame Élisabeth, le chevalier de Crussol et M. de Chabrillant. Le baron de Breteuil étoit dans le salon; il m'a demandé de tes nouvelles. Le comte d'Esterhazy n'est pas ici, ce qui me désespère; mais je pense qu'il y viendra ces jours-ci, car la seule chose qui m'ait consolée de ce voyage est l'espoir de l'y voir à mon aise; je serois bien piquée que cela ne fût pas, mais je ne doute pas qu'il n'y vienne. La Reine est fort occupée de la duchesse de Polignac. On attend d'un moment à l'autre qu'elle accouche. Sa Majesté ira y dîner tous les jours et y passera la journée; elle ne sera ici que pour l'heure du salon. Madame Élisabeth monte à cheval, j'y monterai avec elle; ce sera pour la troisième fois depuis que j'ai sevré Bombon; cela m'amuse assez…»
«Ce 9.
»… Je suis fort contente de mon séjour ici: j'y suis fort bien traitée. Hier, pendant le souper, la duchesse de Duras, qui étoit à côté du Roi, a fait mon éloge; le Roi a dit: J'en pense beaucoup de bien.» Cela m'a fait plaisir. Demain, je vais avec Madame Élisabeth et la Reine dîner à Bellevue, et de là à Saint-Cloud. Je ne m'en suis pas souciée d'abord, parce que cela me coûtera dix louis; mais Madame Élisabeth m'y a déterminée, en disant que dans ce moment-ci plus elle me verroit, et mieux elle seroit. J'ai trouvé qu'elle avoit raison. Je suis fâchée de n'être pas plus aimable, car je l'intéresserois davantage…
»M. de Montesquiou m'a priée plusieurs fois de parler à Madame Élisabeth pour que sa fille, madame de Lastic, soit surnuméraire. J'y ai engagé ma princesse, parce que j'ai imaginé que tu serois bien aise qu'il m'eût quelque obligation. Madame Élisabeth ne s'en soucioit pas beaucoup; mais comme je lui ai dit que cela te feroit sûrement plaisir, cela l'a ébranlée, et elle m'a dit qu'elle y feroit ce qu'elle pourroit…»
Nous quittons ici à regret les lettres de madame de Bombelles, mais nous rencontrerons encore, et plus d'une fois, cette charmante amie de Madame Élisabeth. Le temps marche, il nous entraîne: nous sommes obligé de le suivre.
«Madame Élisabeth a été inoculée en arrivant; elle a subi cette petite opération avec beaucoup de sang-froid: elle est charmée d'être pestiférée, et attend la petite vérole avec la plus grande impatience.» Et le 16 novembre suivant, Marie-Antoinette mandait de Versailles à l'Impératrice, sa mère: «Ma sœur Élisabeth est depuis un mois à Choisy pour son inoculation, qui a fort bien réussi. Elle reviendra ici le 23 de ce mois.» Voir, pour la marche de l'inoculation, la note XI à la fin du volume.
HAC THECA TEGITUR COR AUGUSTUM MARIÆ-THERESIÆ ROM. IMPERAT. HUNG. ET BOHEM. REG. PIÆ, CLEMENTIS, JUSTÆ; QUOD DUM VIXIT, TOTUM CONSECRAVIT DEO, SUBDITIS, SALUTI PUBLICÆ. MIRE LIBERALIS IN EGENOS, VIDUAS ET ORPHANOS; IN ADVERSIS SUPRA SEXUM MAGNANIMA. NATA EST ANNO 1717, DIE 13 MAII, OBIIT AN. 1780, DIE 20 NOVEMBRIS «Dans cette urne est renfermé le cœur auguste de Marie-Thérèse, Impératrice des Romains, Reine de Hongrie et de Bohême, pieuse, clémente et juste; lequel cœur, tant qu'elle vécut, elle consacra tout entier à Dieu, à ses sujets et au salut public. Sa libéralité s'étendit sur les pauvres, les veuves et les orphelins; sa grandeur d'âme dans l'adversité l'éleva au-dessus de son sexe. Née le 13 mai 1717, elle mourut le 29 novembre 1780.»
HIC SITA SUNT VISCERA MARIÆ-THERESIÆ ROM. IMPERAT. HUNG. ET BOHEMIÆ REG. ARCHID. AUST. ERAT DONEC VIXIT MATER REIPUBLICÆ, SUBDITORUM AMOR, STIRPIS SUÆ GLORIA AUGUSTI THRONI FULCRUM ET ORNAMENTUM. NATA AN. 1717, DIE 13 MAII. OBIT AN. 1780, DIE 29 NOVEMBRIS «Ici sont déposées les entrailles de Marie-Thérèse, Impératrice des Romains, Reine de Hongrie et de Bohême, archiduchesse d'Autriche. Elle était, tant qu'elle vécut, la mère de l'État, l'amour de ses sujets, la gloire de sa race, l'appui et l'ornement d'un trône auguste. Née en 1717, le 13 mai, elle est morte le 29 novembre 1780.»