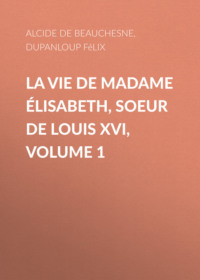Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Vie de Madame Élisabeth, soeur de Louis XVI, Volume 1», sayfa 9
LIVRE DEUXIÈME
LETTRES DE MADAME DE BOMBELLES
1777 – 1782
Voyage de l'Empereur en France. – L'éducation de Madame Élisabeth terminée. – Mot de la jeune princesse. – Question de son mariage. – Lettre de M. de Vergennes au Roi. – Mesdames de Bombelles, de Raigecourt et des Moutiers. – Récit de madame de Bombelles. – Tableau de la cour à cette époque. – Louis XVI. – Le comte de Provence. – Le comte d'Artois. – Madame Élisabeth étrangère aux intrigues. – Sa sagesse et sa raison. – Dames qu'elle choisit pour sa société. – Esquisse de son portrait. – Son appartement à Versailles. – Naissance de Madame Royale. – Récit de la Gazette. – Baptême de Marie-Thérèse-Charlotte. – Observation de Monsieur. – Mort de Marie-Thérèse. – Les seuls mots que Louis XVI ait dits à l'abbé de Vermond. – Le linceul de l'Impératrice-Reine. – Ses obsèques. – Lettre de l'Empereur au prince de Kaunitz; remarque de la Reine. – Dispositions testamentaires de Marie-Thérèse. – Frédéric II à d'Alembert. – Piété filiale de Marie-Antoinette. – Lettres de madame de Bombelles. – Naissance du premier Dauphin: récit de Louis XVI; récit de madame Campan. – Les corporations des arts et métiers de Paris se rendent à Versailles; parmi eux les fossoyeurs. – Les dames de la halle, vêtues de robes noires, complimentent la Reine. Elles dînent au château de Versailles. – Bal offert à la Reine par les gardes du corps. – Dauphins en or; coiffures à l'enfant; catogans. – Nouvelle toilette des enfants. – Fête donnée au Roi et à la Reine par la ville de Paris, à l'occasion de la naissance du Dauphin. – Tendresse de Madame Élisabeth pour les enfants du Roi. – Madame d'Aumale. – Réserve de Madame Élisabeth; sa perspicacité; son dévouement pour ses amies. – Acquisition par le Roi de la propriété de madame de Guéménée à Montreuil. – La Reine y conduit Madame Élisabeth: Vous êtes chez vous. – Description de la maison, du parc. – Madame de Mackau. – Le Monnier. – Vie de Madame Élisabeth à Montreuil; ses bonnes œuvres. – Le comte de Provence. – Le comte d'Artois. – Mesdames. – Le vieux Jacob. – Catherine Vassent. – Mort de Madame Sophie. – Lettre de madame de Bombelles. – Le duc de Penthièvre et madame de Lamballe. – Humbles funérailles de Madame Sophie. – Voyage du comte et de la comtesse du Nord. – Réformes opérées par Louis XVI. – Guerre d'Amérique; son caractère. – Le capitaine Molli. – Deane et Franklin. – Lettre de Louis XVI au roi d'Espagne. – M. Gérard, ministre plénipotentiaire du Roi aux États-Unis. – M. de Bouillé. – M. de la Pérouse. – Indépendance des États-Unis. – Réflexions
L'Empereur, qui voyageait sous le nom de comte de Falkenstein, sans suite, sans éclat, arriva à Paris le vendredi 18 avril 1777, vers les quatre heures du soir, et par une autre barrière que celle où il était attendu. Il descendit chez le comte de Mercy, son ambassadeur, bien qu'il eût fait retenir pour le recevoir l'hôtel de Tréville, rue de Tournon.
Le samedi 19, il se rendit au château de Versailles et se fit annoncer chez la Reine. La Reine le conduisit chez le Roi et les Filles de France; ensuite les Fils de France vinrent le voir chez la Reine. Le 20, le duc d'Orléans et le duc de Penthièvre allèrent s'inscrire chez le comte de Falkenstein, les princesses en firent autant; mais il ne reçut ni les uns ni les autres.
Le lundi 21, il y eut vers sept heures du soir, chez la Reine en particulier, un concert auquel les dames étaient invitées à se rendre en robes de chambre73. Marie-Antoinette présenta à l'Empereur les personnes qui ne l'avaient point encore vu, notamment le duc de Chartres. Le duc de Penthièvre n'arriva qu'à la fin du concert. La Reine lui amena le comte de Falkenstein, en lui disant: «Je vous présente mon frère.» Quoique résolu à un incognito absolu, et ayant abandonné toutes les marques extérieures de la royauté, l'Empereur ne put échapper aux hommages que les princes se croyaient obligés de lui rendre.
«Le lundi 5 mai suivant, raconte le duc de Penthièvre, on a représenté l'opéra de Castor et Pollux sur le grand Opéra de Versailles, pour l'Empereur. Le Roi a été dans sa loge et non dans son fauteuil. Les dames, dans les loges, étoient en robes de chambre74; celles dans l'amphithéâtre, partie étoient en robes de chambre et partie en grand habit. Les loges des princesses étoient à droite et à gauche de celle du Roi, après les portes d'entrée, parce que la principale porte étoit occupée, comme à l'ordinaire, par la loge que l'on y établit en pareille circonstance pour la famille royale, laquelle ne trouveroit point de place dans la loge du Roi, à cause de sa petitesse. Il n'y avoit point de princes. Les ambassadeurs étoient dans les loges.
»Le 9 du même mois, l'Empereur a été à la chasse avec le Roi. Sa Majesté avoit fait faire un habit de son équipage pour l'Empereur. M. de Penthièvre a ignoré cette chasse et ne s'y est point trouvé; il avoit été à une précédente, croyant que Sa Majesté Impériale y seroit, et elle n'y alla point.
»Le lundi d'après, 12 du mois, madame la princesse de Conti, madame de Lamballe et M. de Penthièvre ont été se faire inscrire à la porte de Sa Majesté Impériale, chez son ambassadeur, comme pour prendre congé d'elle. M. le duc de Chartres y avoit été, avant de partir pour la Hollande où il fit alors un voyage, prendre congé de l'Empereur, et lui demander s'il n'avoit rien à faire dire au prince Charles, à Bruxelles. M. de Chartres avoit réglé que sa femme iroit. L'Empereur étoit revenu, depuis l'envoi de ses cartes, chez mesdames de Chartres, de Conti et de Lamballe (et plus d'une fois chez madame de Chartres), et les avait trouvées. M. de Penthièvre lui avoit fait demander s'il ne verroit pas les jardins de Sceaux; l'Empereur lui avoit fait répondre avec honnêteté sur le désir qu'il avoit de les voir.
»Le jeudi 22 du même mois de mai, l'Empereur est venu à Sceaux. M. de Penthièvre lui a rendu tous les hommages possibles. Sa Majesté Impériale vit les jardins, dans lesquels on fit jouer les eaux, comme de raison; elle alla à pied, suivie de M. de Penthièvre; les voitures que l'on avoit fait avancer furent inutiles. En rentrant de la promenade, l'Empereur s'assit sur une chaise; M. le duc d'Orléans, qui se trouva à Sceaux, et M. de Penthièvre prirent des chaises. M. le nonce, qui étoit présent, resta debout75, circonstance qui détermina M. de Penthièvre à se lever. M. de Penthièvre avoit d'abord pris un tabouret, parce que ce fut le seul siége qui se trouvât auprès de lui; il prit ensuite une chaise. Lorsque l'Empereur s'en alla, il ne voulut pas que M. de Penthièvre le reconduisît; il le suivit néanmoins jusqu'à la dernière porte de la pièce, avant celle où Sa Majesté Impériale s'étoit assise, en disant toujours: J'obéis.
»L'Empereur gardoit tellement l'incognito qu'il appela M. le duc d'Orléans et M. de Penthièvre monseigneur. Pendant la promenade, Sa Majesté Impériale mit son chapeau, en faisant une honnêteté à M. de Penthièvre, et le fit mettre à tout le monde. Madame la duchesse de Chartres, madame la princesse de Conti et madame de Lamballe étoient à Sceaux; elles ne furent point de la promenade, parce qu'on alla à pied. On joua au cavagnol, l'Empereur causant debout dans un coin du salon avec M. l'évêque de Rennes, M. l'abbé de Montauban et M. de Penthièvre.
»Le surlendemain, samedi 24, M. de Penthièvre retourna se faire écrire76 à la porte de l'Empereur, chez M. le comte de Mercy.
»Le lundi 26, l'Empereur a été à la chasse avec le Roi, dans la forêt de Rambouillet; M. de Penthièvre s'y est trouvé. M. de Penthièvre croit que l'Empereur étoit venu dans le carrosse du Roi, où la Reine étoit, de Versailles à Saint-Hubert, petite maison de plaisance du Roi, où Sa Majesté a coutume de déjeuner quand elle chasse à Rambouillet; il croit aussi que Sa Majesté Impériale a été plusieurs autres fois avec la Reine, malgré son absolu incognito. L'Empereur s'est toujours mis sur le devant du carrosse du Roi; on dit qu'il a monté en voiture en même temps que Sa Majesté par une portière différente.
»L'Empereur est reparti le 31 mai 1777, pour aller parcourir le royaume. Il étoit venu quelques jours auparavant en personne à la porte de M. de Penthièvre; son ambassadeur étoit avec lui. M. de Penthièvre a trouvé sur sa liste M. le comte de Falkenstein et M. l'ambassadeur de l'Empereur et de l'Impératrice. M. de Penthièvre n'ayant pu aller à Versailles dans ce moment, pria madame de Lamballe de faire parvenir à la Reine qu'il étoit bien fâché de ne pouvoir pas aller lui faire sa cour77.»
À cette époque, madame la princesse de Guéménée avait terminé sa tâche près de Madame Élisabeth. Plus heureuse que sa devancière, elle n'avait eu dans ces dernières années qu'à modérer le zèle et les progrès d'une élève pour qui l'oisiveté était regardée comme un danger et comme un ennui. La jeune princesse croissait en savoir et en vertus. La trempe forte de son âme ne lui inspirait aucun goût pour les arts de pur agrément; la fermeté précoce de son jugement lui faisait prendre en pitié toute conversation oiseuse, aussi bien que toute action inutile. Sa journée était un labeur continuel. Quand son esprit se reposait de l'étude de l'histoire ou des mathématiques, quand son cœur quittait la méditation et la prière, ses mains s'occupaient de ces simples travaux de l'aiguille que les jeunes filles de notre temps négligent et dédaignent, et elle y excellait tellement qu'elle aurait pu se faire un renom parmi les ouvrières les plus renommées. On sait que quelques années plus tard, une de ses dames regardant avec complaisance une admirable broderie que la princesse venait de terminer, lui dit: «C'est vraiment dommage que Madame soit si habile. – Pourquoi donc? demanda la princesse. – Cela conviendroit si bien à des filles pauvres! ce talent leur suffiroit pour gagner leur pain et celui de leur famille. – C'est peut-être pour cela que Dieu me l'a donné, répondit Madame Élisabeth. Et qui sait? un jour peut-être j'en ferai usage pour me nourrir moi et les miens.»
Le 17 mai 1778, la cour partit pour Marly.
Le même jour, Madame Élisabeth, accompagnée de madame la princesse de Guéménée, gouvernante des Enfants de France, des sous-gouvernantes et des dames qui l'accompagnent, se rendit chez le Roi. Madame de Guéménée fit la remise de Madame Élisabeth à Sa Majesté, qui ordonna qu'on fît entrer madame la comtesse Diane de Polignac, dame d'honneur de cette princesse, et madame la marquise de Sérent, sa dame d'atour, entre les mains desquelles le Roi remit Madame Élisabeth.
Dès ce moment, il fut question de son mariage. On parut d'abord destiner sa main à l'infant de Portugal, prince du Brésil, qui était de son âge, et qui dans l'avenir lui aurait apporté le titre de reine. Tout en comprenant les convenances de cette alliance, Madame Élisabeth était loin de la désirer, et quoiqu'elle n'y mît personnellement aucun obstacle, elle se sentit soulagée en apprenant que les négociations ouvertes à ce sujet avaient été rompues.
Peu de temps après, deux autres princes briguèrent l'honneur d'obtenir sa main. L'un était le duc d'Aoste, qui n'avait que cinq ans de plus qu'elle et qui lui offrait, dans une cour voisine et amie de la France, une place sur les degrés du trône, à côté de sa sœur Clotilde; mais dans sa fierté politique, le gouvernement prétendit que la seconde place à la cour de Sardaigne ne convenait pas à une Fille de France. L'autre était l'Empereur Joseph II, qui l'année précédente, lors de son voyage en France, avait été, disait-on, frappé de la vivacité de son esprit et de l'aménité de son caractère78 Aussi prétendit-on que le désir de la revoir n'était pas le moindre motif qui le ramenât à Versailles en 1783. Quatre ans avaient suffi pour transformer la jeune princesse, dont le front, rayonnant de tout l'éclat des grâces printanières, semblait destiné par l'opinion publique à recevoir le bandeau impérial. Le parti antiautrichien qui dominait à la cour, et qui déjà avait semé à l'entour de la Reine des défiances et des haines, s'inquiéta d'une alliance qui devait être contraire à son ascendant et mit tout en œuvre pour l'empêcher. L'intrigue réussit. On a dit sans raison que Madame Élisabeth en conçut quelque regret; l'Empereur n'avait point encore laissé apercevoir dans la politique les excentricités de son esprit, et il venait de perdre une femme dont la jeunesse, les vertus et la piété avaient emporté l'amour et la bénédiction de tout un peuple. Madame Élisabeth, bien qu'elle possédât assurément tout ce qu'il fallait pour recueillir un tel héritage, ne parut pas attacher plus de prix à cette union qu'aux autres alliances que la convenance avait indiquées, mais auxquelles la politique avait trouvé des obstacles. Ou peut-être Celui qui règne dans les cieux et de qui relèvent tous les empires, comme dit Bossuet, Celui dont l'œil voyait déjà s'ouvrir dans l'avenir la prison du Temple et se dresser l'échafaud du 21 janvier, n'avait-il pas voulu enlever toute consolation à la maison royale.
Madame Élisabeth de jour en jour se fortifia contre les écueils de son caractère, de son âge et de la cour; de jour en jour elle sentit davantage ce qui lui manquait. Ses efforts s'accroissaient de sa défiance d'elle-même, et plus elle acquérait de qualités, moins elle se croyait capable de la perfection à laquelle elle devait atteindre. Ce sentiment de son humilité donnait à sa parole une mesure exquise, à ses actions une prudente réserve, à sa charité une discrétion angélique.
Toutes les jeunes personnes qui s'étaient trouvées en contact avec Madame Élisabeth et qui grandissaient sous ses yeux, participant parfois à ses plaisirs, lui avaient voué une vive et sincère amitié. Il en est trois que le cœur d'Élisabeth avait distinguées tout d'abord et auxquelles elle fit une plus grande part d'affection, payée du plus fidèle et du plus tendre dévouement: l'une était mademoiselle de Mackau, qui par son mariage devint madame de Bombelles; l'autre mademoiselle de Causans, qui épousa M. de Raigecourt; la troisième était mademoiselle de la Briffe, qu'elle avait connue presque enfant. C'était une jeune personne d'un esprit charmant et d'une vivacité d'humeur pleine d'à-propos et d'entraînement. Elle venait d'épouser le marquis des Moutiers de Mérinville. Madame Élisabeth environnait d'une tendre sollicitude cette jeune tête, parée de dons trop précieux pour ne pas être très-remarquée, et ne lui épargnait pas les conseils d'une affection presque maternelle.
La vie entière de la marquise des Moutiers, aussi bien que celle de mesdames de Bombelles et de Raigecourt, s'écoula sous le souvenir de la haute influence qui avait dominé sa première jeunesse. La vertu de Madame Élisabeth était comme ce sachet d'ambre gris dont parlent les poëtes de l'Asie: son parfum se communiquait et demeurait à tout ce qu'elle avait touché. Nous aurons souvent l'occasion de trouver ces trois noms mêlés aux confidences, aux lettres, aux événements de la vie que nous avons entrepris d'écrire: Bombelles, Raigecourt et des Moutiers, noms aimés qui devaient donner tant de consolation à Madame Élisabeth et emprunter tant de gloire à son amitié!
Une note écrite par madame de Bombelles, et remise par elle à M. Ferrand en 1795, fait connaître sa première entrevue avec la jeune princesse et la manière dont elle devint sa compagne: «Madame Élisabeth, dit-elle, avoit sept ans lorsque ma mère, désignée par les dames de Saint-Cyr à madame de Marsan comme propre à seconder ses vues et ses soins dans l'éducation de Mesdames, arriva de Strasbourg pour remplir les fonctions de sous-gouvernante. Madame de Marsan, prévenue en sa faveur, la reçut comme si elle eût dû la remercier d'avoir accepté le pénible emploi qu'elle lui avoit confié. Elle voulut voir ma sœur et moi, et nous présenta à Mesdames. Madame Élisabeth me considéra avec l'intérêt qu'inspire à un enfant la vue d'un autre enfant de son âge. Je n'avois que deux ans de plus qu'elle, et étant aussi portée qu'elle à m'amuser, les jeux furent bientôt établis entre nous et la connoissance bientôt faite. Ma mère n'ayant point de fortune, pria madame de Marsan de solliciter pour moi une place à Saint-Cyr. Elle l'obtint, et je m'attendois à être incessamment conduite dans une maison pour laquelle j'avois déjà un véritable attachement. Cependant Madame Élisabeth demandoit sans cesse à me voir; j'étois la récompense de son application et de sa docilité; et madame de Marsan s'apercevant que ce moyen avoit un grand succès, proposa au Roi que je devinsse la compagne de Madame Élisabeth, avec l'assurance que lorsqu'il en seroit temps, il voudroit bien me marier. Sa Majesté y consentit. Dès ce moment, je partageai tous les soins qu'on prenoit de l'éducation et de l'instruction de Madame Élisabeth. Cette infortunée et adorable princesse, pouvant s'entretenir avec moi de tous les sentiments qui remplissoient son cœur, trouvoit dans le mien une reconnoissance, un attachement qui, à ses yeux, me tinrent lieu des qualités de l'esprit et de l'amabilité; elle m'a conservé sans altération des bontés et une tendresse qui m'ont valu autant de bonheur que j'éprouve aujourd'hui de douleur et d'amertume. Je fus mariée à M. de Bombelles. Le Roi voulut bien, sur la demande de sa sœur, me donner une dot de cent mille francs, une pension de mille écus et une place de dame pour accompagner Madame Élisabeth. Cet événement lui causa le plus sensible plaisir. Jamais je n'oublierai l'accent avec lequel elle me dit: «Enfin, voici donc mes vœux remplis: tu es à moi! Qu'il m'est doux de penser que c'est un lien de plus entre nous, et d'espérer que rien ne pourra le rompre!»
Ce bonheur intérieur que commençait à goûter Madame Élisabeth semblait régner dans le palais de Versailles. Jamais la cour de France n'avait offert un tel spectacle: une jeune Reine y vivait en parfaite harmonie avec deux belles-sœurs de son âge, et un jeune Roi aimait à s'appuyer sur l'amitié de ses deux frères. «La plus grande intimité, dit madame Campan, s'établit entre les trois ménages. Ils firent réunir leurs repas et ne mangèrent séparément que les jours où leurs dîners étaient publics. Cette manière de vivre en famille exista jusqu'au moment où la Reine se permit d'aller dîner quelquefois chez la duchesse de Polignac, lorsqu'elle fut gouvernante; mais la réunion du soir pour le souper ne fut jamais interrompue et avait lieu chez madame la comtesse de Provence. Madame Élisabeth y prit place lorsqu'elle eut terminé son éducation, et quelquefois Mesdames, tantes du Roi, y étaient invitées. Cette intimité, qui n'avait point eu d'exemple à la cour, fut l'ouvrage de Marie-Antoinette, et elle l'entretint avec la plus grande persévérance.»
Les jeux et les plaisirs dont se montre avide la jeune cour laissent cependant place à des intrigues qui doivent parfois diviser les membres de la famille royale. Le Roi et ses frères ont chacun un caractère différent. Louis XVI, qui possède les vertus d'un homme de bien, est loin d'avoir toutes celles qui conviennent à un roi. Sa défiance de lui-même est extrême. À l'époque où il n'était encore que Dauphin, on agitait une question difficile à résoudre: «Il faut, dit-il, demander cela à mon frère de Provence.» Confiant envers les autres, il se livre aisément; mais il entre dans des emportements fâcheux quand il s'aperçoit qu'on le trompe. Il n'a ni fermeté dans le caractère ni grâces dans les manières. Comme certains fruits excellents dont l'écorce est amère, il a l'extérieur rude et le cœur parfait. Sévère pour lui seul, il observe rigoureusement les lois de l'Église, jeûne et fait maigre pendant les quarante jours de carême, et trouve bon que la Reine ne l'imite point. Sincèrement pieux, mais formé à la tolérance par l'influence du siècle qu'il subit sans s'en rendre compte, il est disposé, trop disposé peut-être à sacrifier les prérogatives du trône toutes les fois qu'on allègue les intérêts de son peuple; car un des premiers intérêts d'une nation est le maintien d'un pouvoir fort et incontesté. Une royauté affaiblie est impuissante à la fois pour le bien et contre le mal.
Il y a en lui quelque chose d'honnête qui n'accepte pas la solidarité complète du règne précédent; mais, héritier d'un régime dont il porte le poids, il est mal à l'aise entre un passé qui soulève des répugnances et un avenir non point menaçant encore, mais rempli de doutes et de mystères.
Simple, économe, aimant la lecture et l'étude, cherchant l'oubli du trône dans l'exercice de la chasse ou d'un travail manuel, détestant les femmes sans mœurs et les hommes sans conscience, il semble étranger dans une cour dont les mœurs sont légères et les consciences faciles. Un jeune prince plein de modération, au faîte de la puissance et fidèle au devoir, se regardant comme le père de tous les Français et se sentant attiré de préférence vers ceux de ses enfants qui sont les plus faibles, ne peut être apprécié de ses courtisans, gens pour la plupart frivoles ou endettés, corrupteurs ou corrompus, regardant les innovations comme un danger et les réformes comme un crime.
Le comte de Provence, dont l'esprit est égal à l'instruction, cache sous une dignité prudente le regret de n'être point au premier rang. Versé dans la culture des lettres, servi par une mémoire prodigieuse, il se regarde, sous le rapport littéraire, comme bien supérieur au Roi son frère. Ce sentiment est né chez lui dès l'enfance. Un jour, jouant avec ses frères, le duc de Berry lâcha le mot: Il pleuva. «Ah, quel barbarisme! s'écria le comte de Provence; mon frère, cela n'est pas beau: un prince doit savoir sa langue. – Et vous, mon frère, reprit l'aîné, vous devriez retenir la vôtre.» Monsieur se plaît dans la société des gens de lettres, cherche à se rendre compte du souffle des idées qui se lève à l'horizon, se prépare aux événements pour n'en être pas surpris, ménage les partis sans les embrasser, vit avec ses frères sans division et sans confiance, caresse froidement l'opinion; et quand viendra le jour où des combinaisons malencontreuses feront échouer le départ du Roi son frère, il saura avec habileté s'éloigner du péril et se réserver pour l'avenir.
Le comte d'Artois est le type du Français d'autrefois: il en a l'humeur insouciante, l'esprit enjoué, les grâces chevaleresques. Bien fait, recherché dans sa toilette, adroit dans les exercices du corps, il n'apprécie la grandeur que pour les avantages qu'elle donne, la fortune que pour les plaisirs qu'elle procure. La coutume qu'il a de regarder les femmes le suit jusque dans le sanctuaire. «Monseigneur, lui dit un jour Mgr du Coëtlosquet, évêque de Limoges, j'ai une grâce à demander à Votre Altesse Royale, c'est de ne pas aller à la messe.»
Né dans une cour légère et voluptueuse, il en a pris naturellement les habitudes; mais son cœur généreux n'y doit pas périr, et survivra à l'exil, au trône et au malheur.
On comprend qu'autour de ces trois princes, dont nous venons d'esquisser rapidement le caractère, doivent se grouper des hommes de mœurs et d'idées différentes. Les honnêtes sont près de Louis XVI, les politiques près de Monsieur, les frivoles près du comte d'Artois. C'est ainsi que les amis du Roi sont rares, ceux de Monsieur nombreux, ceux du comte d'Artois innombrables. Ceux-ci ont la prétention de se croire plus directement placés sous le patronage de la Reine, qui, jeune, vive et brillante, cherche les plaisirs de son âge et se plaît dans la société du comte d'Artois, dont les goûts se rapprochent des siens. L'esprit pervers de cette époque s'essaye à faire un crime à Marie-Antoinette de trouver son beau-frère aimable; mais il ne parviendra pas, aux yeux de l'histoire, à envenimer des parties de plaisir qui ont toute la cour pour témoin, sans compter la comtesse d'Artois, qui aime tendrement son mari. On devine cependant le parti que cherche à tirer de cette amitié fraternelle la malignité d'un essaim d'étourdis, incapables de supposer le bien et toujours prêts à croire le mal qu'ils ont inventé.
Madame la comtesse de Provence, d'une figure peu sympathique, mais ornée de deux beaux yeux qui lui ont attiré les seuls compliments qu'elle ait mérités, inspira, dit-on, dès la première entrevue une spirituelle repartie à son fiancé. «Monsieur le comte de Provence, lui dit le lendemain le comte d'Artois, toujours disposé à plaisanter, vous aviez la voix bien forte hier; vous avez crié bien fort votre Oui. – C'est, repartit l'époux passionné, que j'aurois voulu qu'il pût se faire entendre jusqu'à Turin.» Cette princesse se montra très-neuve sur l'étiquette, et le cérémonial l'embarrassait beaucoup. Le lendemain de son mariage, comme madame de Valentinois, sa dame d'atour, voulait lui mettre du rouge: «Fi donc! s'écria-t-elle, madame; prenez-vous ma figure pour une tête à perruque? – Madame, lui dit le comte de Provence, conformez-vous à l'usage de la cour, et je vous trouverai infiniment mieux. – Allons, madame de Valentinois, dit-elle, mettez-moi du rouge, et beaucoup, puisque j'en plairai davantage à mon mari.»
Madame juge sévèrement son prochain; elle a une instruction variée, un esprit mordant; elle n'est pas exempte d'ambition. Peu aimée de son mari, quoi qu'en ait dit le comte d'Artois, jalouse de ses sœurs qui ont des enfants, elle affecte en public une gravité que l'observateur clairvoyant considère comme la critique de la vivacité et de la grâce enjouée de la Reine. En 1787, elle eut une conversation très-vive avec Marie-Antoinette, qu'elle exhorta à faire plus de cas du peuple, à se rendre digne des vive la Reine! qu'on lui prodiguait précédemment. La princesse ne trouvant pas que ses sages représentations fissent grand effet sur l'esprit de Sa Majesté, elle s'échauffa davantage et s'écria avec chaleur: «Si vous dédaignez mes avis, Madame, vous ne serez que la reine de France, vous ne serez pas la reine des Français.» On est disposé à croire que, sans encourager ni l'opposition qui luttait contre le Roi, ni la calomnie qui s'attachait aux pas de la Reine, Madame se réjouissait de ces deux injustices, dont l'une donnait plus de faveur à l'ambition de son mari et l'autre plus de relief à sa propre dignité.
La comtesse d'Artois est toute petite, d'une carnation remarquablement blanche et rose, mais son visage est porteur d'un nez très-long, qui donne à sa physionomie délicate et gracieuse quelque chose d'agressif. Bienveillante et charitable, elle est fort aimée, et le privilége qu'elle a d'avoir seule encore donné des héritiers à la couronne lui assure naturellement quelque crédit.
Le banquet qui avait eu lieu à l'occasion de son mariage était demeuré inscrit dans les fastes des fêtes royales, à cause d'un surtout merveilleux de l'invention du sieur Arnoux, célèbre machiniste du temps. Au milieu était une rivière claire et limpide qui coula pendant tout le repas avec une abondance intarissable. Son cours était orné de petits bateaux, de chaumières de pêcheurs, d'arbres, de prairies, et de tout ce qui peut rendre agréables les bords d'un fleuve.
On a aussi retenu de cette époque un mot qui fit quelque peu rire par sa naïveté. La ville de Paris, à l'occasion de ce mariage, dota des filles. Une d'elles (mademoiselle Lise) se présenta pour se faire inscrire. On lui demanda le nom de son amoureux, et où il était. «Je n'en ai point, dit-elle; je croyais que la ville fournissait de tout.» Les officiers municipaux allèrent lui choisir un mari.
Nous avons dit quel était l'intérieur du palais de Versailles dans les années qui précédèrent la révolution. Les princes et les princesses du sang n'y faisaient que de rares apparitions; ils avaient des goûts différents, des habitudes différentes.
«Des trois branches de la maison de Bourbon, disait un jour le vieux maréchal de Richelieu, chacune a un goût dominant et prononcé: l'aînée aime la chasse, les d'Orléans aiment les tableaux, les Condé aiment la guerre. – Et le roi Louis XVI, lui demanda-t-on, qu'aime-t-il? – Ah! c'est différent, il aime le peuple.»
Les princes du sang ne se montraient donc à la cour que dans les jours marqués par l'étiquette. J'en excepte, on le comprend, la princesse de Lamballe, que ses fonctions de surintendante de la maison de la Reine y retenaient, aussi bien que son affection. Les princes du sang, que les querelles du Parlement avaient jetés dans l'opposition, oubliaient que tout leur éclat n'était qu'un reflet du trône, et trouvaient commode de joindre aux priviléges que leur conférait leur naissance les avantages de la popularité que leur attirait la prétendue indépendance de leur opinion. Le temps venait où cette grande maison de Bourbon allait s'affaiblir et se condamner à l'impuissance en divisant ses faisceaux.
Madame Élisabeth avait senti tout ce qu'il y avait de regrettable et de dangereux dans les habitudes de la cour, aussi bien que dans les tendances qui se manifestaient au dehors. Cette action incessante de rivalité et de dénigrement, d'envie et de mensonge, effarouchait la délicatesse et la droiture de son cœur; elle se prenait à regarder le palais de Versailles comme un séjour redoutable. Étrangère à toutes les intrigues, elle n'avait de parti que celui de ses frères, et, quoique décidée à conserver en toute occasion d'amicales relations avec ses belles-sœurs, elle leur mesurait un peu son affection sur le bonheur qu'elles procuraient à ceux qui lui étaient unis par les liens du sang.
La transformation complète du caractère d'Élisabeth, son esprit enjoué, son cœur excellent, l'avaient rendue chère à toute la famille royale et particulièrement au Roi son frère. Heureux de voir que chez elle la sagesse et la raison avaient devancé l'âge, Louis XVI pensa qu'il pouvait pour elle devancer l'époque où l'on formait habituellement la maison d'une fille de France. Une circonstance semblait favoriser son intention. La Reine était au moment de donner le jour au premier gage d'une alliance formée depuis huit ans, et il fut convenu que les personnes chargées de l'éducation de Madame Élisabeth passeraient à celle de l'enfant royal si ardemment désiré79.
Madame Élisabeth va donc se trouver maîtresse de toutes ses actions, et elle n'a pas quinze ans! Elle va être entourée de toutes les splendeurs de la fortune, appelée par tous les plaisirs, observée par tous les regards. Elle n'a pas quinze ans, et elle est libre! Qu'est-ce que la liberté à cet âge, si ce n'est la cessation des études, les amusements, la toilette, la parure et les fêtes? Ce n'est pas là le programme que se trace la jeune sœur du Roi. Son changement d'état lui inspire le plus grand effroi, mais il n'en inspire qu'à elle; elle a pris dans sa conscience la volonté d'exercer sur elle-même la surveillance et le contrôle que ses institutrices n'exerceront plus. Elle s'est dit: «Mon éducation n'est pas terminée, je la continuerai selon les règles établies. Je conserverai tous mes maîtres, j'écouterai les conseils avec plus d'attention, je suivrai leur exemple avec plus de docilité; je ne verrai que les dames qui m'ont élevée ou qui sont attachées à ma personne. Ce n'est pas contre moi que je me prémunis, c'est contre la méchanceté du siècle, si ingénieuse à saisir l'occasion de calomnier. Comme par le passé, je visiterai mes respectables tantes, les dames de Saint-Cyr, les Carmélites de Saint-Denis; les mêmes heures seront consacrées à la religion, à l'étude des langues et des belles-lettres, aux conversations instructives, à mes promenades à pied et à cheval.» Tout ce qu'elle se promettait, elle le tint. Aussi plus tard, lorsqu'elle allait voir ou qu'elle recevait chez elle ses anciennes institutrices, elle put leur dire plus d'une fois, avec une douce et naïve fierté: «Je veux que vous me trouviez toujours digne de votre sourire et de votre approbation.»
«Ainsi que tous les hommes qui étoient dans la chambre; il n'y avoit que les dames d'assises. – M. de Penthièvre nomma madame d'Aubeterre à M. le comte de Falkenstein, M. d'Aubeterre l'ayant désiré. M. le comte de Falkenstein fit beaucoup de politesses à cette dame; il ne la salua point.»
«Madame la princesse de Conti s'est fait inscrire aussi une troisième fois à la porte de l'Empereur, chez M. de Mercy, la veille ou l'avant-veille de son départ, parce que Sa Majesté Impériale étoit revenue une troisième fois à la maison de madame la princesse de Conti, à Paris.»