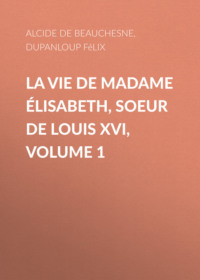Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Vie de Madame Élisabeth, soeur de Louis XVI, Volume 1», sayfa 11
Louis XVI avait fait des réformes utiles dans l'administration intérieure du royaume. Il avait aboli les corvées, en les convertissant en impôts pécuniaires; il avait créé pour Paris le Mont-de-Piété et la Caisse d'escompte, et calmé les craintes d'une banqueroute en assurant le payement des rentes sur l'hôtel de ville. Le premier événement politique de son règne fut la guerre d'Amérique. Des écrivains politiques ont prétendu que la division entre la Grande-Bretagne et ses colonies était l'œuvre du duc de Choiseul, qui, pour se rendre nécessaire, n'avait cessé de troubler par ses sourdes manœuvres la bonne intelligence entre les puissances, et que c'était pour cela, disaient-ils, que l'impératrice de Russie l'appelait le cocher de l'Europe. Quoi qu'il en soit, la guerre d'Amérique ne fut pas seulement occasionnée par le droit mis sur le papier timbré, ni par l'impôt de trois deniers sterling par livre de thé. Des raisons plus élevées forcèrent les Anglo-Américains à prendre les armes.
Dans un acte récemment publié, le Parlement avait déclaré avoir le droit de faire obéir les colonies à toutes ses lois et dans tous les cas. Ce fut cet acte, dont l'exécution aurait emporté jusqu'à l'ombre de la liberté, qui produisit la révolution américaine.
Lorsque la Grande-Bretagne essaya d'établir dans ses colonies une taxe sur le thé, les femmes de Boston s'engagèrent par une convention à ne point faire usage de cette boisson tant que l'insurrection aurait les armes à la main contre la métropole. Les Bostoniens traînèrent par les rues de leur ville la prétendue effigie de l'auteur de cette taxe, avec son nom écrit en gros caractères; cette effigie fut chargée des imprécations populaires, puis pendue à un gibet et brûlée.
Peu de jours après cette manifestation, les représentants des États-Unis s'assemblaient, et, par un acte solennel, déclaraient tous les habitants des colonies libres et indépendants, et défendaient toute relation avec l'Angleterre. Le congrès appela la religion au secours de la liberté naissante, et plaça l'Amérique septentrionale sous la protection immédiate de la Providence. Cette dédicace auguste se fit avec un grand appareil: une couronne consacrée à Dieu fut posée sur la Bible; cette couronne fut ensuite divisée en treize parties pour les députés des treize provinces, et des médailles furent frappées pour perpétuer cet événement.
Voulant justifier sa conduite aux yeux des nations, le congrès publia un manifeste: «Nous déclarons, y est-il dit, ne vouloir pas laisser à nos enfants une indigne servitude. Notre cause est juste, nos ressources sont grandes; nous déclarons, à la face du ciel et de la terre, que nous emploierons avec une constance inébranlable les armes que nos ennemis nous ont forcés de prendre, résolus de mourir libres plutôt que de vivre esclaves. Nous ne combattons point pour faire des conquêtes; nous montrons au monde le triste spectacle d'un peuple outragé sans aucun prétexte par des adversaires qu'il n'avait jamais provoqués. Ils se vantent, ces ennemis orgueilleux, d'être humains et civilisés, et ils nous offrent la servitude ou la mort!..»
Le peuple de New-York, dès que l'acte d'indépendance fut publié, courut en masse à la place publique, abattit la statue de bronze de Georges III, la mutila, et demanda qu'elle fût convertie en instruments de guerre. Toutes les femmes, et à leur tête la femme de Washington87, se firent remarquer par leur zèle patriotique, se dépouillant de leurs bijoux pour en faire hommage à leur pays. Des traits d'un héroïsme antique signalèrent cette guerre mémorable. Il en est un que je ne puis passer sous silence, car sa lecture arracha des larmes d'admiration à Madame Élisabeth. À la bataille de Monmouth, livrée le 28 juin 1778, avant que l'action générale fût engagée, deux batteries avancées échangeaient entre elles un feu très-vif. La chaleur était excessive. La femme d'un canonnier, du nom de Molli, courait sans relâche à une fontaine voisine pour y puiser de l'eau qu'elle apportait aux combattants. Comme elle se disposait à passer au poste de son mari, elle le voit tomber; elle précipite sa marche pour le secourir, il était mort. «Qu'on ôte ce canon de sa place, dit aussitôt l'officier, car je ne puis remplacer le brave qui vient d'être tué. – Non, s'écrie la femme intrépide du canonnier gisant à terre, le canon ne sera point ôté faute de quelqu'un pour le servir. Puisque mon brave mari ne vit plus, je ferai tout ce qui dépendra de moi pour le venger.» Elle se met à l'œuvre, et, pendant toute l'action, elle remplit l'office de canonnier avec tant d'activité et de courage, qu'elle s'attira l'attention et l'éloge de tous ceux qui en furent témoins. Le général Washington lui donna le grade de lieutenant-capitaine et lui en assura la demi-paye sa vie durant. Elle portait l'épaulette, et tout le monde l'appelait capitaine Molli.
En 1776, trois commissaires américains, Benjamin Franklin, Arthur Lee88 et Silas Deane étaient arrivés en France pour solliciter l'assistance du cabinet de Versailles. Leur situation au début fut difficile: le gouvernement français, en effet, n'étant pas prêt à rompre avec l'Angleterre, ne pouvait les reconnaître officiellement. Ce fut dans cette circonstance qu'un ami de M. de Choiseul, M. le Ray de Chaumont, ancien conseiller du roi Louis XV dans ses conseils, grand maître des eaux et forêts et intendant honoraire des Invalides, leur fit offrir de leur prêter sans aucune rétribution une maison située au bout de son parc de Passy89: ce parc occupait tout le terrain où s'élève maintenant le quartier Singer, et il y a peu d'années on voyait encore le mur qui en marquait la limite. L'hôtel, qui était une des résidences d'été de M. le Ray de Chaumont, était construit entre la Seine et l'emplacement où l'on a bâti le magnifique établissement des Frères de la Doctrine chrétienne. La maison qu'habitaient les trois commissaires était située, nous l'avons dit, à l'autre bout du parc, du côté de Beau-séjour; elle n'existe plus aujourd'hui. Ce fut là que furent écrites les lettres de Franklin datées de Passy. M. le Ray de Chaumont, qui avait des rapports fréquents avec les ministres de Louis XVI, se trouva ainsi, au début de la mission des commissaires américains, l'intermédiaire naturel entre eux et le gouvernement français, et il les servit d'autant plus chaleureusement qu'il pensait qu'en agissant ainsi il servait les intérêts de la France en créant de sérieux embarras à l'Angleterre.
Les trois envoyés américains vivaient à Passy dans une grande retraite, et s'occupaient exclusivement des intérêts de leur pays. Très-fêté par les savants ses confrères, comme aussi par les personnes qui pouvaient le posséder, Franklin se montrait difficile à nouer des relations et se tenait dans une réserve qu'on disait prescrite par son gouvernement, et qui, dans tous les cas, était conseillée par la politique. Le premier qui aida efficacement les États-Unis fut l'hôte des commissaires américains, Silas Deane et Franklin. Arthur Lee n'avait pas tardé à retourner en Amérique, et avant 1778 John Adams était venu le remplacer à Passy. La preuve du concours prêté par M. le Ray de Chaumont à la cause de l'indépendance américaine se trouve dans une lettre écrite par le docteur Franklin, et appuyant en 1789 les démarches faites par le fils de son hôte pour rentrer dans des avances considérables faites aux États-Unis90. Un peu plus tard, la cour de Versailles, ardemment sollicitée, sembla prendre intérêt à la cause des insurgents américains. Beaumarchais, qui avait l'oreille de M. de Maurepas, fut autorisé secrètement à faire des armements de commerce avec les colonies anglaises. Ce fut à l'activité comme au crédit de cet agent qu'elles durent l'avantage des approvisionnements indispensables pour leurs premières campagnes. Mais on a dit que Beaumarchais leur vendit fort cher son zèle et ses services. Cependant, sans la participation de son collègue, M. Deane, fatigué des hésitations apparentes de M. de Sartine, ministre de la marine, le pria par écrit de se décider sous quarante-huit heures à faire signer le traité d'union entre la France et l'Amérique septentrionale; qu'autrement il s'arrangerait avec l'Angleterre. Dès que Franklin reçut la confidence: «Vous avez, lui dit-il avec terreur, offensé la cour de France et ruiné l'Amérique. – Tranquillisez-vous jusqu'à ce que nous ayons une réponse, répondit le négociateur. – Une réponse! Nous allons être mis à la Bastille. – C'est ce que nous verrons.»
Peu de temps après parut le premier secrétaire de M. de Sartine: «Messieurs, leur dit-il, vous êtes priés de vous tenir prêts pour une entrevue à minuit; on viendra vous chercher. – À minuit! s'écrie le docteur Franklin dès que le secrétaire fut sorti; vous le voyez, ma prédiction est vérifiée. Monsieur Deane, vous avez tout perdu!»
À minuit, on vint les prendre; ils montèrent dans une voiture qui les conduisit à cinq lieues de Paris, en une maison de campagne où ils furent introduits près de M. de Sartine: «Messieurs, leur dit-il, j'ai préféré vous recevoir ici, afin de mieux couvrir cette démarche d'un voile mystérieux; asseyez-vous: nous allons signer notre traité.»
Franklin, Deane et Arthur Lee furent présentés au Roi, en qualité de députés des États-Unis d'Amérique, par M. de Vergennes, ministre des affaires étrangères. «Ils reçurent, dit une chronique du temps, tous les honneurs usités à l'égard des ministres des puissances de premier ordre; la garde battit aux champs, et les officiers saluèrent de la pique et du drapeau. Le docteur Franklin se dispensa de l'étiquette de porter l'épée, et ce grand homme, suffisamment paré de son propre mérite, avoit un habit de velours noir et uni.»
Le cabinet de Versailles espérait que, dans cette circonstance, l'Espagne trouverait son intérêt à s'unir à la France contre l'Angleterre. Déjà, dès le commencement de 1778, Louis XVI avait confié au roi d'Espagne son désir de traiter avec les États-Unis91. Deux mois après, il mandait au même prince que ce désir était réalisé:
«À Versailles, le 9 mars 1778.
»Monsieur mon frère et oncle, l'étroite amitié, l'union intime et la confiance réciproque qui règnent si heureusement entre nos maisons, m'engagent à lui faire part moi-même de la résolution que j'ai prise. Votre Majesté n'ignore pas les raisons prépondérantes qui m'ont engagé à faire un traité d'amitié et de commerce avec les États-Unis de l'Amérique, étant dans l'intime persuasion de l'avantage qui nous en reviendroit en affoiblissant l'Angleterre d'une partie considérable de ses forces, sachant d'ailleurs qu'elle travailloit à se raccommoder avec ses colonies. Ce que j'avois prévu vient d'arriver. L'Angleterre a mis au jour ses projets pour se réconcilier avec l'Amérique, la nation y applaudit, et il ne manque que le consentement de la dernière pour la réunion, qui, sous quelque forme que ce soit, ne peut que nous être nuisible. J'espère que les mesures que j'ai prises traverseront les mesures de l'Angleterre; mais si, d'une part, la coalition avec les États-Unis est utile, il ne l'est pas moins de soutenir la dignité et l'honneur de la couronne. C'est ce qui m'a engagé à faire faire à Londres la déclaration que mon ambassadeur a ordre de communiquer à Votre Majesté. Elle ne peut que soutenir le courage de l'Amérique et réprimer l'audace de l'Angleterre, qui ne cache pas ses vues hostiles et prochaines. Ces raisons majeures et le secret qui commence à s'échapper, m'ont fait penser qu'il n'y avoit pas à différer de se montrer avec la dignité et la force qui conviennent. J'aurois bien désiré d'avoir l'avis de Votre Majesté, qui m'est bien précieux dans mes déterminations, mais les circonstances ne m'ont pas permis de l'attendre. J'ai fait informer du tout le comte d'Aranda et le chevalier d'Escarano pour leur instruction, et j'ai ordonné au comte de Montmorin de communiquer à Votre Majesté plus en détail les raisons qui m'ont déterminé et les mesures que j'ai prises en conséquence; je désire qu'elles aient son approbation, qui leur ajoutera un nouveau poids. Votre Majesté connoît la vive et sincère amitié avec laquelle je suis,
»Monsieur mon frère et oncle,»De Votre Majesté,»Bon frère et neveu,»Louis92.»
Le 11 juillet 1778, M. Gérard, ministre plénipotentiaire du Roi de France, arriva à Philadelphie. Le 6 août suivant fut un grand jour pour les États-Unis: les représentants de ces États donnaient une audience solennelle à l'envoyé du plus puissant roi de l'Europe. MM. Richard Lee et Samuel Adams, l'un député de la Virginie, l'autre de Massachussets, allèrent prendre dans un carrosse à six chevaux M. Gérard, qu'ils conduisirent à la maison d'État de Philadelphie, où, marchant à sa gauche, ils le menèrent dans la salle du congrès, au fauteuil qui lui était préparé en face de celui du président. Le ministre plénipotentiaire s'étant assis, remit des lettres de créance à son secrétaire, qui les donna au président.
M. Gérard prononça ensuite un discours; cette phrase y fut très-remarquée. «Il n'a pas dépendu de Sa Majesté que ses engagements envers vous n'assurent votre indépendance sans effusion ultérieure de sang et sans aggraver les maux de l'humanité, dont toute son ambition est d'assurer le bonheur.»
La réponse que fit le président au discours du ministre de France commençait ainsi: «Les traités conclus entre Sa Majesté Très-Chrétienne et les États-Unis d'Amérique sont une preuve éclatante de sa sagesse et de sa magnanimité respectables à toutes les nations. Les vertueux citoyens de l'Amérique, en particulier, n'oublieront jamais l'attention bienfaisante qu'elle a donnée à la violation de leurs droits; jamais ils ne méconnoîtront la main protectrice de la Providence qui a daigné les élever jusqu'à un ami aussi puissant et aussi illustre.»…
Dans le courant de mai 1779, l'Espagne déclara que dans cette guerre elle ferait cause commune avec la France. Louis XVI, au reçu de cette nouvelle, écrivit au roi:
«Versailles, le 29 mai 1779.
»Monsieur mon frère et oncle, j'ai appris avec le plus grand plaisir par le retour du dernier courrier que Votre Majesté est décidée à joindre ses forces aux miennes pour combattre l'ennemi commun. J'espère qu'elle ne doute point de la satisfaction que je ressens en voyant la justice de ma cause soutenue par un allié et un parent qui me sont attachés par des liens si chers. J'espère que Dieu daignera bénir le succès de nos armes, et que dans peu nous pourrons rendre glorieusement à nos sujets le bienfait précieux de la paix.
»Votre Majesté connoît la vive et sincère amitié avec laquelle je suis, monsieur mon frère et oncle,
»De Votre Majesté,»Bon frère et neveu,»Louis.»
Nous n'entrerons pas dans les détails des grands événements qui suivirent: notre sujet ne le comporte pas. Nous fûmes heureux dans cette guerre comme auxiliaires: l'Amérique brisa le joug des Anglais et affermit son indépendance; mais notre marine et celle de l'Espagne, notre alliée, furent cruellement éprouvées93.
Cette guerre, bien qu'elle fût, comme toutes les guerres, contraire aux sentiments d'humanité de Madame Élisabeth, avait cependant un côté qui flattait son amour-propre national, et lui rendait moins pénibles des sacrifices qui tournaient à la gloire de son frère et de son pays. Mais ce qu'elle remarquait surtout avec une vive satisfaction dans cette lutte, c'était le sentiment généreux qui la dominait, et parfois en atténuait les malheurs. Ainsi, elle voyait dans un rapport adressé le 26 novembre 1781 au ministre de la marine par le marquis de Bouillé, gouverneur général de la Martinique, que les troupes françaises qui venaient, sous ses ordres, de s'emparer de l'île de Saint-Eustache, avaient montré dans cette circonstance un esprit de justice et de loyauté égal à leur patience et à leur courage94.
«J'ai trouvé chez le gouverneur, rapporte M. de Bouillé, la somme d'un million qui étoit en séquestre jusqu'à la décision de la cour de Londres; elle appartenoit à des Hollandois, et je la leur ai fait remettre d'après les preuves authentiques de leur propriété.»
Le rapport de M. de Bouillé est suivi de la déclaration suivante:
«Le lieutenant-colonel Cockburn, du 35e régiment, qui commandoit à Saint-Eustache lorsque cette île a été enlevée par les François, a déclaré que, sur l'argent déposé dans cette colonie par l'amiral Rodney et le général Waughan, il se trouvoit une somme de 264,000 livres qui lui appartenoit, et il l'a réclamée. Le marquis de Bouillé ayant rassemblé les officiers supérieurs du corps pour leur faire part de la réclamation du lieutenant-colonel Cockburn, ils ont tous été d'avis de rendre cet argent au gouverneur anglois, ce qui a été effectué.»
M. de la Pérouse, capitaine de vaisseau, commandant une division du Roi, après avoir rendu compte à M. le marquis de Castries, ministre de la marine, de ses opérations conduites avec autant de sagesse que d'habileté, terminait ainsi sa lettre, écrite à bord du Sceptre, dans le détroit d'Hudson, le 6 septembre 1782:
«J'ai eu l'attention, en brûlant le fort d'York, de laisser subsister un magasin assez considérable dans un lieu éloigné du feu, et dans lequel j'ai fait déposer des vivres, de la poudre, du plomb, des fusils et une certaine quantité de marchandises d'Europe, les plus propres aux échanges avec les sauvages, afin que quelques Anglois que je sais s'être réfugiés dans les bois, lorsqu'ils reviendront sur leur ancien établissement, trouvent dans ce magasin de quoi pourvoir à leur subsistance jusqu'à ce que l'Angleterre ait pu être instruite de leur situation. Je suis assuré que le Roi approuvera ma conduite à cet égard, et qu'en m'occupant du sort de ces malheureux, je n'ai fait que prévenir les intentions bienfaisantes de Sa Majesté.»
Louis XVI venait d'acquérir à la reconnaissance du peuple américain des droits que le malheur devait rendre plus sacrés, et en effet il n'est pas de contrée où le meurtre juridique du 21 janvier ait causé plus de réprobation, de deuil et de regrets que dans les États de l'Union; mais l'idée républicaine que nous étions allés défendre au delà des mers devait se tourner peu de temps après contre la France: la fièvre contagieuse de la liberté et de l'égalité qui régnait sur le sol américain, communiquée à nos officiers, se répandit par eux à leur retour sur le vieux continent.
Benjamin Franklin, dont la bonhomie apparente cachait un esprit fin et délié, avait plu à la cour et à la ville par sa simplicité même, et tout Paris raffolait de ce sage, qui, dans un siècle où l'on parlait tant de la nature, semblait avoir apporté les habitudes primitives du planteur américain. Sa tête grave et spirituelle à la fois, le tour pittoresque de sa conversation, sa familiarité qui n'excluait pas la dignité, sa naïveté apparente dans laquelle il entrait beaucoup de calcul, son léger accent, tout enfin, jusqu'à son air d'étrangeté, le rendait l'objet d'un empressement et d'un respect curieux: on l'estimait, on l'honorait. L'ambassadeur accrédité près du Roi accréditait sans le savoir la république en France.
La France, tout affectionnée encore à cette époque à la maison royale, semblait attendre impatiemment les nouvelles couches de la Reine. Un fait singulier qui eut lieu la veille de ce grand événement (c'est-à-dire le dimanche 21 octobre 1781) occupa l'attention publique.
Une espèce de pèlerin, grand, bien fait, vêtu de blanc, la tête couverte d'un voile, ayant les jambes entrelacées de rubans de la même couleur au lieu de bas, et des sandales au lieu de souliers, après s'être rendu à Sainte-Geneviève, entra dans Notre-Dame pendant la messe, se dirigea vers la chapelle de la Vierge, où il alluma un grand cierge qu'il tira du fond d'une croix énorme qu'il portait à la main. Ce spectacle attira l'attention des chanoines, dont quelques-uns, traitant la chose gravement, opinaient déjà pour le faire arrêter comme un objet de scandale, car on se doute du brouhaha qu'avait causé une pareille mascarade. Cependant l'avis plus convenable fut de lui envoyer le suisse pour lui demander qui il était, ce qu'il voulait, etc. Il ne donna pour toute réponse qu'un passe-port de M. le lieutenant général de police, qui disait en substance: Laissez passer le porteur du présent billet. Il remit en même temps quelque argent à ce suisse afin de le distribuer aux pauvres, et ajouta qu'il se transportait de là au Calvaire, où l'on dit qu'après avoir fait sa prière, il a quitté son accoutrement bizarre et est monté dans un carrosse qui l'attendait95.
Enfin, le Dauphin vint au monde le 22 octobre 1781.
Louis XVI, dans son Journal, a donné des détails très-circonstanciés sur ce grand événement.
«La Reine, dit-il, avoit très-bien passé la nuit du 21 au 22 octobre. Elle sentit quelques petites douleurs en s'éveillant qui ne l'empêchèrent pas de se baigner. Elle en sortit à dix heures et demie. Les douleurs continuoient à être médiocres; je ne donnai contre-ordre pour le tiré que je devois faire à Saclé qu'à midy. Entre midy et midy et demi, les douleurs augmentèrent… et à une heure un quart juste à ma montre elle est accouchée très-heureusement d'un garçon… Il n'y avoit dans la chambre que madame de Lamballe, Monsieur, le comte d'Artois, mes tantes, madame de Chimay, madame de Mailly, madame d'Ossun, madame de Tavannes et madame de Guéménée, qui alloient alternativement dans le salon de la Paix qu'on avoit laissé vuide. Dans le grand cabinet, il y avoit ma maison, celle de la Reine, et les grandes entrées et les sous-gouvernantes, qui entrèrent tous… et se tinrent dans le fond de la chambre sans intercepter l'air. De tous les princes que madame de Lamballe avoit avertis à midy, il n'y eut que M. le duc d'Orléans qui arriva… (il étoit à la chasse à Fausse-Repose), et il se tint dans la chambre ou le salon de la Paix. M. le prince de Condé, M. de Penthièvre, M. le duc de Chartres, madame la duchesse de Chartres, madame la princesse de Conty et mademoiselle de Condé arrivèrent que la Reine étoit accouchée, M. le duc de Bourbon le soir, et M. le prince de Conty le lendemain. La Reine a vu tous ces princes le lendemain les uns après les autres. Après que la Reine a esté accouchée, on a porté mon fils dans le grand cabinet, où je l'ai vu laver et habiller, et je l'ai remis entre les mains de madame de Guéménée, gouvernante. Après que la Reine a esté délivrée, je lui ai annoncé que c'étoit un garçon, et on lui a porté sur son lit. Après qu'elle l'a eu vu quelque temps, chacun a esté chez soi. J'ai signé les lettres de part de ma main pour l'Empereur, le roi d'Espagne et la princesse de Piémont, et j'ai ordonné qu'on fasse partir les autres que j'avois déjà signées. À trois heures, j'ai esté à la chapelle, où mon fils a été baptisé par le cardinal de Rohan et tenu sur les fonts de baptême par l'Empereur et la princesse de Piémont, représentés par Monsieur et par ma sœur Élisabeth. Il a esté nommé Louis-Joseph-Xavier-François. Mes frères, mes sœurs, mes tantes, M. le duc d'Orléans, M. le duc de Chartres, M. le prince de Condé et M. de Penthièvre ont signé l'acte, les princesses n'ayant pas eu le temps d'estre habillées. Après le baptesme, j'ai entendu en bas le Te Deum chanté par la musique. Le soir, pendant que je voiois tirer le feu d'artifice dans la place d'Armes, le premier président de la chambre des comptes est venu me complimenter; les autres, qui n'estoient pas à Paris, sont venus les jours d'après. Le lendemain à mon lever les ambassadeurs sont venus me faire leur cour, et le nonce à la teste m'a fait un compliment sans cérémonie. À six heures, j'ai reçu les révérences de cent vingt-cinq femmes, mes frères, sœurs, tantes et princesses étant dans le cabinet. Le vendredy 26, je suis parti à quatre heures un quart; étoient dans ma voiture Monsieur, le comte d'Artois, le duc d'Orléans, le duc de Chartres et le prince de Condé. Outre la voiture de service, il y avoit deux voitures de suitte dont les personnes avoient esté invitées par le premier écuyer. Au Cours, j'ai changé de voiture et ai esté dans le grand cérémonial ordinaire à Notre-Dame, où le Te Deum a esté chanté. Toutes les cours y assistoient, et l'archevesque officiant qui m'avoit complimenté à la porte de l'église où s'étoient trouvés les trois autres princes. – Je suis revenu à Versailles dans le mesme ordre. Le dimanche 28, j'ai reçu les compliments d'usage des différentes cours, qui ont esté aussi chez mon fils. Le dimanche 4 novembre, le chapitre Notre-Dame est venu me complimenter dans la chambre, les six corps, les juges consuls à la porte de la chambre, ainsi que les dames de la halle, la compagnie d'arquebuses dans la galerie. Pendant neuf jours tous les métiers et professions sont venus sur la cour de marbre avec des violons et ce qu'ils ont pu imaginer pour témoigner leur joie; je leur ai fait distribuer environ douze mille livres. Après le baptesme de mon fils, M. de Vergennes, grand trésorier du Saint-Esprit, lui a porté le cordon bleu, et M. de Ségur la croix de Saint-Louis.
»Aussitôt après l'accouchement de la Reine, M. de Croismare, lieutenant des gardes du corps de service auprès d'elle, est parti pour aller l'annoncer au corps de ville, qui estoit assemblé… Quand mon fils est sorti de chez la Reine, M. de Tingry l'a conduit chez lui, et y a établi une sentinelle des gardes, un lieutenant et un sous-lieutenant. Il y a eu des Te Deum partout, entr'autres un à la chappelle le 29, où je n'ai pas esté. La Reine, qui a toujours continué de bien aller, a vu ses dames le 29, les princes et princesses le 30, les grandes entrées le 2 novembre, s'est levée sur sa chaise longue le 7, a vu ma maison le 7, et le reste successivement. Le dimanche 4 de novembre, il y a eu Te Deum à la paroisse à Versailles, et pendant le salut au chasteau. Illumination dans toute la ville.»
Complétons le récit du Roi par quelques détails empruntés aux Mémoires de madame Campan.
«Il régna, dit-elle, un si grand silence dans la chambre au moment où l'enfant vint au monde, que la Reine crut n'avoir encore qu'une fille; mais après que le garde des sceaux eut constaté le sexe du nouveau-né, le Roi s'approcha du lit de la Reine et lui dit: «Madame, vous avez comblé mes vœux et ceux de la France; vous êtes mère d'un Dauphin.» La joie du Roi étoit extrême, des pleurs couloient de ses yeux: il présentoit indistinctement sa main à tout le monde, et son bonheur l'avoit entièrement fait sortir de son caractère habituel. Gai, affable, il renouveloit sans cesse les occasions de placer les mots mon fils ou le Dauphin. La Reine, une fois dans son lit, voulut contempler cet enfant si désiré. Madame la princesse de Guéménée le lui apporta. La Reine lui dit qu'elle n'avoit pas besoin de lui recommander ce dépôt précieux, mais que, pour lui faciliter les moyens de lui donner plus librement ses soins, elle partageroit avec elle ceux qu'exigeoit l'éducation de sa fille. Le Dauphin, établi dans son appartement, reçut dans son berceau les hommages et les visites d'usage. Le duc d'Angoulême rencontrant son père à la sortie de l'appartement du Dauphin, lui dit: «Mon Dieu! papa, qu'il est petit, mon cousin! – Il viendra un jour où vous le trouverez bien assez grand, mon fils,» lui répondit presque involontairement le prince.»
Le soir même du jour de la naissance du Dauphin, madame Belloni, dans un costume de fée, chanta sur la scène italienne ce couplet de M. Imbert, qui eut un grand succès:
Je suis Fée, et veux vous conter
Une grande nouvelle:
Un fils de roi vient d'enchanter
Tout un peuple fidèle.
Ce Dauphin que l'on va fêter,
Au trône doit prétendre;
Qu'il soit tardif pour y monter,
Tardif pour en descendre.
Madame de Bombelles s'était empressée d'écrire à son mari:
«Ce 22 octobre 1781.
»C'est moi qui ai eu le bonheur d'apprendre cette bonne nouvelle-là à Madame Élisabeth: tu imagines le plaisir que cela lui a fait. Elle ne pouvoit se persuader qu'il fût bien vrai qu'elle eût un Dauphin. Enfin, tant de personnes l'ont assurée qu'il a bien fallu qu'à la fin elle se livrât à toute sa joie. Cette pauvre petite princesse s'est presque trouvée mal: elle pleuroit, rioit; il est impossible d'être plus intéressante qu'elle ne l'étoit. C'est elle qui a tenu l'enfant au nom de madame la princesse de Piémont avec Monsieur; mais ce qui m'a touchée au dernier point, c'est le contentement du Roi pendant le baptême: il ne cessoit pas de regarder son fils et de lui sourire. Les cris du peuple qui étoit en dehors de la chapelle au moment que l'enfant y est entré, la joie répandue sur tous les visages, m'ont attendrie si fort que je n'ai pu m'empêcher de pleurer. Jusqu'à ce que toutes les cérémonies fussent faites, que nous eussions dîné, il étoit cinq heures et demie, et l'heure de la poste passée. Pour réparer cela, j'enverrai Lentz demain matin à Paris mettre ma lettre à la grande poste; c'est un bon jour, de sorte qu'elle arrivera le plus tôt possible. Ce qu'il y a de bien piquant, c'est que le baron de Breteuil est parti ce matin; cela n'est-il pas guignonnant? Il n'étoit pas à Saint-Denis que la Reine, je suis sûre, souffroit déjà. Il sera chez toi ou bien près d'y arriver quand tu recevras la nouvelle. Je suis si contente, que ma tête n'est pas assez froide pour te dire tout plein de choses que j'avois projet de te mander; ce sera pour après-demain. En attendant, je t'embrasse, et suis bien impatientée d'imaginer que tu seras encore huit jours sans savoir le bonheur de la France…»
«À Versailles, ce 24 octobre 1781.
»La Reine et M. le Dauphin se portent à merveille. Le Roi ira après-demain à Notre-Dame de Paris avec tous les princes rendre grâces à Dieu d'un aussi heureux dénoûment. Madame s'est conduite à merveille: elle a marqué la plus grande satisfaction; je crois bien qu'elle ne l'éprouve pas, mais il est fort honnête et fort prudent à elle d'avoir caché son jeu. Quant à madame de Balbi, je la crois folle, car elle ne se gêne nullement; elle a l'air d'avoir une humeur de chien, tout le monde le remarque; on ne manquera pas de le dire à la Reine. Cela la fera détester plus que jamais, et je ne conçois pas sa mauvaise tête. La nourrice de l'enfant s'appelle madame Poitrine; elle est bien nommée, car elle en a une énorme et un lait excellent, à ce que disent les médecins. C'est une franche paysanne, femme d'un jardinier de Sceaux; elle a le ton d'un grenadier, jure avec une grande facilité; tout cela n'y fait rien, c'est fort heureux même, parce qu'elle ne s'étonne et ne s'émeut de rien, que par conséquent son lait s'altérera difficilement. Les dentelles, le linge qu'on lui a donnés ne l'ont pas surprise; elle a trouvé cela tout simple, et a seulement demandé qu'on ne lui fît pas mettre de poudre, parce qu'elle ne s'en étoit jamais servie, et vouloit mettre son bonnet de six cents francs sur ses cheveux comme les autres cornettes. Son ton amuse tout le monde, parce qu'elle dit quelquefois des choses fort plaisantes.
»…Je t'ai assez parlé du Dauphin de la nation; il faut que je te parle du nôtre. Je te dirai donc que Bombon a deux dents depuis hier, qui sont venues sans que nous nous en doutions; cela fait six… etc…»
»À Versailles, ce 27 octobre 1781.
»Le Roi a été hier à Paris; les illuminations étoient superbes. J'avois bien envie de les aller voir, mais Madame Élisabeth m'en a empêchée…»
«À Versailles, ce 29 octobre 1781.
»J'ai vu ce matin notre petit Dauphin. Il se porte à merveille. Il est beau comme un ange, et les folies du peuple sont toujours les mêmes. On ne rencontre dans les rues que violons, chansons et danses; je trouve cela touchant, et je ne connois pas en vérité de nation plus aimable que la nôtre…»
«À Versailles, ce 5 novembre 1781.
»Comme Madame Élisabeth m'a marqué l'intérêt le plus vif à mes peines, j'ai profité de l'occasion, et lui ai écrit avant-hier pour la prier de parler à M. de Vergennes. Tu verras par la lettre que je t'envoie96 ce qu'elle a dit et ce qu'il a répondu. J'en suis fort contente…
»J'irai dans quelques jours à Montreuil, pour ne pas laisser le petit dans le mauvais air, et à la fin du mois nous irons à Chantilly, où mademoiselle de Condé a eu la bonté de m'inviter à venir avec mon enfant les derniers quinze jours de mon exil. Je jouerai quelques petits rôles. Je l'ai accepté d'autant plus volontiers, que j'ai imaginé que lorsque tu serois ici, tu ne serois pas fâché d'avoir une occasion de renouveler connoissance avec M. le prince de Condé.
»Madame de Sorans et sa fille seront à Chantilly, ainsi que madame de la Roche-Lambert…»
«À Versailles, ce 7 novembre 1781.
»Nous avons de grandes grâces à rendre à Dieu [qui a protégé notre enfant], et à Goëtz qui l'a soigné avec un attachement que je n'oublierai de ma vie. Mon fidèle Lentz m'a tenu avant-hier un propos qui m'a touchée à un point que je ne te puis rendre. Il jouoit avec Bombon, et je lui dis en considérant l'enfant: «Mon Dieu! que je suis heureuse que ce pauvre petit ait échappé à un aussi grand danger! Si j'avois eu le malheur de le perdre, je crois qu'il m'auroit fallu enterrer avec lui.» Il me répondit du fond du cœur: «Ah! madame, il auroit fallu tous nous enterrer aussi.» Jamais je n'ai été si attendrie que dans ce moment-là. Si j'avois osé, je l'aurois embrassé de bon cœur. Qu'il est doux d'être aimé de ses gens, surtout quand ils sont sûrs, honnêtes comme mon pauvre Lentz! Vraiment je l'aime de tout mon cœur, et je préfère cent fois mieux sa tournure franche et un peu gauche à celle de ces laquais élégants qui sont tous de mauvais sujets. Madame de Travanet a été dans le désespoir de ne pouvoir venir garder Bombon; mais son mari s'y est opposé absolument. Madame Élisabeth a eu la bonté de lui écrire dès que la petite vérole de Bombon s'est déclarée, pour l'engager à venir auprès de moi; elle lui a répondu les raisons qui l'en empêchoient. Madame Élisabeth, piquée du refus de son mari, lui a répondu des choses un peu sèches pour lui. La pauvre petite Travanet a été si agitée de l'inquiétude de l'état de Bombon, de la crainte d'avoir déplu à Madame Élisabeth, de l'impatience, de la fermeté de son mari à l'empêcher de me venir voir, qu'elle a été malade. J'ai été désolée de tout cela. J'ai ignoré absolument la démarche de Madame Élisabeth, car, sans cela, je l'aurois empêchée, sachant la frayeur de M. de Travanet que sa femme puisse gagner encore la petite vérole. Si j'étois d'elle, je me ferois inoculer par Goëtz, afin d'en avoir le cœur net…
»J'ai reçu hier une lettre de ta belle-sœur, extrêmement tendre et honnête sur la maladie de Bombon. En général, tout le monde a pris de l'intérêt à mes inquiétudes. Le Roi en a demandé des nouvelles à maman, ainsi que la Reine, et cette dernière, le jour qu'il étoit fort mal, a envoyé chez Madame Élisabeth pour savoir comment il alloit. Madame de Guéménée, madame de Sérent, ont envoyé tous les jours chez moi…»
«À Versailles, ce 10 novembre 1781.
»Sais-tu que M. de Maurepas sera vraisemblablement mort quand tu recevras ma lettre? Il a la goutte dans la poitrine. On lui a mis des vésicatoires qu'il n'a pas sentis. Il a eu cependant ce matin un moment de mieux…; mais, malgré cela, les médecins ne croient pas que cela aille loin. J'en suis fâchée, il nous a toujours voulu du bien, et nous en a fait quand il a pu. Si la révolution que causera sa mort ne porte pas dans quelque temps d'ici le baron de Breteuil au ministère, nous ne devons plus espérer qu'il y arrive jamais. Il est guignonnant qu'il ne soit pas ici à présent, car les absents ont presque toujours tort. On dit, mais je n'en sais rien, que M. de Nivernois succédera à M. de Maurepas.
»J'ai vu ce matin ce pauvre M. d'Hautpoul, qui m'a chargée de te remercier de tes bontés pour son fils, de t'en demander la continuation. Il n'a fait que pleurer tout le temps qu'il étoit chez moi; cela m'a fait une peine horrible. Il est cependant aussi content que la perte qu'il vient de faire peut lui permettre, parce que Madame Élisabeth se charge de faire entrer sa fille à Saint-Cyr et le petit chevalier à l'École militaire…»
«À Versailles, ce 19 novembre 1781.
»Il y a de grandes nouvelles. Premièrement, M. de Maurepas a reçu les sacrements ce matin; il est à toute extrémité, et n'a plus que quelques heures à vivre. Il paroît à peu près certain que M. de Nivernois le remplacera. Ensuite, M. de Lauzun vient d'arriver, et il a appris la nouvelle que nous avions eu un grand combat dans lequel nous avions pris dix-huit cents matelots, tué beaucoup d'Anglois, et qu'en tout ils avoient perdu six mille hommes, et que nous n'avons pas eu un seul homme de mort; cela me paroît si beau que j'ai peine à le croire. C'est cependant Madame Élisabeth qui vient de me le faire dire dans l'instant…»
«À Versailles, ce 21 novembre 1781.
»J'ai reçu ce matin ta lettre du 13, je l'attendois avec une impatience que je ne puis t'exprimer. J'ai presque pleuré en la lisant. Que ta sensibilité à la nouvelle que je t'ai apprise est touchante! Que Bombon ne peut-il déjà jouir du bonheur d'avoir un père tel que toi! Que tu es aimable! Oui, tu peux t'en fier à toute ma vérité, ton fils se porte à merveille, ainsi que moi. À chaque instant je jouis davantage du bonheur d'être ta femme. Ta lettre m'a causé tant de plaisir que je l'ai fait lire tout de suite à M. de Soucy, à madame de Brassens, qui étoient chez moi; je l'ai envoyée à Madame Élisabeth, qui l'a trouvée (comme tu le verras dans son petit billet) charmante. Tu étois bien digne que le ciel fît en ta faveur presque un miracle en te conservant ton fils. Je prie Dieu de tout mon cœur qu'il mette le comble à ses bontés en donnant à cet enfant toutes les vertus et surtout un cœur semblable au tien… J'ai été à confesse cette après-dînée, et ferai demain mes dévotions; ce sera de tout cœur que je rendrai des actions de grâces à Dieu de tous les biens qu'il m'a faits…
»On m'avoit promis la relation de la prise d'York; mais comme elle n'arrive pas, je te dirai que MM. de Grasse et de Rochambeau, avant de l'assiéger, ont dissipé la flotte qui devoit défendre le port, et ont fait couler à fond un vaisseau de guerre; que M. de Rochambeau a attaqué York par terre et M. de Grasse par mer, et que Cornwallis, qui étoit à York, s'est rendu prisonnier avec six mille Anglois. Ce qu'il y a de bien extraordinaire, c'est qu'on dit qu'ils avoient encore des vivres pour trois semaines. Ils se sont rendus le 18 d'octobre. M. de Lauzun est parti le 24, et il est arrivé, comme tu sais, avant-hier; c'est assurément bien aller. MM. de la Fayette, de Noailles, des Deux-Ponts, viennent passer l'hiver ici, et retourneront là-bas le printemps prochain… Madame Élisabeth m'envoie à l'instant le journal des opérations du corps françois; il te coûtera un peu cher de port, mais comme personne n'a encore ces détails que la famille royale, cela t'intéressera…»
Voici le petit billet de Madame Élisabeth dont il est question dans cette lettre:
«Versailles, le 8 janvier 1778. »Monsieur mon frère et oncle, le désir sincère que j'ai de maintenir la véritable harmonie, la concordance et l'unité de système qui doit toujours en imposer à nos ennemis, m'engage à exposer à Votre Majesté ma façon de penser sur la situation présente des affaires. L'Angleterre, notre ennemie commune et invétérée, est engagée depuis trois ans dans une guerre avec ses colonies d'Amérique; nous sommes convenus de concert de ne pas nous en mêler, et regardant toujours les deux partis sous le nom d'Anglois, nous avons rendu le commerce de nos États libre à celle qui y trouvoit le mieux son compte. De cette manière, l'Amérique s'est pourvue d'armes et de munitions, dont elle manquoit. Je ne parle pas des secours d'argent et autres que nous leur avons donnés, le tout étant passé sur le compte du commerce. L'Angleterre a pris de l'humeur de ces secours, et ne nous a pas laissé ignorer qu'elle s'en vengeroit tôt ou tard; elle a même déjà saisi indûment plusieurs de nos bâtiments de commerce dont nous sollicitons en vain la restitution. Nous n'avons pas perdu de temps de notre côté: nous avons fortifié nos colonies les plus exposées et mis sur un pied respectable nos marines, ce qui a contribué à augmenter la mauvaise humeur de l'Angleterre. C'étoit là où en étoient les affaires au mois de novembre dernier. La destruction de l'armée de Burgoyne et l'état très-resserré où est celle de Howe ont changé totalement leur face. L'Amérique est triomphante et l'Angleterre abattue, mais pourtant avec une grande force en marine qui est encore entière et avec l'espérance de s'allier utilement avec leurs colonies, l'impossibilité étant démontrée de les subjuguer par la force. Tous les partis en conviennent. Lord North lui-même a promis en plein parlement un plan de pacification pour la première session, et ils y travaillent fortement de tous côtés. Ainsi il nous est égal que ce ministère-ci soit en place ou un autre. Par des moyens différents ils s'unissent à s'allier avec l'Amérique, et n'oublient pas nos mauvais offices. Ils tomberont avec autant de force sur nous que si la guerre civile n'avoit pas existé. Cela posé, et les griefs que nous avons contre l'Angleterre étant notoires, après avoir pris l'avis de mon conseil, et notamment du marquis d'Ossun, j'ai pensé qu'il étoit juste et nécessaire, ayant avisé aux propositions que font les insurgents, de commencer à traiter avec eux pour empêcher leur réunion à la métropole. J'expose ma façon de penser à Votre Majesté. J'ai ordonné qu'on lui communiquât un mémoire où les raisons sont plus détaillées. Je désire bien vivement qu'elles ayent son approbation, connoissant le poids de son expérience et de sa droiture.
»Votre Majesté ne doute pas de la vive et sincère amitié avec laquelle je suis, Monsieur mon frère et oncle, etc.
»Louis.»
[Закрыть]
«Monsieur mon frère et neveu, Votre Majesté a la complaisance de me confier, par sa lettre du 10 de ce mois, les motifs qui l'ont engagé à ordonner que son ambassadeur à Londres fît au plus tôt une déclaration solennelle sur le traité conclu avec les députés des colonies. Je suis bien sensible à cette nouvelle marque d'amitié dont Votre Majesté m'honore; s'agissant d'une déclaration prise non-seulement par Votre Majesté comme convenable à la dignité de sa couronne après un mûr examen, mais aussi exécutée vraisemblablement avant la réception de sa lettre, je crois devoir m'abstenir sans fixer une opinion. Je ne doute nullement que la prévoyance de Votre Majesté n'ait pris toutes les mesures nécessaires dans des circonstances si critiques, d'autant plus que la moindre omission pourroit produire les conséquences les plus funestes. Les instructions données au chevalier d'Escarano étoient absolument nécessaires, elles m'ont paru très-sages. Je remercie donc bien sincèrement Votre Majesté de cette attention, et surtout pour la pleine liberté d'agir dans laquelle elle me laisse, et que je ne suis pas à même d'accepter, vu la situation où je me trouve. Au reste, je prendrai toujours le plus vif intérêt à la gloire et à la prospérité de Votre Majesté, et serai toujours le plus empressé à lui témoigner la parfaite et sincère amitié avec laquelle je suis, etc.
»Au Pardo, ce 22 mars 1778.»