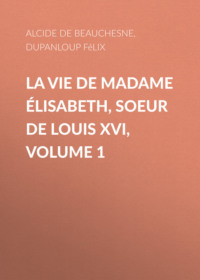Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Vie de Madame Élisabeth, soeur de Louis XVI, Volume 1», sayfa 14
»Madame de Lamballe étoit dans son grand deuil de veuve, et ne paroissoit point à la cour dans le temps de la mort de la Reine; ces circonstances n'étoient pas le moment de supplier le Roi de vouloir bien porter remède à ce qui s'étoit passé lors de la mort de Madame la Dauphine.»
Les papiers joints à ces très-humbles représentations ne furent pas remis au Roi. Le testament de Madame Sophie venait, par sa touchante simplicité, de rendre inutile toute réclamation de ce genre. La princesse demandait «que son corps ne fût point ouvert après sa mort; qu'il fût gardé pendant vingt-quatre heures par les filles de la Charité et par des prêtres, et qu'ensuite il fût porté à Saint-Denis sans aucunes pompes ni cérémonies quelconques, pour y être réuni à ceux de ses père et mère, comme une marque de son respectueux attachement à leurs personnes105.»
Pendant la journée du 3, le corps de Madame Sophie, à visage découvert, fut exposé dans son appartement; dans la matinée du 4, des messes furent dites auprès de sa bière, et dans la soirée du même jour, cette bière fut portée à Saint-Denis sans aucun appareil. Mais nous tenions à constater que, même dans ces tristes circonstances, l'inexorable étiquette avait encore essayé de faire prévaloir ses prétentions. L'idée que l'on se fait du caractère de Madame Élisabeth dispose à croire qu'elle ne comprenait guère ces petites questions de prérogatives élevées en présence d'un cercueil.
Du reste, la mort de cette fille de France, qui fuyait les pompes du monde, trouva dans plus d'une église les solennités du deuil et de la prière: le 6 mars, madame de Narbonne, abbesse de l'abbaye royale de Vernon, fit célébrer pour le repos de son âme un service solennel. Les mêmes honneurs lui étaient simultanément rendus le 12 et à l'abbaye royale de Fontevrault, qui ne pouvait oublier que l'enfance de Madame Sophie s'était écoulée dans sa maison, et à l'abbaye royale de Royal-Lieu, dont l'abbesse (madame de Soulange) avait été une des quatre religieuses chargées de l'éducation de Mesdames à Fontevrault. Un service solennel était célébré à la même intention, le 13 mars, dans l'abbaye royale d'Origny-Sainte-Benoîte, et, le 20 du même mois, dans l'église des Capucins de Meudon, qui y avaient convié les officiers des châteaux de Bellevue et de Meudon.
Le grand-duc Paul Petrowitsch, duc de Holstein-Gottorp, et la grande-duchesse Marie Fedorowna de Wittemberg, son épouse, héritiers présomptifs du trône de Russie, arrivèrent à Paris le 18 mai 1782, entre sept et huit heures du soir, voyageant incognito sous le nom de comte et comtesse du Nord. Ils descendirent à l'hôtel de l'ambassade de Russie, rue de Gramont, au coin du boulevard. Le lendemain, dimanche de la Pentecôte, ils se rendirent à Versailles, non pour offrir, comme il était d'usage, leurs félicitations au Roi et à la Reine, mais pour assister à la procession des chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. Leurs Altesses Impériales étant incognito, furent, sans cérémonie aucune, placées dans la chapelle. Le 20, ils furent présentés à Leurs Majestés et à la famille royale. L'appartement du prince de Condé avait été préparé pour les recevoir. Le comte du Nord alla immédiatement rendre visite au Roi, accompagné des officiers chargés de la conduite des princes étrangers et ambassadeurs; tandis qu'une chaise à porteurs de la Reine, entourée de la livrée de Sa Majesté, allait prendre madame la comtesse du Nord pour la conduire chez la Reine, où elle entra accompagnée de madame de Vergennes, femme du ministre des affaires étrangères. Le comte et la comtesse du Nord virent ensuite toute la famille royale, et dînèrent avec elle dans la pièce qui précédait la chambre de la Reine, et où Leurs Majestés avaient coutume de manger le dimanche. À six heures, ils retournèrent chez la Reine pour entendre le concert: toute la cour était dans le salon de la Paix; l'orchestre était placé sur des gradins élevés dans la galerie; toutes les personnes de la cour qui n'avaient point reçu d'invitation personnelle de la Reine s'assirent sur des pliants qui leur étaient réservés. Le concert dura trois heures; la galerie fut illuminée comme elle l'était d'ordinaire les jours de grand appartement; c'est-à-dire, des girandoles étincelaient sur toutes les consoles, et une rangée de lustres au plafond. Dès que le concert fut fini, le théâtre dressé pour les musiciens fut enlevé; le comte et la comtesse du Nord traversèrent la galerie pour retourner chez eux, au milieu des applaudissements d'une assemblée aussi brillante que nombreuse.
Le vendredi, 24 mai, mesdames les bouquetières du pont Neuf, fidèles à l'usage immémorial où elles sont de fêter et complimenter les princes et princesses, même les têtes couronnées, allèrent en corps présenter au comte et à la comtesse du Nord d'élégants bouquets avec une corbeille de fleurs artistement arrangée. Ces dames se retirèrent de leur présence également heureuses des remercîments et compliments qui satisfaisaient leur amour-propre, et des effets d'une générosité qui comblait leurs souhaits.
Le même jour, les princes moscovites allèrent visiter les nouvelles prisons civiles établies à l'ancien hôtel de la Force, rue des Ballets. Cette maison, terminée depuis peu, et déjà presque remplie, comprenait huit cours et six départements; le premier destiné au logement des employés, le second aux prisonniers pour mois de nourrice, le troisième aux autres débiteurs civils de toute espèce, le quatrième aux prisonniers de police; le cinquième réunissait toutes les femmes détenues, et le sixième servait de dépôt aux mendiants. Le comte et la comtesse du Nord remarquèrent particulièrement les deux chapelles placées dans cette prison, et disposées de manière que chaque espèce de prisonniers pouvait assister régulièrement aux offices, sans qu'ils pussent se voir ni avoir entre eux la moindre communication. Les nobles visiteurs laissèrent dans cet établissement un nouveau témoignage de leur bienfaisance; ils remirent de larges aumônes aux mendiants, et on a prétendu qu'en sortant ils firent délivrer dix mille francs aux prisonniers détenus pour dettes106.
Le lendemain (samedi 25 mai), les illustres voyageurs visitèrent l'église de Notre-Dame. Le chanoine qui leur en fit les honneurs les conduisit ensuite à l'Hôtel-Dieu, dont ils parcoururent les différentes salles, même celle des agonisants. Comme le chanoine et les sœurs elles-mêmes de l'hospice s'extasiaient sur le courage dont Leurs Altesses faisaient preuve, en restant si longtemps au milieu des malades et des moribonds: «Faits pour commander un jour aux hommes, dirent les héritiers du trône de Russie, nous ne saurions trop nous approcher de l'humanité, ni examiner de trop près les maux qui l'affligent, afin de trouver les moyens de les soulager promptement107.»
Le 6 juin, la Reine donna au comte et à la comtesse du Nord la comédie à Trianon. Le spectacle se composait du nouvel opéra de Zémire et Azor, dont Grétry avait fait la musique, et du ballet de la Jeune Françoise, dessiné par Gardel aîné, maître des ballets de la Reine. Madame la baronne d'Oberkirch, qui y assistait, nous donne de cette fête quelques détails qui ne sont point étrangers à notre sujet108: «La cour, dit-elle, était radieuse. Madame la comtesse du Nord avait sur la tête un petit oiseau de pierreries qu'on ne pouvait pas regarder tant il était brillant. Il se balançait par un ressort, en battant des ailes, au-dessus d'une rose, au moindre de ses mouvements. La Reine le trouva si joli qu'elle en voulut un pareil.
»Il y eut ensuite un souper de trois tables, à cent couverts par table. J'eus l'honneur d'être placée près de Madame Élisabeth, et de regarder bien à mon aise cette sainte princesse. Elle était dans tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté, et refusait tous les partis pour rester dans sa famille. – Je ne puis épouser que le fils d'un roi, disait-elle, et le fils d'un roi doit régner sur les États de son père. Je ne serais plus Française; je ne veux pas cesser de l'être. Mieux vaut rester ici, au pied du trône de mon frère, que de monter sur un autre.»
LIVRE TROISIÈME
1783 – 1786
Désastres en Italie, à Rome, à Messine. – La marquise de Spadara. – Madame de Causans. – Madame de Raigecourt. – Baptême du duc d'Angoulême et du duc de Berry. – Inoculation du Dauphin, des ducs d'Angoulême et de Berry. – Mort de la reine de Sardaigne. – La cour se rend à Fontainebleau. – Filet d'or envoyé par Monsieur à Sainte-Assise. – Madame de Raigecourt. – Le chirurgien Loustonneau. – Lettre de Madame Élisabeth. – Mort du duc d'Orléans; caractère de ce prince; sa bienfaisance; madame de Montesson ne drape pas. – Maladie de madame de Causans. – Huit lettres de Madame Élisabeth. – Le paysan Pêcher. – Lettre de Madame Élisabeth. – Mariage de mademoiselle Necker avec le baron de Staël-Holstein. – Présentation de madame de Staël. – Cinq lettres de Madame Élisabeth à Marie de Causans. – Arbres et légumes menacés par les insectes. – Voyage du Roi à Cherbourg; heureux effet de ce voyage. – Esprit de dénigrement et de défiance. – Ouverture du tombeau du comte de Vermandois. – Couches de la Reine; naissance de Madame Sophie. – Madame Élisabeth à Saint-Cyr; anniversaire séculaire de la fondation de cette maison. – Vie tranquille de Montreuil. – Discours de l'évêque d'Alais à Madame Élisabeth. – L'abbé Binos lui dédie son Voyage au mont Liban et en Palestine. – Mot de Madame Élisabeth
Pendant les premiers mois de l'année 1783, de terribles fléaux désolèrent l'Italie. Une pluie torrentielle, telle que de mémoire d'homme on n'en avait vu à Rome, inonda cette ville; le Tibre, sorti de son lit, causa d'affreux ravages. Un tremblement de terre engloutit une partie de Messine. Parmi tant de tristes détails qu'apportaient les récits des désastres de cette ville, on lisait à Montreuil, dans le petit cercle de Madame Élisabeth, la nouvelle de la mort de la marquise de Spadara, fille de M. de Pierrefeu, gentilhomme de Provence.
Au moment du tremblement de terre, madame de Spadara s'était évanouie. Son mari l'avait prise dans ses bras, et était parvenu à l'emporter jusqu'au port. Tandis qu'il dispose tout pour s'embarquer, sa femme, revenue à elle-même, s'aperçoit que son fils n'est point près d'elle; elle s'échappe, elle vole vers sa maison qui est en flammes, mais encore debout; elle y entre résolument: à peine a-t-elle atteint le haut de l'escalier que les marches s'écroulent derrière elle; elle arrive au berceau, s'empare de l'enfant, fuit de chambre en chambre, poursuivie par des éboulements successifs, se montre à un balcon et s'y attache comme à son seul asile; elle implore des secours en montrant son fils; mais quel secours attendre! la terreur publique paralyse tout sentiment de pitié: la mort est présente pour tous, et chacun ne cherche qu'à la fuir. Le feu s'empare de ce qui reste de la maison, et bientôt la pauvre victime de l'amour maternel, tenant dans ses bras l'objet de sa tendresse, tombe écrasée au milieu des débris et des flammes.
«Quel triste événement! dit Madame Élisabeth en s'essuyant les yeux; mais cette pauvre mère a eu du moins la consolation de mourir avec son fils. Songez quelle existence empoisonnée eût été la sienne, si elle eût survécu à son enfant sans avoir tout tenté pour le sauver!» Puis après un moment de silence, elle ajouta: «Cette malheureuse Sicile a, comme son tyran de Syracuse, un glaive de feu toujours suspendu sur sa tête. Elle vit en permanence au milieu des menaces et des périls. Sans doute les nouvelles d'aujourd'hui sont affreuses, et pourtant elles ne sont pas comparables aux désastres qui ont affligé la Sicile il y aura bientôt un siècle109.»
L'émotion que causait cet événement avait distrait Madame Élisabeth de la pensée pénible qui l'occupait depuis quelque temps. Son amie, mademoiselle de Causans, étant chanoinesse de Metz, devait sous peu de jours partir pour cette ville. Les règles de son ordre l'obligeaient à passer huit mois de l'année à son chapitre. Comment se faire à l'idée d'une si longue séparation! La princesse ne pouvait s'y résigner, et elle travailla en silence à empêcher le départ de son amie. Celle-ci reçut un jour une lettre portant sur l'enveloppe ces mots: À mademoiselle de Causans, dame de Madame Élisabeth. Cette lettre est de la princesse elle-même, qui, dans les termes les plus affectueux, lui témoigne la joie de la garder, et la prie de venir dès le lendemain recevoir l'explication de cette énigme. Le lendemain, madame de Causans se présente avec sa fille chez Madame Élisabeth; celle-ci vole à leur rencontre et se jette au cou de son amie: «Je suis touchée comme je dois l'être, dit madame de Causans, de la bienveillance de Madame et des témoignages d'affection qu'elle daigne donner à ma fille; je regrette de me trouver dans la nécessité de les refuser; mais une maxime établie depuis longtemps dans ma famille dit qu'aucune de nos filles ne peut accepter une position à la cour avant d'être mariée.»
Madame Élisabeth ne pouvait combattre chez une mère comme madame de Causans ce qu'elle respectait le plus au monde, la sévérité des principes s'appuyant sur les droits sacrés de l'autorité maternelle. «Votre façon de penser, lui dit-elle, ne peut être contraire à mon bonheur, puisqu'elle a pour but celui de votre fille: eh bien, je la marierai, et nous ne serons pas désunies.»
En effet, plusieurs partis ne tardèrent pas à se présenter. M. de Raigecourt fut agréé par mesdames de Causans.
Madame Élisabeth chercha plusieurs jours dans sa tête et dans son cœur le moyen d'assurer le bien-être du futur ménage. Enfin elle croit l'avoir trouvé. Il dépend du Roi. S'adressera-t-elle à lui pour l'obtenir? C'est la route la plus courte et peut-être la plus facile. Eh bien, non! il lui semble de bon goût de mettre la Reine dans sa confidence; sa délicatesse se réjouit de la rendre complice du bien qu'elle veut faire, et peut-être aussi espère-t-elle l'intéresser davantage à un bonheur qui sera en partie son œuvre. Un matin donc, elle entre chez Marie-Antoinette, et lui dit: «J'ai à vous demander une faveur, mais une faveur qui n'admet pas la possibilité d'un refus. – Elle est donc accordée d'avance? lui dit la Reine. – Non; mais promettez-moi qu'elle le sera. – Je n'en ferai vraiment rien…»
Après une lutte de plaisanteries, on en vient au sérieux, et Madame Élisabeth expose le plan qu'elle a conçu: «Causans va se marier; je veux lui donner cinquante mille écus pour sa dot. Le Roi me donne annuellement trente mille francs d'étrennes; obtenez de lui qu'il me les avance pour cinq ans.»
La Reine se fit avec plaisir l'interprète d'une cause dont le succès était certain, et le Roi saisit avec empressement l'occasion de donner à sa sœur une nouvelle preuve d'affection. Le contrat de mariage du marquis de Raigecourt et de mademoiselle de Causans fut signé par le Roi, la Reine et la famille royale le 27 juin 1784. La joie que ressentait Madame Élisabeth, quand elle eut la certitude de conserver son amie, fut aussi durable que vive. Le jour de l'an arriva sans lui apporter de cadeaux, et quatre autres fois il revint distribuant dans le château de Versailles ses largesses à tout le monde, et n'ayant rien à offrir à Madame Élisabeth. À ce sujet, elle disait avec un enjouement exempt de tout regret: «Moi, je n'ai pas encore d'étrennes, mais j'ai ma Raigecourt.»
C'est surtout dans les lettres de Madame Élisabeth qu'on rencontre ces doux épanchements d'une âme qui se livre tout entière à ses amies. Ainsi elle écrivait le 3 septembre 1784 à madame de Causans pour lui raconter la prise d'habit de madame de Brébeuf, et on retrouve dans sa lettre la vive impression que lui laissaient toujours les événements de ce genre. «Le moment que j'aime le mieux, dit-elle, c'est celui où l'on donne le baiser de paix. Il me fait toujours un effet que je ne puis rendre.» Puis ce sont des paroles où éclatent l'estime profonde qu'elle avait pour le caractère et l'esprit de madame de Causans, le prix qu'elle attachait à l'affection de cette vertueuse femme, et le vif intérêt qu'elle prenait à sa famille.
Si Madame Élisabeth aimait ainsi ses amies, elle obtenait d'elles le plus tendre retour, comme on peut le voir dans les lettres suivantes, écrites par madame de Bombelles à son mari:
«À Paris, ce 1er septembre 1784.
»J'ai été hier à Trianon, où est Madame Élisabeth, qui m'avoit fait chercher en chaise pour monter à cheval avec elle; j'ai vu la Reine, qui m'a traitée avec toutes sortes de bontés; après la course de cheval, Madame Élisabeth est revenue dîner avec la Reine, et la comtesse Diane m'a emmenée à Montreuil, où elle m'a donné à dîner. Elle m'a parlé de toi avec le plus grand intérêt…
»Sais-tu qu'il y a un cône de Cherbourg renversé par un coup de vent? C'est cent mille écus jetés dans l'eau. M. de Castries est parti tout de suite, et je crois que cet incident ralentira un peu l'enthousiasme que causait la création de ce port…»
«À Versailles, ce 17 septembre 1784.
»Je suis si souffrante depuis trois jours que je n'ai pas eu le courage de t'écrire. Imagine-toi que Madame Élisabeth, mercredi dernier, galopant à la chasse, est tombée de cheval; son corps a roulé sous les pieds du cheval de M. de Menou, et j'ai vu le moment où cette bête, en faisant le moindre mouvement, lui fracassoit la tête ou quelque membre. Heureusement j'en ai été quitte pour la peur, et elle ne s'est pas fait le moindre mal; tu penses bien que j'ai eu subitement sauté à bas de mon cheval et volé à son secours. Lorsqu'elle a vu ma pâleur et mon effroi, elle m'a embrassée en m'assurant qu'elle n'éprouvoit pas la plus petite douleur; nous l'avons remise sur son cheval, j'ai remonté le mien, et nous avons couru le reste de la chasse comme si de rien n'étoit. L'effort que j'ai fait pour surmonter mon tremblement, pour renfoncer mes larmes, m'a tellement bouleversée que depuis ce moment-là j'ai souffert des entrailles, de l'estomac, de la tête, tout ce qu'il est possible de souffrir. Cette petite maladie s'est terminée ce matin par une attaque de nerfs très-forte, après laquelle j'ai été à la chasse, et il ne me reste ce soir qu'une si grande lassitude, qu'après t'avoir écrit, je me coucherai. J'ai cependant cru ne pouvoir me dispenser, malgré toutes mes douleurs, d'aller avant-hier à Trianon, et j'ai d'autant mieux fait que j'y ai été traitée à merveille par le Roi, par la Reine, et conséquemment par le reste des personnes qui y étoient; j'y ai perdu mon argent, selon ma louable coutume. J'y étois très-bien mise, et je me serois consolée des frais de ma parure s'ils avoient pu exciter ton admiration; car, étant uniquement occupée du désir que tu m'aimes bien, je voudrois ne perdre aucune occasion d'augmenter, ne fût-ce que d'une ligne, ton intérêt pour moi. J'y ai vu M. d'Adhémar, qui m'a beaucoup parlé de toi et de tout le plaisir qu'il avoit eu à te recevoir à Londres…»
Je citerai encore quelques lettres de madame de Bombelles à son mari; on y trouve un écho fidèle de tout ce qui intéressait la cour, et surtout un témoignage irrécusable du discernement avec lequel Madame Élisabeth choisissait ses amies.
«À Versailles, ce 21 septembre 1784.
»J'ai encore été à Trianon samedi dernier. Si je ne connoissois ton goût pour les agréments que tu pourrois procurer en un certain genre, je te dirois que le Roi a joué au loto à côté de moi, et m'a traitée avec la plus grande distinction; mais craignant de t'affliger, je ne me suis pas conduite de manière à alimenter son sentiment, de sorte qu'il y a toute apparence qu'un aussi beau début n'aura pas de suites: c'est vraiment dommage; mais tu ne le veux pas, il faut bien obéir. L'opéra de Dardanus, qu'on y a joué, est superbe, et j'espère que nous chanterons ensemble tout l'opéra; cela ne sera pas sans nous quereller, mais malgré cela tu t'amuseras…»
À Versailles, ce 30 septembre 1784.
«Pour te donner de la bonne humeur, je te dirai que, dimanche dernier, la Reine est venue à moi, m'a dit qu'elle étoit charmée que nos affaires avançassent, et qu'elle désireroit bien qu'elles fussent déjà terminées, et que je devois savoir qu'elle y prenoit le plus grand intérêt. J'ai répondu à cela qu'elle m'avoit donné trop de preuves de bonté pour que je pusse en douter, et que ce seroit à elle seule à qui je devrois le bonheur de ma vie…
»La duchesse de Polignac a été bien malade d'une fièvre dyssentérique; elle va mieux aujourd'hui. On a fait le conte dans le monde que c'étoit la diminution de sa faveur qui l'avoit mise dans cet état-là…»
«À Saint-Cloud, ce 8 octobre 1784.
»La duchesse de Polignac se porte très-bien; sa faveur, Dieu merci, est plus brillante que jamais. Le Roi y a soupé deux fois depuis huit jours; le baron de Breteuil s'est trouvé aux deux soupers, et il l'y a traité avec toutes sortes de bontés: cela n'empêche pas qu'il n'ait bien des ennemis…»
«À Versailles, ce 16 octobre 1784.
»La Reine ou du moins le Roi vient d'acheter Saint-Cloud; la Reine en est dans la plus grande joie. C'est le baron de Breteuil qui a négocié le marché, et il paroît qu'on lui en sait grand gré, excepté M. de Calonne, qui sera obligé de donner six millions, et à qui cela ne fait pas le moindre plaisir; aisément cela se conçoit. Les enfants iront y passer l'été; cela m'arrange fort, parce que nos visites au Mail nous rapprocheront fort de maman lorsqu'elle y sera. On dit depuis hier que nous n'aurons pas la guerre avec l'Empereur pour les Hollandois, qu'eux-mêmes ne la feront pas; il s'étoit d'abord établi qu'elle étoit indispensable, mais tout est changé, et j'en suis charmée, car j'aime la paix et la tranquillité…
»À propos, Madame Élisabeth m'a dit qu'elle ne pouvoit pas spécifier le nombre de chaque chose qu'elle te prioit de lui apporter. Elle désire simplement qu'il ne soit pas considérable, et te prie de ménager ses finances. Elle veut de plus que je te dise bien des choses de sa part; juge si tu es heureux!..»
«À Versailles, ce 4 novembre 1784.
»Le baron de Breteuil a écrit, au nom du Roi, une lettre à tous les évêques, par laquelle il leur enjoint, de la part de Sa Majesté, de rester dans leur diocèse, et de n'en pas sortir sans une permission particulière. Tu n'imagines pas à quel point un ordre aussi sage fait crier à Paris; il n'y a sorte de mauvaises plaisanteries qu'on ne fasse sur la manière dont la lettre est écrite; on prétend que c'est un abus d'autorité; enfin que sais-je, on jette la pierre au baron, et on dit qu'il n'a eu d'autres motifs que celui de faire parler de lui… Tu sais sûrement que les Hollandois vont avoir la guerre avec l'Empereur, que nous serons neutres; cependant on va envoyer chaque ministre à son poste: M. de Maulevrier va partir, et j'imagine que M. de Vérac partira aussi…»
Le dimanche 28 août 1785, Madame Élisabeth assista au baptême du duc d'Angoulême, âgé de dix ans, et du duc de Berry, qui en avait sept et demi110. «Le Roi (dit une note manuscrite où se reflète l'étiquette de l'époque) a entendu vespres et le salut dans sa tribune, et a rejoint la Reine, après le salut, dans le salon d'Hercule, où les princes et princesses se sont rendus pour se mettre à la suite de Leurs Majestés. Aucun prince n'avoit le cordon bleu sur l'habit, hors M. de Penthièvre, qui avoit cru qu'on devoit l'avoir. La parure étoit simple.
»Le Roi et la Reine sont descendus à l'autel sans s'arrêter à leur prie-Dieu. Le Roi et la Reine ont été parrain et marraine de M. le duc d'Angoulême, et Monsieur et Madame, au nom du roi d'Espagne et de la reine de Sardaigne, de M. le duc de Berry. Ces petits princes étoient en blanc, dans l'ancien habillement françois. La plume a été présentée par un aumônier à M. le duc d'Angoulême, à M. le duc de Berry et aux princes et princesses; M. l'évêque de Senlis ne l'a présentée qu'à Leurs Majestés et au rang d'Enfants de France. Tous les princes et princesses ont signé les actes de baptême; ils avoient été invités à la cérémonie par le maître des cérémonies (le grand maître ne faisant pas encore de fonctions à cause de sa jeunesse), de la part du Roi. Les Cent-Suisses étoient en habit de cérémonie. Les princes ont reconduit le Roi à son appartement, et sans doute les princesses ont reconduit la Reine dans le sien. Les princes n'ont été, ni avant ni après la cérémonie, chez M. le comte et madame la comtesse d'Artois, ni chez les enfants baptisés.»
Le 29, la Reine se rend, avec l'aîné de ses fils, sa fille et Madame Élisabeth, au château de Saint-Cloud, où le Dauphin devait être inoculé le 1er du mois suivant.
Le 30, le Roi les y rejoint.
Le 31, la comtesse d'Artois se transporte aussi dans cette résidence avec ses deux fils, les ducs d'Angoulême et de Berry, qui doivent être inoculés dans la maison de M. Chalus, fermier général, située à Saint-Cloud.
Le 27 septembre, le comte de Scarnafis, ambassadeur de Sardaigne, se rendit en long manteau de deuil à l'audience particulière du Roi, pour lui remettre une lettre de notification de la mort de la reine de Sardaigne, décédée le 19 du mois, à sept heures du soir, au palais de Moncaglieri. Bien que Madame Élisabeth fût informée que depuis plusieurs mois la vie de cette princesse était en péril, elle n'en apprit pas la fin avec moins de peine, surtout en songeant au chagrin que sa chère Clotilde devait en ressentir. Toutefois elle éprouva une grande consolation en lisant dans les lettres et dans les gazettes de Piémont que les restes de la Reine, transportés au château royal de Turin et exposés dans une chapelle ardente, avaient été l'objet des larmes et des prières de tout un peuple, avant d'être enfouis dans les caveaux de Superga. Elle essayait d'en conclure que les nations n'avaient point perdu tout respect filial pour leurs chefs, et qu'un événement qui mettrait en péril la vie du Roi raviverait profondément la fibre patriotique de cette France, si émue naguère à la nouvelle de la ruine de quelques vaisseaux.
Le 10 octobre, la cour quitta Saint-Cloud pour aller habiter Fontainebleau. La Reine, voulant se rendre par eau dans cette résidence, s'embarqua à Paris, au pont Royal, dans un yacht extrêmement élégant, riche et commode, qui avait coûté soixante mille livres. Le matin du départ de Marie-Antoinette, le duc d'Orléans111 reçut à Sainte-Assise une caisse portant son adresse, mais dont l'origine restait inconnue. Excité par la curiosité, il fit ouvrir devant lui la caisse mystérieuse: elle contenait un filet tissu d'or et d'argent avec un talent merveilleux, qui avait, d'après les récits qu'on en fit alors, cent quatre-vingts aunes d'étendue. Outre ce filet, on trouva dans la caisse le madrigal suivant:
À vous, savante enchanteresse,
Ô Montesson, l'envoi s'adresse.
Docile à mon avis follet,
Avec confiance osez tendre
Sur-le-champ ce galant filet,
Et quelque Grâce va s'y prendre.
Ni le duc d'Orléans, ni madame de Montesson, ni personne de leur cour ne devina l'usage qu'il convenait de faire d'un tel cadeau. Le prince ordonna de replacer filet et vers dans la caisse, et de l'adresser de sa part à M. de Crosne, lieutenant de police, en le priant d'en chercher l'auteur et de la lui rendre. Or, pour l'intelligence de cette énigme, il suffisait, ce semble, de savoir que le duc d'Orléans et madame de Montesson, instruits de l'intention de la Reine de se rendre par eau à Fontainebleau, et par conséquent de passer sous les fenêtres de leur château, avaient fait tout au monde pour obtenir de Sa Majesté de s'y reposer; leurs efforts avaient été vains. Le comte de Provence, qui avait du goût pour les plaisanteries ingénieuses et galantes, comme on disait dans ce temps-là, avait inventé ce filet, dont le spectacle, selon lui, devait frapper la Reine: il y voyait un moyen adroit pour l'arrêter respectueusement et lui fournir un prétexte de descendre à terre; mais, comme on le voit, personne à Sainte-Assise ne comprit la pensée de Monsieur. Piqué de la mauvaise chance de son présent, il s'écria dans son premier mouvement de dépit: «Avec tout leur esprit, qu'ils sont bêtes à Sainte-Assise!»
Le 15 octobre, Mesdames Adélaïde et Victoire se rendirent à Fontainebleau, où la cour se trouvait depuis dix jours.
Le 1er novembre, jour de la Toussaint, Madame Élisabeth venait d'assister avec la Reine, dans la chapelle du château, à la grand'messe célébrée par l'évêque de Rodez et chantée par la musique du Roi, et rentrait à peine dans son appartement, lorsqu'elle apprit que madame de Raigecourt, fatiguée d'une grossesse pénible, était demeurée quelques minutes sans connaissance. Madame Élisabeth vole chez son amie. Celle-ci, qui était tout à fait remise et n'avait gardé nul souvenir de son évanouissement, s'étonne de voir la princesse à l'heure où a lieu le dîner de la Reine, et auquel, pendant leur éloignement de Versailles, elle prend toujours part les jours de fête. «Je t'ai crue souffrante, lui dit Élisabeth, et je me suis excusée. – Je ne souffre pas, lui dit son amie, et je ne me suis permis de dire à personne d'avertir Madame. – Si tu ne l'as pas fait, mon cœur, j'espère bien que tu auras toujours à ton service quelqu'un qui, sans tes ordres, saura que je t'aime assez pour être avertie quand tu souffres.»
Le 17 novembre, la cour retourna à Versailles, et Madame Élisabeth fut obligée de partir avec elle. Toutefois elle avait au préalable obtenu pour M. Loustonneau, chirurgien du Dauphin et des Enfants de France, d'un vrai mérite et d'un grand dévouement112, la permission de rester à Fontainebleau; puis elle avait prié une de ses dames de venir tenir compagnie à son amie et de l'entourer des soins les plus tendres. Malgré ces précautions, Madame Élisabeth n'avait pu s'éloigner d'elle sans un serrement de cœur.
Ses regrets s'accrurent encore en apprenant, à son arrivée à Versailles, que madame de Causans était dangereusement malade à Paris. Dans cette position, les angoisses de la princesse étaient vives, mais ses inquiétudes ne se traduisaient pour ses chères malades qu'en témoignages d'intérêt et d'affection. Elle fit organiser un service de courriers sur la route de Paris et sur celle de Fontainebleau. Elle envoya son médecin près de sa Raigecourt pour avoir des renseignements plus positifs sur l'état de sa santé. Madame de Raigecourt donna le jour à un garçon qui ne vécut que peu d'instants. Aussitôt que cette fâcheuse nouvelle arriva à Madame Élisabeth, elle écrivit à madame de Causans pour lui témoigner toute la part qu'elle prenait à cet événement. Dans cette lettre, on voit qu'elle cherche à rassurer son amie sur l'état de madame de Raigecourt: il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Quant à l'enfant, qui est mort après avoir reçu le baptême, Madame Élisabeth, avec sa foi profonde, ne peut le plaindre, c'est un ange de plus dans le ciel.
Les recherches que nous avons faites nous autorisent à croire que Madame Élisabeth faisait ici allusion au tremblement de terre arrivé en Sicile en 1693, et dont une médaille a consacré le souvenir. Cette médaille représente une femme levant les mains au ciel et tenant un enfant la tête en bas. – On aperçoit au second plan l'Etna fumant, la mer grossie par les cadavres humains et les décombres des maisons. L'exergue porte: SICILIA AFFLICTA. Autour se trouve cette légende: PUTATIS ILLOS SUP. QUOS CECID. TURR. IN SILOË PRÆTER OMN. HOM. PECCAVISSE. Luc. XIII. Le revers porte l'inscription suivante:
MEMOR, SICILIÆ, D. 9 ET 11 JANU. A. MDCXCIII, HORR. TERRÆ MOTU CONVULS. SYRAC. AUGUST. CATAN. MESSIN. XIV. URBIB. MAJ. CORRUENTIBUS XVI. MIN. PROSTRATIS IN OMNES, MAR. INFLUENT. RUPT. MONT. STRAGE 100,000 HOM
[Закрыть]