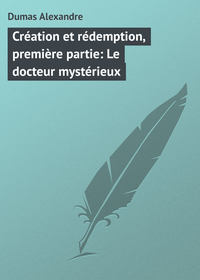Kitabı oku: «Création et rédemption, première partie: Le docteur mystérieux», sayfa 15
Jacques Mérey lui tendit la main. Il n'y avait point à se tromper à l'enthousiasme qui brillait dans ses yeux.
– Général, lui dit-il, disposez de moi comme garde, comme soldat, mais associez-moi d'une façon ou de l'autre à cette grande action qui va sauver la France. Soyons vainqueurs d'abord, et je me charge d'être le Grec de Marathon.
– Eh bien! fit Dumouriez, dites-nous vite ce que vous pensez des passages qui traversent la forêt d'Argonne? Il n'y a pas un instant à perdre, les fers de nos chevaux sont rouges.
Jacques Mérey se pencha sur la carte.
– Écoutez, Thévenot, dit Dumouriez, et ne perdez pas un mot de ce qu'il va dire.
– Soyez tranquille, général.
Il y avait quelque chose de solennel, presque de sacré, dans ces trois hommes qui, inclinés sur une carte, conspiraient l'honneur de la France et le salut de trente millions d'hommes!
– Il y a, dit Jacques Mérey au milieu du plus profond silence, cinq défilés dans la forêt d'Argonne. Suivez-les sous mon doigt. Le premier, à l'extrémité du côté de Semuy, appelé le Chêne Populeux; le second, à la hauteur de Sugny, appelé la Croix-au-Bois; le troisième, en face Brécy, appelé Grand-Pré; le quatrième, en face Vienne-la-ville, appelé la Chalade; le cinquième, enfin, qui n'est autre que la route de Clermont à Sainte-Menehould, appelé les Islettes. Les plus importants sont ceux de Grand-Pré et des Islettes.
– Malheureusement aussi les plus éloignés de nous; aussi à ceux-là je me porterai moi-même avec tout mon monde.
– Maintenant, dit Jacques Mérey, pour accomplir cette opération, vous avez deux routes: l'une qui passe derrière la forêt et qui dérobe votre marche à l'ennemi, l'autre qui passe devant et qui la lui révèle.
Dumouriez réfléchit un instant.
– Je passerai devant, dit-il; en nous voyant faire ce mouvement, je connais Clerfayt, c'est M. Fabius en personne; il croira qu'il m'est arrivé des renforts et que j'attaque séparément Autrichiens et Prussiens; il se retirera derrière Stenay, dans son camp fortifié de Brouenne. Mettez-vous là, Thévenot.
Thévenot s'assit, et, tout fiévreux de la même fièvre qui brûlait le général en lutte avec son génie, tira à lui plume et papier, et attendit.
– Écrivez, dit Dumouriez. Donnez ordre à Deubouquet de quitter le département du Nord et de venir occuper le Chêne Populeux; – à Dillon, de se mettre en marche entre la Meuse et l'Argonne. Je le suivrai avec le corps d'armée. Il marchera jusqu'aux Islettes, qu'il occupera, ainsi que la Chalade, forçant tout devant lui. Vous m'avez prié de vous employer, docteur; je ne sais pas refuser ces demandes-là aux bons patriotes. Je vous mets au poste du danger; vous serez son guide.
– Merci, dit Jacques, tendant la main à Dumouriez.
– Moi, continua Dumouriez, je me charge de la Croix-aux-Bois et de Grand-Pré. Y êtes-vous?
– Oui, dit Thévenot qui, sous la dictée du général, avait pris l'habitude d'écrire aussi vite que la parole.
– Maintenant, ordre à Beurnonville de quitter la frontière des Pays-Bas, où il n'a rien à faire, et d'être à Rethel le 13 avec dix mille hommes.
– Et maintenant, faites battre le départ et sonner le boute-selle.
Ce dernier ordre fut donné par Dumouriez aux deux frères ou aux deux sœurs Fernig, qui s'élancèrent au grand galop dans la ville.
Un quart d'heure après, l'ordre de Dumouriez était exécuté, et l'on entendait, dominant le brouhaha qu'il occasionnait, les fanfares éclatantes de la trompette et les sourds roulement du tambour.
XXV
La Croix-au-Bois
Deux heures après, toute l'armée était en marche et campait à quatre heures de Sedan.
Le lendemain, Dillon avait connaissance des avant-postes de Clerfayt, occupant les deux rives de la Meuse.
Une heure après, sous la conduite de Jacques Mérey, le général Miakinsky attaquait avec quinze cents hommes les vingt-quatre mille Autrichiens de Clerfayt, qui, ainsi que l'avait prévu Dumouriez, se retirait et se renfermait dans son camp de Brouenne. Dillon passa devant le Chêne Populaire qui, nous l'avons dit, devait être occupé et défendu par le général Dubouquet, et continua sa marche entre la Meuse et l'Argonne, suivi par Dumouriez et ses quinze mille hommes.
Le surlendemain, Dumouriez était à Baffu; là, il s'arrêtait pour occuper les défilés de la Croix-aux-Bois et de Grand-Pré.
Dillon continua audacieusement son chemin; il fit garder la Chalade, en passant, par deux mille hommes, et arriva aux Islettes, où il trouva Galbaud avec quatre mille hommes.
Le général était venu là de lui-même, et n'avait pas encore vu Fabre d'Églantine, qui courait après lui sur la route de Châlons.
C'est aux Islettes que Jacques Mérey fut d'une véritable utilité à Dillon; il connaissait le pays, ravins et collines. Il indiqua au général, sur le haut de la montagne qui domine les Islettes, un emplacement admirable pour établir une batterie qui rendait ce passage inabordable et dont, après soixante-seize ans, on voit encore l'emplacement aujourd'hui.
Outre cette batterie, Dillon éleva d'excellents retranchements, fit des abatis d'arbres qui formèrent sur la route autant de barricades, et se rendit complètement maître des deux routes qui conduisent à Sainte-Menehould et de Sainte-Menehould à Châlons. Les travaux de Dumouriez à Grand-Pré étaient non moins formidables: l'armée était rangée sur des hauteurs s'élevant en amphithéâtre; au pied de ces hauteurs étaient de vastes prairies que l'ennemi était forcé d'aborder à découvert.
Deux ponts étaient jetés sur l'Aire, deux avant-gardes défendaient ces deux ponts; en cas d'attaque, elles se retiraient en les brûlant; et, en supposant Dumouriez chassé de hauteur en hauteur, il descendait sur le versant opposé, trouvait l'Aisne qu'il mettait entre lui et les Prussiens en faisant sauter ces deux ponts.
Or, il était à peu près certain que l'ennemi échouerait dans ses attaques et que de ce poste élevé Dumouriez dominerait tranquillement la situation.
Le 8, on apprit que, la veille, Dubouquet, avec six mille hommes, avait occupé le passage du Chêne Populeux; le seul qui restât libre était donc celui de la Croix-aux-Bois, situé entre le Chêne Populeux et le Grand-Pré. Dumouriez y alla de sa personne, fit rompre la route, abattre les arbres et y mit pour le défendre un colonel avec deux escadrons et deux bataillons.
Dès lors sa promesse était remplie; l'Argonne, comme les Thermopyles, était gardée. Paris avait devant lui un retranchement que celui qui l'avait élevé regardait lui-même comme inexpugnable.
Le duc d'Orléans avait tenu parole. Jour par jour, Dumouriez avait été instruit des massacres des prisons; sous une apparente insouciance, ces hideux assassinats de Mme de Lamballe à l'Abbaye, des enfants à Bicêtre, des femmes à la Salpêtrière, lui soulevaient le cœur; il notait les assassins sur le calepin des représailles, et se promettait, tout en souriant à ces horribles nouvelles, une affreuse vengeance si jamais il arrivait au pouvoir.
Le duc d'Orléans lui-même n'était pas resté impassible aux massacres. On avait porté la tête de Mme de Lamballe sous ses fenêtres, sous prétexte qu'une amie de la reine devait être une ennemie du duc d'Orléans; mais on l'avait forcé de saluer cette tête, mais on avait forcé Mme de Buffon de la saluer. Elle s'était levée de table, et, pâle jusqu'à la lividité, à moitié morte, elle avait paru au balcon.
Le duc d'Orléans, qui payait un douaire à Mme de Lamballe, écrivait à Dumouriez:
Ma fortune, à cette mort, s'est augmentée de 300 000 francs de rente, mais ma tête ne tient qu'à un fil.
Je vous envoie mes deux fils aînés, sauvez-les.
Dès lors il n'y avait plus à balancer, il fallait les prendre. Le 10, le duc de Chartres arriva de la Flandre française avec son régiment, dans lequel son frère, le duc de Montpensier, servait comme lieutenant.
C'était à cette époque un beau et brave jeune homme de vingt ans à peine, ayant été élevé à la Jean-Jacques par Mme de Genlis, extrêmement instruit, quoique son instruction fût plus étendue que profonde. Dans les quelques combats où il s'était trouvé, il avait fait preuve d'un rare courage.
Son frère n'était encore qu'un enfant, mais un enfant charmant, comme celui que j'ai connu et qui portait le même nom que lui.
Dumouriez les reçut à merveille, et dès ce jour une idée pointa dans son esprit.
Louis XVI était devenu impossible; trop de fautes, et même de parjures, l'avaient rendu odieux à la nation. La République était imminente; mais serait-elle durable? Dumouriez ne le croyait pas. Le comte de Provence et le comte d'Artois, en s'exilant, avaient renoncé au trône de France. Il ne fallait que populariser, par deux ou trois victoires auxquelles il prendrait part, le nom du duc de Chartres, et, à un moment donné, le présenter à la France comme un moyen terme entre la république et la royauté.
Ce fut le rêve que fit et que caressa Dumouriez à partir de ce moment.
Avec le duc de Chartres et son frère, le corps que Dumouriez avait commandé dans les Flandres vint le rejoindre; il était composé d'hommes très braves, très aguerris, très dévoués. S'il restait quelque doute sur Dumouriez, ce que les nouveaux venus racontèrent de leur général l'effaça.
Puis Dumouriez, avec sa haute intelligence, comprenait que c'est surtout le moral du soldat qu'il faut soutenir. Il ordonna à la musique de jouer trois fois par jour. Il donna des bals sur l'herbe avec des illuminations sur les arbres, bals auxquels il attira toutes les jolies filles de Cernay, de Melzicourt, de Vienne-le-Château, de la Chalade, de Saint-Thomas, de Vienne-la-ville et des Islettes. Les deux princes commencèrent leur étude de la popularité en faisant danser des paysannes. Les deux jeunes hussards les aidaient de leur mieux. Deux ou trois fois Dumouriez invita les officiers prussiens et autrichiens de Stenay, de Dun-sur-Meuse, de Charny et de Verdun à y venir: s'ils fussent venus, il leur eût fait visiter ses retranchements. Ils ne vinrent pas et il ne put se donner le plaisir de cette gasconnade.
Les souffrances cependant étaient à peu près les mêmes pour nos soldats que pour l'ennemi: la pluie cinq jours sur six; on était obligé de sabler avec le gravier de la rivière l'endroit sur lequel on dansait; mauvais vin, mauvaise bière; mais il y avait dans l'air et dans la parole du chef la flamme du Midi; en voyant le général gai, le soldat chantait; en voyant le général manger son pain bis en riant, le soldat mangeait son pain noir en criant: «Vive la nation!»
Un jour, il se passa une chose grave, et qui montra d'outre en outre l'esprit de cette armée sur laquelle reposait le salut de la France.
Chaque jour, des détachements de volontaires arrivaient et étaient incorporés dans des régiments. Châlons, comme les autres villes, envoya son contingent; mais Châlons s'était, au profit de la Révolution, débarrassé de ce qu'il avait de pis: c'était une tourbe de drôles, parmi lesquels se trouvaient une cinquantaine d'hommes qui, sur la circulaire de Marat, avaient septembrisé de leur mieux. Ils aboyèrent en criant: «Vive Marat! la tête de Dumouriez! la tête de l'aristocrate! la tête du traître.» Ils croyaient rallier à eux les trois quarts de l'armée, ils se trouvèrent seuls. Puis, tandis qu'ils faisaient de leur mieux pour mettre la discorde parmi les patriotes, Dumouriez monta à cheval avec ses hussards. Les mutins virent d'un côté mettre quatre canons en batterie, de l'autre côté un escadron prêt à charger. Dumouriez ordonna à ses canonniers d'allumer les mèches, à ses hussards de tirer le sabre du fourreau; il en fit autant qu'eux, et, s'approchant d'eux à la distance d'une trentaine de pas:
– L'armée de Dumouriez, dit-il à haute voix, ne reçoit dans ses rangs que de bons patriotes et des gens honnêtes. Elle a en mépris les maratistes et en horreur les assassins. Il y a au milieu de vous des misérables qui vous poussent au crime. Chassez-les vous-mêmes de vos rangs ou j'ordonne à mes artilleurs de faire feu, et je sabre avec mes hussards ceux qui seront encore debout. Donc, vous entendez, pas de maratistes, pas d'assassins, pas de bourreaux dans nos rangs. Chassez-les. Devenez bons, braves et grands comme ceux parmi lesquels vous avez l'honneur d'être admis!
Cinquante ou soixante hommes furent chassés. Ils disparurent comme s'ils s'étaient abîmés sous terre. Le reste rentra dans les rangs et prit l'esprit de l'armée, complètement pur des excès de l'intérieur.
Jusqu'au 10 septembre, le roi de Prusse resta à Verdun, répétant à qui voulait l'entendre qu'il venait pour rendre au roi la royauté, les églises aux prêtres, les propriétés aux propriétaires.
Ces mots, nous l'avons déjà dit, avaient fait dresser l'oreille au paysan. S'il ne s'était agi que de rendre l'église aux prêtres, le sentiment de la France, qui est profondément religieux, leur en eût de lui-même rouvert les portes, mais en rendant les églises aux prêtres, on rendait les biens au clergé.
Or, on avait confisqué pour quatre milliards de biens aux couvents et aux ordres religieux, et par les ventes qui depuis janvier en avaient été la suite, ces propriétés avaient passé de la main morte à la vivante, des paresseux aux travailleurs, des abbés libertins, des chanoines ventrus, des évêques fastueux aux honnêtes laboureurs1 en huit mois, une France nouvelle s'était faite.
Le 10, cependant, les Prussiens se décidèrent à se mettre en mouvement; ils sondèrent tous nos avant-postes, escarmouchèrent sur le front de tous nos détachements.
Sur plusieurs points, nos soldats étaient si désireux d'en arriver à une action décisive, qu'ils escaladèrent leurs retranchements et chargèrent à la baïonnette.
Le soir même, il y eut rapport chez le général. Jacques Mérey, qui n'avait aucune fonction fixe, s'était chargé d'inspecter tous les postes. Il revint de son inspection en disant que le passage de la Croix-aux-Bois n'était pas suffisamment gardé.
Mais, sur ce point, il ne trouva malheureusement point d'accord avec le colonel qui y commandait. Le passage de la Croix-aux-Bois était le seul que les Prussiens n'eussent pas éprouvé. Le colonel prétendit qu'il leur était inconnu, et que non seulement il y avait assez d'hommes pour le garder, mais qu'il pouvait encore envoyer deux ou trois cents hommes au camp de Grand-Pré.
Jacques Mérey insista près de Dumouriez; mais le colonel, qui tenait à prouver qu'il avait raison, envoya à la Chalade un bataillon et un escadron.
La nuit suivante, tourmenté par ses pressentiments, Jacques Mérey monta à cheval et s'achemina vers le passage de la Croix-aux-Bois.
Mais peu à peu d'autres pensées que celles qui avaient déterminé son départ leur succédèrent dans son esprit, et il se mit à rêver comme il rêvait quand il était seul.
À Éva;
À sa vie si vide depuis qu'elle semblait et même qu'elle était si agitée.
Oui, certes, Jacques Mérey était un excellent patriote; oui, la France tenait dans son cœur la place qu'elle devait y tenir, mais elle n'y avait rien fait perdre à la toute-puissance du souvenir d'Éva.
Où était-elle? que devenait-elle? Ne lui avait-elle pas été arrachée avant que la création complète, non pas du corps, mais du cerveau fût accomplie?
Elle resterait belle, il y avait même à parier qu'elle embellirait encore; mais son esprit serait-il assez soutenu par l'éducation pour conserver un sens moral qui pousse toujours son libre arbitre au bien; sa mémoire serait-elle assez tenace pour continuer d'enfermer dans son cœur le souvenir de celui qui, après Dieu, l'avait faite ce qu'elle était?
– Oh! murmurait Jacques.
La clarté s'était faite dans son esprit, mais il y avait encore du trouble dans son âme…
Et il voyait peu à peu son image s'obscurcissant dans cette âme pour ainsi dire inachevée, jusqu'à ce qu'elle se confondit dans cette nuit du passé où flottent les rêves vains sortis par la porte d'ivoire.
Jacques Mérey avait jeté la bride sur le cou de son cheval. Il n'était plus sur la limite de la forêt d'Argonne, il ne suivait plus les rives de l'Aisne, il n'allait plus surveiller le passage menacé de la Croix-aux-Bois. Il était à Argenton, dans la maison mystérieuse, sous l'arbre de la science; il conduisait Éva dans la grotte où pour la première fois elle lui avait dit qu'elle l'aimait et où elle le lui redisait encore. Il revivait enfin sa vie heureuse, quand tout à coup il crut entendre le pétillement de la fusillade suivi du cri d'alarme!
D'un même mouvement, il se dressa sur ses étriers et son cheval hennit.
Toute la fantasmagorie du passé disparut alors comme dans une féerie. Pareil à un dormeur qu'un rêve avait transporté dans des jardins délicieux, sous un lumineux soleil, et qui se réveille la nuit dans un désert, au milieu des précipices, lui se réveilla dans un chemin boueux, dans une forêt sombre, trempé par une pluie fine et glacée, au milieu des éclairs de l'artillerie et de la fusillade qui illuminaient l'épaisseur du bois.
Jacques Mérey mit son cheval au galop, mais, en arrivant à la petite plaine de Longwée, il se trouva au milieu des fuyards.
Il devina tout, la Croix-aux-Bois avait été attaquée comme il l'avait prévu, la position était forcée par les Autrichiens et les émigrés commandés par le prince de Ligne.
Une espèce de bataillon carré s'était formé au commencement de la petite plaine. Jacques Mérey courut là où on résistait encore. Mais, comme il y arrivait, trois ou quatre cents cavaliers chargeaient le colonel français au milieu de ses quelques centaines d'hommes, avec lesquels il essayait de soutenir la retraite.
Jacques Mérey se jeta au milieu de la mêlée.
Le colonel luttait corps à corps avec deux des cavaliers, qui, par une charge de fond, avaient, au cri de «Vive le roi!» rompu le carré. De ses deux coups de pistolets, Jacques les jeta à bas de leurs chevaux, mais à l'instant même il se trouva entouré; il mit le sabre à la main; puis, au milieu des ténèbres, para et porta quelques coups. La nuit était complètement sombre, on ne voyait qu'à la lueur des coups de pistolet. Deux ou trois coups échangés firent une de ces clartés éphémères; mais à cette clarté Jacques crut reconnaître, sous l'uniforme gris et vert des émigrés, le seigneur de Chazelay. Il jeta un cri de rage, poussa son cheval sur lui; mais au même instant il sentit son cheval faiblir des quatre pieds: une balle qui lui était destinée l'avait atteint à la tête au moment où il le faisait cabrer pour franchir l'obstacle. Il s'abîma entre les pieds des chevaux, resta un instant immobile, s'abritant au cadavre de l'animal mort; puis, se relevant et se glissant par une éclaircie, il se trouva sous le dôme de la forêt, c'est-à-dire dans une profonde obscurité.
Il ne pouvait rien dans cette terrible échauffourée qui livrait un des passages à l'ennemi, mais il pouvait beaucoup s'il prévenait à temps Dumouriez de cette catastrophe. Il s'appuya au tronc d'un chêne, se tâta pour voir s'il n'avait rien de cassé; puis s'orientant, il se rappela qu'un petit sentier conduisait de Longwée à Grand-Pré, et que ce sentier côtoyait une des sources de l'Aisne; il écouta, entendit à quelques pas de lui le murmure d'un ruisseau, descendit une courte berge, trouva la source. Dès lors il était tranquille, comme il avait trouvé le ruisseau il trouva le sentier, éloigné seulement d'une lieue et demie de Grand-Pré. Il y fut en trois quarts d'heure.
Deux heures du matin sonnaient au moment où, trempé tout à la fois de pluie et de sueur, couvert de boue et de sang, il frappait à la porte du général.
XXVI
Le prince de Ligne
Jacques Mérey avait instinctivement trop l'intelligence des accidents de guerre pour communiquer la nouvelle à un autre qu'au général en chef.
C'est, en pareil cas, le sang-froid, la décision rapide et surtout le silence du général qui sauvent l'armée.
Il connaissait la chambre de Dumouriez et s'apprêtait à le faire réveiller par le planton qui veillait dans son antichambre, lorsqu'il vit que la lumière filtrait à travers les rainures de la porte.
Il frappa à cette porte. La voix ferme et nette du général lui répondit:
– Entrez.
Dumouriez n'était pas encore couché. Il travaillait à ses Mémoires, où il avait l'habitude de consigner jour par jour ce qui lui arrivait.
En retard de quelques jours, il se remettait au courant.
– Ah! ah! dit-il en voyant Mérey couvert de boue et de sang. Mauvaise nouvelle, je parie!
– Oui, général; le passage de la Croix-aux-Bois est forcé par les Autrichiens.
– J'en avais le pressentiment. Et le colonel?
– Tué.
– C'est ce qu'il avait de mieux à faire.
Dumouriez alla en toute hâte à un grand plan de la forêt d'Argonne pendu au mur.
– Ah! dit-il philosophiquement, il faut que chaque homme ait le défaut de ses qualités. Ardent à concevoir, je manque souvent de patience dans l'exécution. J'aurais dû étudier chaque passage de mes propres yeux; je ne l'ai pas fait, et, imbécile que je suis, j'ai écrit à l'Assemblée que l'Argonne était les Thermopyles de la France! Voilà mes Thermopyles forcés, et tu n'es pas mort, Léonidas?
– Heureusement, dit Jacques Mérey, après les Thermopyles, Salamines!
– Cela vous est bien aisé à dire, fit Dumouriez avec le plus grand calme. Et si Clerfayt ne perd pas son temps, selon son habitude, s'il tourne la position de Grand-Pré, si avec ses trente mille Autrichiens il occupe les passages de l'Aisne, tandis que les Prussiens m'attaqueront de face, enfermé avec mes vingt-cinq mille hommes par soixante-quinze mille hommes, par deux cours d'eau et de la forêt, je n'ai plus qu'à me rendre ou à faire tuer mes hommes depuis le premier jusqu'au dernier. La seule armée sur laquelle comptât la France est anéantie, et messieurs les alliés peuvent tranquillement prendre la route de la capitale.
– Il faut, sans perdre un instant, les débusquer de là, général.
– C'est bien ce que je vais essayer de faire. Éveillez Thévenot dans la chambre à côté.
Jacques Mérey ouvrit la porte et appela Thévenot. Thévenot ne dormait jamais que d'un œil; il sauta à bas de son lit, passa un pantalon et accourut.
– La Croix-aux-Bois est forcée, lui dit Dumouriez; faites éveiller Charot, qu'il parte avec six mille hommes, et que, coûte que coûte, il reprenne le passage.
Thévenot ne prit que le temps de s'habiller, s'élança vers le quartier du général Charot, le réveilla et lui transmit l'ordre du général.
Pendant ce temps, Jacques Mérey donnait à Dumouriez tous les détails de ce qui s'était passé sous ses yeux à la Croix-aux-Bois.
Lorsque Dumouriez apprit qu'il était revenu au camp de Grand-Pré par des sentiers traversant la forêt, il lui demanda s'il pouvait par ces mêmes sentiers guider une colonne qui attaquerait en flanc tandis que Charot attaquerait en tête.
Jacques Mérey s'engagea à conduire cette colonne, pourvu qu'elle fût formée d'infanterie seulement; quant à la cavalerie, il regardait comme une chose impossible de la faire passer par de pareils chemins.
Quelque diligence que l'on y mît, il était grand jour lorsque la colonne fut prête à partir. Mais Dumouriez réfléchit qu'une attaque de jour entraînait avec elle trop de chances diverses, tandis que, attaqué la nuit d'un côté par lequel il ne pouvait pas attendre l'ennemi, et en même temps obligé de se défendre en tête, il y avait lieu de tout espérer.
Il fallait trois heures au général Charot pour faire les trois lieues qu'il avait à franchir par la chaussée de l'Argonne, trajet qui nécessitait un double détour. Il ne fallait qu'une heure et demie à Jacques pour conduire sa colonne à la hauteur de Longwée.
Il fut donc convenu que Charot partirait à cinq heures pour arriver à la nuit close à l'entrée du défilé, et Jacques à six heures et demie. Les premiers coups de canon de Charot, qui amenait avec lui deux pièces de campagne, devaient servir de signal à Mérey pour charger.
Mérey eut donc le temps de changer d'habits et de prendre un bain avant de se remettre en route, et, à six heures et demie, avec son costume de représentant, un fusil de munition à la main, il prit la tête de la colonne.
Le duc de Chartres avait demandé à être de l'expédition. Mais Dumouriez lui avait dit en riant:
– Patience, patience, monseigneur; attendez une belle bataille à la lumière du soleil, les combats de nuit ne vont pas aux princes du sang.
Puis il avait ajouté à voix basse:
– Surtout quand ils sont aptes à succéder!
À huit heures, Mérey et ses cinq cents hommes voyaient à un quart de lieue, à travers les arbres, les feux des bivouacs qui coupaient la forêt sur toute la ligne du défilé, mais qui se groupaient plus nombreux autour du village de Longwée où était le quartier général du prince de Ligne.
Chaque soldat posa son sac à terre, s'assit sur son sac, mangea un morceau de pain, but une goutte d'eau-de-vie, et plein d'impatience attendit.
Vers dix heures, on entendit les premiers coups de fusil échangés entre les avant-postes autrichiens et l'avant-garde française.
Puis, dix minutes après, le grondement du canon annonça que l'artillerie venait de se mêler de la partie.
Dès les premiers coups de fusil, la petite colonne conduite par Jacques avait vu un grand trouble se manifester sur toute la ligne du défilé; on voyait à la lueur des feux les soldats saisir leurs armes et courir du côté de l'attaque.
Jacques avait toutes les peines du monde à maintenir ses hommes, mais ses instructions étaient précises: ne pas donner avant le premier coup de canon.
Ce premier coup de canon tant attendu se fit enfin entendre. Les soldats saisirent leurs fusils et, Jacques Mérey à leur tête, s'élancèrent.
– À la baïonnette! cria Jacques Mérey. Ne faites feu qu'au dernier moment!
Et tous s'élancèrent à ce cri magique de «Vive la nation!» qui, répété par l'écho de la forêt, eût pu faire croire aux Autrichiens et aux émigrés qu'il était poussé par dix mille voix.
Mais, pour combattre contre la France, les émigrés n'en étaient pas moins braves. Le cri de «Vive le roi!» répondit au cri de «Vive la nation!» Et, pareille à un tourbillon, une charge de cavalerie, conduite par un homme de trente à trente-cinq ans, portant l'uniforme de colonel autrichien, habit blanc, pantalon rouge, ceinture d'or, descendit du haut de la colline où le village était situé.
– Feu à vingt pas, et recevez les survivants sur vos baïonnettes!
Puis, d'une voix qui fut entendue de tous:
– À moi l'officier! cria-t-il.
Et, se plaçant au milieu du chemin, à la tête de la colonne, il attendit que les premiers cavaliers fussent à vingt pas de lui, ajusta l'officier, et fit feu.
Cinq cents coups de fusil accompagnèrent le sien.
Chacun s'était posté le plus commodément possible pour tirer; chacun avait visé à la lueur du feu des bivouacs. La chaussée ne permettait à la cavalerie de charger que sur huit hommes de front; mais les balles, en se croisant, avaient plongé des deux côtés dans les rangs; plus de cent chevaux et de deux cents cavaliers tombèrent.
Quant à l'officier, emporté par le galop de son cheval, il vint rouler auprès de Jacques Mérey, tué roide d'une balle au milieu de la poitrine.
La chaussée était tellement obstruée de cadavres d'hommes et de chevaux, que les derniers rangs ne purent franchir la barricade sanglante qui venait de se lever entre eux et les patriotes.
Quelques-uns des survivants, échappés au massacre, vinrent se jeter sur les baïonnettes et furent tués ou pris.
– Rechargez! cria Mérey, et feu à volonté!
Les patriotes rechargèrent leurs fusils, et, s'élançant sous bois de chaque côté de la chaussée, ce que ne pouvaient faire les cavaliers, ils les poursuivirent en les fusillant. Quant à ceux qui étaient démontés, c'était l'affaire de la baïonnette; tous se défendaient avec acharnement, d'abord parce qu'ils étaient tous braves, ensuite parce qu'ils savaient que tout prisonnier émigré était un homme fusillé.
Donc ils aimaient mieux en finir sur le champ de bataille que dans les fossés d'une citadelle ou contre un vieux mur.
Au reste, on entendait le canon de Charot qui se rapprochait, indication sûre que les Autrichiens battaient en retraite; ils avaient fait la même faute: la Croix-aux-Bois prise, ils ne l'avaient pas fait garder par un nombre d'hommes assez considérable.
Les fuyards arrivèrent sur les derrières de la colonne autrichienne, annonçant que l'armée était coupée, que le corps des émigrés était aux trois quarts exterminé, et que son chef, le prince de Ligne, avait été tué par le premier coup de fusil qui avait été tiré.
Le désordre se mit dans les rangs des Autrichiens et des émigrés; chacun se jeta dans les bois, tirant de son côté. La résistance cessa ou à peu près; trois ou quatre cents Autrichiens furent tués, autant pris; deux cent cinquante émigrés restèrent sur le champ de bataille.
Quelques-uns, après une résistance désespérée, furent conduits à Dumouriez.
Quant à Jacques Mérey, à peine le combat avait-il cessé qu'il songea aux blessés. Les ambulances étaient encore mal organisées à cette époque, ou plutôt elles ne l'étaient pas du tout. Craignant quelque retour offensif de l'ennemi, il fit réunir tous les chevaux sans maître que l'on put trouver, y compris celui du prince de Ligne, que l'on reconnut à sa housse et à ses fontes brodées d'or, et les employa à transporter les blessés à Vouziers, où il établit le quartier général de ses malades, laissant à un plus ambitieux que lui le soin de porter la nouvelle de la victoire au général en chef.
Jacques Mérey ordonna que les Autrichiens fussent amenés avec des soins égaux à ceux qui étaient accordés aux Français; et, couchés dans les mêmes chambres, ils recevaient les mêmes soins.
Mais, à peine l'ambulance était-elle installée, à peine les premiers pansements étaient-ils faits, que le canon se fit entendre de nouveau, et cette fois en se rapprochant de Vouziers, ce qui indiquait que c'était le général Charot qui à son tour battait en retraite.
En effet, au bout de deux heures, quelques-uns de ces hommes qui semblent avoir des ailes aux pieds pour annoncer les catastrophes arrivèrent à Vouziers, se disant suivis du corps d'armée du général Charot qui battait en retraite.
Clerfayt, comprenant l'importance de la position de la Croix-aux-Bois, était accouru au canon avec les trente mille hommes qui lui restaient, et, avec ces trente mille hommes, il avait renversé tout ce qui s'opposait à son passage.