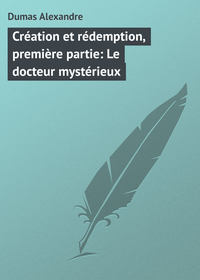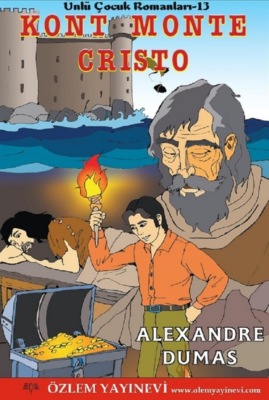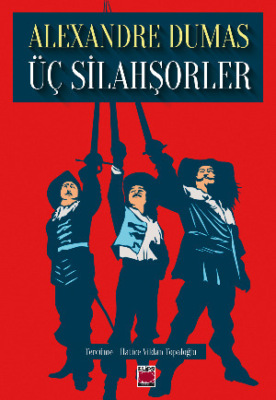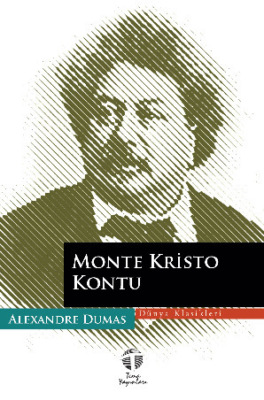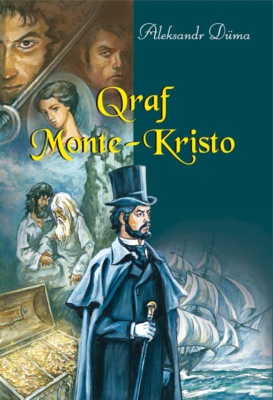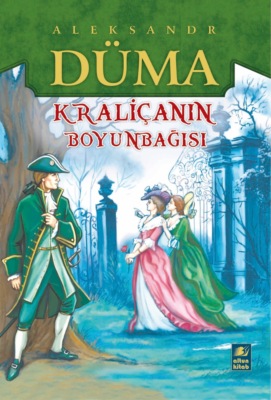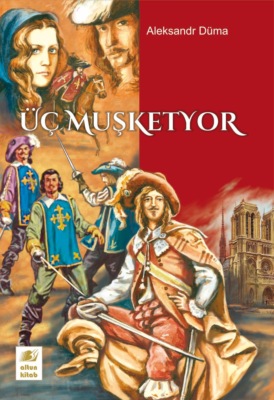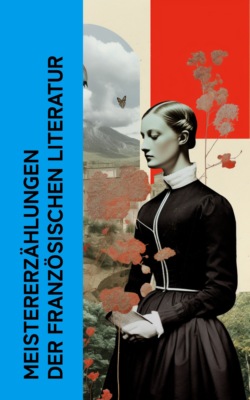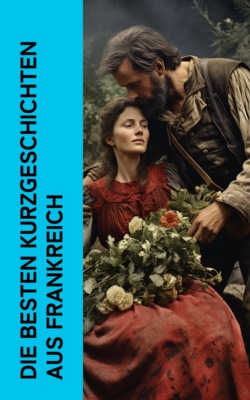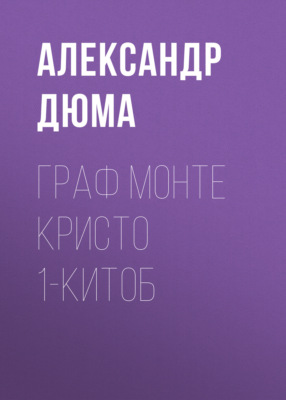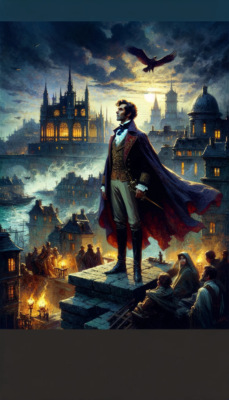Kitabı oku: «Création et rédemption, première partie: Le docteur mystérieux», sayfa 21
XXXVI
Le jugement
Jacques Mérey fut envoyé à Paris par Dumouriez et chargé de présenter à la Convention le jeune Baptiste Renard, qui avait rallié une brigade au moment où celle-ci pliait.
Il partit le 6, à trois heures, courut la poste toute la nuit, et arriva le 7 à temps pour se présenter à la Convention et annoncer la nouvelle, attendue mais inespérée.
– Citoyens représentants, dit-il, messager de Valmy, je viens vous annoncer la victoire de Jemmapes; en quatre heures, nos braves soldats ont enlevé des positions que l'on croyait inexpugnables.
– Comment cela? demanda le président.
– En chantant, répondit Jacques Mérey.
– Et que demande le général pour sa brave armée?
– Du pain et des souliers.
Il y eut un moment d'enthousiasme immense; les canons des Invalides semblèrent faire feu d'eux-mêmes; la nouvelle s'élança par toutes les portes et s'abattit sur Paris.
La grande ville, qui n'était qu'à moitié rassurée par la victoire de Valmy qui la débarrassait des Prussiens, fut folle de joie.
Les maisons s'illuminèrent toutes seules et dégorgèrent leurs habitants; les rues s'emplirent, les cloches sonnèrent, la foule se porta aux Tuileries.
Marie-Joseph Chénier, qui était de la Convention, fit, séance tenante, la première strophe de son hymne:
La victoire, en chantant, nous ouvre la barrière…
Méhul en fit la musique.
Jacques Mérey détourna l'attention de lui et la ramena sur le jeune Baptiste Renard. Il raconta ce qu'il avait fait comme il savait raconter; il montra l'âme du soldat sous la livrée du domestique, et comment tout avait grandi en France, jusqu'aux cœurs des mercenaires.
La Convention comprit qu'il fallait qu'elle grandît celui qui s'était élevé; elle lui vota et lui donna séance tenante les épaulettes de capitaine.
Puis elle reprit sa séance interrompue.
Le jour où l'on apprit la victoire de Valmy, la République fut proclamée; le jour où l'on apprit la victoire de Jemmapes, le roi fut mis en jugement.
Puis les choses marchèrent à pas de géant.
Bruxelles fut occupé par le général Dumouriez.
La Convention rendit un décret par lequel elle promettait aide et secours à tous les peuples qui voudraient renverser leur gouvernement.
Qu'on me permette d'ouvrir ici une parenthèse que je n'ouvrirais pas dans un autre roman que celui-ci, ni dans un autre journal que le Siècle.
On a dû remarquer, ceux du moins qui nous ont lus avec attention, combien nous avons pris à tâche d'introduire l'histoire nationale dans nos livres, et combien la popularité qu'on nous a faite a été mise au service de l'éducation publique.
Michelet, mon maître, l'homme que j'admire comme historien, et je dirai presque comme poète, au-dessus de tous, me disait un jour: «Vous avez plus appris d'histoire au peuple que tous les historiens réunis.»
Et ce jour-là, j'ai tressailli de joie jusqu'au fond de mon âme; ce jour-là, j'ai été orgueilleux de mon œuvre.
Apprendre l'histoire au peuple, c'est lui donner ses lettres de noblesse, lettres de noblesse inattaquables et contre lesquelles il n'y aura pas de nuit du 4 août.
C'est lui dire que quoiqu'il ait toujours eu ses racines dans la nation, que quoiqu'il ait existé comme commune, comme parlement, comme tiers, il ne date réellement que du jour de la prise de la Bastille.
Pour monter dans les carrosses du roi, il fallait faire ses preuves de 1399.
La noblesse du peuple date du 14 juillet.
Il n'y a pas de peuple sans liberté.
Mais nous qui oublions parfois cette sainte maxime, mais qui toujours à un moment donné nous en souvenons, il est bon de voir, malgré nos défaillances, à quel point nous avons infiltré en Europe le principe révolutionnaire; et, disons-le, relativement à la durée de la vie des peuples comparée à la vie humaine, combien rapidement il s'est fait jour!
Nous venons de dire que le 19 novembre, treize jours après la bataille de Jemmapes, la Convention, comprenant sa puissance et mesurant son droit, avait promis protection et secours à tous les peuples qui voudraient renouveler leur gouvernement.
Pourquoi n'avons-nous pas, l'un après l'autre, le temps de dire ce qu'étaient les rois qui représentaient ces gouvernements?
Angleterre: Georges III, un idiot; – Russie: Catherine, une goule; – Autriche: François II, un Tibère; – Espagne: Charles IV, un palefrenier; – Prusse: Frédéric-Guillaume, un mannequin dont ses maîtresses tenaient le fil.
Mais les peuples ne marchent que les uns après les autres sur la route de Damas, et il leur faut des années de tyrannie pour que les écailles leur tombent des yeux.
L'appel aux peuples de 1792 fut proclamé; le Brabant seul y répondit. La révolution du Brabant fut étouffée.
La révolution de 1830 arriva; le gouvernement provisoire appela les peuples à la liberté. Trois peuples répondirent: L'Italie, la Pologne, la Belgique.
Deux peuples furent noyés dans leur sang: l'Italie et la Pologne. La Belgique y gagna la liberté et une constitution.
Puis vint la révolution de 1848, qui appela tous les peuples à la république.
Et alors ce ne fut plus seulement trois peuples qui réclamèrent leur liberté et demandèrent une constitution; ce fut l'Autriche, ce fut la Prusse, ce fut Venise, ce fut Florence, ce fut Rome, ce fut la Sicile, ce furent les provinces danubiennes, ce fut tout ce qui est éclairé enfin par le soleil de la civilisation qui proclama la république.
L'Italie y gagna son unité; l'Autriche, la Prusse, les provinces danubiennes, des constitutions.
Et nunc intelligite, reges!
Reprenons la suite des événements.
Le 27, un décret réunit la Savoie à la France.
Le 30, prise de la citadelle d'Anvers par le général La Bourdonnaye.
Arrêtons-nous ici encore un moment et jetons un coup d'œil sur l'Angleterre, sur l'Angleterre que nous appelions notre sœur aînée et que nous appelons notre amie.
L'Angleterre, le pays le plus savant en sciences mécaniques, le plus ignorant en force morale, nous avait depuis 1789 regardé faire, sans s'inquiéter autrement de nous; elle avait haussé les épaules à notre enthousiasme, elle avait raillé nos volontaires; au premier coup de canon prussien ou autrichien, elle avait cru les voir s'envoler vers Paris comme une volée d'oiseaux.
Pitt, ce grand politique qui n'a jamais été qu'un commis haineux, Pitt, doublé des Grenville, voyait la France, envahie par la Prusse, former une seconde Prusse.
Tout à coup elle voit s'illuminer le côté de la Belgique. Qu'y a-t-il?
La France est au Rhin; la France est aux Alpes; Anvers est pris!
La baïonnette de la France est sur la gorge de l'Angleterre.
Alors l'île aux quatre mers est prise d'une de ces paniques qui lui sont particulières, comme elle en prit une en 1805 quand elle vit Napoléon à Boulogne, un pied sur les bateaux plats, et une autre, en 1842, quand trois millions de chartistes entourèrent le parlement.
Déjà une société anglaise étant venue féliciter la Convention, son président Grégoire leur dit à leur grande épouvante:
– Estimables républicains, la royauté se meurt sur les décombres féodaux; un feu dévorant va les faire disparaître; ce feu, c'est la Déclaration des droits de l'Homme.
Vous figurez-vous l'effet que ferait la Déclaration des droits de l'Homme dans un pays où un paysan n'a pas le droit de tuer le renard qui mange ses poules ni le corbeau qui abat ses noix?
Cependant le procès du roi se poursuivait, et la nécessité de faire disparaître tout ce qui faisait obstacle à la Révolution devenait impérieuse.
Faire la conquête du monde, pour la France, n'était pas urgent; mais faire la conquête d'elle-même était nécessaire.
La France avait contre elle trois principes ennemis:
L'Église;
La noblesse;
La royauté.
L'Église, on l'a vu par la guerre de la Vendée, qui fut toute aux mains des prêtres.
La noblesse, on l'a vu par les six mille émigrés de Condé qui portèrent les armes contre la France.
La royauté! la royauté, qui était coupable, comme l'ont prouvé les royalistes eux-mêmes, lorsque chacun a réclamé, en 1815, la récompense de services qui n'étaient rien autre chose que des trahisons, et qui cependant, par sa fausse éducation, par son invincible ignorance, par l'erreur du droit divin, pouvait se croire innocente.
La France s'était débarrassée de l'Église en décrétant la mise en vente des biens des couvents.
La noblesse avait débarrassé la France d'elle en émigrant.
Restait donc la royauté.
C'était le dernier obstacle; de là tant de haine dans sa destruction.
La maxime favorite de Louis XVI – c'est M. de Malesherbes, son défenseur lui-même, qui l'a dit, maxime qui dérive directement du fameux mot de Louis XIV: L'État, c'est moi– était celle-ci:
La loi suprême, c'est le salut de l'État
Seulement, la question est là: l'État est-il dans la royauté ou dans la nation?
La question est reconnue aujourd'hui, et ceux-là mêmes qui règnent avouent en montant sur le trône qu'ils ne sont que les mandataires de la nation.
Il est vrai qu'une fois sur le trône ils l'oublient presque aussitôt.
Mais oublier un principe n'est pas le détruire, c'est forcer les autres de s'en souvenir, voilà tout.
L'erreur disait: «La loi suprême est le salut de l'État.»
La vérité dit: «La loi suprême est le salut public.»
Or le roi avait conspiré contre le salut public:
En essayant de sortir du royaume;
En continuant ses relations avec ses frères;
En protestant contre la Révolution dans son adresse au roi de Prusse;
En demandant à son beau-frère ou en faisant demander par la reine, ce qui était la même chose, les secours de troupes autrichiennes.
La Convention ignorait tout cela, puisque ces faits ne nous furent révélés qu'à la Restauration; mais elle comprenait instinctivement que la mort du roi était nécessaire.
Le roi vivant, qu'en eût-on fait?
Prisonnier, il eût constamment conspiré pour sortir de sa prison.
Exilé, il eût constamment conspiré pour rentrer en France.
La vie du roi était inviolable, dira-t-on.
Mais la vie de la France était-elle moins inviolable que celle du roi?
Tuer un homme est un crime.
Tuer une nation est un forfait.
Et cependant tous ces hommes hésitaient à porter la main, non pas sur le roi, mais sur l'homme.
Presque tous, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, s'étaient prononcés contre la peine de mort.
Ces hommes qui ont tant tué – nécessité aux coins de fer! – ces hommes avaient presque tous pour principe cette première loi de l'humanité: ce qu'il y a de plus sacré, c'est la vie humaine.
Duport avait dit: «Rendons l'homme respectable à l'homme.»
Robespierre avait dit: «Il faut au moins pour condamner que les jurés soient unanimes.»
Aussi, pour porter le dernier coup à Louis XVI, choisit-on un homme dont l'entrée à la Chambre était une violation de la justice: il n'avait que vingt-quatre ans, Saint-Just.
Étrange précaution de la Providence.
Il monta à la tribune.
Nous connaissons tous Saint-Just. Nous l'avons vu dans ses portraits, grave, mince, roide, le cou perdu dans sa cravate de batiste, avec son teint mat, ses yeux bleu faïence d'une dureté slave, ses sourcils les couronnant comme une barre tirée à la règle au-dessus d'eux, avec cela le front bas et les cheveux descendant jusqu'aux sourcils.
– Pour juger César il n'a fallu, dit-il, d'autre formalité que vingt-deux coups de poignard.
– Il faut tuer, il n'y a plus de loi pour le juger, lui-même les a détruites.
– Il faut le tuer comme ennemi, on ne juge qu'un citoyen; pour juger le tyran il faudrait d'abord le faire citoyen.
– Il faut le tuer comme coupable pris en flagrant délit, la main dans le sang. La royauté est d'ailleurs un crime éternel, un roi est hors la nature; de peuple à roi, nul rapport naturel.
Il faut lire cette page, que nous empruntons à Michelet, pour se faire une idée exacte de l'effet que produisit le discours de Saint-Just.
«L'atrocité du discours eut un succès d'étonnement. Malgré les réminiscences classiques qui sentaient leur écolier (Louis est un Catilina, etc., etc.), personne n'avait envie de rire. La déclaration n'était pas vulgaire; elle dénotait dans le jeune homme un vrai fanatisme. Ses paroles, lentes et mesurées, tombaient d'un poids singulier et laissaient de l'ébranlement, comme le lourd couteau de la guillotine. Par un contraste choquant, elles sortaient, ces paroles froidement impitoyables, d'une bouche qui semblait féminine. Sans ses yeux bleus fixes et durs, ses sourcils fortement barrés, Saint-Just eût pu passer pour une femme. Était-ce la vierge de Tauride? Non, ni les yeux, ni la peau, quoique blanche et fine, ne portaient à l'esprit un sentiment de pureté. Cette peau très aristocratique, avec un caractère singulier d'éclat et de transparence, paraissait trop belle et laissait douter s'il était bien sain.
»L'énorme cravate serrée, que seul il portait alors, fit dire à ses ennemis, peut-être sans cause, qu'il cachait des humeurs froides. Le cou était comme supprimé par la cravate, par le collet roide et haut; effet d'autant plus bizarre que sa taille longue ne faisait point du tout attendre cet accourcissement du cou. Il avait le front très bas, le haut de la tête comme déprimé, de sorte que les cheveux, sans être longs, touchaient presque aux yeux. Mais le plus étrange était son allure d'une roideur automatique qui n'était qu'à lui. La roideur de Robespierre n'était rien auprès. Tenait-elle à une singularité physique, à un excessif orgueil, à une dignité calculée? Peu importe. Elle intimidait plus qu'elle ne semblait ridicule. On sentait qu'un être tellement inflexible de mouvement devait l'être aussi de cœur. Ainsi, lorsque dans son discours, passant du roi à la Gironde, et laissant là Louis XVI, il se tourna d'une pièce vers la droite et dirigea sur elle avec sa parole, sa personne tout entière, son dur et meurtrier regard, il n'y eut personne qui ne sentît le froid de l'acier.»
Louis XVI fut condamné à mort sans sursis à la majorité de trente-quatre voix.
Jacques Mérey motiva ainsi son vote:
– Ennemi de la mort comme médecin et ne pouvant cependant méconnaître la culpabilité de Louis XVI, je vote pour la prison perpétuelle.
Il venait de prononcer deux arrêts à la fois: celui de Louis XVI et le sien.
XXXVII
L'exécution
De tout ce que nous venons d'écrire, il demeure clair pour les lecteurs que Louis XVI fut condamné parce qu'il était un danger national.
La France, qui devait non seulement vivre et prospérer par sa mort, mais secouer, lui mort, l'esprit de la révolution sur les autres peuples, devait mourir avec lui et par lui.
Ce qu'on voulut tuer surtout, avec le roi, c'est l'appropriation d'un peuple à un homme.
Le Breton Lanjuinais l'a dit: «Il y a de saintes conspirations.»
Les conspirations saintes, c'est le retour du droit, c'est la rentrée du vrai maître dans la maison, c'est l'expulsion de l'intrus.
Les vrais régicides ne sont point Thraséas et ses complices qui tuèrent Caligula, ce sont les flatteurs qui persuadèrent à Caligula qu'il était dieu!
Le roi entendit avec beaucoup de calme sa sentence, que le ministre de la Justice alla lui lire au Temple.
Une circonstance bizarre, presque providentielle, l'avait depuis longtemps mis en face de sa propre mort.
M. de Richelieu, le courtisan par excellence, avait à prix d'or, et pour en faire cadeau à Mme du Barry, acheté le beau portrait de Charles Ier par Van Dick.
Quel rapport y avait-il entre Mme du Barry, le roi d'Angleterre et le peintre flamand?
Il fallait un bien fin courtisan pour le trouver.
Le jeune page qui tient le cheval du roi était portrait comme le roi. C'était le page favori de Charles Ier. Il s'appelait Bary.
Il s'agissait de faire accroire à Mme du Barry que le page était un des ancêtres de son mari.
Ce ne fut pas chose difficile; la pauvre créature croyait tout ce que l'on voulait.
Elle avait son appartement dans les mansardes de Versailles. Elle plaça le tableau debout contre la muraille. Il était de hauteur avec l'appartement.
M. de Richelieu l'avait au reste renseignée sur ce qu'était Charles Ier.
Et quand Louis XV la venait voir, elle le faisait asseoir sur son canapé, placé juste en face du portrait, et elle lui disait:
– Tu vois, la France, c'est un roi qui a eu le cou coupé pour n'avoir pas osé résister à son parlement.
Louis XV mourut. Mme du Barry fut exilée. Le chef-d'œuvre de Van Dyck demeura dans les mansardes de Versailles.
Puis les journées des 5 et 6 octobre arrivèrent. Louis XVI et la famille royale furent ramenés à Paris.
Les Tuileries, inhabitées depuis longtemps, étaient démeublées. On prit au hasard, dans les appartements vides de Versailles, des meubles et des tableaux.
Les appartements des anciennes favorites fournirent leur contingent.
Louis XVI, en entrant dans sa chambre à coucher, se trouva en face du portrait de Charles Ier.
Il prit ce hasard pour un avertissement de la Providence, et depuis ce jour pensa à la mort.
Il dormit profondément la veille de l'exécution, se réveilla avant le jour, entendit la messe à genoux, refusa de voir la reine à qui il avait promis de dire adieu la veille, de peur de s'attendrir.
Enfin, à huit heures, il sortit de son cabinet et entra dans sa chambre à coucher, où l'attendait la troupe.
Tout le monde avait le chapeau sur la tête.
– Mon chapeau? demanda Louis XVI.
Cléry le lui remit et il se coiffa.
Puis il ajouta:
– Cléry, voici mon anneau d'alliance; vous le remettrez à ma femme et lui direz que ce n'est qu'avec peine que je me sépare d'elle.
Puis, tirant son cachet de sa poche:
– Voici pour mon fils, dit-il.
Sur le cachet étaient gravées les armes de France.
Dans les traditions royales, c'était le trône qu'il lui transmettait.
Il s'approcha d'un homme de la Commune, nommé Jacques Roux.
– Voulez-vous recevoir mon testament? lui demanda-t-il.
L'homme se recula.
– Je ne suis ici, dit-il, que pour vous conduire à l'échafaud.
– Donnez, dit un autre municipal; je m'en charge.
– Prenez-vous votre redingote, sire? demanda Cléry.
Il fit signe que non.
Il était en habit de couleur sombre, en culotte noire, en bas blancs, en gilet de molleton blanc.
Au fond de la voiture, son confesseur, l'abbé Edgeworth, Irlandais, élève des jésuites de Toulouse, prêtre non assermenté, l'attendait.
Il y monta, s'assit près de lui. Deux gendarmes montèrent derrière lui et s'assirent sur la banquette de devant.
Le roi tenait un livre de messe à la main; il se mit à lire des psaumes.
Il était dans une voiture à lui.
Les rues étaient à peu près désertes, portes et fenêtres étaient fermées; personne ne paraissait même derrière les vitres.
On eût dit une nécropole.
Le pouls de Paris ne battait plus que sur la place de la Révolution.
Il était dix heures dix minutes lorsque la voiture s'arrêta en face du pont tournant.
Les commissaires de la Commune étaient sous les colonnes du garde-meuble; ils avaient mission d'assister à la mort et de dresser procès-verbal de l'exécution; autour de l'échafaud, une triple batterie de canons menaçait les spectateurs de trois côtés, laissant entre leurs affûts et la plate-forme un grand espace vide; de tous côtés on ne voyait que troupes, car il avait été question d'un complot pour enlever le prisonnier.
Grâce à cette quadruple haie de troupes qui environnaient de tous côtés l'échafaud, et qui s'ouvrirent pour laisser passer les condamnés, les spectateurs les plus proches étaient à plus de trente pas.
Ces militaires étaient des fédérés que l'on avait choisis parmi les plus exaltés.
Vingt tambours, avec leurs caisses, se tenaient sur la face de l'échafaud où se trouvait la lucarne, et tournaient le dos par conséquent au pont Louis XV.
La voiture s'arrêta à quelques pas des degrés par lesquels on montait à la plate-forme.
Le roi retrouva quelques paroles impérieuses pour recommander son confesseur aux deux gendarmes qui étaient avec lui dans la voiture.
Puis il descendit vaillamment le premier; son confesseur le suivit.
Les aides de l'exécuteur se présentèrent pour le déshabiller, mais lui fit un pas en arrière, jeta à terre son habit, son gilet et sa cravate.
Alors, au pied des degrés, une lutte d'un instant eut lieu entre les valets et lui.
Ils voulaient lui lier les mains avec des cordes.
Mais alors Sanson s'avança. Comme il l'avait dit à Jacques Mérey, il était un vieux serviteur de la royauté.
De grosses larmes roulaient le long de ses joues.
Voyant que le roi ne voulait pas se laisser lier les mains avec des cordes, il tira de sa poche un mouchoir de fine batiste, et, avec la même humilité qu'un valet de chambre:
– Avec un mouchoir, sire, dit-il.
Ce mot, sire, que Louis XVI n'avait entendu depuis si longtemps que dans la bouche de son défenseur Malesherbes, qui, quoique en face de la Convention, ne l'appela jamais autrement, le toucha profondément. Il tendit les deux mains et se les laissa lier avec le mouchoir.
Pendant ce temps, l'abbé Edgeworth s'était approché du roi et lui disait:
– Souffrez cet outrage comme une dernière ressemblance avec le Dieu qui va être votre récompense.
Mais déjà le roi avait tendu les deux mains, et, en tendant les mains, acceptant cette comparaison entre lui et Jésus-Christ:
– Je boirai le calice jusqu'à la lie, dit-il.
Le roi s'appuya sur le prêtre pour monter les marches de l'échafaud trop roides pour qu'il pût les gravir sans soutien; mais à la dernière marche une espèce de vertige lui prit; il s'élança sur la plate-forme jusqu'à son extrémité et s'écria:
– Français, je meurs innocent du crime que l'on m'impute. Je pardonne…
En ce moment, à un signe de Henriot, les vingt tambours partirent à la fois et étouffèrent la voix du roi dans leur roulement.
Le roi devint très rouge, frappa du pied en criant d'une voix terrible:
– Taisez-vous!
Mais les tambours continuèrent.
– Je suis perdu, reprit le roi. Je suis perdu.
Et il se livra aux bourreaux.
Mais, pendant qu'on lui mettait les sangles, il continua de crier:
– Je meurs innocent, je pardonne à mes ennemis. Je désire que mon sang apaise la colère de Dieu.
Les tambours continuèrent de battre et de couvrir sa voix jusqu'à ce que sa tête fût tombée.
Le valet du bourreau la prit et la montra au peuple. Sanson, appuyé à la guillotine, était prêt à se trouver mal.
Pendant les quelques secondes où le bourreau montra la tête au peuple, le peintre Greuze, qui se trouvait là, et qui au reste avait eu souvent l'occasion de voir le roi, fit un terrible portrait de cette tête coupée.
Le corps, placé dans un panier, fut porté au cimetière de la Madeleine et plongé dans la chaux vive.
Pendant ce temps, les fédérés avaient rompu leurs rangs pour tremper leurs baïonnettes dans le sang. Le peuple se précipita à son tour, acheva de les disperser, et alors, soit haine, soit vexation, chacun voulut avoir une part de son sang; les uns y trempèrent leurs mouchoirs et les autres les manches de leurs chemises, les autres enfin du papier.
Quelques cris de grâce se firent entendre.
Pour beaucoup, la sensation que produisit cette mort fut terrible, pour quelques-uns mortelle.
Un perruquier se coupa la gorge avec son rasoir, une femme se jeta dans la Seine, un ancien officier mourut de saisissement, un libraire devint fou.
L'agitation causée dans Paris par cette exécution fut doublée par un assassinat qui avait eu lieu la veille et qui en faisait craindre d'autres.
Ce n'était point sans raison qu'on avait parlé d'un complot ayant pour but d'enlever le roi. Cinq cents royalistes s'y étaient engagés, vingt-cinq seulement se réunirent; la tentative même échoua.
Mais un de ces hommes voulut, autant qu'il était en son pouvoir, venger le roi pour son compte.
C'était un ancien garde du corps nommé Pâris.
Il se tenait caché à Paris, rôdant autour du Palais-Royal, dans le but de tuer le duc d'Orléans.
Il était l'amant d'une parfumeuse ayant sa boutique à la galerie de bois.
Après le vote, et après avoir lu les noms de ceux qui avaient voté, il alla dîner dans un de ces restaurants souterrains comme il y en avait quelques-uns au Palais-Royal.
Celui-là avait une certaine réputation, et se nommait Février.
Il y voit un conventionnel qui soldait sa dépense, il entend quelqu'un en passant dire:
– Tiens, c'est Saint-Fargeau!
Il se rappelle qu'il vient de lire que Saint-Fargeau a voté la mort du roi.
Il s'approche de lui.
– Vous êtes Saint-Fargeau? lui demanda-t-il.
– Oui, répondit celui-ci.
– Vous avez pourtant l'air d'un homme de bien, dit le garde du corps d'une voix triste.
– Je le suis en effet, dit Saint-Fargeau.
– Si vous l'étiez, vous n'auriez pas voté la mort du roi.
– J'ai obéi à ma conscience, dit-il.
– Tiens, dit le garde du corps, moi aussi j'obéis à la mienne.
Et il lui passa son sabre au travers du corps.
Le hasard faisait dîner Jacques Mérey à une table voisine. Il s'élança, mais à temps seulement pour recevoir le blessé entre ses bras.
On le transporta dans la chambre des maîtres de l'établissement, mais en le posant sur le lit il expira.
– Heureuse mort! s'écria Danton en apprenant l'événement. Ah! si je pouvais mourir ainsi!
On a vu que, dans le récit de la mort du roi, je rectifie une erreur et donne une explication. L'erreur que je rectifie est d'exonérer la mémoire de Santerre du fameux roulement de tambour.
Santerre s'en était allé avec la Commune du 10-Août. Henriot était venu avec la Commune révolutionnaire.
Je dois cette rectification au fils de Santerre lui-même, qui est venu me trouver la preuve à la main.
Quant à l'explication, elle porte sur le débat qui eut lieu au pied de l'échafaud entre le roi et les exécuteurs.
Le roi ne luttait pas dans un désespoir inintelligent pour prolonger sa vie. Il luttait pour n'avoir pas les mains liées avec une corde.
Il ne fit pas de difficulté lorsqu'il s'agit d'un mouchoir.
Je dois ce curieux détail à M. Sanson lui-même, l'avant-dernier exécuteur de ce nom.