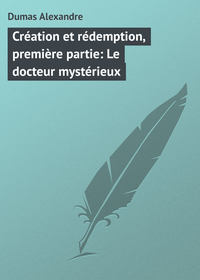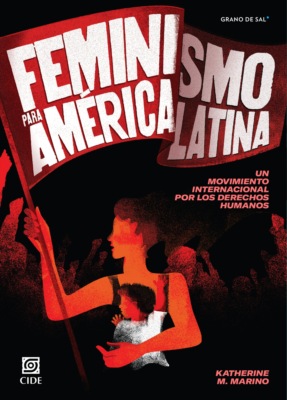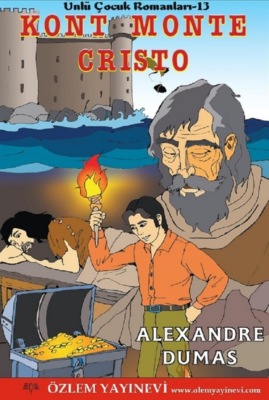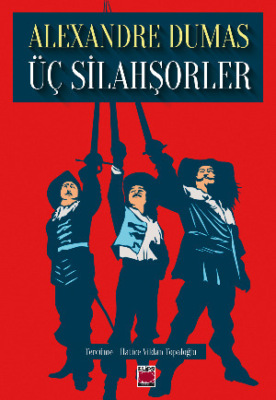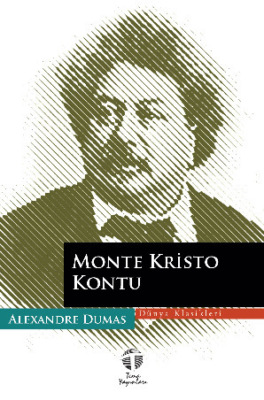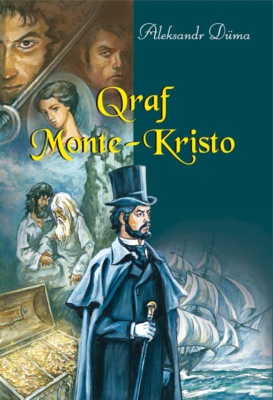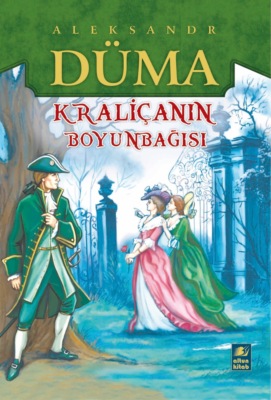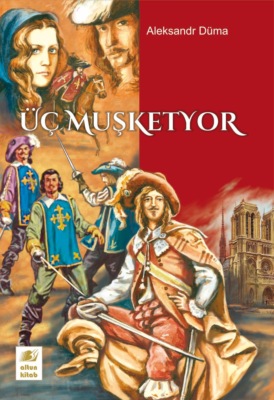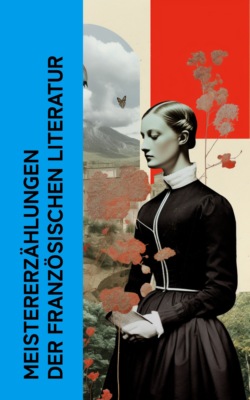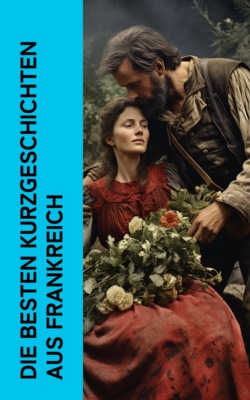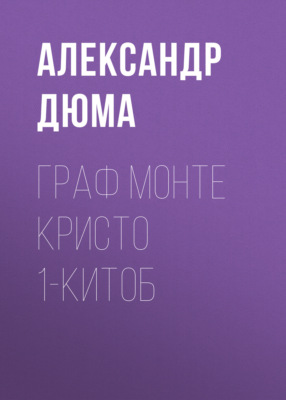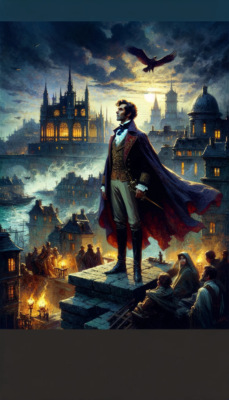Kitabı oku: «Création et rédemption, première partie: Le docteur mystérieux», sayfa 22
XXXVIII
Chez Danton
Le soir même de la mort du roi, deux hommes se tenaient près du lit d'une femme, sinon mourante, du moins gravement malade.
L'un était debout, pensif, lui tâtant le pouls dont il comptait les battements, et étant calme et froid comme la science dont il était le représentant.
L'autre, les doigts enfoncés dans les cheveux, se pressait violemment la tête de ses deux mains, tandis qu'on voyait le bas de son visage se couvrir de larmes dont la source était cachée, et que sa bouche laissait échapper un râle sourd, indice de colère plus encore que de douleur.
Ces deux hommes étaient Jacques Mérey et Georges Danton.
La mourante était Mme Danton.
En rentrant chez lui, Danton avait trouvé sa femme dans un tel état de prostration qu'il avait à l'instant même envoyé chercher Jacques Mérey; puis, en l'attendant, l'homme aux violentes étreintes avait voulu serrer la chère malade contre son cœur, et doucement elle l'avait repoussé.
C'était ce faible mouvement de la main d'une femme mourante qui avait brisé le cœur de cet homme à qui l'on croyait un cœur de bronze.
Dans ce mouvement, si faible qu'il fût, il y avait la séparation éternelle de deux âmes.
Danton, dans un moment de faiblesse, avait promis à Mme Danton de ne pas voter la mort du roi.
Il l'avait non seulement votée sans sursis, sans remise, mais provoquée violemment.
À dix heures et demie du matin, le roi avait été exécuté.
En sortant de la Convention, il était rentré chez lui, avait trouvé sa femme plus mal, avait voulu l'embrasser, et avait été repoussé par elle.
Il ne cherchait plus même à lire dans les yeux du médecin la mort ou la vie.
Même avec la vie, c'était encore la mort pour lui. Cette femme, qu'il aimait avec toute la passion dont son cœur était capable, cette femme qui avait toujours partagé ses caresses quand elle ne les avait pas sollicitées, cette femme l'avait repoussé.
La mère de ses deux enfants l'avait repoussé.
Il y avait donc dans le cœur de cette femme quelque chose de mort avant la mort: c'était son amour pour lui.
– Mon ami, dit Jacques Mérey après un instant de silence, veux-tu me laisser seul un instant avec ta femme?
Danton se leva, sortit en trébuchant, entra dans la chambre voisine, referma la porte; mais, malgré la porte refermée, on entendit le bruit d'un sanglot qui s'achevait en imprécation.
La malade resta muette, mais tressaillit.
Jacques Mérey s'assit près d'elle, gardant la main qu'il tenait entre les siennes.
– Vous avez eu aujourd'hui une émotion violente? demanda Jacques Mérey à Mme Danton.
– N'est-ce point aujourd'hui, à dix heures et demie du matin, que le roi a été exécuté? demanda-t-elle.
– Oui, madame.
– En entendant crier la mort, j'ai été prise d'un vomissement de sang.
– Est-il possible, madame, fit Jacques Mérey, qu'une chose qui vous est aussi étrangère que la mort du roi ait produit un pareil effet sur vous, la femme de Danton?
– C'est justement parce que je suis la femme de Danton que la mort du roi ne saurait m'être étrangère. Ne suis-je pas la femme de l'homme qui a voté la mort sans sursis, sans délai, sans appel?
– Trois cent quatre-vingt-dix représentants l'ont votée avec lui, insista Jacques Mérey.
– Vous ne l'avez pas votée, vous! s'écria-t-elle avec un accent profondément douloureux.
– Ce n'est point parce que le roi ne la méritait pas, madame, que je ne l'ai point votée, c'est parce que mon état de médecin et mon peu de croyance à une autre vie m'obligent de combattre la mort où je la rencontre.
Il se fit un silence d'un instant.
– Combien de temps croyez-vous que j'aie encore à vivre? demanda tout à coup Mme Danton.
Jacques tressaillit et la regarda.
– Mais, lui dit-il, la question n'en est pas encore là.
– Écoutez, dit Mme Danton en lui pressant faiblement la main, j'ai reçu trois coups dont un seul suffirait à tuer une existence, et chacun est entré plus profondément: le 10 août, le 2 septembre et le 21 janvier. Quand je suis entrée dans ce sombre et froid hôtel du ministère de la Justice, il m'a semblé entrer dans mon tombeau, et je l'ai dit à Georges en souriant tristement: «Je n'en sortirai pas vivante.» Je me trompais de bien peu, monsieur Mérey, j'en suis sortie mourante.
– Et pourquoi cet hôtel du ministère vous faisait-il si grand-peur, madame?
La malade haussa imperceptiblement les épaules.
– Les hommes sont faits pour les révolutions, dit-elle. Dieu, en les créant forts, leur a dit: «Luttez et combattez!» mais les femmes sont faites pour le foyer et l'amour; Dieu, en les créant faibles, leur a dit: «Soyez épouses, soyez mères!» Pauvre fille d'un limonadier du coin du pont Neuf, toute mon ambition s'étendait à avoir comme mon père une petite maison à Fontenay ou à Vincennes. Je l'ai épousé pauvre et obscur; je croyais au génie de l'avocat et non à l'orageuse fortune de l'homme politique; le chêne a poussé trop vite et trop vigoureusement, il a tué le pauvre lierre.
La porte se rouvrit à ces mots, et, rugissant de douleur, Danton vint s'abattre à genoux devant le lit de sa femme, lui baisant les pieds.
– Non! criait-il, non! tu ne mourras pas. N'est-ce pas qu'on peut la sauver? Eh! mon Dieu! que deviendrais-je donc si tu mourais? Que deviendraient nos pauvres enfants?
– C'était au nom des pauvres enfants du Temple que je t'avais demandé de ne pas voter la mort du pauvre roi.
– Oh! s'écria Danton, les femmes ne comprendront donc jamais rien! Suis-je le maître de ce que je fais? pas plus que dans une tempête le patron d'une barque n'est le maître de son bateau; une vague me soulève, l'autre m'abîme. La femme qui m'aimerait, qui m'aimerait véritablement, ne devrait pas me juger, mais se contenter de me plaindre et de panser mes éternelles blessures. Les hommes qui, comme moi, jettent une si terrible abondance de vie en dehors, les tribuns qui nourrissent les peuples de leur parole, du souffle de leur poitrine, du sang de leur cœur, ont besoin du foyer, et, au foyer, de douces mains qui leur refassent le cœur, d'une douce haleine qui leur hématose le sang; s'il y trouve les luttes, les querelles, les larmes, il est perdu. Non! s'écria-t-il, non, tu n'as pas le droit d'être malade! non, tu n'as pas le droit de mourir. Malade entre deux berceaux! Mourante et voulant mourir! voilà ce qu'il y a de plus douloureux, et, chaque fois que je rentre déchiré de plus de blessures que Régulus dans son tonneau, chaque fois que je laisse à la porte l'armure de l'homme politique et le masque d'acier, je trouve ici cette blessure bien autrement douloureuse, cette plaie bien autrement terrible et saignante: la certitude donnée par elle-même, par la femme que j'aime, je ne dirai pas plus que la France, puisque c'est à la France que je la sacrifie, mais plus que ma propre vie, que dans un mois, dans quinze jours, dans huit jours peut-être, je vais être déchiré de moi-même, coupé en deux, guillotiné du cœur; dis-moi, Jacques, connais-tu un homme aussi malheureux que moi?
Et il se redressa, levant les deux poings au ciel, menaçant et terrible comme Ajax.
– Mon ami, mon Georges, dit Mme Danton, tu es injuste. Je ne veux rien, moi! Je ne puis rien, moi! Je me sens glisser sur une pente, voilà tout, la pente de la mort. Chaque jour, je suis un peu moins une femme, un peu plus une ombre. Je fonds. Je te fuis, je t'échappe chaque fois que tes bras essayent de me serrer contre ton cœur. Oh! mon Dieu! moi aussi, s'écria-t-elle, je voudrais bien vivre. J'ai été si heureuse.
Puis elle ajouta tout bas:
– Autrefois!
– Le plus dur dans tout cela, vois-tu, reprit Danton, car je vois bien qu'elle dit vrai, c'est qu'il ne me sera pas même donné de la voir jusqu'au bout; c'est que je n'aurai pas la consolation de recevoir son adieu; c'est qu'il me faudra quitter ce lit de mort.
– Et pourquoi cela? Pourquoi cela? s'écria la pauvre femme, qui n'avait pas prévu cette suprême douleur et qui avait rêvé de mourir au moins dans les bras de l'homme qu'elle aimait.
– Mais parce que ma situation contradictoire va éclater, parce qu'il va peut-être m'être impossible, le roi mort, de mettre Danton d'accord avec Danton, parce que la France, parce que le monde ont eu les yeux sur moi dans ce fatal procès. Elle m'accuse d'avoir voté la mort. Et c'est moi qui ai hasardé le seul moyen de sauver le roi! C'est moi qui ai dit pour me rapprocher de la Gironde, qui n'a pas eu l'intelligence de me tendre la main et de nous faire, avec la Commune et les cordeliers, une majorité, c'est moi qui ai dit par deux fois: La peine, quelle qu'elle soit, doit-elle être ajournée après la guerre? Si la Gironde avait dit oui, la proposition passait. C'était une planche que je posais sur l'abîme. La Gironde devait y passer la première, donner l'exemple au centre, qui l'eût suivie. La Montagne en resta muette d'étonnement. Robespierre me regarda et son œil brilla de joie. «Il se perd! disait-il, il se perd. Il avance vers la Gironde, c'est-à-dire vers l'abîme.» Vergniaud crut à une ruse: comme si Danton se donnait la peine de ruser! Au lieu de venir à moi, la Gironde alla à la Montagne: elle ne voulait que la mort de la royauté, et sa majorité vota la mort du roi. Du moment où la droite était divisée, elle était annulée. Il était facile de prévoir que le centre faible et flottant se porterait vers la gauche. Eh bien! que pouvais-je faire de plus pour elle? Le 15 décembre, jour où l'on vota sur la culpabilité, je suis resté ici, près d'elle. J'ai dit que j'étais inquiet de sa santé, et j'ai risqué ma tête. Mon acte d'accusation commencera par ces mots: «Où étais-tu le 15?» Quand je suis rentré, le 16, il n'y avait plus de Commune, il n'y avait plus de Gironde, il n'y avait plus que la Montagne tonnante et rugissante. Mais la Montagne n'est pas libre, c'est l'esprit jacobin, c'est la pression jacobine, c'est la police, c'est l'inquisition, c'est la tyrannie. La Révolution se faisant purement jacobine perdra ce qu'elle a de grand, de généreux, d'humanitaire. Je vis que la droite était perdue, et avec la droite la Convention. Je me vis, moi, Danton, avec ma force et mon génie, asservi à la médiocrité jacobine. J'avais ou à me créer une force nouvelle, ou à me laisser dévorer par la lourde mâchoire de Robespierre. C'est pour cela que je revins tonnant et terrible, déterminé à reprendre la tête de la Révolution. N'étais-je pas le plus fort de la Commune? les gens de la Commune ne sont-ils pas des cordeliers trop heureux de me suivre. Il me fallait redevenir et je suis redevenu le Danton de la colère, du jugement et de la mort. Ils l'ont voulu; j'avais été jusque-là le Danton de 92; à partir du 16 décembre, je suis le Danton de 93. Écoute ceci, ma bien-aimée femme, mon épouse chérie, dit Danton, descendant des hauteurs où il venait de s'élever. Je comprends le sacrifice, je comprends le dévouement lorsque, en se jetant dans le gouffre comme Curtius, on est sûr que le gouffre se refermera sur vous et que la patrie sera sauvée. Mais aujourd'hui ce n'est pas seulement la France qu'il s'agit de sauver, c'est le monde. Périr, qu'est-ce que c'est cela périr? Un homme qui périt, c'est une unité de moins, un zéro souvent; mais la France! la France c'est aujourd'hui l'apôtre, le dépositaire des droits et de la liberté du genre humain. Elle porte à travers les tempêtes l'arche sainte des lois éternelles, elle porte cette lumière si longtemps attendue, allumée par le génie après tant de siècles. On ne peut pas laisser sombrer l'arche, on ne peut pas laisser éteindre la lumière avant qu'elle ait illuminé la France, avant qu'elle ait éclairé le monde. Des temps mauvais viendront peut-être où elle s'affaiblira, où elle disparaîtra même comme disparaissent les volcans; mais alors, si l'on ne sait plus où la trouver, on cherchera dans nos sépulcres. La flamme d'une torche n'en rayonne pas moins pour s'être allumée à la lampe d'une tombe!
Mme Danton poussa un soupir et tendit la main à son mari en disant:
– Tu as raison; sois tout ce que tu voudras, mais reste Danton.
XXXIX
La Gironde et la Montagne
Danton l'avait dit: Dans la femme était la pierre d'achoppement de la Révolution.
Ce qui se passait chez lui se reproduisait à tout moment et partout.
Depuis le Palais-Royal, regorgeant de maisons de jeu et de maisons de filles, jusqu'aux steppes de la Bretagne, où l'on rencontre de lieue en lieue une chaumière, c'était la femme qui énervait l'homme.
Si l'on peut compter quelques femmes ardentes et courageuses, comme Olympe de Gouges et Théroigne de Méricourt, quelques nobles matrones patriotes comme Mme Roland et Mme de Condorcet, quelques amantes dévouées comme Mme de Keralio et Lucile, le nombre des torpilles fut incalculable.
Les émotions politiques trop vives, les alternatives de la vie et de la mort, poussaient l'homme aux plaisirs sensuels.
On accusait Danton de conspirer.
– Est-ce que j'ai le temps! répondit-il. Le jour je défends ma tête ou demande la tête des autres; la nuit je m'acharne à l'amour.
Craignant de mourir, on prenait l'amour comme une distraction.
Las de vivre, on prenait le plaisir comme un suicide.
À mesure qu'un parti politique faiblissait, loin de se recruter, loin de se défendre, il ne songeait plus, comme ces sénateurs de Capoue qui s'empoisonnèrent à la fin d'un repas, qu'à se couronner de roses et à mourir.
C'est ainsi que meurt le constitutionnel Mirabeau; c'est ainsi que mourra le girondin Vergniaud; c'est ainsi que mourra le cordelier Danton; et qui sait si l'amour du Spartiate Robespierre pour la Lacédémonienne Cornélie n'a pas énervé les derniers moments du chef des jacobins?
Il y avait du plaisir pour tous les tempéraments.
Il y avait le Palais-Royal, tout éblouissant d'or et de luxe, où des courtisanes patentées venaient à vous et vous priaient d'être heureux.
Il y avait les salons de Mme de Staël et de Mme de Buffon, où l'on vous permettait de l'être.
Les filles étaient en général pour l'ancien régime, les grands seigneurs payaient mieux évidemment que tous ces nouveaux venus de province arrivés pour faire les affaires de la France.
Les deux salons que nous venons de nommer, sans vouloir faire et sans permettre qu'il soit fait aucune comparaison, tenaient l'autre extrémité de l'échelle sociale, mais, comme les étages inférieurs, avaient une tendance à la réaction.
Supposez tous les étages intermédiaires occupés par la bourgeoisie, qui depuis le 2 septembre était paralysée par la peur.
Et vous aurez l'inertie entre deux forces attractives.
Au milieu de ces deux forces attractives, agissant au haut et au bas de la société, les hommes politiques s'énervaient.
Dans le milieu inerte, ils se résignaient.
Un homme politique qui se résigne est un homme perdu.
Tous ces hommes qui étaient arrivés pleins d'enthousiasme, croyant à l'unité, à l'égalité, à la fraternité, et qui voyaient dès l'abord les dissensions terribles d'une Assemblée qui devait durer trois ou quatre ans, faisaient naturellement un soubresaut en arrière; alors ils étaient attirés dans un des milieux que nous avons dit, et peu à peu ils y perdaient non pas la force de mourir, mais celle de vaincre.
Mme de Staël n'avait jamais été véritablement républicaine. Mais, du temps où s'il était agi de défendre son père, elle avait fait une ardente opposition. Apôtre de Rousseau d'abord, après la fuite de son père elle devint disciple de Montesquieu. Ambitieuse et ne pouvant jouer un rôle par elle-même, ne pouvant jouer un rôle par son honnête et froid mari, elle avait voulu en jouer un par son amant. Un jour, on la vit tout éperdue d'amour pour un charmant fat sur la naissance duquel couraient les bruits les plus étranges. M. de Narbonne fut nommé ministre de la Guerre; elle lui mit aux mains l'épée de la Révolution. La main était trop faible pour la porter, elle passa à celle de Dumouriez.
On la croyait très bien avec les girondins, Robespierre lui aussi; mais c'était le malheur de ces pauvres honnêtes gens d'être compromis, non point parce qu'ils changeaient d'opinion, mais parce que les modérés prenaient la leur: les girondins ne devenaient pas royalistes, mais bon nombre de royalistes se faisaient girondins.
Le salon de Mme de Buffon, quoique placé sous le drapeau du prince Égalité, n'en passait pas moins pour un salon réactionnaire, et à coup sûr celui-là n'avait pas volé sa réputation. Les Laclos, les Sillery et même les Saint-Georges avaient beau faire les démocrates, si le dernier n'était pas un grand seigneur, c'était au moins le bâtard d'un grand seigneur.
Quand on est trompé par ce titre, la Gironde, on commence par chercher dans ce malheureux parti des hommes de Bordeaux ou tout au moins du département, mais on est tout étonné de n'en trouver que trois, les autres sont Marseillais, Provençaux, Parisiens, Normands, Lyonnais, Genevois même.
Cette différence d'origine n'a-t-elle pas été pour quelque chose dans leur facile décomposition? Les hommes d'un même pays ont toujours quelques points d'homogénéité par lesquels ils se soudent les uns aux autres; quel lien naturel voulez-vous qu'il y ait entre le Marseillaix Barbaroux, le Picard Condorcet et le Parisien Louvet?
La première condition de cette dissonance territoriale fut la légèreté.
Il y eut un moment où la Montagne eut deux chefs: au lieu de la laisser se diviser par la dualité, les girondins se crurent assez forts pour les abattre l'un après l'autre.
Lorsque Danton donna sa démission du ministère de la Justice, les girondins lui demandèrent des comptes; des comptes à Danton, qui rentrait aussi pauvre dans son triste appartement et dans sa sombre maison des Cordeliers qu'il en était sorti.
Ces comptes, il fallait les rendre. Tant qu'ils n'étaient pas rendus, Danton était accusé. Il s'abrita sous le drapeau de la Montagne; Robespierre tenait ce drapeau, il fallait à son tour attaquer Robespierre.
Robespierre avait toujours avancé à force d'immobilité; ce n'était pas lui qui marchait, c'était le terrain même sur lequel il était placé; ses adversaires, en se détruisant, ne lui ouvraient pas un chemin pour aller aux événements, mais ouvraient un chemin aux événements pour venir à lui.
Vergniaud n'avait pas voulu qu'on attaquât Danton, qu'il regardait comme le génie de la Montagne.
Brissot ne voulait point que l'on attaquât Robespierre, que l'on n'était pas sûr d'abattre.
Mais Mme Roland haïssait Danton et Robespierre; elle était haineuse comme sont les âmes austères, comme étaient les jansénistes; enfermée dans une espèce de temple, elle avait son Église, ses fidèles, ses dévots; on lui obéissait comme on eût obéi à la vertu et à la liberté réunies.
Ces hommages presque divins l'avaient gâtée; elle avait fait deux grands pas vers Robespierre, mais tout aux Duplay, elle n'avait eu aucune prise sur lui.
Elle lui écrivit en 91 pour l'attirer au parti qui fut depuis la Gironde. Il se contenta d'être poli, et refusa.
Elle lui écrivit en 92.
Il ne répondit point.
C'était la guerre.
Nous avons vu comment elle avait été déclarée à Danton. On décida d'attaquer Robespierre.
Mais, au lieu de le faire attaquer par un homme comme Condorcet, comme Roland, comme Rabaut-Saint-Étienne, par un pur enfin, on le fit attaquer par un jeune, ardent, plein de feu, c'est vrai, mais qui ne pouvait rien contre un homme continent comme Scipion, incorruptible comme Cincinnatus.
On le fit attaquer par Louvet de Couvrai, par l'auteur d'un roman sinon obscène, du moins licencieux; on le fit attaquer par l'auteur de Faublas.
On fit attaquer le visage pâle, la figure austère, l'âme intègre, par un homme jeune homme souriant, délicat et blond, paraissant de dix ans plus jeune qu'il n'était, par un marchand de scandale qui en avait fait pas mal pour son compte, car on prétendait que lui-même était le héros de son roman.
Quand il monta à la tribune pour attaquer, il n'y eut qu'un cri:
– Tiens, Faublas!
L'accusation échoua.
Dès lors il y eut rupture complète entre Robespierre et les Roland, entre la Montagne et la Gironde.
Revenons à ce que nous avons dit au commencement de ce chapitre: que depuis le Palais-Royal regorgeant de maisons de jeu et de maisons de filles, jusqu'aux steppes de la Bretagne où l'on rencontre de lieue en lieue une chaumière, c'était la femme qui énervait l'homme.
Généreuse contre elle-même, la Révolution, par un de ses premiers décrets, abolissait la dîme.
Abolir la dîme, c'était faire rentrer en ami dans la famille le prêtre qui jusque-là en avait été regardé comme l'ennemi.
Faire rentrer le prêtre dans la famille, c'était préparer à la Révolution son ennemi le plus dangereux: la femme.
Qui a fait la sanglante contre-révolution de la Vendée? La paysanne, – la dame, – le prêtre.
Cette femme agenouillée à l'église et disant son chapelet, que fait-elle? Elle prie. – Non, elle conspire.
Cette femme assise à sa porte, la quenouille au côté, le fuseau à la main, que fait-elle? Elle file. – Non, elle conspire.
Cette paysanne qui porte un panier avec des œufs à son bras, une cruche de lait sur sa tête, où va-t-elle? Au marché. – Non, elle conspire.
Cette dame à cheval qui fuit les grandes routes et les sentiers battus pour les landes désertes et les chemins à peine tracés, que fait-elle? – Elle conspire.
Cette sœur de charité qui semble si pressée d'arriver, qui suit le revers de la route en égrenant son rosaire, que fait-elle? Elle se rend à l'hôpital voisin. – Non, elle conspire.
Ah! voilà ce qui les rendait furieux, ces hommes de la Révolution qui se sont baignés dans le sang; voilà ce qui les faisait frapper à tâtons, tuer au hasard. C'est qu'ils se sentaient enveloppés de la triple conspiration de la paysanne, de la dame et du prêtre, et qu'ils ne les voyaient pas.
Eh bien! tout sortait de l'église, de cette sombre armoire de chêne qu'on appelle le confessionnal.
Lisez la lettre de l'armoire de fer, la lettre des prêtres réfractaires réunis à Angers, en date du 9 février 1792. Quel est le cri du prêtre? Ce n'est pas d'être séparé de Dieu, c'est d'être séparé de ses pénitentes. On ose rompre ces communications que l'Église non seulement permet, mais autorise.
Où croyez-vous que soit le cœur du prêtre? Dans sa poitrine? Non, le cœur n'est pas où il bat, il est où il aime; le cœur du prêtre est au confessionnal.
Et, s'il est permis de comparer les choses profanes aux choses sacrées, nous vous montrerons cet acteur ou cette actrice. Sublimes de sentiment, de poésie, de passion, pour qui jouent-ils si ardemment, pour qui tentent-ils d'atteindre à la perfection? Pour un être idéal qu'ils se créent, qui est dans la salle, qui les regarde, qui les applaudit.
Il en est de même du prêtre, même en le supposant chaste; il a, au milieu de ses pénitentes, une jeune fille, mieux encore, une jeune femme – avec la jeune femme, le champ des investigations est plus complet – dont le visage, vu à travers le grillage de bois, l'éclaire jusqu'à l'éblouissement, dont la voix, dès qu'il l'entend, s'empare de tous ses sens et pénètre jusqu'à son cœur.
En enlevant au prêtre la mariage charnel, on lui a laissé le mariage spirituel, le seul dont on dût se défier. Aux yeux de l'Église même, ce n'est pas saint Joseph qui est le vrai mari de la Vierge, c'est le Saint-Esprit.
Eh bien! dans ces terribles années 92, 93, 94, tout homme dont la femme se confessa eut un Saint-Esprit ignoré dans la maison. Cent mille confessionnaux envoyaient la réaction au foyer domestique, soufflant la pitié pour le prêtre réfractaire, soufflant la haine contre la nation, comme si la nation n'avait pas été l'homme, la femme, les enfants! soufflant le doute contre les biens nationaux, c'est-à-dire contre la prospérité, le bien-être, le bonheur de l'avenir.
Voici pour la province, pour la Bretagne et la Vendée surtout. Paris eut la légende du Temple.
Le roi et sa famille affamés ou à peu près!
Le roi avait au Temple trois domestiques et treize officiers de bouche.
Son service se composait de quatre entrées, de deux rôtis de trois pièces chacun, de quatre entremets, de trois compotes, de trois assiettes de fruits, d'un carafon de bordeaux, d'un de malvoisie, d'un de madère.
Pendant les quatre mois que le roi resta au Temple, sa dépense de bouche fut de 40 000 francs; 10 000 francs par mois, 333 francs par jour.
On sait que le roi était grand mangeur, puisqu'il mangeait à l'Assemblée tandis que l'on tuait les défenseurs du château qu'il venait d'abandonner. Mais enfin, avec 333 francs par jour, cinq personnes ne meurent pas de faim.
Les gens que l'on retrouva fous ou hébétés à la Bastille, ne se rappelant même pas leur nom, avaient dû être plus mal nourris que ceux-là.
Toute la promenade du roi se composait de terrains secs et nus, avec des compartiments de gazons flétris et quelques arbres brûlés au soleil de l'été ou effeuillés au vent d'automne! Il s'y promenait avec sa sœur, sa femme et ses enfants.
Mais Latude, qui resta trente ans dans les cachots de la Bastille, eût regardé comme une grande faveur de faire une pareille promenade une fois tous les huit jours.
Mais Pellisson, qui dans les mêmes cachots n'avait pour distraction qu'une araignée que son geôlier lui écrasa, à qui on enleva l'encre et le papier, qui écrivit avec le plomb de ses vitres sur les marges de ses livres, mais Pellisson, que le grand roi tint cinq ans en prison, n'avait ni la table ni la promenade de Louis XVI.
Mais ce Silvio Pellico, brûlé par les plombs et dévoré par les moustiques de Venise; mais cet Andryane qui laissait une de ses jambes gangrenées aux chaînes de son cachot, avaient-ils pour satisfaire leur appétit un dîner à trois services et un carré de terre pour se promener?
Ce n'étaient pas des rois, je le sais bien, mais c'étaient des hommes; aujourd'hui qu'on sait qu'un roi n'est qu'un homme, je demande la même justice pour eux, la même haine pour leurs bourreaux que s'ils eussent été rois.
Nous avons employé tout ce chapitre à tracer le travail sourd qui se faisait non seulement dans toute la France, mais à Paris, pour séparer la miséricordieuse Gironde de l'inexorable Montagne.
Seulement, la réaction, au lieu d'amener la pitié, amena la Terreur.
Veut-on savoir où la réaction était arrivée? – Lisons ces quelques lignes de Michelet, – puissent-elles donner à la France entière l'idée de lire les autres!
«À la Noël de 92, il y eut un spectacle étonnant à Saint-Étienne-du-Mont; la foule y fut telle que plus de mille personnes restèrent à la porte et ne purent entrer.
»Chose triste que tout le travail de la Révolution aboutît à remplir les églises. Désertes en 88, elles sont pleines en 92, pleines d'un peuple qui prie contre la Révolution, c'est-à-dire contre la victoire du peuple.»
Ce fut ce qui détermina Danton à faire une dernière tentative pour rapprocher la Montagne et la Gironde.