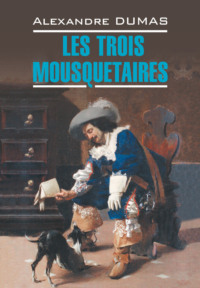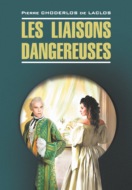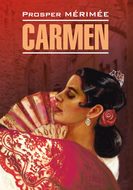Kitabı oku: «Les Trois Mousquetaires / Три мушкетера», sayfa 8
IX. D’Artagnan se dessine
Comme l’avaient prévu Athos et Porthos, au bout d’une demi-heure d’Artagnan rentra. Cette fois encore il avait manqué son homme, qui avait disparu comme par enchantement. D’Artagnan avait couru, l’épée à la main, toutes les rues environnantes, mais il n’avait rien trouvé qui ressemblât à celui qu’il cherchait, puis enfin il en était revenu à la chose par laquelle il aurait dû commencer peut-être, et qui était de frapper à la porte contre laquelle l’inconnu était appuyé ; mais c’était inutilement qu’il avait dix ou douze fois de suite fait résonner le marteau, personne n’avait répondu, et des voisins qui, attirés par le bruit, étaient accourus sur le seuil de leur porte ou avaient mis le nez à leurs fenêtres, lui avaient assuré que cette maison, dont au reste toutes les ouvertures étaient closes, était depuis six mois complètement inhabitée.
Pendant que d’Artagnan courait les rues et frappait aux portes, Aramis avait rejoint ses deux compagnons, de sorte qu’en revenant chez lui, d’Artagnan trouva la réunion au grand complet.
« Eh bien ? dirent ensemble les trois mousquetaires en voyant entrer d’Artagnan, la sueur sur le front et la figure bouleversée par la colère.
– Eh bien, s’écria celui-ci en jetant son épée sur le lit, il faut que cet homme soit le diable en personne ; il a disparu comme un fantôme, comme une ombre, comme un spectre.
– Croyez-vous aux apparitions ? demanda Athos à Porthos.
– Moi, je ne crois que ce que j’ai vu, et comme je n’ai jamais vu d’apparitions, je n’y crois pas.
– La Bible, dit Aramis, nous fait une loi d’y croire : l’ombre de Samuel apparut à Saül, et c’est un article de foi que je serais fâché de voir mettre en doute, Porthos.
– Dans tous les cas, homme ou diable, corps ou ombre, illusion ou réalité, cet homme est né pour ma damnation, car sa fuite nous fait manquer une affaire superbe, messieurs, une affaire dans laquelle il y avait cent pistoles et peut-être plus à gagner.
– Comment cela ? » dirent à la fois Porthos et Aramis.
Quant à Athos, fidèle à son système de mutisme, il se contenta d’interroger d’Artagnan du regard.
« Planchet, dit d’Artagnan à son domestique, qui passait en ce moment la tête par la porte entrebâillée pour tâcher de surprendre quelques bribes de la conversation, descendez chez mon propriétaire, M. Bonacieux, et dites-lui de nous envoyer une demi-douzaine de bouteilles de vin de Beaugency : c’est celui que je préfère.
– Ah çà, mais vous avez donc crédit ouvert chez votre propriétaire ? demanda Porthos.
– Oui, répondit d’Artagnan, à compter d’aujourd’hui, et soyez tranquilles, si son vin est mauvais, nous lui en enverrons quérir d’autre.
– Il faut user et non abuser, dit sentencieusement Aramis.
– J’ai toujours dit que d’Artagnan était la forte tête de nous quatre, fit Athos, qui, après avoir émis cette opinion à laquelle d’Artagnan répondit par un salut, retomba aussitôt dans son silence accoutumé.
– Mais enfin, voyons, qu’y a-t-il ? demanda Porthos.
– Oui, dit Aramis, confiez-nous cela, mon cher ami, à moins que l’honneur de quelque dame ne se trouve intéressé à cette confidence, à ce quel cas vous feriez mieux de la garder pour vous.
– Soyez tranquilles, répondit d’Artagnan, l’honneur de personne n’aura à se plaindre de ce que j’ai à vous dire. »
Et alors il raconta mot à mot à ses amis ce qui venait de se passer entre lui et son hôte, et comment l’homme qui avait enlevé la femme du digne propriétaire était le même avec lequel il avait eu maille à partir à l’hôtellerie du Franc Meunier.
« Votre affaire n’est pas mauvaise, dit Athos après avoir goûté le vin en connaisseur et indiqué d’un signe de tête qu’il le trouvait bon, et l’on pourra tirer de ce brave homme cinquante à soixante pistoles. Maintenant, reste à savoir si cinquante à soixante pistoles valent la peine de risquer quatre têtes.
– Mais faites attention, s’écria d’Artagnan qu’il y a une femme dans cette affaire, une femme enlevée, une femme qu’on menace sans doute, qu’on torture peut-être, et tout cela parce qu’elle est fidèle à sa maîtresse !
– Prenez garde, d’Artagnan, prenez garde, dit Aramis, vous vous échauffez un peu trop, à mon avis, sur le sort de Mme Bonacieux. La femme a été créée pour notre perte, et c’est d’elle que nous viennent toutes nos misères. »
Athos, à cette sentence d’Aramis, fronça le sourcil et se mordit les lèvres.
« Ce n’est point de Mme Bonacieux que je m’inquiète, s’écria d’Artagnan, mais de la reine, que le roi abandonne, que le cardinal persécute, et qui voit tomber, les unes après les autres, les têtes de tous ses amis.
– Pourquoi aime-t-elle ce que nous détestons le plus au monde, les Espagnols et les Anglais ?
– L’Espagne est sa patrie, répondit d’Artagnan, et il est tout simple qu’elle aime les Espagnols, qui sont enfants de la même terre qu’elle. Quant au second reproche que vous lui faites, j’ai entendu dire qu’elle aimait non pas les Anglais, mais un Anglais.
– Eh ! ma foi, dit Athos, il faut avouer que cet Anglais était bien digne d’être aimé. Je n’ai jamais vu un plus grand air que le sien.
– Sans compter qu’il s’habille comme personne, dit Porthos. J’étais au Louvre le jour où il a semé ses perles, et pardieu ! j’en ai ramassé deux que j’ai bien vendues dix pistoles pièce. Et toi, Aramis, le connais-tu ?
– Aussi bien que vous, messieurs, car j’étais de ceux qui l’ont arrêté dans le jardin d’Amiens, où m’avait introduit M. de Putange, l’écuyer de la reine. J’étais au séminaire à cette époque, et l’aventure me parut cruelle pour le roi.
– Ce qui ne m’empêcherait pas, dit d’Artagnan, si je savais où est le duc de Buckingham, de le prendre par la main et de le conduire près de la reine, ne fût-ce que pour faire enrager M. le cardinal ; car notre véritable, notre seul, notre éternel ennemi, messieurs, c’est le cardinal, et si nous pouvions trouver moyen de lui jouer quelque tour bien cruel, j’avoue que j’y engagerais volontiers ma tête.
– Et, reprit Athos, le mercier vous a dit, d’Artagnan, que la reine pensait qu’on avait fait venir Buckingham sur un faux avis ?
– Elle en a peur.
– Attendez donc, dit Aramis.
– Quoi ? demanda Porthos.
– Allez toujours, je cherche à me rappeler des circonstances.
– Et maintenant je suis convaincu, dit d’Artagnan, que l’enlèvement de cette femme de la reine se rattache aux événements dont nous parlons, et peut-être à la présence de M. de Buckingham à Paris.
– Le Gascon est plein d’idées, dit Porthos avec admiration.
– J’aime beaucoup l’entendre parler, dit Athos, son patois m’amuse.
– Messieurs, reprit Aramis, écoutez ceci.
– Écoutons Aramis, dirent les trois amis.
– Hier je me trouvais chez un savant docteur en théologie que je consulte quelquefois pour mes études… »
Athos sourit.
« Il habite un quartier désert, continua Aramis : ses goûts, sa profession l’exigent. Or, au moment où je sortais de chez lui… »
Ici Aramis s’arrêta.
« Eh bien ? demandèrent ses auditeurs, au moment où vous sortiez de chez lui ? »
Aramis parut faire un effort sur lui-même, comme un homme qui, en plein courant de mensonge, se voit arrêter par quelque obstacle imprévu ; mais les yeux de ses trois compagnons étaient fixés sur lui, leurs oreilles attendaient béantes, il n’y avait pas moyen de reculer.
« Ce docteur a une nièce, continua Aramis.
– Ah ! il a une nièce ! interrompit Porthos.
– Dame fort respectable », dit Aramis.
Les trois amis se mirent à rire.
« Ah ! si vous riez ou si vous doutez, reprit Aramis, vous ne saurez rien.
– Nous sommes croyants comme des mahométistes et muets comme des catafalques, dit Athos.
– Je continue donc, reprit Aramis. Cette nièce vient quelquefois voir son oncle ; or elle s’y trouvait hier en même temps que moi, par hasard, et je dus m’offrir pour la conduire à son carrosse.
– Ah ! elle a un carrosse, la nièce du docteur ? interrompit Porthos, dont un des défauts était une grande incontinence de langue ; belle connaissance, mon ami.
– Porthos, reprit Aramis, je vous ai déjà fait observer plus d’une fois que vous êtes fort indiscret, et que cela vous nuit près des femmes.
– Messieurs, messieurs, s’écria d’Artagnan, qui entrevoyait le fond de l’aventure, la chose est sérieuse ; tâchons donc de ne pas plaisanter si nous pouvons. Allez, Aramis, allez.
– Tout à coup, un homme grand, brun, aux manières de gentilhomme…, tenez, dans le genre du vôtre, d’Artagnan.
– Le même peut-être, dit celui-ci.
– C’est possible, continua Aramis,… s’approcha de moi, accompagné de cinq ou six hommes qui le suivaient à dix pas en arrière, et du ton le plus poli : “Monsieur le duc, me dit-il, et vous, madame”, continua-t-il en s’adressant à la dame que j’avais sous le bras…
– À la nièce du docteur ?
– Silence donc, Porthos ! dit Athos, vous êtes insupportable.
– Veuillez monter dans ce carrosse, et cela sans essayer la moindre résistance, sans faire le moindre bruit. »
– Il vous avait pris pour Buckingham ! s’écria d’Artagnan.
– Je le crois, répondit Aramis.
– Mais cette dame ? demanda Porthos.
– Il l’avait prise pour la reine ! dit d’Artagnan.
– Justement, répondit Aramis.
– Le Gascon est le diable ! s’écria Athos, rien ne lui échappe.
– Le fait est, dit Porthos, qu’Aramis est de la taille et a quelque chose de la tournure du beau duc ; mais cependant, il me semble que l’habit de mousquetaire…
– J’avais un manteau énorme, dit Aramis.
– Au mois de juillet, diable ! fit Porthos, est-ce que le docteur craint que tu ne sois reconnu ?
– Je comprends encore, dit Athos, que l’espion se soit laissé prendre par la tournure ; mais le visage…
– J’avais un grand chapeau, dit Aramis.
– Oh ! mon Dieu, s’écria Porthos, que de précautions pour étudier la théologie !
– Messieurs, messieurs, dit d’Artagnan, ne perdons pas notre temps à badiner ; éparpillons-nous et cherchons la femme du mercier, c’est la clef de l’intrigue.
– Une femme de condition si inférieure ! vous croyez, d’Artagnan ? fit Porthos en allongeant les lèvres avec mépris.
– C’est la filleule de La Porte, le valet de confiance de la reine. Ne vous l’ai-je pas dit, messieurs ? Et d’ailleurs, c’est peut-être un calcul de Sa Majesté d’avoir été, cette fois, chercher ses appuis si bas. Les hautes têtes se voient de loin, et le cardinal a bonne vue.
– Eh bien, dit Porthos, faites d’abord prix avec le mercier, et bon prix.
– C’est inutile, dit d’Artagnan, car je crois que s’il ne nous paie pas, nous serons assez payés d’un autre côté. »
En ce moment, un bruit précipité de pas retentit dans l’escalier, la porte s’ouvrit avec fracas, et le malheureux mercier s’élança dans la chambre où se tenait le conseil.
« Ah ! messieurs, s’écria-t-il, sauvez-moi, au nom du Ciel, sauvez- moi ! Il y a quatre hommes qui viennent pour m’arrêter ; sauvez-moi, sauvez-moi ! »
Porthos et Aramis se levèrent.
« Un moment, s’écria d’Artagnan en leur faisant signe de repousser au fourreau leurs épées à demi tirées ; un moment, ce n’est pas du courage qu’il faut ici, c’est de la prudence.
– Cependant, s’écria Porthos, nous ne laisserons pas…
– Vous laisserez faire d’Artagnan, dit Athos, c’est, je le répète, la forte tête de nous tous, et moi, pour mon compte, je déclare que je lui obéis. Fais ce que tu voudras, d’Artagnan. »
En ce moment, les quatre gardes apparurent à la porte de l’antichambre, et voyant quatre mousquetaires debout et l’épée au côté, hésitèrent à aller plus loin.
« Entrez, messieurs, entrez, cria d’Artagnan ; vous êtes ici chez moi, et nous sommes tous de fidèles serviteurs du roi et de M. le cardinal.
– Alors, messieurs, vous ne vous opposerez pas à ce que nous exécutions les ordres que nous avons reçus ? demanda celui qui paraissait le chef de l’escouade.
– Au contraire, messieurs, et nous vous prêterions main-forte, si besoin était.
– Mais que dit-il donc ? marmotta Porthos.
– Tu es un niais, dit Athos, silence !
– Mais vous m’avez promis…, dit tout bas le pauvre mercier.
– Nous ne pouvons vous sauver qu’en restant libres, répondit rapidement et tout bas d’Artagnan, et si nous faisons mine de vous défendre, on nous arrête avec vous.
– Il me semble, cependant…
– Venez, messieurs, venez, dit tout haut d’Artagnan ; je n’ai aucun motif de défendre monsieur. Je l’ai vu aujourd’hui pour la première fois, et encore à quelle occasion, il vous le dira lui-même, pour me venir réclamer le prix de mon loyer. Est-ce vrai, monsieur Bonacieux ? Répondez !
– C’est la vérité pure, s’écria le mercier, mais monsieur ne vous dit pas…
– Silence sur moi, silence sur mes amis, silence sur la reine surtout, ou vous perdriez tout le monde sans vous sauver. Allez, allez, messieurs, emmenez cet homme ! »
Et d’Artagnan poussa le mercier tout étourdi aux mains des gardes, en lui disant :
« Vous êtes un maraud, mon cher ; vous venez me demander de l’argent, à moi ! à un mousquetaire ! En prison, messieurs, encore une fois, emmenez-le en prison et gardez-le sous clef le plus longtemps possible, cela me donnera du temps pour payer. »
Les sbires se confondirent en remerciements et emmenèrent leur proie.
Au moment où ils descendaient, d’Artagnan frappa sur l’épaule du chef :
« Ne boirai-je pas à votre santé et vous à la mienne ? dit-il, en remplissant deux verres du vin de Beaugency qu’il tenait de la libéralité de M. Bonacieux.
– Ce sera bien de l’honneur pour moi, dit le chef des sbires, et j’accepte avec reconnaissance.
– Donc, à la vôtre, monsieur… comment vous nommez-vous ?
– Boisrenard.
– Monsieur Boisrenard !
– À la vôtre, mon gentilhomme : comment vous nommez-vous, à votre tour, s’il vous plaît ?
– D’Artagnan.
– À la vôtre, monsieur d’Artagnan !
– Et par-dessus toutes celles-là, s’écria d’Artagnan comme emporté par son enthousiasme, à celle du roi et du cardinal. »
Le chef des sbires eût peut-être douté de la sincérité de d’Artagnan, si le vin eût été mauvais ; mais le vin était bon, il fut convaincu.
« Mais quelle diable de vilenie avez-vous donc faite là ? dit Porthos lorsque l’alguazil en chef eut rejoint ses compagnons, et que les quatre amis se retrouvèrent seuls. Fi donc ! quatre mousquetaires laisser arrêter au milieu d’eux un malheureux qui crie à l’aide ! Un gentilhomme trinquer avec un recors !
– Porthos, dit Aramis, Athos t’a déjà prévenu que tu étais un niais, et je me range de son avis. D’Artagnan, tu es un grand homme, et quand tu seras à la place de M. de Tréville, je te demande ta protection pour me faire avoir une abbaye.
– Ah çà, je m’y perds, dit Porthos, vous approuvez ce que d’Artagnan vient de faire ?
– Je le crois parbleu bien, dit Athos ; non seulement j’approuve ce qu’il vient de faire, mais encore je l’en félicite.
– Et maintenant, messieurs, dit d’Artagnan sans se donner la peine d’expliquer sa conduite à Porthos, tous pour un, un pour tous, c’est notre devise, n’est-ce pas ?
– Cependant… dit Porthos.
– Étends la main et jure ! » s’écrièrent à la fois Athos et Aramis.
Vaincu par l’exemple, maugréant tout bas, Porthos étendit la main, et les quatre amis répétèrent d’une seule voix la formule dictée par d’Artagnan :
« Tous pour un, un pour tous. »
« C’est bien, que chacun se retire maintenant chez soi, dit d’Artagnan comme s’il n’avait fait autre chose que de commander toute sa vie, et attention, car à partir de ce moment, nous voilà aux prises avec le cardinal. »
X. Une souricière au XVIIe siècle
L’invention de la souricière ne date pas de nos jours ; dès que les sociétés, en se formant, eurent inventé une police quelconque, cette police, à son tour, inventa les souricières.
Comme peut-être nos lecteurs ne sont pas familiarisés encore avec l’argot de la rue de Jérusalem, et que c’est, depuis que nous écrivons – et il y a quelque quinze ans de cela —, la première fois que nous employons ce mot appliqué à cette chose, expliquons-leur ce que c’est qu’une souricière.
Quand, dans une maison quelle qu’elle soit, on a arrêté un individu soupçonné d’un crime quelconque, on tient secrète l’arrestation ; on place quatre ou cinq hommes en embuscade dans la première pièce, on ouvre la porte à tous ceux qui frappent, on la referme sur eux et on les arrête ; de cette façon, au bout de deux ou trois jours, on tient à peu près tous les familiers de l’établissement.
Voilà ce que c’est qu’une souricière.
On fit donc une souricière de l’appartement de maître Bonacieux, et quiconque y apparut fut pris et interrogé par les gens de M. le cardinal. Il va sans dire que, comme une allée particulière conduisait au premier étage qu’habitait d’Artagnan, ceux qui venaient chez lui étaient exemptés de toutes visites.
D’ailleurs les trois mousquetaires y venaient seuls ; ils s’étaient mis en quête chacun de son côté, et n’avaient rien trouvé, rien découvert. Athos avait été même jusqu’à questionner M. de Tréville, chose qui, vu le mutisme habituel du digne mousquetaire, avait fort étonné son capitaine. Mais M. de Tréville ne savait rien, sinon que, la dernière fois qu’il avait vu le cardinal, le roi et la reine, le cardinal avait l’air fort soucieux, que le roi était inquiet, et que les yeux rouges de la reine indiquaient qu’elle avait veillé ou pleuré. Mais cette dernière circonstance l’avait peu frappé, la reine, depuis son mariage, veillant et pleurant beaucoup.
M. de Tréville recommanda en tout cas à Athos le service du roi et surtout celui de la reine, le priant de faire la même recommandation à ses camarades.
Quant à d’Artagnan, il ne bougeait pas de chez lui. Il avait converti sa chambre en observatoire. Des fenêtres il voyait arriver ceux qui venaient se faire prendre ; puis, comme il avait ôté les carreaux du plancher, qu’il avait creusé le parquet et qu’un simple plafond le séparait de la chambre au-dessous, où se faisaient les interrogatoires, il entendait tout ce qui se passait entre les inquisiteurs et les accusés.
Les interrogatoires, précédés d’une perquisition minutieuse opérée sur la personne arrêtée, étaient presque toujours ainsi conçus :
« Mme Bonacieux vous a-t-elle remis quelque chose pour son mari ou pour quelque autre personne ?
– M. Bonacieux vous a-t-il remis quelque chose pour sa femme ou pour quelque autre personne ?
– L’un et l’autre vous ont-ils fait quelque confidence de vive voix ? »
« S’ils savaient quelque chose, ils ne questionneraient pas ainsi, se dit à lui-même d’Artagnan. Maintenant, que cherchent-ils à savoir ? Si le duc de Buckingham ne se trouve point à Paris et s’il n’a pas eu ou s’il ne doit point avoir quelque entrevue avec la reine. »
D’Artagnan s’arrêta à cette idée, qui, d’après tout ce qu’il avait entendu, ne manquait pas de probabilité.
En attendant, la souricière était en permanence, et la vigilance de d’Artagnan aussi.
Le soir du lendemain de l’arrestation du pauvre Bonacieux, comme Athos venait de quitter d’Artagnan pour se rendre chez M. de Tréville, comme neuf heures venaient de sonner, et comme Planchet, qui n’avait pas encore fait le lit, commençait sa besogne, on entendit frapper à la porte de la rue ; aussitôt cette porte s’ouvrit et se referma : quelqu’un venait de se prendre à la souricière.
D’Artagnan s’élança vers l’endroit décarrelé, se coucha ventre à terre et écouta.
Des cris retentirent bientôt, puis des gémissements qu’on cherchait à étouffer. D’interrogatoire, il n’en était pas question.
« Diable ! se dit d’Artagnan, il me semble que c’est une femme : on la fouille, elle résiste, – on la violente, – les misérables ! »
Et d’Artagnan, malgré sa prudence, se tenait à quatre pour ne pas se mêler à la scène qui se passait au-dessous de lui.
« Mais je vous dis que je suis la maîtresse de la maison, messieurs ; je vous dis que je suis Mme Bonacieux, je vous dis que j’appartiens à la reine ! » s’écriait la malheureuse femme.
« Mme Bonacieux ! murmura d’Artagnan ; serais-je assez heureux pour avoir trouvé ce que tout le monde cherche ? »
« C’est justement vous que nous attendions », reprirent les interrogateurs.
La voix devint de plus en plus étouffée : un mouvement tumultueux fit retentir les boiseries. La victime résistait autant qu’une femme peut résister à quatre hommes.
« Pardon, messieurs, par… », murmura la voix, qui ne fit plus entendre que des sons inarticulés.
« Ils la bâillonnent, ils vont l’entraîner, s’écria d’Artagnan en se redressant comme par un ressort. Mon épée ; bon, elle est à mon côté. Planchet !
– Monsieur ?
– Cours chercher Athos, Porthos et Aramis. L’un des trois sera sûrement chez lui, peut-être tous les trois seront-ils rentrés. Qu’ils prennent des armes, qu’ils viennent, qu’ils accourent. Ah ! je me souviens, Athos est chez M. de Tréville.
– Mais où allez-vous, monsieur, où allez-vous ?
– Je descends par la fenêtre, s’écria d’Artagnan, afin d’être plus tôt arrivé ; toi, remets les carreaux, balaie le plancher, sors par la porte et cours où je te dis.
– Oh ! monsieur, monsieur, vous allez vous tuer, s’écria Planchet.
– Tais-toi, imbécile », dit d’Artagnan. Et s’accrochant de la main au rebord de sa fenêtre, il se laissa tomber du premier étage, qui heureusement n’était pas élevé, sans se faire une écorchure.
Puis il alla aussitôt frapper à la porte en murmurant :
« Je vais me faire prendre à mon tour dans la souricière, et malheur aux chats qui se frotteront à pareille souris. »
À peine le marteau eut-il résonné sous la main du jeune homme, que le tumulte cessa, que des pas s’approchèrent, que la porte s’ouvrit, et que d’Artagnan, l’épée nue, s’élança dans l’appartement de maître Bonacieux, dont la porte, sans doute mue par un ressort, se referma d’elle-même sur lui.
Alors ceux qui habitaient encore la malheureuse maison de Bonacieux et les voisins les plus proches entendirent de grands cris, des trépignements, un cliquetis d’épées et un bruit prolongé de meubles. Puis, un moment après, ceux qui, surpris par ce bruit, s’étaient mis aux fenêtres pour en connaître la cause, purent voir la porte se rouvrir et quatre hommes vêtus de noir non pas en sortir, mais s’envoler comme des corbeaux effarouchés, laissant par terre et aux angles des tables des plumes de leurs ailes, c’est-à-dire des loques de leurs habits et des bribes de leurs manteaux.
D’Artagnan était vainqueur sans beaucoup de peine, il faut le dire, car un seul des alguazils était armé, encore se défendit-il pour la forme. Il est vrai que les trois autres avaient essayé d’assommer le jeune homme avec les chaises, les tabourets et les poteries ; mais deux ou trois égratignures faites par la flamberge du Gascon les avaient épouvantés. Dix minutes avaient suffi à leur défaite et d’Artagnan était resté maître du champ de bataille.
Les voisins, qui avaient ouvert leurs fenêtres avec le sang-froid particulier aux habitants de Paris dans ces temps d’émeutes et de rixes perpétuelles, les refermèrent dès qu’ils eurent vu s’enfuir les quatre hommes noirs : leur instinct leur disait que, pour le moment, tout était fini.
D’ailleurs il se faisait tard, et alors comme aujourd’hui on se couchait de bonne heure dans le quartier du Luxembourg.
D’Artagnan, resté seul avec Mme Bonacieux, se retourna vers elle : la pauvre femme était renversée sur un fauteuil et à demi évanouie. D’Artagnan l’examina d’un coup d’oeil rapide.
C’était une charmante femme de vingt-cinq à vingt-six ans, brune avec des yeux bleus, ayant un nez légèrement retroussé, des dents admirables, un teint marbré de rose et d’opale. Là cependant s’arrêtaient les signes qui pouvaient la faire confondre avec une grande dame. Les mains étaient blanches, mais sans finesse : les pieds n’annonçaient pas la femme de qualité. Heureusement d’Artagnan n’en était pas encore à se préoccuper de ces détails.
Tandis que d’Artagnan examinait Mme Bonacieux, et en était aux pieds, comme nous l’avons dit, il vit à terre un fin mouchoir de batiste, qu’il ramassa selon son habitude, et au coin duquel il reconnut le même chiffre qu’il avait vu au mouchoir qui avait failli lui faire couper la gorge avec Aramis.
Depuis ce temps, d’Artagnan se méfiait des mouchoirs armoriés ; il remit donc sans rien dire celui qu’il avait ramassé dans la poche de Mme Bonacieux. En ce moment, Mme Bonacieux reprenait ses sens. Elle ouvrit les yeux, regarda avec terreur autour d’elle, vit que l’appartement était vide, et qu’elle était seule avec son libérateur. Elle lui tendit aussitôt les mains en souriant. Mme Bonacieux avait le plus charmant sourire du monde.
« Ah ! monsieur ! dit-elle, c’est vous qui m’avez sauvée ; permettez-moi que je vous remercie.
– Madame, dit d’Artagnan, je n’ai fait que ce que tout gentilhomme eût fait à ma place, vous ne me devez donc aucun remerciement.
– Si fait, monsieur, si fait, et j’espère vous prouver que vous n’avez pas rendu service à une ingrate. Mais que me voulaient donc ces hommes, que j’ai pris d’abord pour des voleurs, et pourquoi M. Bonacieux n’est-il point ici ?
– Madame, ces hommes étaient bien autrement dangereux que ne pourraient être des voleurs, car ce sont des agents de M. le cardinal, et quant à votre mari, M. Bonacieux, il n’est point ici parce qu’hier on est venu le prendre pour le conduire à la Bastille.
– Mon mari à la Bastille ! s’écria Mme Bonacieux, oh ! mon Dieu ! qu’a-t-il donc fait ? pauvre cher homme ! lui, l’innocence même ! »
Et quelque chose comme un sourire perçait sur la figure encore tout effrayée de la jeune femme.
« Ce qu’il a fait, madame ? dit d’Artagnan. Je crois que son seul crime est d’avoir à la fois le bonheur et le malheur d’être votre mari.
– Mais, monsieur, vous savez donc…
– Je sais que vous avez été enlevée, madame.
– Et par qui ? Le savez-vous ? Oh ! si vous le savez, dites-le-moi.
– Par un homme de quarante à quarante-cinq ans, aux cheveux noirs, au teint basané, avec une cicatrice à la tempe gauche.
– C’est cela, c’est cela ; mais son nom ?
– Ah ! son nom ? c’est ce que j’ignore.
– Et mon mari savait-il que j’avais été enlevée ?
– Il en avait été prévenu par une lettre que lui avait écrite le ravisseur lui-même.
– Et soupçonne-t-il, demanda Mme Bonacieux avec embarras, la cause de cet événement ?
– Il l’attribuait, je crois, à une cause politique.
– J’en ai douté d’abord, et maintenant je le pense comme lui. Ainsi donc, ce cher M. Bonacieux ne m’a pas soupçonnée un seul instant… ?
– Ah ! loin de là, madame, il était trop fier de votre sagesse et surtout de votre amour. »
Un second sourire presque imperceptible effleura les lèvres rosées de la belle jeune femme.
« Mais, continua d’Artagnan, comment vous êtes-vous enfuie ?
– J’ai profité d’un moment où l’on m’a laissée seule, et comme je savais depuis ce matin à quoi m’en tenir sur mon enlèvement, à l’aide de mes draps je suis descendue par la fenêtre ; alors, comme je croyais mon mari ici, je suis accourue.
– Pour vous mettre sous sa protection ?
– Oh ! non, pauvre cher homme, je savais bien qu’il était incapable de me défendre ; mais comme il pouvait nous servir à autre chose, je voulais le prévenir.
– De quoi ?
– Oh ! ceci n’est pas mon secret, je ne puis donc pas vous le dire.
– D’ailleurs, dit d’Artagnan (pardon, madame, si, tout garde que je suis, je vous rappelle à la prudence), d’ailleurs je crois que nous ne sommes pas ici en lieu opportun pour faire des confidences. Les hommes que j’ai mis en fuite vont revenir avec main-forte ; s’ils nous retrouvent ici nous sommes perdus. J’ai bien fait prévenir trois de mes amis, mais qui sait si on les aura trouvés chez eux !
– Oui, oui, vous avez raison, s’écria Mme Bonacieux effrayée ; fuyons, sauvons-nous. »
À ces mots, elle passa son bras sous celui de d’Artagnan et l’entraîna vivement.
« Mais où fuir ? dit d’Artagnan, où nous sauver ?
– Éloignons-nous d’abord de cette maison, puis après nous verrons. »
Et la jeune femme et le jeune homme, sans se donner la peine de refermer la porte, descendirent rapidement la rue des Fossoyeurs, s’engagèrent dans la rue des Fossés-Monsieur-le-Prince et ne s’arrêtèrent qu’à la place Saint-Sulpice.
« Et maintenant, qu’allons-nous faire, demanda d’Artagnan, et où voulez-vous que je vous conduise ?
– Je suis fort embarrassée de vous répondre, je vous l’avoue, dit Mme Bonacieux ; mon intention était de faire prévenir M. de La Porte par mon mari, afin que M. de La Porte pût nous dire précisément ce qui s’était passé au Louvre depuis trois jours, et s’il n’y avait pas danger pour moi de m’y présenter.
– Mais moi, dit d’Artagnan, je puis aller prévenir M. de La Porte.
– Sans doute ; seulement il n’y a qu’un malheur : c’est qu’on connaît M. Bonacieux au Louvre et qu’on le laisserait passer, lui, tandis qu’on ne vous connaît pas, vous, et que l’on vous fermera la porte.
– Ah ! bah, dit d’Artagnan, vous avez bien à quelque guichet du Louvre un concierge qui vous est dévoué, et qui grâce à un mot d’ordre… »
Mme Bonacieux regarda fixement le jeune homme.
« Et si je vous donnais ce mot d’ordre, dit-elle, l’oublieriez-vous aussitôt que vous vous en seriez servi ?
– Parole d’honneur, foi de gentilhomme ! dit d’Artagnan avec un accent à la vérité duquel il n’y avait pas à se tromper.
– Tenez, je vous crois ; vous avez l’air d’un brave jeune homme, d’ailleurs votre fortune est peut-être au bout de votre dévouement.
– Je ferai sans promesse et de conscience tout ce que je pourrai pour servir le roi et être agréable à la reine, dit d’Artagnan ; disposez donc de moi comme d’un ami.
– Mais moi, où me mettrez-vous pendant ce temps-là ?
– N’avez-vous pas une personne chez laquelle M. de La Porte puisse revenir vous prendre ?
– Non, je ne veux me fier à personne.
– Attendez, dit d’Artagnan ; nous sommes à la porte d’Athos. Oui, c’est cela.
– Qu’est-ce qu’Athos ?
– Un de mes amis.
– Mais s’il est chez lui et qu’il me voie ?
– Il n’y est pas, et j’emporterai la clef après vous avoir fait entrer dans son appartement.
– Mais s’il revient ?
– Il ne reviendra pas ; d’ailleurs on lui dirait que j’ai amené une femme, et que cette femme est chez lui.
– Mais cela me compromettra très fort, savez-vous !
– Que vous importe ! on ne vous connaît pas ; d’ailleurs nous sommes dans une situation à passer par-dessus quelques convenances !
– Allons donc chez votre ami. Où demeure-t-il ?
– Rue Férou, à deux pas d’ici.
– Allons. »
Et tous deux reprirent leur course. Comme l’avait prévu d’Artagnan, Athos n’était pas chez lui : il prit la clef, qu’on avait l’habitude de lui donner comme à un ami de la maison, monta l’escalier et introduisit Mme Bonacieux dans le petit appartement dont nous avons déjà fait la description.