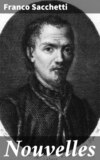Kitabı oku: «Curiosa», sayfa 9
XX
LE HASARD
DU COIN DU FEU
PAR CRÉBILLON FILS64
On n’édite guère la Nuit et le Moment sans l’accompagner du Hasard du Coin du feu; ce sont deux compositions du même genre, qu’on ne sépare pas l’une de l’autre: elles sont destinées à se faire pendant, quoique écrites par l’auteur à près de dix ans de distance (1755-1763). Avec ces deux petits romans dialogués, on a, comme le dit très bien Ch. Monselet, le Théâtre complet de Crébillon fils. «Ne souriez pas,» ajoute-t-il, «ce théâtre-là en vaut bien d’autres. Dans la Nuit et le moment, il n’y a que deux personnages: Clitandre et Cidalise; la scène se passe au petit coucher de cette dernière. On assiste à un siège en règle: quel tacticien que Crébillon! Ainsi qu’on le devine, la place est forcée de se rendre, et, au lendemain matin, Cidalise et Clitandre refont ensemble le lit. Tenez ce dialogue pour un chef-d’œuvre. Les personnages, dans le Hasard du coin du feu, sont au nombre de quatre: le Duc, la Marquise, Célie et La Tour, valet de chambre de Célie. Cette fois il s’agit d’une femme qui se laisse ravir insensiblement les dernières faveurs, sans avoir pu amener son vainqueur à lui dire ces trois mots indispensables: Je vous aime. Comme esprit, comme sous-entendus, comme peinture de mœurs, l’auteur tant vanté du Caprice n’a jamais fait aussi bien. Je dois avouer pourtant que la mise en scène des Proverbes de Crébillon offrirait plusieurs difficultés.» C’est aussi bien notre opinion; l’action, arrivée à une certaine phase, atteint un tel degré d’animation, que le public s’effaroucherait d’une mimique aussi expressive; mais à la lecture on est sous le charme, et le dénouement est si bien préparé, si finement gazé, que personne n’est tenté de jeter le holà.
Un petit point négligé par Ch. Monselet dans la rapidité de son appréciation: la Nuit et le Moment, c’est le siège d’une femme par un homme, avec toutes les roueries, toutes les feintes, toutes les hardiesses de la stratégie amoureuse; le Hasard du coin du feu développe les incidents de la situation contraire: le siège d’un homme par une femme. La stratégie opère en sens inverse et d’une façon peut-être plus délicate encore; car si l’homme ne craint guère de montrer à une femme qu’il la désire, la femme est naturellement plus réservée; son rôle est d’amener tout doucement à ce qu’on s’aperçoive de ce qu’elle ne peut dire et, après être arrivée à son but, d’avoir encore l’air de se faire prier, ou de pousser les cris d’une pauvre victime prise de force. Crébillon a nuancé tout cela avec un art parfait. Célie est laissée seule, au coin du feu, en tête-à-tête avec le Duc, l’amant déclaré de son amie, la Marquise. Le Duc, un causeur étincelant d’esprit, effleure toutes sortes de sujets galants; Célie manœuvre pour faire prendre un tour plus intime à la conversation, qui tantôt s’éloigne, tantôt se rapproche du terrain sur lequel elle voudrait la fixer: une déclaration en bonne forme. Mais le Duc est trop attaché à la Marquise. Toutefois, il n’a pas la sottise de laisser échapper une occasion pareille, et l’originalité de la scène, c’est l’entêtement qu’il met à ne pas donner à Célie une satisfaction très mince, tout en l’accablant de protestations bien plus directes. Avec elle, il entend réduire l’amour à la formule de Chamfort: l’échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. C’était à peu près la formule de tout le monde, au XVIIIe siècle.
Avril 1881.
XXI
LES DIALOGUES
DE LUISA SIGEA65
La supercherie littéraire dont Chorier s’était avisé, pour se mettre à couvert, en attribuant ces Dialogues à Luisa Sigea de Tolède, dont le manuscrit perdu aurait été traduit en Latin par le savant Hollandais Meursius, n’a pas eu un succès de bien longue durée. L’opinion, un moment égarée, n’a pas tardé à faire justice de l’assertion facétieuse qui prêtait à la vertueuse fille d’honneur de Dona Maria de Portugal une si vaste érudition en matière érotique66. On fut un peu plus longtemps à revenir sur le compte de Meursius et, en plein XVIIIe siècle, quelques critiques étrangers attribuaient encore l’Aloysia au laborieux érudit Hollandais. On songea aussi à Isaac Vossius et à Jean Westrène, jurisconsulte de La Haye; mais en France le jour était fait depuis longtemps sur cette question, et de son vivant même Chorier put voir que le masque derrière lequel il s’abritait ne tarderait pas à être arraché. Un passage de ses Mémoires, écrits en Latin, restés longtemps inédits et que la Société de Statistique de l’Isère s’est enfin décidée à publier dans son Bulletin (tome IV, 1846), le montre aux prises à ce sujet d’une manière assez violente avec l’Intendant de justice du Dauphiné, sur la dénonciation d’Étienne Le Camus, évêque de Grenoble.
«Je m’attirai la haine de Le Camus,» dit-il. «Vingt ans auparavant67 la Satire d’Aloysia Sigea, écrite en Latin, d’un style élégant et fleuri, avait vu le jour. Lorsque tout d’abord elle tomba entre les mains des hommes, comme nul n’ignorait que je fusse savant en Latin, je ne sais quels lettrés me soupçonnèrent perfidement et injurieusement d’être l’auteur de cette Satire. Aux yeux de Le Camus, qui veut du mal à tout le monde, sans aucun égard pour les mérites, un soupçon qui n’a pas la moindre importance tient d’ordinaire lieu de preuve complète. Il s’étonnait, disait-il, qu’un pareil livre eût pu être publié impunément; il me désignait tout haut, afin d’exciter contre moi la malveillance. Pour persuader à d’Herbigny68 cette imposture, aussi éloignée de la vérité que les ténèbres le sont de la lumière, il remuait ciel et terre. Je fus trouver d’Herbigny, non pour m’excuser, mais pour repousser l’accusation. Tandis que je lui parle avec la liberté d’un honnête homme et d’un innocent, il m’échappe de lui dire que ceux qui m’accusaient avec tant de fausseté en avaient menti impudemment; je ne croyais pas le choquer en m’exprimant de la sorte. Mais indigné de ce que je ne tiens pas compte de son rang, il s’emporte et ne se contente pas de vociférer, il se met en rage contre moi avec d’autant plus de fureur que je m’efforçais plus soigneusement d’expliquer le mot. Que faire? je me retirai de sa présence. Georges Matelon, de Vienne, supérieur des Capucins de Grenoble, me rapporta du caractère de ces deux personnages beaucoup de traits qui adoucirent mon chagrin. Je me consolai par le témoignage de ma conscience; ne me sentant coupable d’aucune faute, je n’avais à pâlir d’aucune»69.
La conscience de Chorier était beaucoup moins nette qu’il ne se plaît à le dire, et si l’évêque ne put fournir contre lui, à cette époque, des preuves absolument convaincantes, Chorier nous en a laissé assez, dans ses Mémoires, dans la Préface d’une édition nouvelle de l’Aloysia (1678 ou 1679), dans son recueil de Poésies Latines publié à Grenoble en 1680, pour que nous soyons tout à fait édifiés. Les Mémoires, à côté de la dénégation intéressée qu’on vient de lire, contiennent cet aveu précieux, que Chorier, dans sa jeunesse, avait composé deux satires, l’une Ménippée, l’autre Sotadique. La satire Ménippée est perdue, mais la Sotadique est évidemment celle qu’il a publiée sous le nom de Luisa Sigea. Tout en niant comme un beau diable en être l’auteur, il n’était pas fâché de laisser à la postérité des indices auxquels elle pourrait reconnaître la véritable paternité de l’œuvre. Il en a encore fourni d’autres, avec une imprudence dans laquelle on peut très bien voir un calcul. L’édition de 1678 (ou 1679) renferme, outre un septième Dialogue resté vingt ans inédit, deux pièces de vers, De laudibus Aloysiæ et Tuberonis Genethliacon, que Chorier a reconnues siennes en les insérant dans son recueil de Poésies de 1680. Cet indice a été relevé comme suffisamment probant par l’abbé d’Artigny, La Monnoye, Lancelot, etc.; il l’est bien davantage si l’on rapproche le Tuberonis Genethliacon de certain passage de la Préface où les mêmes invectives sont reproduites contre le personnage voilé sous le pseudonyme de Tubero, qui paraît avoir été un ennemi personnel de Chorier. L’importance de cette Préface (Summo viro Aloysia, ex Elysiis hortis) a échappé à tous les critiques; son examen aurait pourtant donné plus de certitude à leurs conjectures.
Si l’on pèse, en effet, avec quelque attention les raisons alléguées jusqu’ici pour faire de Chorier l’auteur incontestable de l’Aloysia, on s’aperçoit que tout ce dont il est atteint et convaincu, c’est d’avoir corrigé les épreuves des Dialogues, veillé à leur exécution typographique, reçu gratuitement un certain nombre d’exemplaires: les choses se seraient passées de même s’il n’eût été que l’éditeur de l’œuvre d’un autre; et, quant aux deux pièces de vers qui sont de lui, elles auraient pu être insérées sans son aveu. En même temps qu’ils ne trouvent contre Chorier que des présomptions si faibles, tous semblent s’être donné le mot pour prétendre que, dans ses autres ouvrages, l’avocat Dauphinois est entièrement dépourvu d’imagination et de style, que son Latin est lourd et pédantesque, sans aucune grâce. «Personne ne soupçonnait Chorier d’écrire si bien en Latin,» dit l’abbé d’Artigny. Les continuateurs de Moréri ont été plus loin encore, en raillant Guy Allard, qui trouvait aux vers de Chorier de la saveur et de la pureté: «Cela fait bien peu d’honneur à son goût,» disaient-ils. Charles Nodier70 s’est sans doute appuyé là-dessus pour émettre fort légèrement l’assertion suivante: «Je suis loin de défendre les mœurs de Chorier, qui lui ont probablement attiré cette méchante imputation» (d’avoir composé l’Aloysia), «mais je connais son style Français et Latin, qui met son innocence à l’abri de tout soupçon de ce genre. Chorier ne manquait pas d’instruction, mais ce serait se moquer que de chercher dans ses écrits de la verve et de l’éloquence, et ce sont les caractères distinctifs de la Latinité néologique et maniérée du faux Meursius.» Qui ne serait trompé, à une affirmation aussi nette? Une chose est cependant certaine pour nous, c’est que Nodier n’avait pas lu deux pages du Latin de Chorier; il s’est imaginé en avoir lu. Sans se livrer à de profondes études comparatives, on reconnaît à première vue dans les écrits Latins de Chorier, y compris l’Aloysia, les mêmes procédés de style, les mêmes tournures, les mêmes périodes Cicéroniennes, le même choix de mots. Si l’Aloysia se trouve avoir plus d’attraits que la Vie de Boissat, les Carmina ou les Mémoires, cela tient uniquement au sujet; l’écrivain, avec ses qualités et ses défauts, reste parfaitement identique à lui-même.
La première édition, parue, comme nous l’avons dit plus haut, vers 1658, ne contenait que six Dialogues: Velitatio, Tribadicon, Fabrica, Duellum, Libidines, Veneres; telle se présenta tout d’abord l’œuvre originale, telle nous la reproduisons, au moins provisoirement. Ce n’est pas que nous contestions l’authenticité du Septième, intitulé Fescennini, que Chorier crut devoir ajouter à l’édition de 1678. Ce supplément, sans faire corps avec l’ouvrage et restant en dehors du plan primitif, est bien de la même main, et l’on pénètre sans difficulté le motif qui en a dicté la composition: il fut imaginé pour que l’on pût attribuer l’ouvrage avec une ombre de vraisemblance à Luisa Sigea, attribution à laquelle Chorier n’avait pas songé d’abord, et dont l’idée ne lui vint qu’après coup. La scène des six premiers Dialogues se place en Italie; les interlocuteurs sont tous des Italiens, des Italiennes; parmi les quelques comparses qui apparaissent çà et là se rencontrent un Français et un Allemand: d’Espagne et d’Espagnols, pas un mot. Il était bien peu naturel à Luisa Sigea de ne jamais parler ni de son pays, ni de ses amis et connaissances, dans une pareille étude de mœurs, où ce que l’on a sous les yeux est ce que l’on peint avec plus de précision. Le Septième Dialogue eut pour but de réparer cette inadvertance; quoique les interlocutrices, Tullia et Ottavia, restent les mêmes, la scène se trouve transportée en Espagne, sans que rien n’explique ce changement à vue, et les maris des deux héroïnes sont métamorphosés en Espagnols pur sang; s’ils ont un voyage à faire, ce n’est plus à Rome ou à Naples, comme dans les premiers Dialogues, c’est à Tarragone. Les anecdotes qui y sont contées fournissent au fameux Louis Vivès, contemporain de Luisa Sigea, l’occasion de jouer un certain rôle; Gonzalve de Cordoue figure à plusieurs reprises dans le récit; les noms des Ponce, des Guzman, des Albuquerque, des Gomez, des Padilla, y reviennent continuellement. Sans doute Chorier avait l’intention de faire subir à tout le reste de l’ouvrage la même transposition de lieux et de personnages, puis il y aura renoncé. Tel qu’il est, ce Supplément se présente avec de nombreuses lacunes; des récits commencés, puis coupés par une interruption, ne sont pas repris: des pages entières manquent. On remarque aussi, entre cette partie et les premières, des contradictions bizarres. Chorier, qui avait peur d’être compromis, a dû laisser exprès imparfait cet appendice: il se réservait ainsi la possibilité de donner au manuscrit un air de vétusté qui le mettait personnellement à l’abri du soupçon. C’était un malin bien capable de prendre une précaution de ce genre, pour le cas où on l’inquiéterait. Ce septième Dialogue a d’ailleurs de l’intérêt, de la variété; les morceaux que l’auteur n’a pas négligé d’achever offrent des peintures d’un charme égal à celui qui est répandu à profusion dans tout le reste; peut-être le donnerons-nous plus tard sous le titre de Supplément.
Il nous faut dire un mot, en terminant, des traductions qui ont précédé celle-ci. La plus ancienne, Aloysia ou Entretiens académiques des dames, 1680, pet. in-12, réimprimée sous les deux titres suivants: Les Sept entretiens satyriques d’Aloysia, Cologne, 1681, et Aloisia ou l’Académie des dames en sept entretiens satyriques, augmentée de nouveau, Cologne, 1693 et 1700, in-12, passe pour être de l’avocat Nicolas, fils du libraire de Grenoble qui aurait édité l’ouvrage Latin71; elle est très mauvaise. Celle que l’on réimprime encore en Belgique, le Meursius Français ou l’Académie des Dames, Amsterdam, 1788, 3 vol. in-18, est réputée meilleure; ce n’est cependant pas une traduction, c’est un travail à côté, fait sur le même sujet, avec des développements autres. Presque partout, le Traducteur a défiguré le dialogue au point de le rendre méconnaissable, intercalé des dissertations et réflexions ineptes, qui n’appartiennent qu’à lui, et des couplets ridicules où nage rime avec large, pour remplacer des citations d’Ovide ou de Lucrèce. Même lorsqu’il a la prétention de suivre le texte, il le paraphrase si lourdement que toute la grâce, toute la saveur de cette Latinité si élégante, si fleurie, se trouve noyée dans un verbiage insipide. Le début du Premier Entretien est, somme toute, la partie qu’il a traitée avec le plus de soin, celle où il s’écarte le moins du texte. La voici, pour qu’elle serve de point de comparaison:
Tullie. Bonjour, Octavie.
Octavie. Votre servante, ma cousine, je suis ravie de vous voir; je pensais présentement à vous.
Tullie. Je viens, ma très chère, me réjouir avec toi de la nouvelle que j’ai apprise de ton mariage avec Pamphile; je te jure, en amie, que j’y prends autant de part que si j’en devais partager le plaisir la première nuit de tes noces. Ah! mon enfant, que tu seras heureuse! Car ta beauté te rend digne des plus tendres caresses d’un mari.
Octavie. Je vous suis fort obligée, ma cousine, de la part que vous prenez à mes intérêts; je n’attendais rien moins de votre amitié et je suis ravie que votre visite nous donne lieu de nous entretenir pleinement sur ce sujet. J’ai appris hier de ma mère que je n’avais plus que deux jours de terme; elle a déjà fait dresser un lit et préparé dans le plus bel appartement de notre maison une chambre et toutes les choses les plus nécessaires pour cette fête. Mais pour vous dire vrai, ma chère Tullie, tout cet appareil me donne plus de crainte qu’il ne me cause de joie, et je ne puis pas même concevoir le plaisir que vous dites que j’en dois recevoir.
Tullie. Ce n’est pas une chose fort surprenante qu’étant tendre et jeune comme tu es, car à peine as-tu atteint ta quinzième année, tu ignores des choses qui m’étaient entièrement inconnues quand je fus mariée, quoique je fusse un peu plus âgée que toi. Angélique me disait assez souvent que je goûterais les plaisirs du monde les plus délicieux; mais, hélas! mon ignorance me rendit insensible à toutes ses paroles.
Octavie. Vous me surprenez, Tullie, et j’ai de la peine à croire ce que vous voulez me persuader de votre ignorance; pensez-vous que je ne sache pas que vous avez toujours passé pour une des filles les plus éclairées de notre sexe? que vous vous êtes rendue savante dans l’histoire et dans les langues étrangères? et que j’ignore que la connaissance des choses les plus cachées de la nature n’a pu échapper à la vivacité de votre esprit?
Tullie. Il est vrai, Octavie, que j’ai une obligation bien particulière à mes parents de ce qu’ils m’ont élevée dans l’étude de tout ce qu’il y a de plus beau et de plus curieux à savoir. J’ai tâché aussi de répondre parfaitement à leur intention; car, bien loin de faire gloire de ma science et de ma beauté, selon la coutume de celles de notre sexe, j’ai évité le faste et la galanterie comme un écueil dangereux, et j’ai fait tous mes efforts pour acquérir seulement la réputation d’une fille sage et honnête.
Octavie. Ceux qui ne veulent point nous flatter disent qu’il n’y a rien de plus rare qu’une femme savante et éclairée qui se conserve dans les bornes de l’honnêteté. Il semble que plus nous recevons de lumière, moins nous avons de vertus, et je me souviens, Tullie, de vous avoir ouï faire des discours sur ce sujet qui ne se ressentaient point de l’affectation que vous venez de faire paraître en décrivant votre conduite. Car, parlons franchement, serait-il bien possible que votre beauté, qui est capable toute seule d’enflammer les cœurs, ne vous eût point fait naître d’occasions de divertissements auxquels vous n’avez pu résister? non, je ne puis me le persuader, puisque votre esprit même suffirait pour engager ceux qui seraient assez aveugles pour être insensibles aux traits de votre visage.
Tullie. Comment! Octavie, où est donc la simplicité de tantôt? Le nom de mariage te faisait peur, et tu parles à présent d’amour, de beauté et de divertissements. Tu sais ce que c’est que d’engager un cœur, et tu as l’esprit assez vif pour découvrir ce que je voulais te dissimuler. Je t’avouerai tout, puisque tu as été assez adroite pour pénétrer les sentiments de mon cœur, je ne veux plus faire de mystères avec toi, je te demande seulement une ingénuité pareille à la mienne et que la confidence que tu me donneras dans tes amitiés soit sincère.
Octavie. Ah! Tullie, qu’une fille amoureuse a de peine à cacher au dehors ce qui se passe au dedans d’elle-même! Vous avez beau déguiser vos paroles, je vois dans vos yeux les mouvements de votre âme, et la sympathie qui est entre ces deux parties m’en a fait connaître la vérité. Soyez donc une autre fois plus sincère et plus véritable, et n’abusez pas de la crédulité d’une jeune fille comme moi. Si vous le demandez, je vous ouvrirai mon cœur comme à ma plus intime; et afin que vous n’en doutiez pas, je vais vous en donner des preuves par le récit de ce qui s’est passé entre Pamphile et moi… etc., etc.
Si de temps à autre on ne rencontrait, comme point de repère, une phrase à peu près rendue, on croirait à peine que le Traducteur avait sous les yeux le même texte que nous. En poursuivant la lecture, on fait les découvertes les plus imprévues. A certain moment, Octavie interrompt le récit que lui fait Tullie en s’écriant: «C’est assurément qu’il avait le feu au derrière et qu’il ne pouvait l’éteindre que par son secours;» on cherche dans le Latin, et on s’aperçoit que cette gentillesse est toute de l’invention du Traducteur; Tullia poursuit son récit, sans qu’Ottavia l’interrompe. Dans le Colloquium IV, Ottavia suggère à Tullia cette objection: «Sed dixisti tunc non alte tibi infixum fuisse Calliæ mucronem?» Traduction: «Ah! le pauvre enfant, qu’il avait de peine!» On relèverait un millier de traits aussi réjouissants. Cependant ces inepties s’achètent, et ceux qui se les procurent à prix d’or s’imaginent savourer enfin le Meursius, ce livre si célèbre, le chef-d’œuvre du genre. C’est le cas de le répéter: il n’y a que la foi qui sauve.
Mai 1881.