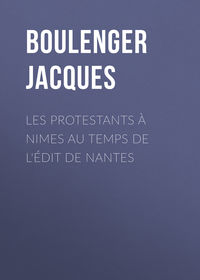Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Les protestants à Nimes au temps de l'édit de Nantes», sayfa 3
III
LES FINANCES DU CONSISTOIRE
Les comptes du «receveur des deniers de l’église» et du «receveur des deniers des pauvres».
Deniers des pauvres: Recettes. Qui on assiste. Secours en nature. Tableau des secours délivrés par le consistoire de Nîmes entre janvier et mars 1596. Visites de charité. Surveillance de l’hôpital des pauvres.
Deniers de l’église: Dépenses. Recettes: les imposés; la levée des rôles. Églises «ingrates». Pension payée à l’église par la ville.
Il reste maintenant à étudier les finances du consistoire de Nîmes et à montrer quels étaient ses revenus. Il lui en fallait d’importants pour subvenir aux dépenses qui lui étaient imposées: entretien des pasteurs et des proposants, gages de l’avertisseur et des autres fonctionnaires, aumônes, pensions aux nouveaux convertis, enfin dépenses des synodes et colloques, car chaque église doit solder les frais de ses députations aux assemblées ecclésiastiques. En matière de finances, comme en tout le reste, ce sont les consistoires qui forment la base de l’édifice protestant: sans leur argent, pas d’assemblées, et toute la hiérarchie du parti se trouve désagrégée.
A Nîmes, le budget de l’église se divise en deux parts distinctes: les «deniers de l’église» et les «deniers des pauvres».
Chacune a son «receveur», son banquier, choisi chaque année parmi les membres du consistoire, le plus souvent un ancien267. Une délibération du 31 janvier 1601 montre que le receveur des deniers du ministère touchait à cette époque des gages de 100 l.; mais c’est le seul renseignement que j’aie trouvé sur ce point268.
Les receveurs ne devaient délivrer aucune somme que sur la présentation de «mandements», tirés sur eux par les anciens269. Et à l’expiration de leur charge, chaque année, il fallait qu’ils rendissent compte de leur gestion devant une commission nommée par le consistoire270.
Le «receveur des deniers de l’église» à Nîmes présentait: 1o les pièces justificatives de ses comptes, comprenant, d’une part, les mandements tirés sur lui, et d’autre part, les quittances de ses payements, avec leur bordereau271; 2o le «livre des quitances des paiements de nos pasteurs…», comprenant les quittances des pasteurs, proposants et autres salariés du consistoire, qui était en quelque sorte la mise au net des pièces précédentes, dont il ne comprenait pas le détail272; 3o un registre contenant les noms des imposés pour l’entretien des ministres, avec le chiffre de leurs taxes, et une liasse renfermant toutes les pièces relatives au recouvrement de ces impositions273.
Le receveur des deniers des pauvres avait des comptes moins compliqués: il ne présentait que les mandements tirés sur lui et les quittances de ses paiements avec leur bordereau274. La commission déléguée par le consistoire vérifiait tous ces comptes et en donnait aux deux receveurs une «décharge» qu’elle inscrivait sur un autre registre spécial275, et qu’on mentionnait souvent dans le livre du consistoire276. Puis les comptes étaient renfermés dans un coffre et formaient les archives de l’église277.
J’ai dit que les deniers des pauvres étaient tout à fait distincts des deniers de l’église. Il arrive, en effet, qu’on fasse procès aux «povres de l’église278», dont les revenus provenaient soit de legs testamentaires, soit de quêtes faites par les diacres.
Les legs étaient assez fréquents et variaient beaucoup; je n’en ai pas trouvé, néanmoins, de considérables: en 1598, un conseiller au présidial, Antoine de Malmont, lègue 20 l., et le baile de Saint-Jean de Valeriscle 25 l. aux pauvres de Nîmes279. En revanche, il y en a un grand nombre de peu d’importance: voici, par exemple, à Congeniès, un laboureur qui laisse 30 sols280; l’hôte du logis des Arènes à Nîmes, Armand Gaubin, ne destine aux indigents que 10 sols281, et, même, un certain Jacques Malafosse, de Congeniès, ne leur en donne pas plus de 5282. Ce ne sont pas d’ailleurs ces «légatz pies» qui forment la plus grosse part du revenu des pauvres, et heureusement, car ils ne doivent pas être fort exactement payés, s’il arrive fréquemment, comme en 1597, que les magistrats se permettent d’en disposer283. Au reste, une partie des legs est consacrée à l’entretien des pasteurs, et ainsi les pauvres n’ont pas le bénéfice de toute la charité des testateurs284.
Les quêtes faites par les anciens et les diacres formaient leur principale ressource. Il n’y a que fort peu de renseignements sur ce point. On faisait la quête au temple dans un «bassin285». En outre, on plaçait des troncs «aux» boutiques des marchands, et on les visitait, ce semble, au commencement de chaque année286. Enfin, tous les ans, on réunissait les objets perdus dans le temple et non réclamés, on les vendait, et l’on en versait le produit au bassin: en 1596, on retire ainsi 2 l. 14 sols, et en 1601, 2 l. 16 sols287.
Ces quêtes étaient les vraies ressources des pauvres. Elles devaient fournir parfois des sommes importantes. Le synode national de Montauban, en 1594, décide que, lorsqu’il se trouvera une somme notable des deniers des pauvres «que l’urgente nécessité n’obligera pas d’emploier pour leur subvention, les diacres, par l’avis du consistoire, pourront en faire quelque prêt à des gens solvables pour faire valoir cet argent à la plus grande utilité des pauvres… à la charge qu’on le puisse retirer promptement en cas de nécessité288». C’était là une permission assez dangereuse, mais ces spéculations paraissaient si séduisantes que, le synode national de Saumur les ayant interdites en 1596289, celui de Montpellier les autorisa de nouveau en 1598290. Il est peu probable que le consistoire de Nîmes ait pu user de la permission à l’époque qui nous occupe, car il avait grand mal à entretenir ses très nombreux indigents291 et, l’«urgente nécessité» ne devait pas lui permettre d’amasser un capital pour le placer.
Il secourait non seulement les pauvres de la ville, mais encore ceux des autres provinces. Ainsi, en 1597, l’église de Grenoble ayant fait parvenir aux Nîmois une lettre réclamant secours, le consistoire décide que «tout ce qui sera levé au bassin» lui sera envoyé, et que l’on communiquera la lettre aux autres églises du colloque292. On faisait également l’aumône aux pauvres étrangers à la cité qui se présentaient avec des attestations de leur église d’origine. Cette coutume, nommée la «passade293», prêtait à de nombreux abus.
Des vagabonds exploitaient les églises en exhibant de fausses lettres de leurs prétendus consistoires. C’est en vain que, pour y remédier, le synode national de Montpellier (1598) décide que l’on ne devra accorder aucune attestation avant d’avoir examiné en consistoire si les raisons données par l’intéressé pour partir au loin sont plausibles; que ses «âge, poil, stature» devront être spécifiés; et que les ministres auxquels il s’adressera en chemin devront garder ou détruire l’attestation qu’il présentera et lui en donner une autre, s’il y a lieu, «pour la prochaine église294». L’abus subsiste, et le consistoire de Nîmes se voit forcé d’ordonner que, dorénavant, les pasteurs comme les anciens ne pourront délivrer à ceux qui «demandent la passade… aucungz bilhetz de 5 solz… qui n’aye esté délibéré au consistoire, ou à l’yssue du presche, et signé par quatre pour le moingz295».
Il ne leur enlevait point, ce semble, le droit de distribuer des «bilhetz» de moins de 5 sols, payables par le receveur des deniers des pauvres. Celui-ci, comme nous l’avons vu, conservait précieusement tous ces mandements comme pièces justificatives de ses dépenses. Ils pouvaient monter à des sommes variables. Par exemple, du 1er janvier au 27 mai 1601, sire Dalbiac, à Nîmes, a reçu des billets pour 52 l. 19 sols296, ce qui donne environ une moyenne de 125 l. d’aumônes par an. Cela ne me paraît pas très considérable, si l’on songe que chaque pasteur reçoit 600 l. de traitement annuel297.
D’ailleurs, ces sommes, pour minimes qu’elles soient, semblent distribuées avec équité. Marque d’une tolérance rare à cette époque, on fait la charité même à des catholiques, et sans leur demander la plus petite abjuration en retour. «Jane Varlède, papiste, sera assistée de 10 souls pour une fois, atandu sa pouvretté298», décide le consistoire. «La femme de Pierre Michel… estant en extrême pouvreté… bien que soit papiste, luy sera assisté de 10 sols sans conséquance299.»
Les nouveaux convertis sont entretenus pendant un certain temps, quand ils sont incapables de gagner leur vie, comme il arrive aux défroqués. On paye leur apprentissage: Pierre, fustier, réclame au consistoire la dépense «que le novisse moyne a faict à sa maison à raison de 5 sols chascung jour300». Si l’église ne peut placer son converti, elle écrit à ses voisines et le leur adresse301. Le synode provincial et le colloque en prennent «soing» et cherchent «si quelque église le voudra entretenir302». D’ailleurs, ils se trouvent souvent mal de leur bonté. Le colloque de Nîmes, par exemple, se voit réclamer 400 l. par Mre Mathieu Guilien, apothicaire, «qu’un jadis moine, nommé François Hon», mis en apprentissage chez lui pour trois ans par le colloque, «auroit dérobé303». Ailleurs, c’est un ancien moine de Tournon, nommé Denys Enard, que le consistoire de Nîmes envoie comme apprenti chez Mre Noguier, chirurgien, au prix de 8 l. par mois: «lequel apprenti s’en seroit allé sans luy rien dire» au bout de onze jours, en emportant «deux couvre chefz de valleur de 24 solz tous deux»; il faut donc payer les 24 sols et 3 l. pour les onze jours d’apprentissage, plus 4 l. 10 sols pour deux chemises que le consistoire avait fait acheter «pour bailher au susd. Denys Enard304».
Car il remettait souvent les secours en nature. Je vois, en effet, qu’il fait délivrer pour 20 l. de «cadis à la vefve de Parant pour lui fere une robbe305»; qu’il assiste d’une «eymine de bled», valant 15 sols, Jean St-Huict, serrurier306, etc. En tout cas, pour le principe, lorsqu’il donne une somme d’argent, il spécifie presque toujours l’emploi qu’en doit faire l’assisté: si Estienne Audiballe reçoit un écu, c’est «pour achepter une robbe à la fripperye307».
Certains pauvres étaient en quelque sorte abonnés et touchaient une certaine somme chaque semaine, tandis que d’autres étaient secourus une fois pour toutes. Parmi les premiers se trouvaient les malades, dont le consistoire prenait grand soin. Une pauvre femme, Claude Deleuse, étant tombée «malade à l’extrémité», il décide que l’ancien du quartier devra avertir ses parents tout d’abord, mais «en cas de nécessité luy adressera avec son diacre308». Souvent, il ordonne que certains pauvres recevront une somme remise à la discrétion «du diacre et surveillant de leur cartier309». Le tableau suivant renferme les noms des indigents assistés entre janvier et mars 1596, avec la mention de ce qu’on leur a donné310.

Le consistoire avait donc, en l’espace de trois mois, fourni à 26 personnes différentes des secours variant entre 10 l. et 5 sols. Il est juste de constater que ce tableau ne comprend que les aumônes énumérées dans le livre du consistoire, et que les anciens et les pasteurs avaient le droit de distribuer des bons pour des sommes peu importantes.
Ce qu’il faut retenir, c’est le soin avec lequel l’église s’occupe des indigents. Il ne se passe pas une séance sans qu’un des anciens propose une infortune à soulager, et sans que le consistoire fasse la charité suivant ses moyens, assez faibles à la vérité. En janvier 1602, il décide de reprendre une ancienne coutume qui lui semble propre à ranimer le zèle des dames de la ville: elle consiste à faire visiter les pauvres chaque semaine, par des «damoiselles et autres honnorables personnes311». Il fait donc dresser un rôle des demoiselles «honnorables», et, tous les mercredis, il désigne deux d’entre elles à cet effet. Ce sont les plus hautes dames de la ville: Mme d’Aubais et Mme de Rochemore312, Mlle la Criminelle et Mlle la lieutenante de Rozel313, Mlles de la Rouvière314, de la Croix315, etc. Elles sont chargées, notamment, d’aller voir les pensionnaires de l’hôpital. Le consistoire semble avoir toujours exercé une surveillance efficace sur cet hôpital. En 1597, il rappelle sévèrement à l’avocat des pauvres que c’est son devoir de s’en occuper316. Il prie les consuls de veiller à ce que «les serviteurs et servantes de l’hospital traictent bien les povres317». Il leur recommande encore d’y recevoir une malheureuse «femme boiteuse318». Enfin, il s’assemble avec les consuls et les magistrats pour pourvoir au logement des indigents319.
Voilà comment on employait les deniers des pauvres. Ce n’était pas une grosse somme, et l’on en retenait encore un cinquième pour l’entretien des proposants320. Mais tout au moins les aumônes étaient distribuées équitablement.
La part la plus importante des revenus du consistoire était comprise sous la dénomination: «deniers de l’église» ou encore «deniers du ministère», parce qu’elle était surtout destinée aux pasteurs.
Le «receveur des deniers de l’église» avait bien des dépenses à couvrir: d’abord, les frais qu’entraînaient les longues négociations auxquelles il fallait se livrer pour obtenir un pasteur «perpétuel», quand l’église s’en trouvait dépourvue; puis les gages des pasteurs en exercice; en leur absence l’entretien des ministres «prêtés», et après leur mort, la pension de leurs veuves321; enfin, il payait l’avertisseur, les employés du consistoire322 et les députations aux colloques et aux synodes.
Celles-ci devaient être, autant que possible, nombreuses, «afin de resserrer l’union des églises». Un synode national recommande aux localités qui ont plusieurs pasteurs d’en envoyer «alternativement… le plus grand nombre qu’elles pourront323». Mais de telles délégations coûtaient cher, et d’autant plus cher qu’elles étaient composées d’un plus grand nombre de personnes. Certaines églises n’étaient pas assez riches pour les supporter; aussi elles s’entendaient pour choisir le même représentant au synode national et s’unissaient pour payer son entretien324.
Lorsqu’il s’agissait seulement d’un synode provincial, les frais de voyage et de séjour des députés étaient moins élevés. C’est pourquoi Nîmes y envoyait assez souvent, outre ses représentants réguliers, des députations extraordinaires325.
La note présentée par Isaac Roux, ancien d’Aimargues, délégué par son église au synode de Saint-Germain de Calberte, peut nous donner une idée de ce que devaient dépenser les députés de Nîmes: «Pour la disnée à Calvisson», on lui doit 1 l. 6 sols; «pour avoir refferré la cavale à Canes», 2 sols; «pour la souppée et couchée à Enduse», 1 l. 6 sols; «pour avoir fait raccoutrer la celle de la cavale,» 5 sols; pour la ferrure «du petit bidet,» 1 sol 6 deniers; «pour une guide de Saint-Étienne jusques à Saint-Jan», 1 sol; «item 1 sol en pain [sic] pour la cavalle326», etc. On rembourse aux députés le prix de la location de leurs chevaux, et, pour aller au colloque de Montpellier, un cheval loué par le pasteur, avec sa selle et sa bride, se paye 30 sols327.
Généralement les délégations aux synodes coûtent plus cher que les délégations aux colloques, car le voyage qu’ont à faire les envoyés est plus long. Ainsi la députation de l’église de Nîmes au synode de Sauve (1597) lui revient à 39 l. 12 s. tournois328; au lieu que le consistoire ne débourse que 4 écus, soit 12 l., pour les frais du pasteur Chambrun et de l’ancien De Vieulx au colloque d’Aiguesmortes en novembre 1598329, et un seul écu pour les dépenses de Falguerolles à celui de Vauvert, au mois d’août de la même année330. – Jusqu’en 1599, la ville où se tenait le synode était très favorisée puisque ses députés n’avaient pas à se déplacer; mais à cette date on décida qu’elle aurait à «loger les pasteurs et anciens [des autres localités], avec les montures, en maison bourgeoise» et à ses dépens331. Malgré cette mesure, les frais de délégation paraissaient encore trop lourds aux petites églises réunies sous un seul pasteur: contrairement à la Discipline, elles n’envoyaient qu’un ancien avec leur ministre pour les représenter332 et payaient chacune leur part des frais333.
Outre les députations aux assemblées, on prenait encore sur les deniers du ministère l’achat des objets servant au culte, l’entretien du temple334 et de la bibliothèque.
L’église de Nîmes n’avait pas attendu les encouragements des synodes nationaux de Saumur (1596), ou de Jargeau (1601) pour «dresser» une bibliothèque propre à servir à ses ministres et à ses proposants335. En janvier 1596, elle ne s’occupait plus déjà que de la «parachever» et achetait pour 7 écus les livres qu’un libraire avait apportés à Nîmes336; peu après, le pasteur Falguerolles et l’avocat Chalas découvraient dans «la bibliothèque de feu M. de Saint-Cézary… deux volumes de Concilles et la Response et examen du concile de Trante, faictz par Rennitus», et les achetaient 3 écus pour le consistoire337. Les livres étaient alors chez Chalas338, et il y en avait un nombre suffisant pour que leur catalogue fût considéré comme un travail nécessaire et assez important339. D’ailleurs, on ne cessait d’en acheter de nouveaux. Ainsi, le 8 janvier 1597, on paye «3 l. 8 sols tournois pour huit livres de M. de Falguerolles340». Chalas partant en voyage, on le charge d’en rapporter quelques-uns341. On presse, en 1597, la rédaction de l’«inventaire et contrerollage» de la bibliothèque342, que le nouveau consistoire de 1599 fait vérifier en entrant en charge343. En octobre de cette même année, le synode ayant arrêté que «les ministres seroyent tenuz tenir en leurs cheres une bible de la nouvelle version», le consistoire se décide à vendre celle qui lui sert actuellement. «Et au mesme instant, au consistoire, a este enchérie, et, après plusieurs enchères, délivrée à M. Rostang du Vieux pour le prix de 3 escus sol344». Puis, on achète une superbe bible «de la nouvelle version… dorée, lavée, réglée», que l’on paye 4 écus et demi345. En 1601, la «Bibliotheca patrum par Marguarites de la Bigne, impression de Paris de l’an 1589, en 9 tomes» est acquise moyennant 18 écus, et sa reliure en «vert carton», plus le port, revient à 5 écus 30 sols346. Enfin, il faut ajouter à cela qu’en 1600 on avait fait faire un «cabinet» pour les livres347.
Il est fort probable que les petites églises du colloque de Nîmes ne devaient pas avoir de bibliothèques faute d’argent, puisque une ville comme Montpellier, siège d’une académie, se voyait, en 1598, exhortée par le synode à se faire «une collection de livres en théologie348». Quoi qu’il en soit, ce ne fut pas, comme le dit M. de Felice349, le synode nat. de La Rochelle, en 1607, qui encouragea le premier les églises à se créer des bibliothèques, et Nîmes en possédait une fort importante bien longtemps auparavant.
Les deniers du ministère devaient subvenir à toutes les dépenses que je viens d’énumérer; voyons d’où ils provenaient.
Le roi promit aux églises, en 1598, de leur donner 45 000 écus. Cette promesse ne fut pas tenue350, si bien que le consistoire de Nîmes dut continuer à pourvoir à l’entretien des ministres par des impositions sur les habitants. A l’époque qui nous occupe, on décidait officiellement que ceux de la Religion seuls en auraient la charge351; mais, vu les difficultés de toutes sortes qu’on avait à recouvrer une subvention si nécessaire, on n’hésitait pas, en pratique, à taxer les catholiques, et ce après comme avant l’édit de Nantes352.
Chaque année, le consistoire extraordinaire, avec le concours des magistrats et des consuls353, décidait quelle somme on prélèverait: tantôt 500 écus comme en 1596354, tantôt 800 comme en 1601355. Il déléguait ensuite quelques membres des consistoires vieux et nouveau, un des magistrats, un ou deux consuls, pour en faire la répartition sur les habitants356. Cette répartition, inscrite sur un livre long nommé «la tariffe357», était alors présentée au magistrat pour qu’il en autorisât l’exaction358. Une fois le «livre signé», on chargeait de lever l’imposition celui qui faisait «meilheure condition», après avoir pris l’avis des consuls: ainsi, en 1600, l’ancien Salveton ayant accepté «d’en fere l’exaction pour 100 l. tournois», on décide «que le bail de lever led. libvre sera passé aud. sire Salveton359». Mais on ne donnait pas toujours la levée à forfait et le consistoire la confiait souvent à des agents qu’il surveillait lui-même. Le 9 décembre 1598, en effet, nous le voyons décider que «les diacres et anciens… poursuyvront ceulx quy sont commis à la levée des rolles360»; et une autre fois, il ordonne qu’elle se fera «par survelliances et ysles… par les nommés à cest effect… suivant les rolles361».
La levée a lieu d’ailleurs très malaisément et les petites églises comme les grandes ne mettent aucun enthousiasme à entretenir leurs pasteurs. A Nîmes, les uns se plaignent d’être trop imposés et ne veulent pas payer intégralement leur taxe; les autres «ne veullent payer rien du tout362» et il y réussissent: on décide de les «adjouster» aux rôles de l’année suivante363, mais c’est toujours un an de gagné, et pourquoi céderaient-ils davantage plus tard? Un nommé Jehan de Vidalle déclare «qu’il yroit plus tost baptizer son enfant à la messe que bailher rien à MM. les ministres364», et il est probable que l’«exhortation pour l’entretenement des pasteurs» que Chambrun fait en chaire après le prêche ne doit pas être sur lui d’un effet puissant365.
Aussi, la levée est-elle loin de rendre ce qu’elle devrait et les pasteurs ne peuvent-ils obtenir leurs gages. En mars 1598, il est dû à Falguerolles, «oultre les arreyrages de l’année passée… ung cartier de la présante366». En mai, le consistoire est forcé d’emprunter 300 l., remboursables dans trois mois et au taux de 12 %, desquelles Chambrun prend 100 l., Falguerolles 200 et Moynier rien367. Cela ne remplit pas la bourse du ministère: en septembre, il ne s’y trouve encore «pas d’argent, mesmes pour les pasteurs servans368». On atteint ainsi l’époque369 de la levée de l’imposition, que l’on décide le 21 octobre. Naturellement, elle ne se fait pas mieux que d’habitude; en décembre, on décide de «poursuyvre» ceux qui en sont chargés370, car, sans doute, on la veut terminée pour la fin de l’année. Les pasteurs sont tellement pressés qu’à peine quelque argent se trouve-t-il entre les mains du receveur qu’ils demandent qu’on leur délivre à chacun 12 écus371. D’ailleurs, c’est la coutume de leur distribuer à mesure ce qui rentre372, car il est impossible de réunir une somme suffisante pour les payer en une fois.
Cependant, en 1599, le consistoire semble vouloir se libérer à l’égard des ministres. Il charge le sieur de Saint-Cézary de prévenir le conseil de ville de la difficulté que présentent la levée des rôles et l’entretien du ministère; il ordonne de poursuivre rigoureusement «ceulx quy doibvent d’argent des bénéfices pour le payement» des pasteurs373; le receveur déposera le compte de ce que les ministres ont reçu sur leur assistance374; enfin, ceux qui refuseront de payer seront traînés devant le juge criminel375. Malgré tout, en juillet, il reste dû encore tellement d’argent aux pasteurs que l’un d’eux, Falguerolles, prévient le consistoire qu’il s’en plaindra au colloque376. Quelques mois plus tard, il mourait377 sans avoir jamais pu toucher les 200 écus qui lui étaient dus378.
Ainsi la ville de Nîmes ne pouvait arriver à fournir les sommes nécessaires à «l’entretien de l’église». S’il en était ainsi dans la plus riche et la plus puissante ville du colloque, on imagine ce qui se passait dans les autres. Les assemblées sont remplies par les querelles d’argent des pasteurs et des consistoires. D’ailleurs, que pouvait-on sur les fidèles? La Discipline autorisait les colloques et les synodes à procéder par des censures ecclésiastiques contre les églises coupables d’«ingratitude» envers leurs ministres et à aller même jusqu’à les priver du culte. Cette peine grave, la seule efficace, on peut le dire, pouvait bien être prononcée contre des églises de peu d’importance379, mais comment l’appliquer à des villes comme Nîmes, exposée aux influences catholiques et où les fidèles se trouvaient livrés aux «séductions» des prêtres et des jésuites? Nous verrons que les pasteurs combattaient ces influences à grand’peine. Ceux d’Alais, réclamant au synode leur ministre Ferrier qui leur avait été emprunté pour quelque temps, se plaignent que «plusieurs de la Religion, se voyantz sans preche, seroient alez au sermon de Rhodes, jésuite380». On juge de ce qui se serait passé dans les mêmes conditions à Nîmes, où le consistoire se trouve forcé de sévir à chaque instant contre des fidèles et même contre des proposants381, qui ont été «ouyr» le P. Coton.
Aussi ne songeait-on pas à appliquer de peines aussi radicales, ni même à appliquer aucune peine. En voici la preuve. Un synode de 1594 avait ordonné que les diacres et anciens ne pourraient quitter leurs charges avant d’avoir «satisffait à l’entretainement des ministres382». Conformément à cette décision, on voit, en janvier 1597, le consistoire de Nîmes s’engager à ne pas se séparer avant d’avoir soldé «ce que restera des gaiges deubz à MM. les pasteurs383». Cependant, le 9 décembre, il décide de procéder à la nomination des anciens pour l’année suivante. Les pasteurs en appellent «d’aultant qu’ilz ne sont payés de leurs gaiges384»; mais le consistoire nouveau n’en remplace pas moins tranquillement le «vieux», et le règlement reste inappliqué.
La municipalité payait une pension à l’église, destinée notamment à l’entretien des proposants. C’était, d’ailleurs, assez peu de chose et insuffisant à sortir le consistoire de peine: en 1598, la pension se monte à 86 l. 15 sols385. Elle était levée par un exacteur des tailles386 et portait sur tous les habitants, même les catholiques387. De plus, le gouvernement communal aidait les anciens à poursuivre le payement des impositions faites pour le ministère388. Son intervention fut autorisée par l’édit de Nantes qui donna le droit aux consistoires de citer en justice les huguenots se refusant à payer leur taxe389.
L’église de Nîmes se résolut à employer ce moyen en février 1599390. Il ne paraît pas qu’elle en ait obtenu des résultats excellents, si l’on on juge par les plaintes et les menaces de Falguerolles en juillet 1599391 et de Moynier en mai 1600392, qui contraignirent le consistoire à faire des emprunts onéreux pour fournir quelque argent à ses ministres393. C’était encore un moyen inefficace. Les pasteurs durent se résigner à n’être pas payés.