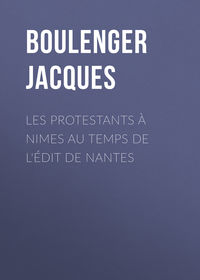Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Les protestants à Nimes au temps de l'édit de Nantes», sayfa 6
En résumé, on peut dire que les catholiques et les protestants se trouvaient aussi nettement séparés qu’au temps des guerres civiles. Les huguenots, plus forts, opprimaient à Nîmes les papistes en les empêchant d’exercer librement leur culte et en les forçant à payer des impositions dont une bonne part servait à solder les frais de la Religion. Les catholiques, d’autre part, étaient dans l’impossibilité de se défendre, puisque, se trouvant en minorité, ils ne pouvaient pénétrer dans le conseil de ville. C’était le contraire exactement de ce qui se passait dans le reste de la France. Aussi, à Nîmes, l’édit de Nantes ne pouvait qu’être favorable aux catholiques et défavorable aux réformés. C’est pourquoi ceux-ci l’accueillirent fort mal613.
VII
RAPPORTS AVEC LES CATHOLIQUES
(Suite)
Les deux partis luttent d’influence morale.
Propagande par les écrits. Les synodes la régularisent. Commission pour l’examen des ouvrages. Les imprimeurs responsables. Pasteurs désignés pour répondre aux pamphlets. Pasteurs poursuivis en justice.
Propagande par la parole. 1. Controverses. Permission du magistrat. Exemple: controverse entre Daniel Chamier et le P. Coton (1600). Influence des controverses sur la foi et les conversions. 2. Prédications. Succès du P. Coton. Influence des jésuites.
Conversions. Les moines ou prêtres convertis aidés pécuniairement. Règlement calviniste pour les conversions. Nouveaux catholiques persécutés.
Les guerres civiles étaient enfin terminées. Nicolas Froumenteau, dans un livre ambitieusement intitulé: Le secret des finances de la France descouvert et réparti en trois livres (Paris, 1581, in-8), nous a laissé un triste dénombrement des maisons abattues, des villages incendiés, des habitants tués. «Pour le seul diocèse de Nîmes, on ne compte pas moins de 1.300 maisons brûlées, 11.782 victimes des discordes civiles», dit Ménard614. Cela explique la réaction qui se produisit ensuite. J’ai montré qu’à l’époque qui nous occupe, les esprits n’étaient pas calmés: à la moindre alerte on s’armait615. Mais on ne se battait pas. Les bourgeois étaient dégoûtés de l’héroïsme; ils retournaient à leur commerce, à leur famille. La lutte était devenue pacifique: pasteurs et jésuites se combattaient par des pamphlets; ou bien ils se défiaient à de grandes controverses théologiques qui avaient lieu en public, devant des juges, à la manière scolastique, et à la suite desquelles chacun des deux champions proclamait invariablement sa victoire; ou bien encore ils rivalisaient d’éloquence, le prêtre en son sermon, le pasteur en son prêche; enfin ils se disputaient les enfants, pour les élever selon ce que l’un et l’autre parti croyait les idées saines, et les jésuites obtenaient assez souvent que les parents huguenots leur confiassent l’éducation de leurs fils. Bref, le but que poursuivait chaque parti dans cette guerre pacifique était de provoquer des conversions à sa propre religion, et c’est, en somme, une lutte d’influences morales que je vais avoir à exposer.
Les pamphlets correspondaient à notre journalisme actuel, aussi passionnants pour les lecteurs de ce temps-là que peuvent le paraître nos feuilles politiques.
Les synodes de Bas-Languedoc organisèrent de bonne heure la propagande par les écrits; ils tâchèrent de donner une unité à cet amas de pamphlets par lequel les huguenots répondaient à l’amas des pamphlets jésuites, en forçant les ministres à soumettre leurs ouvrages à une commission nommée par eux. En 1601, on décide que, suivant la Discipline, aucun livre ne sera imprimé avant que MM. les pasteurs Gigord, de Montpellier, Moynier, de Nîmes, Gasques, du Vigan, Baille, d’Anduze, et La Faye, de Saint-Germain, «n’ayent jugé de la nécessité d’iceluy, et quand et quand, veu led. livre despuis l’épistre liminaire jusqu’à la fin, et donné leur approbation au pied d’un exemplaire à la main signé par eux616». C’était régulariser un usage que l’on observait déjà depuis longtemps617. Le synode national de Montpellier aurait voulu même que les libraires protestants n’éditassent aucun livre sans l’avoir auparavant communiqué aux ministres de leurs églises618. Je ne crois pas que cette prescription ait été jamais exécutée. Mais il est certain que les éditeurs étaient considérés comme responsables des ouvrages contraires à la religion qu’ils publiaient619.
C’était donc pour les pasteurs une fonction régulière que de répondre aux Jésuites. Le synode chargeait nominalement un et, souvent, plusieurs d’entre eux de répliquer à tel ou tel pamphlet catholique620. Dans ce cas, il les faisait indemniser des frais de l’impression, tantôt par le colloque621, tantôt par le consistoire. Par exemple, la réponse du pasteur Jean de Falguerolles à la Salmonée de Reboul, tirée à 600 exemplaires, coûtera «4 l. la feuille» à l’église de Nîmes622.
Les catholiques s’efforçaient d’empêcher autant que possible la publication des ouvrages protestants. En 1601, en effet, on voit les réformés demander au roi de faire défense à tous ses officiers et magistrats d’informer «à occasion des livres par eulx composés, imprimés ou vendus en faict de relligion, et discipline, ou police ecclésiastique623». D’ailleurs, les synodes s’efforcent toujours de protéger ceux de leurs membres qui sont poursuivis «pour avoir respondu aux Jésuites». Ils payent les frais de leur procès624. Cette solidarité des protestants leur fera reconnaître hautement et imprudemment, en 1602, les fameuses thèses de Ferrier où il soutenait que le pape est l’Antechrist625; on lui remboursera ses frais d’impression626 et on enverra un député en cour spécialement pour solliciter sa grâce auprès du roi627.
Quelquefois les pasteurs étaient provoqués par les jésuites à de grandes discussions à la manière scolastique que l’on faisait en public et devant des juges, qui d’ailleurs ne s’accordaient jamais sur le résultat.
Comme ces controverses, lorsqu’elles avaient lieu solennellement, à la suite de défis, risquaient de «passionner» les auditeurs628 et de provoquer des émeutes, il fallait généralement demander à la justice la permission pour les deux adversaires de «disputer». C’est ce que fit le consistoire de Nîmes en mai 1599. Le pasteur Ferrier, d’Alais, avait été provoqué par le P. Coton, si l’on en croit les documents protestants629; ou Coton l’avait été par Ferrier d’après le P. Prat630. En 1601 seulement, un synode détermina les conditions auxquelles les pasteurs pourraient relever de semblables défis et rendit, par conséquent, les controverses plus rares631. Mais l’église de Nîmes ne fit que se conformer à un usage fréquent lorsqu’elle répondit, en 1599, au défi du P. Coton.
Elle fit venir Ferrier à ses frais632, et adressa au sénéchal une requête demandant l’autorisation nécessaire pour que la conférence projetée pût avoir lieu. La cour refusa la permission. Mais le consistoire qui, sans doute, désirait vivement une défaite du P. Coton, afin de combattre l’engouement dont les fidèles commençaient à se prendre pour ses prédications633, tenait fort à ce que la rencontre eût lieu. Il décida634 d’envoyer au sénéchal une seconde requête aux fins d’obtenir la permission nécessaire. En faveur de leur demande (où ils disaient que Ferrier avait été provoqué), les réformés alléguaient que l’autorisation avait été refusée par un conseil composé uniquement de catholiques: or, les édits ordonnaient que de pareils jugements ne pourraient être rendus que par des juges catholiques et des juges protestants en nombre égal. «Il y avait dans ces allégations deux erreurs volontaires», dit à ce propos le P. Prat635, «d’abord la provocation était venue non de la part du P. Coton, mais du côté des ministres, ils le savaient bien; ensuite, la défense portait, entre autres signatures, celle de Calvière, juge criminel, et dévoué, comme sa famille, aux idées nouvelles; elle n’avait donc pas été faite par les seuls magistrats catholiques. D’ailleurs, c’était le consistoire lui-même qui, par les avocats Cheyron et Charles636, ses députés, s’était adressé avec les représentants du P. Coton à la cour du sénéchal pour en obtenir l’autorisation. Il en avait donc reconnu l’autorité; pourquoi la récusait-il ensuite?» Comme on voit, le P. Prat n’a pas lu la requête présentée par les huguenots; d’ailleurs, il se base uniquement sur l’Apologétique du P. Coton: son récit s’en ressent. Mais ne confondons pas son livre de propagande avec un ouvrage historique. Pour en revenir à Ferrier et à Coton, leur dispute ne fut pas autorisée637. Les Nîmois se vantèrent que «l’audace de Coton, jésuite, [avait été] réprimée»638, et nul doute que les catholiques n’aient agi pareillement de leur côté.
Toutes les controverses n’étaient pas interdites par les autorités comme le fut celle-là. Certaines, au contraire, se passaient en présence de magistrats chargés d’en proclamer les résultats: il en fut ainsi de la grande dispute de l’infatigable P. Coton et de Daniel Chamier, ministre de Montélimar, en septembre et octobre 1600. Elle est assez bien connue aujourd’hui, grâce aux Actes publiés en 1601 par chacun des deux adversaires, que M. Read et le P. Prat ont analysés639, et dont pourtant M. le pasteur Arnaud ignore une partie640. Ces Actes donnent chacun une version un peu différente. On peut les compléter par deux copies conformes prises à la mairie de Nîmes et conservées au consistoire sous la cote B, 1. La première est ainsi intitulée: «15 décembre 1600. Actes faits par M. Annibal d’Aymin, chanoine de Nismes, au nom du P. Coton, jésuite, au sieur Chalas, comme procureur fondé du ministre Chamier, avec les réponses dud. Chalas pour led. Chamier, touchant l’exhibition des actes originaux de la conférence publique entre lesd. P. Coton et ministre Chamier, et collationnement des copies desd. actes.» La seconde commence par ces mots: «22 janvier 1601. Acte de réquisitions fait par Maistre Annibal d’Aymin, chanoine de Nismes, au nom du P. Coton, Jésuite, pour faire recevoir par ceux du consistoire de Nismes la réponse par écrit dud. P. Coton aux objections du ministre Chamier, proposées tant verbalement que par écrit dans une conférence publique.»
Une étude approfondie de la conférence de septembre et octobre 1600 ne saurait rentrer dans le cadre de ce chapitre. J’en rapporterai seulement ce qui peut avoir un intérêt général et montrer comment se passaient ordinairement les controverses de ce genre.
Chamier arriva à Nîmes exprès pour la conférence. Elle eut lieu «au logis du Roy, nommé la Thrésorerie», nous dit Chamier641. Ses «modérateurs» furent le cardinal de Sourdis «en habit violet, comme archevêque, hormis qu’il avoit le bonnet rouge», l’évêque de Nîmes Valernod, Daniel de Calvière, juge criminel, de Rozel, lieutenant principal. Comme simples assistants étaient deux conseillers au Parlement de Toulouse, les magistrats des deux religions, les principaux et plus anciens avocats et «un grand nombre d’autres notables et bons habitants642». Les deux adversaires ayant nommé leurs secrétaires, Chamier demanda à l’assemblée la permission de faire sa prière selon la coutume réformée, tandis que Coton ferait la sienne suivant le rite romain. Mais les catholiques se récrièrent et il fut décidé que chacun ferait son oraison à part soi. Puis la dispute commença. Les secrétaires, au commencement, résumaient ce que l’un et l’autre champion disait; mais comme beaucoup de choses risquaient ainsi de leur échapper, car ceux qui écrivent «ne peuvent de leurs mains suivre la langue d’un qui discourt», Coton proposa à Chamier de dicter ce qu’ils voulaient chacun «ou proposer ou respondre». Ce qui fut accepté643. Cependant, le jésuite était trop éloquent pour renoncer à discourir, aussi les deux adversaires développaient-ils de vive voix leurs arguments avant d’en dicter la substance à leurs secrétaires644. La conférence durait ainsi depuis six jours sans résultat, lorsqu’arriva à Nîmes le président de la chambre mi-partie de Castres, Fresne-Canaye. Le mardi 3 octobre, Coton et Chamier furent étonnés de ne trouver personne à la Trésorerie en arrivant. Bientôt, on vint leur dire que M. de Fresne-Canaye les mandait chez lui. Ils s’y rendirent et, aussitôt, le président leur fit une allocution où il leur disait que le roi n’aimait pas les disputes; que, pourtant, s’ils s’étaient «contenus dans les termes de la matière pour laquelle» ils s’étaient assemblés645, on aurait pu les souffrir, mais qu’ils s’étaient «jetés en des lieux communs de la doctrine desbattue dès si longtemps», si bien que «les assistans se passionnoient»; bref, la conférence était interrompue646. On décida d’en publier les actes. Mais les exemplaires des deux secrétaires ne purent être collationnés, car Chamier refusait de céder son original, craignant, disait-il, qu’on le falsifiât647. Chacun imprima donc les actes de son côté. Coton commença: son ouvrage parut sous le nom de Demezat avant celui de Chamier; il n’y déclarait pas moins que sa publication venait en réponse «à M. Chamier, ayant esté si osé que de publier lesd. Actes pleins d’absurdités, dépravations, faussetés». Je laisse à penser si le pasteur releva la mauvaise foi de son adversaire648.
Telle est en résumé l’histoire de cette célèbre controverse. Elle avait fait grand bruit. Mais toutes n’en causaient pas autant. On n’a pas conservé la relation de la «dispute» qui eut lieu entre Moynier, de Nîmes, et le P. Coton en 1600. On sait seulement que le lieutenant principal de Rozel y avait présidé et qu’il avait ordonné qu’on n’en publierait aucune relation; il eut du mal, au reste, à faire observer sa décision: le consistoire voulut bien ne rien imprimer, mais ce fut à la condition que le P. Coton se soumettrait à la même loi649. Moynier avait, dès le 5 avril, composé la relation «des disputtes qu’il auroict heu contre Couton650».
Les controverses étaient assez fréquentes dans tout le colloque de Nîmes. Nous voyons, par exemple, en 1596, que «le moyne qui est en lad. ville [d’Aimargues] demanda de conférer» avec M. Nissolle, pasteur, «et, estans assemblés, M. Nicolas [de Nîmes, beau-frère du pamphlétaire Reboul] soustint tousjours led. moyne, et après l’alla accompagner et fist bruit par tout led. lieu que led. sieur Nissolle avoit perdu sa cause651». Un autre jour, on décide à Nîmes d’organiser une conférence entre M. Maurice, ministre de Nages, et le jésuite Poursan, ce «que plusieurs de ceste ville requièrent grandement652».
Car il semble, en effet, que ces controverses aient vraiment été de quelque poids dans la conscience des fidèles. A cette époque, les huguenots étaient très instruits dans la théologie, le peuple se passionnait pour des points de dogme, et le souci que l’on voit aux autorités de mettre une limite au nombre de ces conférences en est la preuve.
Les controverses durent même déterminer des conversions à l’une ou l’autre religion. La femme de M. le receveur Bon, «révoltée», prie le consistoire d’organiser une conférence entre le pasteur Moynier et le P. Coton «aux fins de voir sy la femne dud. Bon est en erreur». Mais le consistoire ne croit pas devoir lui accorder ce qu’elle demande: Moynier, avec un diacre et un ancien, se contentera de se rendre chez elle pour la «forthiffier… sur les poins dont elle est en doute, et suyvant les réquisitions de lad. damoyselle653».
On a remarqué que c’était presque toujours contre les jésuites que les pasteurs avaient à lutter et spécialement contre le P. Coton. Ce Père, confesseur futur de Henri IV, devait avoir une éloquence remarquable: la peine que le consistoire avait à empêcher les fidèles de se rendre à ses sermons en témoigne654, et ses adversaires eux-mêmes la reconnaissent655. L’extrême douceur de ses manières et la politesse de son esprit lui valurent de grands succès partout où il alla. Il fut le «premier de sa profession, dit-on, qui eût tant honoré Calvin que de l’appeler Monsieur»; jusqu’alors on ne le nommait jamais autrement que le Démon incarné656. Coton ne se fixa pas «à Nîmes dès 1596 comme controversiste» ainsi que le dit M. Germain657: il habitait Avignon et le quittait souvent, il est vrai, mais toujours momentanément, pour soutenir de sa parole et de sa science le parti catholique658. Aussi était-il fort connu et déjà, en 1600, très influent. A cette époque, il s’offre au chapitre de Saint-Gilles pour demander au roi, avec l’évêque Valernod, la réunion de ses bénéfices et la réédification de son église659. Le chapitre cathédral de Nîmes décide que, pour l’engager à venir prêcher, son syndic «lui fera fere un beau manteau de bon drap660».
C’est que ses sermons avaient grand succès. Le consistoire de Nîmes ne parvient pas à empêcher les fidèles d’aller les entendre. A chaque séance, il lui faut appeler ceux qui «vont ouyr Couton661». Les écoliers en théologie eux-mêmes, bien que se destinant au ministère, s’y laissaient entraîner662. Beaucoup de personnes font comme eux. Las de réprimander tout le monde pour le même motif, le consistoire fait publier en chaire que ceux qui vont au sermon seront suspendus des sacrements663. Quelques jours plus tard, le succès de Coton est tel qu’on décide d’en saisir le synode provincial664, lequel fait un article spécial contre ceux qui «vont ouïr les prescheurs de la papauté665»; et cet article est publié en chaire «les deux sènes du jour de Pasques666».
On voit que les pasteurs avaient fort à faire pour combattre les jésuites et le P. Coton. Et ils n’avaient pas seulement à défendre les parents, mais encore les enfants. Il arrivait, en effet, que certains réformés envoyaient leur fille aux «nonnains»667 et leur fils aux Jésuites. J’ai parlé de l’obstination que la femme du lieutenant Favier mit à ne pas retirer ses enfants aux Jésuites d’Avignon. Menaces du consistoire, prières, rien n’y fit668. Elle exposa un jour pourquoi elle ne voulait pas y consentir. La délibération est intéressante; on lui demande pourquoi elle ne rappelle pas ses enfants: «A respondu que c’est à cause que le collège de ceste ville [de Nîmes] n’est si bien réglé qu’il seroit requis, et elle a desir de les advancer comme elle en est obligée. Et, par l’expérience, despuis que ses enfantz sont en Avignon, ilz sont plus retenus, avec plus d’instruction qu’ilz n’avoient lhors qu’ilz estoient en ceste ville. Et c’est pourquoy elle est résolue de les fere estudier. Et si on a tant de désir qu’elle les tire de là, a requis de luy indiquer quelque lieu hors de ceste ville pour les y fere estudier. – Luy a esté indiqué les collèges de Genève, Montpelier et Montauban. – A respondu qu’elle n’a poinct ouy parler du collège de Montauban et qu’elle s’en informera, et, si elle est asseurée que ses enfantz y facent profit, elle y advisera.» On la censure et on la menace de la suspendre publiquement des sacrements, ce à quoi elle répond: «qu’elle n’est poinct de deux cens et que c’est le pis qu’on luy a peu faire, et de la publier qu’on ne peult parce qu’on n’a pas publié personne de plusieurs que ont norri leurs enfantz aux Jésuites669». Ainsi, un certain nombre de fidèles confiaient leurs enfants à la Compagnie de Jésus, qui en devait préparer singulièrement les conversions.
On comprend que les raides huguenots aient détesté leurs adversaires dont la propagande souple et obstinée leur faisait tant de mal. Ils auraient bien voulu que l’ordonnance du Parlement concernant l’expulsion de la Compagnie fût exécuté670. Mais le Parlement de Toulouse était favorable aux Jésuites: pour répondre à l’arrêt du 18 août 1598, défendant aux Français d’envoyer leurs enfants aux collèges des Jésuites, même à l’étranger, il en rendit un autre, le 23 septembre de la même année, qui interdisait, dans toute l’étendue de sa juridiction, d’inquiéter les prêtres et les écoliers de la Compagnie de Jésus671. Ceux-ci conservèrent donc leurs collèges672, et j’ai montré que leur instruction était appréciée de certains huguenots même. On trouve partout la preuve de leur influence. Les précautions disciplinaires que prennent les assemblées contre l’introduction des «superstitions» catholiques en témoignent673. Le chapitre de Saint-Gilles envoie exprès son syndic à Avignon chercher un prédicateur jésuite674. Ceux de l’église de Nîmes réclament au synode un pasteur dont ils ont grand besoin «pour estres assaliz des Jésuites les plus doctes et disertz que les papistes puissent recouvrer675». Les protestants de la province demandent continuellement que la Compagnie de Jésus soit expulsée tout au moins des villes qui leur appartiennent. Ainsi lorsque le lieutenant-général Anne de Ventadour676 vient à Montpellier, «le consistoire de Montpellier est chargé de faire représenter à M. de Ventadour le danger qu’il y a» à introduire les Jésuites «en ceste province677». En 1600, en 1601, les réformés prient le roi de leur défendre l’entrée des villes de sûreté et d’interdire leurs collèges «nouvellement établis678». C’est montrer une véritable terreur de l’influence jésuitique.
Mais les huguenots avaient aussi leur propagande bien organisée. J’ai dit ailleurs679 qu’ils s’occupaient des convertis, les soutenaient de leurs deniers, leur faisaient apprendre un métier: cela permettait aux prêtres et aux moines d’adopter la confession de foi des églises réformées sans risquer de mourir de faim. Certains devenaient pasteurs, comme cet ancien cordelier, nommé Tolosani, qui, le 15 décembre 1596, «proposa à Castres, et alla être ministre à Vabres680».
Le synode nat. de Saumur (1596) décide qu’on enregistrera le nom des convertis et qu’on leur fera, si possible, signer leur acte de conversion681; on doit spécifier en termes exprès le renoncement à la messe dans leur réception682. Ce règlement paraît avoir été observé dans le colloque de Nîmes: je trouve, par exemple, dans le registre du consistoire d’Aimargues, la mention suivante: «Le 12e d’aoust 1601, Jean Nivolat, d’Aymargues, s’est présenté au consistoire pour estre receu en l’église, et, après avoir renié la messe et toute idolâtrie pour vivre au pur service de Dieu, a esté exhorté de se présenter le Dimanche suyvant pour estre receu devant toute l’église683». C’est sous cette forme généralement que sont enregistrés les actes de conversion.
Ceux qui abandonnaient la religion réformée pour le papisme devaient être fort mal vus et peut-être même persécutés par les huguenots, comme les convertis à la Réforme l’étaient par les catholiques. L’édit de Nantes ne changea rien à cela: ainsi, en 1602, Honorat Majol, maître écrivain de Nîmes, fut séparé de certains prêtres et chanoines qu’il accompagnait et empêché de rentrer dans la ville par le capitaine Volpellière, commandant la garde d’une des portes, parce qu’il avait abjuré le calvinisme depuis une semaine684. On peut dire qu’aucun des deux partis n’aimait les «apostats», surtout quand leur conversion s’était faite avec éclat, comme celle du moine Burdeus à la Réforme685 ou celle de Guillaume de Reboul au papisme686.