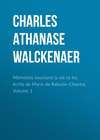Kitabı oku: «Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 1», sayfa 23
Ainsi le duc de Rohan-Chabot devait en partie à l'appui du prince de Condé son nom, son rang et sa fortune; mais comme il était aussi redevable de tout cela à Mazarin et à la reine, ce n'est qu'avec regret qu'il s'était vu obligé, pour rester fidèle à Condé, de se déclarer contre le roi. Aussi était-il un des plus ardents dans le parti de ceux qui voulaient la paix, et par conséquent un de ceux que Condé employait avec le plus de confiance dans ses négociations avec Mazarin648. La duchesse de Rohan-Chabot était à cet égard dans les mêmes sentiments que son mari. D'un caractère énergique et altier, elle dominait ses volontés, mais non pas ses affections; et depuis quelque temps il s'abandonnait sans partage à l'amour dont il était épris pour la marquise de Sévigné649.
CHAPITRE XXVIII.
1652-1653
Position du Gaston.—Ses fautes, qui causent son exil.—Caractère et genre de vie de sa femme, Marguerite de Lorraine.—MADEMOISELLE occupe pendant la guerre le premier rang dans Paris.—Son caractère; ses relations avec le prince de Condé.—Ses projets de mariage.—Bons mots du roi et de la reine d'Angleterre sur MADEMOISELLE.—Les deux fils de cette reine servent dans deux armées différentes.—Conduite du duc de Lorraine.—Tous les partis flattent MADEMOISELLE, sans se confier à elle.—Son genre de dévotion.—Elle croyait aux astrologues.—Grand nombre de noblesse militaire et d'officiers dans Paris, par le voisinage des armées.—Fêtes données par MADEMOISELLE.—Autres réunions.—Turenne et le duc de Lorraine font traîner la guerre en longueur.—Fêtes données dans les camps.—Trêves et négociations.
Gaston était le seul qui pût, de concert avec le parlement, donnera l'opposition un caractère de légalité. Quoique le roi eût été déclaré majeur, Gaston pouvait soutenir qu'il n'était pas libre, et prendre, dans l'intérêt de son neveu, des mesures pour que le royaume ne souffrit aucun dommage de ceux qui voulaient faire tourner à leur profit l'inexpérience d'un monarque encore trop jeune pour pouvoir se conduire par lui-même. Aussi le prince de Condé montrait en toute occasion une grande déférence pour Gaston; il employait tous les moyens pour obtenir son consentement sur toutes ses démarches. Tous les partis négociaient avec lui et intriguaient avec lui. Gaston, faible et irrésolu, n'en embrassait aucun, n'en servait aucun avec suite et sincérité. C'était le moyen d'être abandonné par tous, et d'assurer le succès de Mazarin. Ce succès était dans son intérêt, et il le sentait, car il chercha à transiger avec la cour; mais, faute de l'avoir fait à temps, il fut obligé de se soumettre sans condition, et fut exilé par lettres de cachet au moment de la rentrée du roi. Pendant toute la durée de la guerre, des flots de peuple se portaient quelquefois à son palais du Luxembourg, situé alors hors de l'enceinte des remparts de Paris; et on voyait fréquemment sortir de ce palais des négociateurs et des courriers. Du reste, il vivait fort retiré, et il n'y avait chez lui ni ces nombreuses réunions, ni ces fêtes, ni ces repas splendides qui se succédaient alors presque journellement chez les personnages que leurs rangs appelaient à jouer les premiers rôles dans leurs partis. La duchesse d'Orléans, Marguerite de Lorraine, était alors affligée de la perte d'un de ses enfants, et enceinte d'un autre. Bonne, bienfaisante, pleine de sens et de raison, au besoin même énergique, mais nerveuse, vaporeuse, inégale, indolente, elle ne pouvait se résoudre à tenir cercle, et aimait à vivre dans la retraite. Aussi le cardinal de Retz, dans ses Mémoires, nous dépeint-il MONSIEUR, lorsqu'il revenait avec lui du parlement au Luxembourg, entrant dans son cabinet de livres, jetant sur la table son chapeau couvert d'un panache de plumes, et fermant ensuite la porte au verrou; puis commençant par des exclamations ou des questions ces longues discussions, où se développaient si bien, mais si longuement, les avantages et les inconvénients de toutes les combinaisons politiques; et où, après plusieurs heures écoulées dans d'éloquentes polémiques, les deux interlocuteurs se séparaient sans avoir rien arrêté, rien résolu. C'est aussi dans ce cabinet que Gaston donnait tous ses rendez-vous, que se tenaient toutes ses conférences. Si, après avoir longtemps délibéré, on n'était pas d'accord, alors on proposait de passer chez la duchesse d'Orléans pour avoir son avis. Quoiqu'elle eût peu d'étendue dans l'esprit, on estimait sa franchise, sa droiture et son jugement: elle avait plus d'élévation d'âme et de force dans le caractère que son mari; et les conseillers de celui-ci, lorsqu'ils n'étaient pas de son avis, aimaient, ainsi que lui, à recourir aux décisions de sa femme650. Mais alors il ne fallait pas que les consultants fussent trop nombreux, car elle n'eût pu rester avec eux tous dans la même chambre; il ne fallait pas qu'aucun d'eux eût des bottines de cuir de Russie, si fort à la mode alors, car elle n'en aurait pu supporter l'odeur sans se trouver mal. Lors même que son frère le duc de Lorraine vint à Paris, Marguerite ne changea rien à ses habitudes et à son genre de vie; et quand absolument il fallait que Gaston donnât un grand dîner ou une fête, ce n'était point dans son palais que la chose avait lieu, c'était chez son chancelier: la femme de celui-ci, la comtesse de Choisy, en faisait les honneurs; la duchesse n'y paraissait point651.
Il résultait de cet intérieur de Gaston, que mademoiselle de Montpensier, sa fille du premier lit, qui avait des goûts tout opposés à ceux de sa belle-mère, tenait, en l'absence de la cour, le premier rang dans Paris, et que durant cette année de troubles et de guerre civile elle fut réellement la reine de la société. Ce qui ajoutait encore pour elle à l'illusion, c'est que c'était aux Tuileries, où elle demeurait alors652, qu'elle donnait ses concerts, ses bals et ses divertissements. Le courage qu'elle avait montré à Orléans, cette générosité qui la porta à faire des levées d'hommes à ses frais, tout contribua à la rendre populaire et chère aux partis qui s'opposaient à la cour et à Mazarin. Les chefs cherchaient à profiter de la faiblesse qu'elle avait de s'abandonner toujours aux espérances les plus flatteuses relativement aux mariages qu'elle désirait contracter. Le prince de Condé, s'il réussissait, lui faisait entrevoir comme certain, par son mariage avec Louis XIV, la couronne de France en perspective. La Rochefoucauld et les autres amis de ce prince, lorsqu'on recevait de Bordeaux des nouvelles qui annonçaient que la princesse de Condé, naturellement délicate, était dangereusement malade, lui parlaient du veuvage du prince de Condé comme prochain; ils émettaient l'opinion que, dans cette supposition, le prince ne pourrait rien faire de plus avantageux pour lui que de se proposer pour l'épouser, et qu'ils l'y engageraient. Alors toutes les attentions, les prévenances que Condé avait pour elle lui paraissaient des indices certains de ses vues pour l'avenir; et comme elle avait une grande admiration pour ce héros, lorsque ses espérances faiblissaient du côté du roi, elle se reposait délicieusement sur l'idée d'une autre union honorable, et où les âges comme les penchants mutuels seraient mieux assortis. Quand des nouvelles plus rassurantes sur la santé de madame la Princesse faisaient évanouir ou du moins éloignaient encore cet espoir, les lettres de Fuensaldagne, appuyées par les promesses du duc de Lorraine, lui donnaient l'assurance d'épouser l'archiduc653; et ainsi toujours une nouvelle chimère était substituée à celle qu'elle avait longtemps nourrie: elle la caressait avec la même crédulité, parce qu'en effet sa naissance et ses grands biens donnaient de la probabilité aux projets que son imagination faisait éclore.
La reine d'Angleterre, dont MADEMOISELLE, ainsi que je l'ai déjà dit, avait refusé le fils aîné, le Prétendant, disait malignement que, comme la célèbre Pucelle, MADEMOISELLE ferait le salut de la France, puisqu'elle avait, comme elle, commencé par chasser les Anglais et sauvé Orléans. Cette reine, quoique du parti de la cour, était, à cause de son rang et de son rôle de conciliatrice, de toutes les fêtes et de toutes les réunions qui avaient lieu alors dans Paris654. Une chose qui étonnait, c'est que ses deux fils (qu'on vit depuis monter l'un après l'autre sur le trône d'Angleterre) servaient, l'un dans l'armée du duc de Lorraine, l'autre dans l'armée de Turenne. On ignorait que le duc de Lorraine, avant d'avoir reçu de l'argent de l'Espagne pour aller secourir Condé, en avait accepté auparavant de la France pour joindre son armée à l'armée royale. C'est d'après cette promesse qu'on l'avait laissé entrer dans l'intérieur du royaume; et le prince Charles d'Angleterre s'était mis comme volontaire dans son armée, jusqu'à ce qu'il fut décidé de quel côté il se tournerait.
MADEMOISELLE avait lieu de croire que Mazarin et la reine ne consentiraient jamais à son mariage avec le roi, à moins qu'ils n'y fussent contraints par les succès de l'armée des princes. Cette seule considération suffisait pour mettre MADEMOISELLE dans le parti de la duchesse de Longueville, qui poussait Condé à la guerre655. Elle avait, d'ailleurs, des prétentions sur le cœur de Condé aussi bien que sur sa main; et il suffisait que la duchesse de Châtillon, dont elle était jalouse, eût embrassé le parti de la paix pour qu'elle se jetât avec chaleur dans les rangs du parti contraire656. Si les chefs de tous les partis la flattaient et cherchaient à l'attirer à eux, aucun cependant ne lui confiait ses secrets; on redoutait l'instabilité de ses résolutions, son inexpérience dans les affaires, ses vanités, ses imprudences, sa fougue, ses scrupules, ses inconséquences. Portant jusqu'à l'excès l'orgueil du rang et de la naissance, le sentiment seul de sa dignité l'eût défendue contre l'entraînement des passions, lors même qu'elle n'eût pas été portée à y résister par des principes de vertu et par attachement à la religion. Elle n'avait cependant qu'une dévotion peu fervente; mais, de même que la reine mère se retirait souvent dans son oratoire afin de prier pour le succès des troupes royales, MADEMOISELLE faisait sans cesse dire des messes pour le triomphe de l'armée des princes657. Nous apprenons par elle-même qu'elle désapprouva les génuflexions au milieu de la rue et les autres démonstrations, peu sincères selon elle, auxquelles le prince de Condé se soumit lorsque, le 11 juin, le clergé promena dans Paris, avec toute la pompe d'une procession générale, la châsse de sainte Geneviève658. Cette procession avait été ordonnée, sur les instances du peuple, par le parlement, le jour même où il délibéra comment il réaliserait les cent cinquante mille livres promises à celui qui apporterait la tête de Mazarin659. La conduite que Condé tint dans cette circonstance fut considérée par MADEMOISELLE comme un acte d'hypocrisie indigne de lui, et dont le seul motif était de plaire au peuple. Il est évident aussi, d'après la manière dont elle s'exprime dans ses Mémoires, que la foi aux reliques de la douce vierge de Nanterre était affaiblie dans la classe élevée, et même que toutes les croyances de ce genre étaient considérées comme des préjugés populaires et des superstitions bourgeoises, peu dignes de la haute aristocratie; mais en même temps nous apprenons, par les nombreux témoignages de personnages de cette caste, qu'elle était adonnée à l'astrologie et à la divination, et qu'elle croyait aux revenants660.
L'entrée de Condé et des princes qui l'accompagnaient amena dans Paris un grand nombre de généraux et d'officiers; et ceux des armées campées dans les environs profitèrent d'un voisinage peu favorable à la discipline, mais très-propice au plaisir661. Il semblait que tous les jeunes guerriers, que l'élite de la noblesse de France, et même des pays circonvoisins, s'étaient donné rendez-vous dans la capitale. On reconnaissait, aux couleurs de leurs écharpes, les chefs dont ils dépendaient, les partis et les peuples auxquels ils appartenaient: celles des Lorrains, rouges; des Espagnols, jaunes; de Gaston, bleues; de Condé, isabelle662. Cette réunion de brillants uniformes donnait un éclat à toutes les fêtes qui avaient lieu alors, et fournissait des occasions d'en augmenter le nombre. Cependant la présence de tant d'étrangers, ces drapeaux et ces étendards de l'Espagne que l'on voyait sans cesse flotter avec les drapeaux et les étendards de la France, offensaient les regards sévères des magistrats du parlement, et causaient une vive douleur aux nobles royalistes qui n'avaient pas rejoint la cour, et aux honnêtes bourgeois qui, en embrassant le parti de la Fronde, n'avaient pas abjuré l'amour de leur pays.
C'était précisément cette quantité de guerriers de tant de partis et de nations qui réjouissait la haute noblesse des deux sexes, entièrement livrée à l'ardeur des factions et à la fougue de ses passions. Elle y voyait un signe de force; elle y trouvait un motif de sécurité pour le présent, et d'espérance pour l'avenir. La plupart de ces héroïnes de la Fronde, si belles, si jeunes, si coquettes, étaient charmées de se voir favorisées par les circonstances dans le désir qu'elles avaient de s'attirer le plus grand nombre d'hommages, de mettre plus de variété et de séduction dans ce commerce de galanterie que favorisaient singulièrement l'agitation et le désordre des guerres.
Aussi les fêtes ne discontinuaient pas: MADEMOISELLE en donnait presque tous les soirs663; et quand elle s'en abstenait, ses deux dames d'honneur, les comtesses de Fiesque et de Frontenac, profitaient de ces jours de vacances pour en donner à leur tour664. La comtesse de Choisy en rendait pour MONSIEUR, la duchesse de Châtillon pour le prince de Condé, la présidente de Pommereul pour le cardinal de Retz, qui ne pouvait admettre chez lui de tels divertissements; mais il y donnait de somptueux repas. Des soirées brillantes avaient lieu aussi chez les duchesses de Chevreuse, d'Aiguillon, de Montbazon, de Rohan, et chez la marquise de Bonnelle. Tous les genres de plaisirs connus alors trouvaient place dans ces soirées, surtout dans celles que donnait MADEMOISELLE, les plus complètes et les plus belles. Elle faisait presque toujours venir les comédiens et les vingt-quatre violons. On commençait par jouer une comédie, ou une tragédie, ou un ballet; ensuite concert; puis après venait le jeu de colin-maillard, ou d'autres jeux de société. Après ces jeux on dansait, et on terminait par une exquise et somptueuse collation. Les cartes, que plus tard Mazarin mit à la mode, ne se voyaient que rarement à ces divertissements665. Mais quand vint la belle saison, les plaisirs de ce monde frivole et brillant ne se renfermèrent pas uniquement dans Paris.
Turenne et le duc de Lorraine employaient toute leur tactique pour faire traîner la guerre en longueur666: le premier, afin de donner le temps au cardinal Mazarin de détruire les partis en les divisant; le second, pour les tromper tous. Tout le monde voulait négocier: le parti de la Fronde et du parlement, pour ne pas se battre; Gaston, pour se faire honneur du rétablissement de la paix; le prince de Condé, pour ne pas paraître y mettre obstacle, et faire acheter cette paix par des concessions qui lui fussent avantageuses; le duc de Lorraine, pour obtenir de l'argent de toutes mains; Retz, pour conserver son cardinalat et son archevêché, garder la faveur de Gaston, et obtenir de la cour l'oubli du passé667. Ainsi les corps d'armée, longtemps en présence sans vouloir se combattre, campaient. Ces espèces de trêves, jointes aux négociations qui avaient lieu et qu'on s'efforçait en vain de rendre secrètes, firent souvent croire à la paix bien avant quelle ne fût conclue668. Alors les officiers et les personnages des divers partis communiquaient entre eux; car il ne faut pas oublier de remarquer que, quoiqu'on se battît avec valeur, qu'on se tuât, qu'on se fît des prisonniers dans un jour de bataille, les haines que les chefs avaient les uns contre les autres n'existaient pas également parmi leurs partisans respectifs. Ceux-ci s'étaient partagés en des camps différents par des motifs d'intérêt, par suite de leurs liaisons ou de leur parenté, et quelques-uns par caprice et pour ne pas rester oisifs. Les soldats désertaient, et passaient facilement d'une armée dans une autre669; la gaieté régnait au milieu des dangers et de la mort. Les plus hauts personnages, entraînés par cette disposition générale des esprits, conservaient entre eux les bienséances que nécessitait leur intimité ou que réclamaient les liens du sang. Ainsi, quoique Gaston fût réputé le chef de l'opposition et des frondeurs, le roi lui envoya le duc d'Amville, pour lui faire des compliments de condoléance sur la mort de son fils le duc de Valois670. C'était avec jovialité et courtoisie que les généraux se combattaient. Chavagnac, qui tenait pour Condé, n'en conférait pas moins familièrement et amicalement avec Turenne; et ayant appris qu'il manquait de provisions pour sa cuisine, il eut soin, lorsqu'il l'eut quitté, de lui faire porter un bon dîner. Turenne lui promit, en récompense, de venir bientôt l'assiéger dans Étampes671.
Les suspensions des opérations militaires avaient lieu au milieu de l'été: les Parisiens en profitaient pour prendre l'air hors de leurs remparts. Les belles dames, les héroïnes de la Fronde, montaient à cheval, et, accompagnées de jeunes cavaliers, elles se rendaient au camp des princes, à celui du duc de Lorraine. On les y recevait au bruit des trompettes et de la musique guerrière; on leur donnait des festins sous la tente, et l'on dansait sous les ombrages des bois voisins. MADEMOISELLE se plaisait beaucoup à ces brillantes cavalcades: toujours montée sur un superbe coursier et suivie d'un nombreux cortége, elle aimait à assister aux revues, aux exercices, aux parades, et aux évolutions militaires. Ces divers spectacles attiraient hors de Paris une grande partie de sa population: les routes étaient couvertes de carrosses, de bourgeois à cheval, de gens à pied, qui allaient et revenaient sans cesse de la ville aux camps et des camps à la ville. Ce beau soleil, ces belles campagnes, ces réjouissants banquets, ces pompes belliqueuses, ravissaient un peuple prompt et facile à s'émouvoir; il oubliait les maux causés par ses divisions, et la guerre ne lui paraissait plus exister que pour donner plus d'éclat aux fêtes et plus de variété au plaisir672. Mais elle avait dans le midi de la France un caractère de perfidie et d'atrocité réprouvé par les habitants de la capitale.
CHAPITRE XXIX.
1652-1653
Arrivée du duc de Lorraine à Paris.—Sa présence y augmente la licence des mœurs.—Portrait du duc de Lorraine.—Sa politique.—Sa conduite envers les femmes.—Ses réponses aux duchesses de Châtillon et de Montbazon.—Sa déférence envers MADEMOISELLE.—Il fait sa cour à la comtesse de Frontenac.—Il paraît à la place Royale déguisé en abbesse.—Propos de mademoiselle de Rambouillet à ce sujet.—Pourquoi le désordre avait pénétré jusque dans les cloîtres.—Conduite des religieuses de Longchamps.—Supplique de l'abbesse de ce monastère au cardinal de La Rochefoucauld.—Enquête faite à ce sujet par Vincent de Paul.
La licence des mœurs, que l'état de la société semblait avoir portée au plus haut degré, fut encore augmentée par l'arrivée de Charles IV, duc de Lorraine, à Paris673. Ce prince, âgé alors de quarante-huit ans, joignait à une taille élevée une constitution robuste, et montrait une grande habileté à tous les exercices du corps. Actif, joyeux, spirituel et goguenard, il aimait par-dessus tout le métier de la guerre, où il excellait; aimé du soldat et du peuple, il était envers ses inférieurs communicatif et indulgent jusqu'à l'excès, mais fier, silencieux et méticuleux avec ses égaux, avec les princes souverains, et même avec les têtes couronnées. Ancien amant de la duchesse de Chevreuse, qui s'était autrefois réfugiée à sa cour, beau-frère de Gaston, qui avait épousé sa sœur sans l'autorisation et contre la volonté du roi son frère, le duc de Lorraine avait passé sa vie à lutter contre Richelieu et contre la France; à perdre, à reprendre ses États, et à les reperdre encore; à lever sans cesse des troupes et à combattre. Non compris dans le traité de Munster, dépouillé de son duché et de toutes ses places fortes, dont quelques-unes étaient occupées par Condé, qu'il haïssait, il n'avait pour tout bien, pour toute ressource qu'une armée de dix mille hommes, qui lui était dévouée, parce qu'il la laissait piller et s'enrichir aux dépens des pays où il la conduisait. Il se vendait successivement à l'Allemagne, à l'Espagne, à la France; faisait profession de ne tenir à sa parole qu'autant que son intérêt l'y obligeait: sa vie était celle d'un brigand plutôt que celle d'un prince souverain674. Il avait les yeux du chat, et il en avait aussi la perfidie675. Il aimait passionnément les femmes, et ne se croyait pas plus engagé avec elles par les cérémonies du mariage qu'avec les rois par les conditions d'un traité. Il avait à cet égard bravé l'opinion publique et les excommunications du pape, en osant, de sa propre autorité, déclarer nul son mariage avec la duchesse Nicole, dont il s'était approprié la souveraineté, et en épousant ensuite Béatrix de Cusane, princesse de Cantecroix676. Cette belle et spirituelle personne le suivait partout à cheval, et on l'avait surnommée sa femme de campagne.
D'après la situation des affaires à cette époque et la force respective des armées, le duc de Lorraine, en se réunissant à Condé ou à Turenne677, pouvait à son gré faire pencher la balance en faveur de l'un ou de l'autre. Il se trouvait donc ainsi l'arbitre entre des partis auxquels il s'intéressait fort peu, sachant bien que le faible Gaston, lors même que la cause des princes triompherait, ne serait pas le régulateur de la France, mais bien Condé, dont il n'espérait pas plus que de Fuensaldagne ou de Mazarin. Il dissimulait ses véritables sentiments à son beau-frère avec plus de soin encore qu'à tout autre; et tantôt il simulait un complet dévouement, tantôt il affectait de la froideur, suggérait des querelles de préséance, et faisait craindre une défection678. La marche avancée de son armée, sa visite à Paris, donnèrent des craintes à la cour, excitèrent des soupçons, et forcèrent Turenne de lever le siége d'Étampes et de se rapprocher de la capitale679. Tous les partis, dont les intrigues aboutissaient à Paris, devenu le centre des négociations, cherchaient donc à profiter du séjour du duc de Lorraine pour l'attirer à eux. Lui, par l'intermédiaire de l'ex-ministre Châteauneuf, continuait toujours en secret ses relations et ses pourparlers avec la cour680. Les femmes, qui jouaient un si grand rôle dans les affaires, employèrent toutes les ressources de la coquetterie, tous les moyens que la finesse et la ruse propres à leur sexe purent leur suggérer, pour influencer d'une manière conforme à l'intérêt de leur parti les déterminations de Charles IV681. Le rusé partisan non-seulement profita, mais abusa de la position que les circonstances lui avaient faite. Il poussa jusqu'à l'excès la bouffonnerie et le dévergondage des paroles, auxquels il avait l'habitude de s'abandonner dans le commerce ordinaire de la vie682. Ses manières si étranges parurent piquantes et naïves à cette société, déjà portée à la licence, continuellement remuée par des sensations extraordinaires, et toujours avide d'en éprouver de nouvelles. Ce qui aurait dû le faire expulser de tous les cercles polis fut précisément ce qui le fit rechercher, ce qui excita la curiosité, ce qui le mit à la mode. Lorsqu'il se trouvait seul au milieu des dames, et que la conversation tombait sur les désastres occasionnés par les troupes de tous les partis683, il se plaisait, dans ses récits, à exagérer les dévastations et les cruautés de ses soldats. Selon lui, le vol, le viol, le meurtre, étaient pour eux de petits crimes: ils mangeaient de la chair humaine, et à ce sujet il se livrait à d'horribles détails, semblables à ceux des contes d'ogres que l'on faisait alors aux enfants684, et que depuis Perrault a consignés par écrit685. Cependant il les débitait avec un si grand sang-froid, qu'on doutait s'il parlait sérieusement ou s'il plaisantait: il semblait se complaire à être plutôt considéré comme le chef d'une troupe de démons que comme un général d'armée. Il se taisait sur les intérêts et les affaires qui paraissaient avoir été le but de son voyage à Paris; ou quand on l'interrogeait et qu'on voulait le sonder, il répondait par des plaisanteries: s'il daignait faire une réponse sérieuse, elle était évasive. Pressé un jour par les duchesses de Châtillon et de Montbazon de s'expliquer sur ses intentions, il les prit toutes deux par la main, et dit: Allons, mesdames, appelons les violons, dansons, amusons-nous; c'est ainsi qu'on doit négocier avec les dames686. Cependant celles qui lui parlaient d'une manière conforme à ses intérêts s'en faisaient écouter. Ainsi la princesse de Guémené sut l'empêcher d'aller secourir Étampes, en lui démontrant que par là il rendrait Condé trop puissant. Il flattait l'orgueil de MADEMOISELLE, en ayant pour elle plus de déférence qu'il n'en montrait pour sa propre sœur, la duchesse d'Orléans: il lui parlait souvent de son mariage avec l'archiduc, et il avait pour elle des égards et un ton de galanterie respectueuse tout différent de celui qu'il prenait avec les autres femmes. La politique entrait pour beaucoup dans cette conduite; mais il s'y joignait un autre motif. La jolie comtesse de Frontenac lui avait plu687, et il ne pouvait voir aussi fréquemment qu'il le désirait la dame d'honneur sans se mettre très-avant dans les bonnes grâces de la princesse. Mais il se montrait aussi fort sensible aux charmes de ses nièces, les deux filles de Gaston. MADEMOISELLE en fut jalouse, et ce sentiment fit disparaître en elle toute l'affection que le duc de Lorraine lui avait inspirée. Elle se réjouit de le voir quitter Paris, et apprit sans regret la nouvelle de la retraite de son armée; ce qui pourtant portait un coup fatal au parti qu'elle avait embrassé688. Les intérêts du cœur ou ceux de la vanité l'emportent toujours chez les femmes sur tous les autres. Rarement sont-elles assez maîtresses d'elles-mêmes pour sacrifier leurs goûts, leurs antipathies, leurs préférences, aux nécessités d'un grand dessein689.
Une anecdote relative au duc de Lorraine, toute frivole qu'elle pourra sembler à quelques lecteurs, va trop directement au but que nous nous sommes proposé, de donner dans ce chapitre une idée de la liberté du commerce qui régnait alors entre les deux sexes, pour que nous la passions sous silence.
Charles IV pria mademoiselle de Chevreuse de le mener à la place Royale, un jour que l'on faisait jouer les violons; mais en même temps il désira rester inconnu. Pour le satisfaire, il fut décidé qu'on le couvrirait d'une grande écharpe noire que prêta l'abbesse de Maugiron, et qu'ainsi déguisé, mademoiselle de Chevreuse le ferait passer pour sa sœur, l'abbesse de Pont-aux-Dames690. Arrivés à la place Royale, mademoiselle de Chevreuse et sa prétendue sœur rencontrèrent mademoiselle de Rambouillet avec madame de Souvré ou de Bois-Dauphin, et mademoiselle d'Harcourt, qui étaient prêtes à monter en voiture pour se rendre dans une maison du voisinage, où elles étaient invitées à souper. Mademoiselle de Rambouillet témoigna à mademoiselle de Chevreuse la surprise qu'elle éprouvait de la trouver à pied à cette heure sur la place publique; et elle lui demanda en même temps quelle était cette grande personne en noir qui l'accompagnait, et se tenait à l'écart. «C'est, dit mademoiselle de Chevreuse en parlant à l'oreille de mademoiselle de Rambouillet, le duc de Lorraine qui veut rester incognito, et que je fais passer pour ma sœur, l'abbesse de Pont-aux-Dames.» En même temps mademoiselle de Chevreuse, en s'adressant au duc de Lorraine, lui dit: «Ma sœur, pourquoi vous tenez-vous si loin? Ces dames vous font-elles peur? Ce sont nos meilleures amies; elles veulent vous dire bonsoir.» Le duc de Lorraine s'approcha, et joua son rôle de religieuse le mieux qu'il put; mais, dans son embarras, il ne répondait que par des signes et des remercîments aux questions qu'on lui adressait. Mademoiselle de Rambouillet, naturellement gaie et malicieuse, s'efforça, mais en vain, de faire monter dans sa voiture mademoiselle de Chevreuse et sa prétendue sœur. Elle dit depuis à Conrart que si elle avait réussi, elle avait le projet, aussitôt que tout le monde aurait été placé, de faire peur au grand guerrier, en faisant lever la portière de la voiture, et en criant: «Touche, cocher, droit au Pont-Neuf! nous sommes toutes mazarines; nous tenons M. de Lorraine, et il faut le jeter à l'eau.»
Il ne faut pas s'étonner si l'on voyait alors des abbesses, même cloîtrées, figurer à cette époque dans le monde et dans les cercles de Paris. Un grand nombre de religieuses avaient été obligées de quitter leurs couvents et de se réfugier en ville, pour fuir les dangers auxquels elles étaient exposées de la part d'une soldatesque sans frein, qui pillait et dévastait les campagnes; mais ces exilées du cloître retrouvaient des périls aussi grands, quoique d'une autre nature, dans le sein de la capitale. Plusieurs d'entre elles, par le séjour qu'elles y firent, ajoutèrent un nouveau genre de scandale à ceux que présentaient déjà les désordres de ces temps, mais elles n'outragèrent pas aussi ouvertement la morale publique que les religieuses de Longchamps. L'abbaye de Longchamps, fondée près du bois de Boulogne par la sœur de saint Louis, et richement dotée par cette princesse, avait été soustraite par elle à la juridiction de l'évêque de Paris et du clergé régulier, et placée sous la direction des frères mineurs, c'est-à-dire des cordeliers de l'ordre de Saint-François. De là était résulté le relâchement à la règle, et la corruption qui en avait été la suite. Elle s'y perpétuait depuis le quatorzième siècle, et avait encore augmenté pendant la régence et la Fronde. Les parloirs n'étaient point fermés; des hommes, qui n'étaient pas même parents des religieuses, y avaient accès, et s'entretenaient avec elles à l'insu de l'abbesse. Les confesseurs venaient de nuit, sous prétexte de remplir les devoirs de leur ministère, et se trouvaient ainsi à des heures indues tête à tête avec leurs pénitentes. Quelques-uns même, gagnés à prix d'argent, avaient ouvert leurs confessionnaux à des laïques déguisés; des jeunes gens avaient été surpris nuitamment introduits dans l'intérieur du couvent par de jeunes religieuses, ou par les sœurs tourières, avec lesquelles les frères mineurs étaient sur le pied d'une indécente familiarité. Les recteurs du monastère et les pères provinciaux, qui étaient les supérieurs ecclésiastiques de l'abbesse, au lieu de la seconder dans ses pieux efforts pour la répression des abus, la punition des délits, révoquaient et annulaient les mesures qu'elle prenait pour y mettre un terme. Le désordre et l'insubordination croissaient rapidement, et semblaient être portés à leur plus haut point, lorsque la marche des troupes et les progrès des opérations militaires autour de Paris forcèrent toute la communauté de Longchamps de se réfugier dans cette capitale. Les sœurs qui avaient lutté avec tant d'audace contre l'autorité de l'abbesse s'en affranchirent entièrement, et ne conservèrent même plus les apparences de la soumission. On les vit, gardant leur costume de religieuse, donner à ces vêtements, symbole de la pureté et de la sévère pudeur, une immodeste élégance, que le charme de la nouveauté et le contraste de leur sainte profession rendaient plus voluptueuse et plus séduisante. Elles portaient des rubans couleur de feu, des gants d'Espagne, des montres d'or, des bijoux, et tous les ornements mondains que pouvait admettre le genre d'habits dont elles étaient revêtues. Sous prétexte de faire des visites à leurs parents, leurs connaissances, elles sortaient, et passaient des jours et des nuits dans la chambre de leurs amants. L'abbesse, de concert avec les religieuses les plus âgées, et avec les jeunes religieuses qui ne s'étaient point écartées de leurs devoirs, se détermina à avoir recours à l'autorité supérieure. Sur l'instance du procureur général, l'abbaye de Longchamps avait été replacée, dès l'année 1560, par un arrêt du parlement, sous la discipline de l'évêque de Paris; mais l'ordre des frères mineurs n'avait pas voulu reconnaître cet arrêt: et d'ailleurs il en eût été autrement, qu'on n'eût rien pu espérer du cardinal de Retz, qui, en sa qualité de coadjuteur, administrait le diocèse. Ses mœurs étaient connues, et on savait qu'il ne consentirait jamais à prendre aucune mesure qui pût attenter aux priviléges d'un ordre monastique qui lui était dévoué, et qui, par le nombre et la richesse de ses couvents, avait dans Paris une grande influence. L'abbesse crut donc devoir s'adresser directement au pape. Elle lui fit présenter une supplique, qui fut écoutée favorablement. Le cardinal de La Rochefoucauld, d'après les ordres du saint-père, en écrivit au respectable Vincent de Paul; et sur le rapport de ce pieux ecclésiastique (rapport où nous avons puisé ces faits), lorsque la guerre de la Fronde fut terminée, on prit des mesures pour rétablir la règle dans le couvent de Longchamps. Ces mesures furent efficaces; mais cependant le monastère ne subit pas une reforme aussi sévère que celle qu'avait opérée dans Port-Royal des Champs son abbesse, la célèbre Angélique Arnauld, qui quarante ans avant cette époque, refusa à son propre père la permission d'entrer dans l'intérieur de son cloître691.