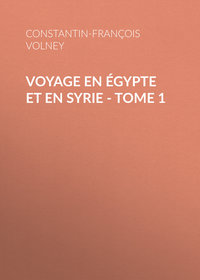Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Voyage en Égypte et en Syrie - Tome 1», sayfa 10
CHAPITRE XIII.
Tableau résumé de l'Égypte
L'ÉGYPTE fournirait encore matière à beaucoup d'autres observations; mais comme elles sont étrangères à mon objet, ou qu'elles rentrent dans celles que j'aurai occasion de faire sur la Syrie, je ne m'étendrai pas davantage.
Si l'on se rappelle ce que j'ai exposé de la nature et de l'aspect du sol; si l'on se peint un pays plat, coupé de canaux, inondé pendant 3 mois, fangeux et verdoyant pendant 3 autres, poudreux et gercé le reste de l'année; si l'on se figure sur ce terrain des villages de boue et de briques ruinés, des paysans nus et hâlés, des buffles, des chameaux, des sycomores, des dattiers clair-semés, des lacs, des champs cultivés, et de grands espaces vides; si l'on y joint un soleil étincelant sur l'azur d'un ciel presque toujours sans nuages, des vents plus ou moins forts, mais perpétuels: l'on aura pu se former une idée rapprochée de l'état physique du pays137. On a pu juger de l'état civil des habitants, par leurs divisions en races, en sectes, en conditions; par la nature d'un gouvernement qui ne connaît ni propriété, ni sûreté de personnes, et par l'image d'un pouvoir illimité confié à une soldatesque licencieuse et grossière: enfin l'on peut apprécier la force de ce gouvernement en résumant son état militaire, la qualité de ses troupes; en observant que dans toute l'Égypte et sur les frontières il n'y a ni fort, ni redoute, ni artillerie, ni ingénieurs, et que, pour la marine, on ne compte que les 28 vaisseaux et cayasses de Suez, armés chacun de 4 pierriers rouillés, et montés par des marins qui ne connaissent pas la boussole. C'est au lecteur à établir sur ces faits l'opinion qu'il doit prendre d'un tel pays. S'il trouvait, par hasard, que je le lui présente sous un point de vue différent de quelques autres relations, cette diversité ne devrait point l'étonner. Rien de moins unanime que les jugements des voyageurs sur les pays qu'ils ont vus: souvent contradictoires entre eux, celui-ci déprime ce que celui-là vante; et tel peint comme un lieu de délices ce qui pour tel autre n'est qu'un lieu fort ordinaire. On leur reproche cette contradiction; mais ils la partagent avec leurs censeurs mêmes, puisqu'elle est dans la nature des choses. Quoi que nous puissions faire, nos jugements sont biens moins fondés sur les qualités réelles des objets, que sur les affections que nous recevons, ou que nous portons déja en les voyant. Une expérience journalière prouve qu'il s'y mêle toujours des idées étrangères, et de là vient que le même pays qui nous a paru beau dans un temps nous paraît quelquefois désagréable dans un autre. D'ailleurs, le préjugé des habitudes premières est tel, que jamais l'on ne peut s'en dégager. L'habitant des montagnes hait les plaines; l'habitant des plaines déprise les montagnes. L'Espagnol veut un ciel ardent; le Danois un temps brumeux. Nous aimons la verdure des forêts; le Suédois préfère la blancheur des neiges: le Lapon, transporté de sa chaumière enfumée dans les bosquets de Chantilly, y est mort de chaleur et de mélancolie. Chacun a ses goûts, et juge en conséquence. Je conçois que, pour un Égyptien, l'Égypte est et sera toujours le plus beau pays du monde, quoiqu'il n'ait vu que celui-là. Mais, s'il m'est permis d'en dire mon avis comme témoin oculaire, j'avoue que je n'en ai pas pris une idée si avantageuse. Je rends justice à son extrême fertilité, à la variété de ses produits, à l'avantage de sa position pour le commerce: je conviens que l'Égypte est peu sujette aux intempéries qui font manquer nos récoltes; que les ouragans de l'Amérique y sont inconnus; que les tremblements qui de nos jours ont dévasté le Portugal et l'Italie y sont très-rares, quoique non pas sans exemples138; je conviens même que la chaleur qui accable les Européens n'est pas un inconvénient pour les naturels: mais c'en est un grave que ces vents meurtriers de sud; c'en est un autre que ce vent de nord-est qui donne des maux de tête violents; c'en est encore un que cette multitude de scorpions, de cousins, et surtout de mouches, telle que l'on ne peut manger sans courir risque d'en avaler. D'ailleurs, nul pays d'un aspect plus monotone; toujours une plaine nue à perte de vue; toujours un horizon plat et uniforme139; des dattiers sur leur tige maigre, ou des huttes de terre sur des chaussées: jamais cette richesse de paysages, où la variété des objets, où la diversité des sites occupent l'esprit et les yeux par des scènes et des sensations renaissantes: nul pays n'est moins pittoresque, moins propre aux pinceaux des peintres et des poètes: on n'y trouve rien de ce qui fait le charme et la richesse de leurs tableaux; et il est remarquable que ni les Arabes ni les anciens ne font mention des poètes d'Égypte. En effet, que chanterait l'Égyptien sur le chalumeau de Gessner et de Théocrite? Il n'a ni clairs ruisseaux, ni frais gazons, ni antres solitaires; il ne connaît ni les vallons, ni les coteaux, ni les roches pendantes. Thompson n'y trouverait ni le sifflement des vents dans les forêts, ni les roulements du tonnerre dans les montagnes, ni la paisible majesté des bois antiques, ni l'orage imposant, ni le calme touchant qui lui succède: un cercle éternel des mêmes opérations ramène toujours les gras troupeaux, les champs fertiles, le fleuve boueux, la mer d'eau douce, et les villages semblables aux îles. Que si la pensée se porte à l'horizon qu'embrasse la vue, elle s'effraie de n'y trouver que des déserts sauvages, où le voyageur égaré, épuisé de soif et de fatigue, se décourage devant l'espace immense qui le sépare du monde; il implore en vain la terre et le ciel; ses cris, perdus sur une plaine rase, ne lui sont pas même rendus par des échos: dénué de tout, et seul dans l'univers, il périt de rage et de désespoir devant une nature morne, sans la consolation même de voir verser une larme sur son malheur. Ce contraste si voisin est sans doute ce qui donne tant de prix au sol de l'Égypte. La nudité du désert rend plus saillante l'abondance du fleuve, et l'aspect des privations ajoute au charme des jouissances: elles ont pu être nombreuses dans les temps passés, et elles pourraient renaître sous l'influence d'un bon gouvernement; mais, dans l'état actuel, la richesse de la nature y est sans effet et sans fruit. En vain célèbre-t-on les jardins de Rosette et du Kaire; l'art des jardins, cet art si cher aux peuples policés, est ignoré des Turks, qui méprisent les champs et la culture. Dans tout l'empire les jardins ne sont que des vergers sauvages où les arbres, jetés sans soin, n'ont pas même le mérite du désordre. En vain se récrie-t-on sur les orangers et les cédrats qui croissent en plein air: on fait illusion à notre esprit, accoutumé d'allier à ces arbres les idées d'opulence et de culture qui chez nous les accompagnent. En Égypte, arbres vulgaires, ils s'associent à la misère des cabanes qu'ils couvrent, et ne rappellent que l'idée de l'abandon et de la pauvreté. En vain peint-on le Turk mollement couché sous leur ombre, heureux de fumer sa pipe sans penser: l'ignorance et la sottise ont sans doute leurs jouissances, comme l'esprit et le savoir; mais, je l'avoue, je n'ai pu envier le repos des esclaves, ni appeler bonheur l'apathie des automates. Je ne concevrais pas même d'où peut venir l'enthousiasme que des voyageurs témoignent pour l'Égypte, si l'expérience ne m'en eût dévoilé les causes secrètes.
Des exagérations des voyageurs
On a dès long-temps remarqué dans les voyageurs une affectation particulière à vanter le théâtre de leurs voyages, et les bons esprits, qui souvent ont reconnu l'exagération de leurs récits, ont averti, par un proverbe, de se tenir en garde contre leur prestige140; mais l'abus subsiste, parce qu'il tient à des causes renaissantes. Chacun de nous en porte le germe; et souvent le reproche appartient à ceux mêmes qui l'adressent. En effet, qu'on examine un arrivant de pays lointains, dans une société oisive et curieuse: la nouveauté de ses récits attire l'attention sur lui; elle mène jusqu'à la bienveillance pour sa personne; on l'aime parce qu'il amuse, et parce que ses prétentions sont d'un genre qui ne peut choquer. De son côté, il ne tarde pas de sentir qu'il n'intéresse qu'autant qu'il excite des sensations nouvelles. Le besoin de soutenir, l'envie même d'augmenter l'intérêt, l'engagent à donner des couleurs plus fortes à ses tableaux; il peint les objets plus grands pour qu'ils frappent davantage: les succès qu'il obtient l'encouragent; l'enthousiasme qu'il produit se réfléchit sur lui-même; et bientôt il s'établit entre ses auditeurs et lui une émulation et un commerce par lequel il rend en étonnement ce qu'on lui paie en admiration. Le merveilleux de ce qu'il a vu rejaillit d'abord sur lui-même; puis, par une seconde gradation, sur ceux qui l'ont entendu, et qui à leur tour le racontent: ainsi la vanité, qui se mêle à tout, devient une des causes de ce penchant que nous avons tous, soit pour croire, soit pour raconter les prodiges. D'ailleurs, nous voulons moins être instruits qu'amusés, et c'est par ces raisons que les faiseurs de contes, en tout genre, ont toujours occupé un rang distingué dans l'estime des hommes et dans la classe des écrivains.
Il est pour les voyageurs une autre cause d'enthousiasme: loin des objets dont elle a joui, l'imagination privée s'enflamme; l'absence rallume les désirs, et la satiété de ce qui nous environne prête un charme à ce qui est hors de notre portée. On regrette un pays d'où l'on désira souvent de sortir, et l'on se peint en beau les lieux dont la présence pourrait être encore à charge. Les voyageurs qui ne font que passer en Égypte ne sont pas dans cette classe, parce qu'ils n'ont pas le temps de perdre l'illusion de la nouveauté; mais quiconque y séjourne peut y être rangé. Nos négociants le savent, et ils ont fait à ce sujet une observation qu'on doit citer: ils ont remarqué que ceux même d'entre eux qui ont le plus senti les désagréments de cette demeure ne sont pas plus tôt retournés en France, que tout s'efface de leur mémoire; leurs souvenirs prennent de riantes couleurs; en sorte que 2 ans après on n'imaginerait pas qu'ils y eussent jamais été. «Comment pensez-vous encore à nous?» m'écrivait dernièrement un résident au Kaire; «comment conservez-vous les idées vraies de ce lieu de misère141, lorsque nous avons éprouvé que tous ceux qui repassent les oublient au point de nous étonner nous-mêmes?» Je l'avoue, des causes si générales et si puissantes n'eussent pas été sans effet sur moi-même; mais j'ai pris un soin particulier de m'en défendre, et de conserver mes impressions premières, pour donner à mes récits le seul mérite qu'ils pussent avoir, celui de la vérité. Il est temps de les reporter sur des objets d'un intérêt plus vaste; mais comme le lecteur ne me pardonnerait pas de quitter l'Égypte sans parler des ruines et des pyramides, j'en dirai deux mots.
CHAPITRE XIV.
Des ruines et des pyramides 142
J'AI déja exposé comment la difficulté habituelle des voyages en Égypte, devenue plus grande en ces dernières années, s'opposait aux recherches sur les antiquités. Faute de moyens, et surtout de circonstances propres, on est réduit à ne voir que ce que d'autres ont vu, et à ne dire que ce qu'ils ont déja publié. Par cette raison, je ne répéterai pas ce qui se trouve déja répété plus d'une fois dans Paul Luca, Maillet, Siccard, Pocoke, Graves, Norden, Niebuhr, et récemment dans les Lettres de Savary. Je me bornerai à quelques considérations générales.
Les pyramides de Djizé sont un exemple frappant de cette difficulté d'observer dont j'ai fait mention. Quoique situées à 4 lieues seulement du Kaire, où il réside des Francs, quoique visitées par une foule de voyageurs, on n'est point encore d'accord sur leurs dimensions. On a mesuré plusieurs fois leur hauteur par les procédés géométriques, et chaque opération a donné un résultat différent143. Pour décider la question, il faudrait une nouvelle mesure solennelle, faite par des personnes connues; mais en attendant, on doit taxer d'erreur tous ceux qui donnent à la grande pyramide autant d'élévation que de base, attendu que son triangle est très-sensiblement écrasé. La connaissance de cette base me paraît d'autant plus intéressante, que je lui crois du rapport à l'une des mesures carrées des Égyptiens; et dans la coupe des pierres, si l'on trouvait des dimensions revenant souvent les mêmes, peut-être en pourrait-on déduire leurs autres mesures.
On se plaint ordinairement de ne point comprendre la description de l'intérieur de la pyramide; et en effet, à moins d'être versé dans l'art des plans, on a peine à se reconnaître sur la gravure. Le meilleur moyen de s'en faire une idée, serait d'exécuter en terre crue ou cuite, une pyramide dans des proportions réduites, par exemple, d'un pouce par toise. Cette masse aurait 8 pieds 4 pouces de base, et à peu près 7 et demi de hauteur: en la coupant en 2 portions de haut en bas, on y pratiquerait le premier canal qui descend obliquement, la galerie qui remonte de même, et la chambre sépulcrale qui est à son extrémité. Norden fournirait les meilleurs détails; mais il faudrait un artiste habitué à ce genre d'ouvrages.
La ligne du rocher sur lequel sont assises les pyramides ne s'élève pas au-dessus du niveau de la plaine de plus de 40 à 50 pieds. La pierre dont il est formé, est, comme je l'ai dit, une pierre calcaire blanchâtre, d'un grain pareil au beau moellon, ou à cette pierre connue dans quelques provinces sous le nom de rairie. Celle des pyramides est d'une nature semblable. Au commencement du siècle, on croyait, sur l'autorité d'Hérodote, que les matériaux en avaient été transportés d'ailleurs; mais des voyageurs, observant la ressemblance dont nous parlons, ont trouvé plus naturel de les faire tirer du rocher même; et l'on traite aujourd'hui de fable le récit d'Hérodote, et d'absurdité cette translation de pierres. On calcule que l'aplanissement du rocher en a dû fournir la majeure partie; et, pour le reste, on suppose des souterrains invisibles, que l'on agrandit autant qu'il est besoin. Mais si l'opinion ancienne a des invraisemblances, la moderne n'a que des suppositions. Ce n'est point un motif suffisant de juger, que de dire: Il est incroyable que l'on ait transporté des carrières éloignées; il est absurde d'avoir multiplié des frais qui deviennent énormes, etc. Dans les choses qui tiennent aux opinions et aux gouvernements des peuples anciens, la mesure des probabilités est délicate à saisir: aussi, quelque invraisemblable que paraisse le fait dont il s'agit, si l'on observe que l'historien qui le rapporte a puisé dans les archives originales; qu'il est très-exact dans tous ceux que l'on peut vérifier; que le rocher libyque n'offre en aucun endroit des élévations semblables à celles qu'on veut supposer, et que les souterrains sont encore à connaître; si l'on se rappelle les immenses carrières qui s'étendent de Saouâdi à Manfalout, dans un espace de 25 lieues; enfin, si l'on considère que leurs pierres, qui sont de la même espèce, n'ont aucun autre emploi apparent144; on sera porté tout au moins à suspendre son jugement, en attendant une évidence qui le détermine. Pareillement quelques écrivains se sont lassés de l'opinion que les pyramides étaient des tombeaux, et ils en ont voulu faire des temples ou des observatoires; ils ont regardé comme absurde qu'une nation sage et policée fît une affaire d'état du sépulcre de son chef, et comme extravagant qu'un monarque écrasât son peuple de corvées, pour enfermer un squelette de 5 pieds dans une montagne de pierres: mais, je le répète, on juge mal les peuples anciens, quand on prend pour terme de comparaison nos opinions, nos usages. Les motifs qui les ont animés peuvent nous paraître extravagants, peuvent l'être même aux yeux de la raison, sans avoir été moins puissants, moins efficaces. On se donne des entraves gratuites de contradictions, en leur supposant une sagesse conforme à nos principes; nous raisonnons trop d'après nos idées, et pas assez d'après les leurs. En suivant ici, soit les unes, soit les autres, on jugera que les pyramides ne peuvent avoir été des observatoires d'astronomie145; parce que le mont Moqattam en offrait un plus élevé, et qui borne ceux-là; parce que tout observatoire élevé est inutile en Égypte, où le sol est très-plat, et où les vapeurs dérobent les étoiles plusieurs degrés au-dessus de l'horizon; parce qu'il est impossible de monter sur la plupart des pyramides; enfin, parce qu'il était inutile de rassembler 11 observatoires aussi voisins que le sont les pyramides, grandes et petites, que l'on découvre du local de Djizé. D'après ces considérations, on pensera que Platon, qui a fourni l'idée en question, n'a pu avoir en vue que des cas accidentels; ou qu'il n'a ici que son mérite ordinaire d'éloquent orateur. Si, d'autre part, on pèse les témoignages des anciens et les circonstances des lieux, si l'on fait attention qu'auprès des pyramides il se trouve 30 à 40 moindres monuments, offrant des ébauches de la même figure pyramidale; que ce lieu stérile, écarté de la terre cultivable, a la qualité requise des Égyptiens pour être un cimetière, et que près de là était celui de toute la ville de Memphis, la plaine des Momies; on sera persuadé que les pyramides ne sont que des tombeaux. L'on croira que les despotes d'un peuple superstitieux ont pu mettre de l'importance et de l'orgueil à bâtir pour leur squelette une demeure impénétrable, quand on saura que, dès avant Moïse, il était de dogme à Memphis que les ames reviendraient au bout de 6,000 ans habiter les corps qu'elles avaient quittés: c'était par cette raison que l'on prenait tant de soin de préserver ces mêmes corps de la dissolution, et que l'on s'efforçait d'en conserver les formes au moyen des aromates, des bandelettes et des sarcophages. Celui qui est encore dans la chambre sépulcrale de la grande pyramide est précisément dans les dimensions naturelles; et cette chambre, si obscure et si étroite146, n'a jamais pu convenir qu'à loger un mort. On veut trouver du mystère à ce conduit souterrain qui descend perpendiculairement dans le dessous de la pyramide; mais on oublie que l'usage de toute l'antiquité fut de ménager des communications avec l'intérieur des tombeaux, pour y pratiquer, aux jours prescrits par la religion, les cérémonies funèbres, telles que les libations et les offrandes d'aliments aux morts. Il faut donc revenir à l'opinion, toute vieille qu'elle peut être, que les pyramides sont des tombeaux147; et cet emploi, indiqué par toutes les circonstances locales, l'est encore par un usage des Hébreux, qui, comme l'on sait, ont presque en tout imité les Égyptiens, et qui, à ce titre, donnèrent la forme pyramidale aux tombeaux d'Absalon et de Zakarie, que l'on voit encore dans la vallée de Josaphat: enfin, il est constaté par le nom même de ces monuments, qui, selon une analyse conforme à tous les principes de la science, me donne mot à mot, chambre ou caveau du mort148.
La grande pyramide n'est pas la seule qui ait été ouverte. Il y en a une autre à Saqâra qui offre les mêmes détails intérieurs. Depuis quelques années, un bek a tenté d'ouvrir la 3e en grandeur du local de Djizé, pour en tirer le trésor supposé. Il l'a attaquée par le même côté et à la même hauteur que la grande est ouverte; mais après avoir arraché 2 ou 300 pierres, avec des peines et une dépense considérable, il a quitté sans succès son avaricieuse entreprise. L'époque de la construction de la plupart des pyramides n'est pas connue; mais celle de la grande est si évidente, qu'on n'eût jamais dû la contester. Hérodote l'attribue à Cheops, avec un détail de circonstances qui prouve que ses auteurs étaient bien instruits149. Or ce Cheops, dans sa liste, la meilleure de toutes, se trouve le second roi après Protée150, qui fut contemporain de la guerre de Troie; et il en résulte, par l'ordre des faits, que sa pyramide fut construite vers les années 140 et 160 de la fondation du temple de Salomon, c'est-à-dire, 850 ans avant Jésus-Christ.
La main du temps, et plus encore celle des hommes, qui ont ravagé tous les monuments de l'antiquité, n'ont rien pu jusqu'ici contre les pyramides. La solidité de leur construction, et l'énormité de leur masse, les ont garanties de toute atteinte, et semblent leur assurer une durée éternelle. Les voyageurs en parlent tous avec enthousiasme, et cet enthousiasme n'est point exagéré. L'on commence à voir ces montagnes factices 10 lieues avant d'y arriver. Elles semblent s'éloigner à mesure qu'on s'en approche; on en est encore à une lieue, et déja elles dominent tellement sur la terre, qu'on croit être à leur pied; enfin l'on y touche, et rien ne peut exprimer la variété des sensations qu'on y éprouve151: la hauteur de leur sommet, la rapidité de leur pente; l'ampleur de leur surface, le poids de leur assiette, la mémoire des temps qu'elles rappellent; le calcul du travail qu'elles ont coûté, l'idée que ces immenses rochers sont l'ouvrage de l'homme si petit et si faible, qui rampe à leurs pieds; tout saisit à la fois le cœur et l'esprit d'étonnement, de terreur, d'humiliation, d'admiration, de respect: mais, il faut l'avouer, un autre sentiment succède à ce premier transport. Après avoir pris une si grande opinion de la puissance de l'homme, quand on vient à méditer l'objet de son emploi, on ne jette plus qu'un œil de regret sur son ouvrage; on s'afflige de penser que, pour construire un vain tombeau, il a fallu tourmenter 20 ans une nation entière; on gémit sur la foule d'injustices et de vexations qu'ont dû coûter les corvées onéreuses et du transport, et de la coupe, et de l'entassement de tant de matériaux. On s'indigne contre l'extravagance des despotes qui ont commandé ces barbares ouvrages; ce sentiment revient plus d'une fois en parcourant les monuments de l'Égypte: ces labyrinthes, ces temples, ces pyramides, dans leur massive structure, attestent bien moins le génie d'un peuple opulent et ami des arts, que la servitude d'une nation tourmentée par le caprice de ses maîtres. Alors on pardonne à l'avarice, qui, violant leurs tombeaux, a frustré leur espoir; on en accorde moins de pitié à ces ruines; et tandis que l'amateur des arts s'indigne dans Alexandrie de voir scier les colonnes des palais, pour en faire des meules de moulin, le philosophe, après cette première émotion que cause la perte de toute belle chose, ne peut s'empêcher de sourire à la justice secrète du sort, qui rend au peuple ce qui lui coûta tant de peines, et qui soumet au plus humble de ses besoins l'orgueil d'un luxe inutile.
C'est l'intérêt de ce peuple, sans doute, plus que celui des monuments, qui doit dicter le souhait de voir passer en d'autres mains l'Égypte; mais, ne fût-ce que sous cet aspect, cette révolution serait toujours très-désirable. Si l'Égypte était possédée par une nation amie des beaux-arts, on y trouverait, pour la connaissance de l'antiquité, des ressources que désormais le reste de la terre nous refuse; peut-être y découvrirait-on même des livres. Il n'y a pas 3 ans qu'on déterra près de Damiât plus de 100 volumes écrits en langue inconnue152; ils furent incontinent brûlés sur la décision des chaiks du Kaire. A la vérité le Delta n'offre plus de ruines bien intéressantes, parce que les habitants ont tout détruit par besoin ou par superstition. Mais le Saïd moins peuplé, mais la lisière du désert moins fréquentée en ont encore d'intactes. On en doit surtout espérer dans les Oasis; dans ces îles séparées du monde par une mer de sable, où nul voyageur connu n'a pénétré depuis Alexandre. Ces cantons, qui jadis avaient des villes et des temples, n'ayant point subi les dévastations des barbares, ont dû garder leurs monuments, par cela même que leur population a dépéri ou s'est anéantie; et ces monuments, enfouis dans les sables, s'y conservent comme en dépôt pour la génération future. C'est à ce temps, moins éloigné peut-être qu'on ne pense, qu'il faut remettre nos souhaits et notre espoir. C'est alors qu'on pourra fouiller de toutes parts la terre du Nil et les sables de la Libye; qu'on pourra ouvrir la petite pyramide de Djizé, qui, pour être démolie de fond en comble, ne coûterait pas 50,000 livres: c'est peut-être encore à cette époque qu'il faut remettre la solution des hiéroglyphes, quoique les secours actuels me paraissent suffisants pour y arriver.
Mais c'en est assez sur des sujets de conjectures: il est temps de passer à l'examen d'une autre contrée qui, sous les rapports de l'état ancien et de l'état moderne, n'est pas moins intéressante que l'Égypte elle-même.
Lorsque j'écrivais ceci en 1786, je ne connaissais pas la lettre d'Amrou au kalife Omar, laquelle traite précisément sous les mêmes rapports du même sujet. Le lecteur ne peut que me savoir gré de lui citer ce morceau curieux de l'éloquence orientale.
Lettre du kalife Omar ebn-el-Kattâb, à Amrou, son lieutenant en Égypte O Amrou, fils d'el-Aâs, ce que je désire de toi, à la réception de cette lettre, c'est que tu me fasses de l'Égypte une peinture assez exacte et assez vive pour que je puisse m'imaginer voir de mes propres yeux cette belle contrée. Salut.
Réponse d'Amrou O prince des fidèles! peins-toi un désert aride, et une campagne magnifique au milieu de deux montagnes, dont l'une a la forme d'une colline de sable, et l'autre du ventre d'un cheval étique ou du dos d'un chameau: voilà l'Égypte! Toutes ses productions et toutes ses richesses, depuis Asouan (Syène) jusqu'à Menchâ, viennent d'un fleuve béni qui coule avec majesté au milieu d'elle. Le moment de la crue et de la retraite de ses eaux est aussi réglé que le cours du soleil et de la lune; il y a une époque fixe dans l'année où toutes les sources de l'univers viennent payer à ce roi des fleuves le tribut auquel la Providence les a assujetties envers lui. Alors les eaux augmentent, sortent de son lit, et couvrent toute la face de l'Égypte pour y déposer un limon productif. Il n'y a plus de communication d'un village à l'autre, que par le moyen de barques légères, aussi nombreuses que les feuilles de palmier.
Lorsqu'ensuite arrive le moment où ses eaux cessent d'être nécessaires à la fertilité du sol, ce fleuve docile rentre dans les bornes que le destin lui a prescrites, pour laisser recueillir le trésor qu'il a caché dans le sein de la terre.
Un peuple protégé du ciel, et qui comme l'abeille ne semble destiné qu'à travailler pour les autres, sans profiter lui-même du prix de ses sueurs, ouvre légèrement les entrailles de la terre, et y dépose des semences dont il attend la fécondité du bienfait de cet être qui fait croître et mûrir les moissons.—Le germe se développe, la tige s'élève, l'épi se forme par le secours d'une rosée qui supplée aux pluies, et qui entretient le suc nourricier dont le sol est imbu. A la plus abondante récolte succède tout à coup la stérilité. C'est ainsi, ô prince des fidèles! que l'Égypte offre tour à tour l'image d'un désert poudreux, d'une plaine liquide et argentée, d'un marécage noir et limoneux, d'une prairie verte et ondoyante, d'un parterre orné de fleurs variées, et d'un guéret couvert de moissons jaunissantes: béni soit le créateur de tant de merveilles!
Trois choses, ô prince des fidèles! contribuent essentiellement à la prospérité de l'Égypte et au bonheur de ses habitants. La première, de ne point adopter légèrement des projets inventés par l'avidité fiscale, et tendants à accroître l'impôt; la seconde, d'employer le tiers des revenus à l'entretien des canaux, des ponts et des digues; la troisième, de ne lever l'impôt qu'en nature, sur les fruits que la terre produit. Salut.
[Закрыть]
Il y en eut un très-violent entre autres l'an 1112.
[Закрыть]
On peut, à ce sujet, consulter les planches de Norden, qui rendent cet état sensible.
[Закрыть]
Multum mentitur qui multum vidit
[Закрыть]
Personne n'a moins que moi de sujets d'humeur contre l'Égypte: j'y ai éprouvé, de la part de nos négociants, l'accueil le plus généreux et le plus honnête; jamais il ne m'est arrivé aucun accident désagréable, pas même de mettre pied à terre devant les Mamlouks. Il est vrai que le plus souvent, et malgré la honte qu'on y attribue, je ne marchais qu'à pied dans les rues.
[Закрыть]
La vue des pyramides, que je joins à cette édition, et qui manque aux premières, n'est pas prise du bord du fleuve même, qui en est trop distant, mais du bord du canal qui se trouve dans la plaine avant d'arriver au rocher, et qui n'est rempli qu'au temps de l'inondation. Le talent de l'artiste me paraît avoir donné dans ce dessin circonscrit l'idée la plus étendue et la plus exacte de ces prodigieux monuments.
[Закрыть]
A la liste de ces différences, alléguée par Savary, il faut ajouter la mesure récente de Niebuhr qui donne à la grande pyramide 480 pieds de hauteur perpendiculaire.
[Закрыть]
Je n'entends pas les seules pyramides de Djizé, mais toutes en général. Quelques-unes, comme celle de Bayamont, n'ont de rochers ni dessous, ni aux environs. Voyez Pocoke.
[Закрыть]
Néanmoins je ne conteste pas à la plus grande des pyramides la propriété que lui a découverte l'ingénieux et savant Dupuis.
[Закрыть]
Elle a 13 pas de long sur 11 de large, et à peu près autant de hauteur.
[Закрыть]
La grande pyramide elle-même en est un; mais s'il est constaté que le côté de sa base équivaut juste à 1 stade alexandrin (de 684 pieds 9 pouces 60 centièmes), et se trouve être exactement la 500 partie d'un degré du cercle terrestre, tel que nous-mêmes le connaissons; si, comme l'observe l'ingénieux et savant Dupuis, ses pans sont disposés sous un angle tel qu'à l'entrée du soleil dans les signes équinoxiaux son disque paraît placé au sommet pour le spectateur à genoux à la base, il faut convenir que dans la construction de celle-là l'on a combiné d'autres motifs. Au reste, ces questions seront bientôt éclaircies par les savants qui sont en Égypte.
[Закрыть]
Voici la marche de cette étymologie. Le mot français pyramide, est le grec pyramis, idos; mais dans l'ancien grec, l'y était prononcé ou; donc il faut dire pouramis. Lorsque les Grecs, après la guerre de Troie, fréquentèrent l'Égypte, ils ne devaient point avoir, dans leur langue, le nom de cet objet nouveau pour eux; ils dûrent l'emprunter des Égyptiens. Pouramis n'est donc pas grec, mais égyptien. Or, il paraît constant que les dialectes de l'Égypte, qui étaient variés, ont eu de grandes analogies avec ceux des pays voisins, tels que l'Arabie et la Syrie. Il est vrai que, dans ces langues, p est une prononciation inconnue; mais il est de fait aussi que les Grecs, en adoptant des mots barbares, les altéraient presque toujours, et confondaient souvent un son avec un autre à peu près semblable. Il est de fait encore, que, dans des mots connus, p se trouve sans cesse pris pour b, qui n'en diffère presque pas. Dans cette donnée, pouramis devient bouramis. Or, dans le dialecte de la Palestine, bour signifie toute excavation en terre, une citerne, une prison proprement souterraine, un sépulcre. Voyez Buxtorf, Lexicon hebr. Reste amis, où l's finale me paraît une terminaison substituée au t, qui n'était point dans le génie grec, et qui faisait l'oriental, a-mit, du mort; bour a-mit, caveau du mort; cette substitution de l's au t a un exemple dans atribis, bien connu pour être atribit: c'est aux connaisseurs à juger s'il est beaucoup d'étymologies qui réunissent autant de conditions que celle-ci.
[Закрыть]
Ce prince, dit-il, régna cinquante ans, et il en employa vingt à bâtir la pyramide. Le tiers de l'Égypte fut employé, par corvées, à tailler, à transporter et à élever les pierres.
[Закрыть]
Il est remarquable que si l'on écrivait le nom égyptien allégué par les Grecs, en caractères phéniciens, on se servirait des mêmes lettres que nous prononçons pharao; l'o final est dans l'hébreu un h, qui à la fin des mots devient très-souvent t.
[Закрыть]
Je ne connais rien de plus propre à figurer les pyramides, à Paris, que l'Hôtel des Invalides, vu du Cours-la-Reine. La longueur du bâtiment étant de six cents pieds, égale précisément la base de la grande pyramide; mais pour s'en figurer la hauteur et la solidité, il faut supposer que la face mentionnée s'élève en un triangle dont la pointe excède la hauteur du dôme des deux tiers de ce dôme même (il a 300 pieds): de plus, que la même face doit se répéter sur 4 côtés en carré, et que tout le massif qui en résulte, est plein, et n'offre à l'extérieur qu'un immense talus disposé, par gradins.
[Закрыть]
Je tiens ce fait des négociants d'Acre, qui le racontent sur la foi d'un capitaine de Marseille, qui, dans le temps, chargeait du riz à Damiât.
[Закрыть]