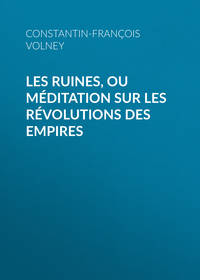Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Les Ruines, ou méditation sur les révolutions des empires», sayfa 22
Tout mon livre des Ruines, que vous traitez si mal, et qui vous a pourtant amusé, porte évidemment ce caractère: au moyen des opinions contrastantes que j'y ai jetées, il respire en général un esprit de doute et d'incertitude qui me paraît le plus convenable à la faiblesse de l'entendement humain, et le plus propre à son perfectionnement, en ce qu'il y laisse toujours une porte ouverte à des vérités nouvelles; tandis que l'esprit de certitude et de croyance fixe, bornant nos progrès à une première opinion reçue, nous enchaîne au hasard, et pourtant sans retour, au joug de l'erreur ou du mensonge, et cause les plus graves désordres dans l'état social; car, se combinant avec les passions, il engendre le fanatisme, qui, tantôt de bonne foi et tantôt hypocrite, toujours intolérant et despote, attaque tout ce qui n'est pas lui, se fait persécuter quand il est faible, devient persécuteur quand il est fort, et fonde une religion de terreur qui anéantit toutes les facultés, et démoralise toutes les consciences; tellement que, soit sous l'aspect politique, soit sous l'aspect religieux, l'esprit de doute se lie aux idées de liberté, de vérité, de génie; et l'esprit de certitude aux idées de tyrannie, d'abrutissement et d'ignorance.
D'ailleurs, si, comme il est vrai, l'expérience d'autrui et la nôtre nous apprennent chaque jour que ce qui nous a paru vrai dans un temps, nous semble ensuite prouvé faux dans un autre, comment pouvons-nous attribuer à nos jugements cette confiance aveugle et présomptueuse qui poursuit de tant de haine ceux d'autrui? Il est raisonnable, sans doute, et il est honnête d'agir selon la sensation présente et selon sa conviction; mais si, par la nature des choses, cette sensation varie en elle-même et dans ses causes, comment ose-t-on imposer à soi et aux autres une invariable conviction? comment surtout ose-t-on exiger cette conviction dans des cas où il n'y a point réellement de sensation, ainsi qu'il arrive dans les questions purement spéculatives, où l'on ne peut démontrer aucun fait présent?
Aussi lorsqu'ouvrant le livre de la nature, bien plus authentique et bien plus facile à lire que des feuilles de papier noirci de grec ou d'hébreu; lorsque je considère que la différence d'opinions de trente ou quarante religions, et de deux ou trois mille sectes, n'a pas apporté et n'apporte pas encore le plus petit changement dans le monde physique; lorsque je considère que le cours des saisons, la marche du soleil, la quantité de pluie et de beau temps sont les mêmes pour les habitants de chaque pays, chrétiens, musulmans, idolâtres, catholiques, protestants, etc., etc., je suis porté à croire que l'univers est gouverné par d'autres lois de justice et de sagesse que celles que suppose un égoïsme étroit et intolérant: et comme, en vivant avec des hommes de cultes très-divers, j'ai remarqué qu'ils avaient cependant des mœurs très-semblables; c'est-à-dire que dans toute secte chrétienne, mahométane, et même parmi des gens qui n'appartiennent à aucune, j'ai trouvé des hommes qui pratiquaient toutes les vertus privées ou publiques, et cela sans affectation; tandis que d'autres, parlant sans cesse de Dieu et de la religion, se livraient à toutes les habitudes perverses condamnées par leur propre croyance, je me suis persuadé que la partie morale était la seule essentielle comme elle est la seule démontrable des systèmes religieux; et comme de votre aveu même, page 62, le seul but de la religion est de rendre les hommes meilleurs pour les rendre plus heureux, j'ai conclu qu'il n'y avait réellement dans le monde que deux religions, celle du bon sens et de la bienfaisance, et celle de la malice et de l'hypocrisie.
En terminant cette lettre, M. le docteur, je me trouve embarrassé du sentiment que je dois vous offrir; car en me déclarant, page 123, qu'en tout cas vous ne vous souciez guère du mépris de gens comme moi43, quoique je ne vous en eusse jamais témoigné, vous m'indiquez clairement que vous ne vous souciez pas non plus de mon estime: c'est donc à votre bon goût et à votre discernement que je laisse le soin d'apprécier le sentiment qui convient à ma situation, et qui appartient à votre caractère.
C.-F. VOLNEY.
Philadelphie, 2 mars 1797.
DISCOURS
SUR
L'ÉTUDE PHILOSOPHIQUE
DES LANGUES
AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR
L'académie française a des séances de trois espèces, qu'il ne faut pas confondre: chaque semaine, elle tient une séance d'office, consacrée à la rédaction du Dictionnaire, objet spécial de son institution; chaque année, elle tient une séance publique, où elle rend compte de ses travaux; enfin, depuis deux ans, le premier mardi de chaque mois elle tient une séance privée, que l'on pourrait appeler réunion de famille. En s'imposant librement celle-ci, avec l'agrément du gouvernement, l'Académie française a eu le double but de resserrer les liens de l'amitié entre ses membres, et d'exciter leur émulation réciproque par la communication confidentielle de leurs ouvrages, projetés ou exécutés: ces lectures, auxquelles les seuls membres de l'Institut sont admis, procurent à leurs auteurs des observations dictées par la bienveillance et le bon goût. De ces séances, sont déja sorties, sur le sujet toujours profond de la grammaire, des idées lumineuses, et des fragmens d'histoire et de poésie d'un mérite éminent. À la séance d'octobre dernier, un académicien, dont le public a toujours accueilli les productions ingénieuses, termina la lecture d'une Dissertation sur l'origine, la formation, la variété, le progrès et le déclin des langues: les opinions se partagèrent sur certains points de sa théorie déja indiquée dans une feuille du Moniteur, il y a quelques années; ce partage est devenu le motif du présent discours.... Son auteur, conduit par ses études à d'autres résultats, a trouvé convenable de les exposer à son tour. Son travail, préparé rapidement pour novembre, n'a été lu que le premier mardi de décembre.... Les avis ont pu se partager aussi; mais le temps qui appartenait à une autre lecture, n'a pas permis d'entrer en discussion sur celle-ci......44; c'est donc sur sa propre responsabilité qu'il publie aujourd'hui son opinion, à laquelle le principal intérêt qu'il attache est d'appeler l'attention des esprits méditatifs sur une branche de connaissances trop peu cultivée en France.
DISCOURS SUR L'ÉTUDE PHILOSOPHIQUE DES LANGUES
§. 1er.
NOUVEAUTÉ DE CETTE ÉTUDE CHEZ LES MODERNES: IGNORANCE ABSOLUE DES ANCIENS À CET ÉGARD
Messieurs,
J'appelle étude philosophique des langues toute recherche impartiale tendante à connaître ce qui concerne les langues en général; à expliquer comment elles naissent et se forment; comment elles s'accroissent, s'établissent, s'altèrent et périssent; à montrer leurs affinités ou leurs différences, leur filiation, l'origine même de cette admirable faculté de parler, c'est-à-dire de manifester les idées de l'esprit par les sons de la bouche, sons qui à leur tour deviennent, à titre d'éléments, un sujet digne de méditation. L'un de nos confrères, pour qui nous professons tous des sentimens d'estime et d'amitié, a déja mérité nos remercîments par le soin qu'il a pris de porter notre attention vers un sujet si intimement lié à nos fonctions de grammairiens français: M. Andrieux, en s'interrogeant sur la plupart des questions que je viens de citer, nous en a fait sentir l'importance et l'étendue, en même temps que, par le doute méthodique dont il a revêtu ses opinions et ses vues, il nous a indiqué combien ce sujet nous est encore neuf et difficile. Aujourd'hui, Messieurs, si je marche sur sa trace, c'est moins avec la prétention de vous apporter un surcroît d'instruction qu'un surcroît de preuves de notre inexpérience, permettez-moi de dire nationale, et de notre infériorité, sur ces questions, relativement aux étrangers.
Eh! comment serions-nous avancés dans l'étude des langues, surtout dans l'étude philosophique, lorsque rien, dans notre éducation française, ne nous y prépare, lorsque, dans notre éducation littéraire et religieuse, divers préjugés y sèment des obstacles: nous nous vantons d'avoir eu pour maîtres les beaux esprits de Rome et de la Grèce; voyons-nous qu'aucun d'eux se soit occupé de l'étude des langues sous les rapports étendus que je viens de citer? Trouvons-nous dans leurs écrivains d'autre mention de langues et de langage que pour mépriser, sous le nom de Barbare, ce qui n'est pas romain ou grec? L'encyclopédiste Pline l'ancien nous instruit agréablement, sans doute, quand il nous dit que dans une ville de la Colchide, Rome entretenait cent trente interprètes pour répondre à cent trente peuples divers qui venaient y pratiquer un commerce déja déclinant, puisque Pline ajoute qu'antérieurement ils venaient au nombre de trois cents. J'entends encore avec un vif intérêt cet auteur me dire que dans l'Ibérie, la Gaule, l'Italie, on avait compté les langues par centaines; et je le conçois, quand je songe qu'avant les conquérants, chaque ville, chaque territoire nourrissait un peuple ennemi de son voisin, et séparé de lui en toutes choses; mais de telles citations et autres semblables n'atteignent point à nos questions: il y a plus, je ne me rappelle point avoir lu, en aucun auteur grec ou latin, la mention d'aucune grammaire étrangère composée par curiosité ou par motif de commerce ou d'instruction. Avons-nous même aucune grammaire grecque composée avant notre ère? Chez les Romains de la république, ce genre d'étude fut tardif; Varron seul le signale par son érudition et ses vues philosophiques.
§. II.
ÉCOLE GRECQUE: SYSTÈMES ÉTABLIS AVANT LES FAITS OBSERVÉS
Chez les Grecs comme chez les Romains, on peut dire que l'étude du langage n'a eu qu'un but rhétorique, je veux dire l'art d'émouvoir les passions, art suscité par la nature du gouvernement de ces peuples, long-temps resté plus ou moins démocratique: on ne peut le nier, ces peuples furent d'habiles artistes à cet égard; mais sous le point de vue d'étude philosophique du langage, je ne crains pas de dire qu'ils sont restés presque aussi enfants que les sauvages de l'Amérique du nord, les uns et les autres nous racontant gravement, sur l'autorité de leurs ancêtres, que l'art de parler fut inventé par les manitous, les génies et les dieux. Un peuple peut produire de grands peintres, de grands poëtes, de grands orateurs, sans être avancé dans aucune science exacte: ces talents tiennent à l'art d'exprimer les sensations et les passions; mais approfondir des connaissances métaphysiques telles que la formation des idées et leur manifestation par le langage, cela est d'une tout autre difficulté. Je ne vois que Platon, cette abeille de toute science, ce poëte de toute philosophie, qui montre en ce genre quelques aperçus dans son dialogue intitulé Kratyle; et cependant, après la lecture de ce morceau, on se trouve peu avancé dans la solution des deux questions proposées à Socrate: il est même permis de dire que le résultat le plus clair est l'artificieux procédé du compositeur, qui, ayant posé la double question de savoir si le langage est né de la nature des choses, ou de la convention des hommes, a déguisé son embarras sous les tergiversations de Socrate, qui raisonne tantôt pour et tantôt contre, et qui indique plutôt le faible que le fort de chaque opinion.
Aujourd'hui que, par les progrès généraux de la civilisation humaine et de toutes les connaissances physiques et morales, nous avons sous nos yeux plus de six cents vocabulaires de nations diverses, et plus de cent grammaires; aujourd'hui que, dans ces vocabulaires, nous voyons les objets des besoins les plus simples et les plus naturels exprimés par des noms totalement divers, les raisonnements de Platon deviennent bien peu de chose, et c'est aux faits que nous devons demander de l'instruction.
À côté des tâtonnements systématiques et des théories prématurées des anciens, je ne vois qu'un seul fait, presque puéril en apparence, mais qui donne lieu à des inductions assez lumineuses: je veux parler de expérience imaginée par un roi d'Égypte, dans l'intention de découvrir la race d'hommes là plus ancienne. Cette expérience nous est racontée par un historien dont les anciens n'ont point su apprécier le mérite, mais dont la fidélité, et l'instruction, constatées aujourd'hui par une élite de savants dans l'expédition française en Égypte, replacent l'autorité et le crédit au premier rang des témoignages anciens. Voici ce que dit cet historien, qui est Hérodote:
§. III.
ÉCOLE ÉGYPTIENNE
«Le roi Psamméticus fit remettre deux enfants nouveau-nés, pris au hasard, entre les mains d'un berger, chargé de les élever au milieu de ses troupeaux royaux, avec l'injonction de ne jamais proférer devant eux une seule parole, et de les laisser constamment seuls dans une habitation séparée. Ce berger devait leur amener des chèvres, à certains intervalles, les faire téter, et ne plus s'en occuper ensuite. Psamméticus, en prescrivant ces diverses précautions, se proposait de connaître, lorsque le temps des vagissements du premier âge serait passé, dans quel langage ces enfants commenceraient à s'exprimer. Les choses s'étant exécutées comme il l'avait ordonné, il arriva qu'après deux ans écoulés, au moment où le berger, qui s'était conformé aux instructions qu'il avait reçues, ouvrait la porte et se préparait à entrer, les deux enfants, tendant les mains vers lui, se mirent à crier ensemble, Bêkos. Le berger n'y fit d'abord pas beaucoup d'attention; mais en réitérant ses visites et ses observations, il remarqua que les enfants répétaient toujours le même mot: il en instruisit le roi, qui ordonna de les amener en sa présence. Psamméticus ayant ouï de leur bouche le mot bêkos, fit rechercher si cette expression avait un sens dans la langue de quelque peuple; il apprit que les Phrygiens s'en servaient pour dire du pain. Les Égyptiens, après avoir pesé les conséquences de cette expérience, consentirent à regarder les Phrygiens comme d'une race plus ancienne qu'eux.»
Raisonnons sur ce fait: des savants d'Égypte veulent, par l'entremise de leur roi, savoir quelle est la langue naturelle de l'homme; quelle langue il parle avant d'avoir eu aucun maître, et reçu ou fait aucune convention.
Ils ont donc cru, ces savants, qu'il y a une langue naturelle, un langage inné, un instinct de parler comme un instinct de manger et de marcher. Si leur opinion était vraie, toute langue originale, toute langue de peuple sauvage devrait être la même; tout individu égaré dans les forêts de Hanovre et de Champagne, comme nous en avons vu, devait dire bêk; or, nous ne voyons rien de semblable.
Nos savants de Psammétique ont cru que deux enfants séquestrés parleraient sans maître; ils n'ont donc pas cru le langage né des conventions de l'état social. Mais que serait, à quoi servirait une langue sans la société?
Les deux enfants ont prononcé un premier mot; ce mot, vous le sentez, n'a pas été précisément le grec bêk-os: l'historien s'est plié au génie de sa langue, à l'intolérante habitude de sa nation, qui veut toujours ajouter ses finales harmonieuses à la roideur des mots barbares. Les enfants ont dit bêk: les savants égyptiens ont supposé que ce mot était de pure invention; mais vous, Messieurs, qui calculez toutes les circonstances de cette épreuve, vous n'oubliez pas que ces enfants ont chaque jour entendu le cri de deux chèvres, et vous sentez qu'ils n'ont fait qu'imiter ce cri: cette imitation est une chose naturelle, et ici nous voyons l'onomatopée se montrer comme moyen premier du langage. Ces petites machines nerveuses ont répété le cri qui les frappait, et qui, s'étant lié à l'action de l'animal dont elles tiraient leur subsistance, est devenu l'indice de leurs besoins, de leur désir de boire et de manger; par cette liaison, la convention s'est établie entre les deux enfants et le berger ou tout autre être humain, même entre les enfants et la chèvre; et comme nous savons que la chèvre sent elle-même ce langage, nous y voyons la preuve que les animaux mêmes y participent dans la proportion de leurs facultés.
En vérité, c'est un sujet d'étonnement que de voir les savants de Psamméticus, sourds et aveugles à de tels indices; mais en même temps, c'est pour nous une nouvelle preuve que, quand notre esprit est imbu d'un préjugé, il perd la faculté de voir tout ce qui est hors de sa ligne; ce sont les yeux d'un malade de la jaunisse, qui ne peut voir les objets que jaunes; pourrions-nous bien répondre de notre santé à nous-mêmes, sur un nombre de sujets?
Nos Égyptiens s'enquièrent chez quel peuple existe le mot bêk; le hasard veut que dans la langue phrygienne il signifie pain, et les voilà qui concluent qu'il y a liaison intime, affinité naturelle entre le mot bêk et la substance pain: quelle misérable logique! D'abord le mot bêk a pu exister en d'autres langues; les Égyptiens en ont-ils fait la recherche chez les Chinois, les Tartares, les Indous, les Celtes, mêmes chez leurs voisins Arabico-Phéniciens? nous le trouverions, s'il était nécessaire, certainement avec d'autres sens. Mais en outre, comment ont-ils pu supposer un mot naturel, pour un objet qui ne l'est pas, qui est objet d'art, inventé tardivement, pour une opération très-compliquée, puisqu'il a fallu semer du froment, le recueillir, le battre, le moudre, le pétrir, le lever, le cuire pour en faire du pain; ensuite, comment sur un seul mot fonder une opinion généralisée? comment n'avoir pas continué l'expérience pour en voir le développement, et surtout la solution de la grande difficulté, celle de la construction grammaticale? Qui pourra nier qu'à cette époque tous ces savants n'aient été de grands enfants dans l'art des expériences, dans l'étude de la nature, dans la science subtile de l'idéologie?
Prenons acte de ce fait, pour apprécier les connaissances métaphysiques de l'ancien monde connu à cette époque; nous pouvons croire que les druides et les brahmanes n'étaient pas plus avancés.
C'était vers l'an 648, Thalès venait de naître; moins de deux siècles après, l'an 460, Hérodote était en Égypte, où il recevait cette anecdote consignée dans des mémoires historiques; il la racontait, quatorze ans plus tard, à la multitude des Grecs assemblés dans le Cirque Olympique (vers 446); quarante-six ans plus tard (vers l'an 400), Platon, qui avait voyagé et séjourné en Égypte, et qui connaissait le livre d'Hérodote, professait dans son dialogue de Kratyle l'opinion des savants égyptiens. Ne devient-il pas très-probable que Platon, ici, comme sur tant d'autres points, n'a été que l'écho des métaphysiciens d'Égypte?
Aristote, qui suivit Platon, et qui lui est supérieur en toute branche de science positive, n'est pas plus avancé ici; dira-t-on qu'il a implicitement résolu la question de la formation du langage par son axiome profond et célèbre, Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu (Rien n'est dans l'entendement qui n'ait d'abord été dans la sensation)? Sans doute, la conséquence est bien que l'homme seul a pu inventer les signes de ses idées; qu'aucun agent extérieur n'a pu lui souffler ou suggérer ces signes quand leurs modèles n'existaient pas; qu'en un mot le langage est le fruit de son organisation physique, et de ses conventions artificielles et sociales. Mais quand on voit combien peu Aristote lui-même a su tirer parti de son grand principe métaphysique, on ne peut nier que les conséquences n'en soient restées bien occultes, jusqu'à ce que Locke, il y a cent trente ans seulement, soit venu les mettre en une évidence qui a paru une création; encore est-il vrai que malgré qu'après lui l'esprit lumineux des Condillac et des Tracy ait de plus en plus éclairci le problème, il n'a point encore reçu tous les développements qu'il requiert.
L'école d'Alexandrie, qui fut le plus heureux fruit des conquêtes d'Alexandre, dut produire des recherches et des raisonnements sur nos questions; mais on a droit de penser qu'elle ne fut que l'écho du passé.
§ IV.
ÉCOLE JUIVE
À côté de cette école, je ne dirai pas, naquit, je dis, sortit de son obscurité l'école juive, qui, loin d'offrir rien de nouveau, ne fit que reproduire des doctrines surannées. En effet, lorsque la cosmogonie juive nous parle d'un premier couple humain, crée par Dieu, ou par les dieux, elle nous présente d'une manière seulement différente ce que disent la plupart des autres cosmogonies; et lorsqu'elle ajoute que le premier homme donna des noms propres à tous les oiseaux du ciel, à tous les animaux de la terre; comme plusieurs de ces noms, en langue hébraïque, sont caractéristiques de leurs facultés ou actions et propriétés, c'est-à-dire, de leur nature, il s'ensuit que l'auteur, ou les auteurs de cette cosmogonie, ont été dans l'opinion égyptienne que nous venons de voir, et à laquelle les idées innées de Platon ont du donner une nouvelle force. Cette induction en acquiert elle-même, quand les Juifs nous attestent que les sciences égyptiennes ont été la souche des leurs.
Je n'aperçois pas une semblable analogie à un autre fait qu'ils nous citent, relatif encore à la question des langues, je veux dire, celui de leur confusion à l'occasion de la tour de Babel, c'est-à-dire de la pyramide de Babylone, qui fut l'observatoire astronomique des prêtres chaldéens, cité par tous les historiens, comme existant depuis un temps immémorial. Il m'est d'autant plus nécessaire d'exposer ici le propre texte, Messieurs, que, par un cas étrange, vous allez voir qu'il se trouve ne pas porter le sens qu'on lui a donné jusqu'à ce jour.
«Toute la terre avait une seule lèvre (c'est-à-dire un seul langage, et un seul parler ou discours), et des hommes partis de l'Orient, s'établirent dans la vallée de Sennar, et ils se dirent: Pétrissons de la terre, cuisons des briques; et la brique leur devint pierre, la boue, mortier; et ils se dirent: Bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit dans le ciel; faisons-nous un nom (ou un signal: le mot hébreu a les deux sens), afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre: et Dieu, descendit pour voir cette tour, et il dit: Ce peuple n'a qu'une lèvre ou langue: rien ne les empêchera d'exécuter leur pensée (leur projet): descendons, et confondons leur lèvre; qu'ils ne s'entendent plus l'un l'autre; et Dieu les dispersa ainsi, et ils cessèrent de bâtir leur ville…»
Voilà, Messieurs, le texte littéral: il veut quelques observations grammaticales. D'abord, le mot hébreu traduit, la terre (Ars, en arabe Ard), n'a pas rigoureusement le sens que les interprètes lui donnent; ils avouent que les Hébreux n'ont eu aucune idée de la terre globe; que ce peuple a cru confusément qu'elle était une grande île portée sur l'eau, sans savoir sur quoi portait l'eau; que ce peuple parfaitement ignorant en toutes choses physiques45, ne connaissait rien à trois cents lieues au delà de ses frontières, etc. La vérité est que dans la langue hébraïque, le mot terre est habituellement pris pour pays, lequel n'a point de terme propre; partout on lit, la terre de Juda, la terre d'Israël, la terre de Chanaan, la terre d'Égypte, la terre de Sennar, ce qui ne signifie que pays: or, l'on n'a aucun droit de distinguer en français ou en latin, ce que l'original ne distingue pas; et si l'on veut raisonner par probabilités naturelles, on ouvre la porte à un genre de discussions que les interprètes entendent rejeter à leur gré.
Secondement, les interprètes et la Vulgate, qui les guide, ont traduit: «Faisons-nous un nom, une renommée, afin que nous ne soyons pas dispersés». Entre les deux membres de cette phrase, il n'y a aucune analogie. Je traduis avec le savant Vossius, faisons-nous un signal; ce qui est un des sens reconnus du mot hébreu (shem): là, il y a analogie; un signal élevé, visible de loin, est propre à empêcher la dispersion. Serai-je hérétique pour ces observations? Je pourrais en faire encore une sur ce mot: Dieu descendit, et de suite il est dit: descendons. Si je ne comprends pas ce surcroît de descente, l'une au singulier et l'autre au pluriel, serai-je traduit devant un jury anglais? J'arrive au fond de la question.
Le narrateur dit que toute la terre ou contrée n'avait qu'une langue, il ne la spécifie pas cette langue. Quelqu'un a-t-il le droit de décréter que ce fut l'hébraïque? il me semble que non; d'abord parce que le texte lui-même ne le spécifie pas; 2º parce que dans l'histoire d'Abraham, ce père de la race hébraïque, lorsque le texte dit qu'il naquit dans la terre de Sennar (bien connue pour être un pays syrien), qu'ensuite son père l'emmena dans le pays de Harran (également syrien), ce texte donne droit de penser que la langue nationale de la famille d'Abraham fut le syrien ou syriaque, dont, au temps de Jacob et de Laban, l'existence formelle nous est attestée, et se continue sans interruption jusqu'à des époques postérieures et certaines; 3º enfin, parce que l'on peut démontrer historiquement et grammaticalement que l'hébreu n'est qu'un dialecte phénicien formé depuis Abraham, par l'incorporation que lui et ses descendants ne cessèrent de faire à leur naissante et faible tribu, des naturels du pays où ils s'établirent.
Je ne prétends point contester aux interprètes, que les constructeurs de la tour de Babylone aient tout à coup oublié leur langue; je ne me fais pas juge des possibilités naturelles: une langue peut s'oublier par un mal subit de cerveau; mais décréter, comme le font nos infaillibles, que ces constructeurs parlèrent tout à coup des langues nouvelles, c'est ce que je nierais dans un concile, parce que le texte m'y autorise par son silence; il dit nûment: Confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus l'un l'autre; or, ceci ne dit pas du tout qu'ils parlèrent d'autres langues, mais seulement qu'ils cessèrent de se comprendre; et ils purent cesser par défaut de prononciation, par bredouillage, par confusion de termes, par emploi involontaire d'un mot pour l'autre; enfin, d'une manière que l'on n'a ni l'obligation, ni le droit de spécifier; ils ne s'entendirent plus, voilà tout.
Actuellement, Messieurs, appréciez l'extrême légèreté, la préoccupation aveugle de tant de docteurs qui ont voulu, qui veulent encore que cet événement soit la source où il faut chercher l'origine des innombrables langues qu'a parlées et que parle l'espèce humaine. Lesquels des savants de Psamméticus ou des nôtres sont les plus aveugles, les plus entêtés de préjugés?
Si je trouve à l'ancienne doctrine juive, sur le langage naturel, une analogie, et presqu'une origine profane, je n'assurerai pas que j'en trouve une semblable au récit historique que je viens de vous présenter; néanmoins, vous me permettrez une citation qui est du moins singulière; elle m'est fournie par les historiens de cette même ville de Babylone, dans un récit que nous a transmis Diodore de Sicile.
«Après la mort de Ninus, fondateur de l'empire assyrien, sa femme, Sémiramis, compagne et rivale de sa gloire, voulut, par des actions étonnantes, surpasser son mari. Ninus avait employé plusieurs années à bâtir une ville, immense à la vérité, mais qui, placée en pays montueux, sur un fleuve rebelle (le Tigre), n'était qu'une grande et inerte bourgade. Sémiramis voulut construire une cité commerciale et militaire, qui fût à la fois l'entrepôt des marchandises de l'Inde et de la basse Asie, le boulevard d'un pays riche par lui-même, l'asyle d'une population nombreuse contre l'invasion de l'ennemi, l'épouvantail des Arabes du désert, et en même temps le marché nécessaire et opulent qui les attirât en temps de paix: en un mot, Sémiramis traça le plan de Babylone; ce fut un carré de douze mille mètres, ou trois lieues de longueur sur chaque côté, flanqué d'un mur de soixante-quinze pieds de hauteur, etc. Sémiramis projetant déja d'autres grandes entreprises, statua que celle-ci ne durerait qu'un an; pour cet effet, elle leva une corvée de deux millions d'hommes, pris dans la population bigarrée de son vaste empire, depuis les sources de l'Indus jusqu'à l'Euxin (ou mer Noire), et depuis le Caucase jusqu'à l'Arabie Heureuse. Qu'on se figure la sensation, la rumeur que dut causer le spectacle d'une telle multitude diverse de costumes, de mœurs, et surtout de langages ou de dialectes dont le nombre a pu passer quatre-vingts ou cent! Qu'on voie cette multitude, jetée confusément, distribué militairement sur ses ateliers; occupée principalement à fabriquer l'incroyable quantité de briques qu'exigèrent de telles murailles, et des quais proportionnés sur l'Euphrate, et un pont, et deux châteaux forts; enfin, une pyramide appelée tour par les gens du pays, c'est-à-dire par les Arabes chaldéens, dont le dialecte, comme l'hébreu et le syrien, n'a que le mot tour pour exprimer tout édifice saillant et élevé46. Cette tour, encore subsistante au temps d'Hérodote, et qui, sur trois cent sept pieds de base, et autant d'élévation, dut être un objet si frappant dans une plaine rase, ne fut pas un stérile monument comme ceux d'Égypte: ce fut un magnifique et utile cadeau que l'habile Sémiramis fit aux prêtres du pays, les chaldéens, pour leur servir d'observatoire astronomique, et favoriser de plus en plus l'étude d'une science qui les avait rendus célèbres au dehors, et puissants au dedans, sur l'esprit d'un peuple conquis que cette reine voulait apprivoiser. Qu'on juge de l'étonnement de ce peuple ignorant et superstitieux, ne connaissant que sa langue arabe et que le désert qui entourait son île. Supposons que deux ou trois cents ans après ont eût demandé à de telles gens pourquoi et comment avait été bâtie cette montagne, il me semble entendre ces Arabes répondre:
«Aux temps anciens, il vint du côté de la Perse (qui est l'Orient) des hommes puissants à qui il prit fantaisie d'élever cette tour; ils voulaient, dit-on, monter au ciel, et cela pour regarder nos dieux (c'est-à-dire les astres, dieux du temps et du pays); mais la confusion se mit dans leur langage, par un pouvoir divin, et ils furent obligés de se disperser (comme firent les ouvriers de Sémiramis); en mémoire de cet événement, cette ville a gardé chez nous le nom de Babul, c'est-à-dire confusion47.»
Ce langage est d'autant plus étrange, que dès long-temps M. Priestley n'avait reçu de ma part que des honnêtetés. En 1791 je lui adressai un mémoire sur la chronologie, à l'occasion des tableaux qu'il avait publiés: pour toute réponse il m'injuria en 1792..... Après m'avoir injurié, me trouvant ici l'hiver dernier, il me fit prier à dîner chez son hôte et ami M. Russell; après m'avoir fait beaucoup de politesses à ce dîner, il m'invective de nouveau dans un pamphlet; après m'avoir invectivé, il me rencontre dans la rue de Spruce, veut me prendre la main comme à un ami, et il parle de moi sous ce nom en grande compagnie. Je demande au public, qu'est-ce que le docteur Priestley?