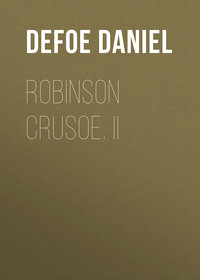Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Robinson Crusoe. II», sayfa 3
COMBAT AVEC LES LOUPS
La nuit approchait et commençait à se faire noire, ce qui empirait notre situation; et, comme le bruit croissait, nous pouvions aisément reconnaître les cris et les hurlements de ces bêtes infernales. Soudain nous apperçûmes deux ou trois troupes de loups sur notre gauche, une derrière nous et une à notre front, de sorte que nous en semblions environnés. Néanmoins, comme elles ne nous assaillaient point, nous poussâmes en avant aussi vite que pouvaient aller nos chevaux, ce qui, à cause de l'âpreté du chemin, n'était tout bonnement qu'un grand trot. De cette manière nous vînmes au-delà de la plaine, en vue de l'entrée du bois à travers lequel nous devions passer; mais notre surprise fut grande quand, arrivés au défilé, nous apperçûmes, juste à l'entrée, un nombre énorme de loups à l'affût.
Tout-à-coup vers une autre percée du bois nous entendîmes la détonation d'un fusil; et comme nous regardions de ce côté, sortit un cheval, sellé et bridé, fuyant comme le vent, et ayant à ses trousses seize ou dix-sept loups haletants: en vérité il les avait sur ses talons. Comme nous ne pouvions supposer qu'il tiendrait à cette vitesse, nous ne mîmes pas en doute qu'ils finiraient par le joindre; infailliblement il en a dû être ainsi.
Un spectacle plus horrible encore vint alors frapper nos regards: ayant gagné la percée d'où le cheval était sorti, nous trouvâmes les cadavres d'un autre cheval et de deux hommes dévorés par ces bêtes cruelles. L'un de ces hommes était sans doute le même que nous avions entendu tirer une arme à feu, car il avait près de lui un fusil déchargé. Sa tête et la partie supérieure de son corps étaient rongées.
Cette vue nous remplit d'horreur, et nous ne savions où porter nos pas; mais ces animaux, alléchés par la proie, tranchèrent bientôt la question en se rassemblant autour de nous. Sur l'honneur, il y en avait bien trois cents! – Il se trouvait, fort heureusement pour nous, à l'entrée du bois, mais à une petite distance, quelques gros arbres propres à la charpente, abattus l'été d'auparavant, et qui, je le suppose, gisaient là en attendant qu'on les charriât. Je menai ma petite troupe au milieu de ces arbres, nous nous rangeâmes en ligne derrière le plus long, j'engageai tout le monde à mettre pied à terre, et, gardant ce tronc devant nous comme un parapet, à former un triangle ou trois fronts, renfermant nos chevaux dans le centre.
Nous fîmes ainsi et nous fîmes bien, car jamais il ne fut plus furieuse charge que celle qu'exécutèrent sur nous ces animaux quand nous fûmes en ce lieu: ils se précipitèrent en grondant, montèrent sur la pièce de charpente qui nous servait de parapet, comme s'ils se jetaient sur leur proie. Cette fureur, à ce qu'il paraît, était surtout excitée par la vue des chevaux placés derrière nous: c'était là la curée qu'ils convoitaient. J'ordonnai à nos hommes de faire feu comme auparavant, de deux hommes l'un, et ils ajustèrent si bien qu'ils tuèrent plusieurs loups à la première décharge; mais il fut nécessaire de faire un feu roulant, car ils avançaient sur nous comme des diables, ceux de derrière poussant ceux de devant.
Après notre seconde fusillade, nous pensâmes qu'ils s'arrêteraient un peu, et j'espérais qu'ils allaient battre en retraite; mais ce ne fût qu'une lueur, car d'autres s'élancèrent de nouveau. Nous fîmes donc nos salves de pistolets. Je crois que dans ces quatre décharges nous en tuâmes bien dix-sept ou dix-huit et que nous en estropiâmes le double. Néanmoins ils ne désemparaient pas.
Je ne me souciais pas de tirer notre dernier coup trop à la hâte. J'appelai donc mon domestique, non pas mon serviteur VENDREDI, il était mieux employé: durant l'engagement il avait, avec la plus grande dextérité imaginable chargé mon fusil et le sien; mais, comme je disais, j'appelai mon autre homme, et, lui donnant une corne à poudre, je lui ordonnai de faire une grande traînée le long de la pièce de charpente. Il obéit et n'avait eu que le temps de s'en aller, quand les loups y revinrent, et quelques-uns étaient montés dessus, lorsque moi, lâchant près de la poudre le chien d'un pistolet déchargé, j'y mis le feu. Ceux qui se trouvaient sur la charpente furent grillés, et six ou sept d'entre eux tombèrent ou plutôt sautèrent parmi nous, soit par la force ou par la peur du feu. Nous les dépêchâmes en un clin-d'œil; et les autres furent si effrayés de cette explosion, que la nuit fort près alors d'être close rendit encore plus terrible, qu'ils se reculèrent un peu.
Là-dessus je commandai de faire une décharge générale de nos derniers pistolets, après quoi nous jetâmes un cri. Les loups alors nous montrèrent les talons, et aussitôt nous fîmes une sortie sur une vingtaine d'estropiés que nous trouvâmes se débattant par terre, et que nous taillâmes à coups de sabre, ce qui répondit à notre attente; car les cris et les hurlements qu'ils poussèrent furent entendus par leurs camarades, si bien qu'ils prirent congé de nous et s'enfuirent.
Nous en avions en tout expédié une soixantaine, et si c'eût été en plein jour nous en aurions tué bien davantage. Le champ de bataille étant ainsi balayé, nous nous remîmes en route, car nous avions encore près d'une lieue à faire. Plusieurs fois chemin faisant nous entendîmes ces bêtes dévorantes hurler et crier dans les bois, et plusieurs fois nous nous imaginâmes en voir quelques-unes; mais, nos yeux étant éblouis par la neige, nous n'en étions pas certains. Une heure après nous arrivâmes à l'endroit où nous devions loger. Nous y trouvâmes la population glacée d'effroi et sous les armes, car la nuit d'auparavant les loups et quelques ours s'étaient jetés dans le village et y avaient porté l'épouvante. Les habitants étaient forcés de faire le guet nuit et jour, mais surtout la nuit, pour défendre leur bétail et se défendre eux-mêmes.
Le lendemain notre guide était si mal et ses membres si enflés par l'apostème de ses deux blessures, qu'il ne put aller plus loin. Là nous fûmes donc obligés d'en prendre un nouveau pour nous conduire à Toulouse, où nous ne trouvâmes ni neige, ni loups, ni rien de semblable, mais un climat chaud et un pays agréable et fertile. Lorsque nous racontâmes notre aventure à Toulouse, on nous dit que rien n'était plus ordinaire dans ces grandes forêts au pied des montagnes, surtout quand la terre était couverte de neige. On nous demanda beaucoup quelle espèce de guide nous avions trouvé pour oser nous mener par cette route dans une saison si rigoureuse, et on nous dit qu'il était fort heureux que nous n'eussions pas été touts dévorés. Au récit que nous fîmes de la manière dont nous nous étions placés avec les chevaux au milieu de nous, on nous blâma excessivement, et on nous affirma qu'il y aurait eu cinquante à gager contre un que nous eussions dû périr; car c'était la vue des chevaux qui avait rendu les loups si furieux: ils les considéraient comme leur proie; qu'en toute autre occasion ils auraient été assurément effrayés de nos fusils; mais, qu'enrageant de faim, leur violente envie d'arriver jusqu'aux chevaux les avait rendus insensibles au danger, et si, par un feu roulant et à la fin par le stratagème de la traînée de poudre, nous n'en étions venus à bout, qu'il y avait gros à parier que nous aurions été mis en pièces; tandis que, si nous fussions demeurés tranquillement à cheval et eussions fait feu comme des cavaliers, ils n'auraient pas autant regardé les chevaux comme leur proie, voyant des hommes sur leur dos. Enfin on ajoutait que si nous avions mis pied à terre et avions abandonné nos chevaux, ils se seraient jetés dessus avec tant d'acharnement que nous aurions pu nous éloigner sains et saufs, surtout ayant en main des armes à feu et nous trouvant en si grand nombre.
Pour ma part, je n'eus jamais de ma vie un sentiment plus profond du danger; car, lorsque je vis plus de trois cents de ces bêtes infernales, poussant des rugissements et la gueule béante, s'avancer pour nous dévorer, sans que nous eussions rien pour nous réfugier ou nous donner retraite, j'avais cru que c'en était fait de moi. N'importe! je ne pense pas que je me soucie jamais de traverser les montagnes; j'aimerais mieux faire mille lieues en mer, fussé-je sûr d'essuyer une tempête par semaine.
Rien qui mérite mention ne signala mon passage à travers la France, rien du moins dont d'autres voyageurs n'aient donné le récit infiniment mieux que je ne le saurais. Je me rendis de Toulouse à Paris; puis, sans faire nulle part un long séjour, je gagnai Calais, et débarquai en bonne santé à Douvres, le 14 janvier, après avoir eu une âpre et froide saison pour voyager.
J'étais parvenu alors au terme de mon voyage, et en peu de temps j'eus autour de moi toutes mes richesses nouvellement recouvrées, les lettres de change dont j'étais porteur ayant été payées couramment.
Mon principal guide et conseiller privé ce fut ma bonne vieille veuve, qui, en reconnaissance de l'argent que je lui avais envoyé, ne trouvait ni peines trop grandes ni soins trop onéreux quand il s'agissait de moi. Je mis pour toutes choses ma confiance en elle si complètement, que je fus parfaitement tranquille quant à la sûreté de mon avoir; et, par le fait, depuis, le commencement jusqu'à la fin, je n'eus qu'à me féliciter de l'inviolable intégrité de cette bonne gentlewoman.
J'eus alors la pensée de laisser mon avoir à cette femme, et de passer à Lisbonne, puis de là au Brésil; mais de nouveaux scrupules religieux vinrent m'en détourner2. – Je pris donc le parti de demeurer dans ma patrie, et, si j'en pouvais trouver le moyen, de me défaire de ma plantation3.
Dans ce dessein j'écrivis à mon vieil ami de Lisbonne. Il me répondit qu'il trouverait aisément à vendre ma plantation dans le pays; mais que, si je consentais à ce qu'au Brésil il l'offrit en mon nom aux deux marchands, les survivants de mes curateurs, que je savais fort riches, et qui, se trouvant sur les lieux, en connaissaient parfaitement la valeur, il était sûr qu'ils seraient enchantés d'en faire l'acquisition, et ne mettait pas en doute que je ne pusse en tirer au moins 4 ou 5,000 pièces de huit.
J'y consentis donc et lui donnai pour cette offre mes instructions, qu'il suivit. Au bout de huit mois, le bâtiment étant de retour, il me fit savoir que la proposition avait été acceptée, et qu'ils avaient adressé 33,000 pièces de huit à l'un de leurs correspondants à Lisbonne pour effectuer le paiement.
De mon côté je signai l'acte de vente en forme qu'on m'avait expédié de Lisbonne, et je le fis passer à mon vieil ami, qui m'envoya des lettres de change pour 32,800 pièces de huit 4, prix de ma propriété, se réservant le paiement annuel de 100 MOIDORES pour lui, et plus tard pour son fils celui viager de 50 MOIDORES 5, que je leur avais promis et dont la plantation répondait comme d'une rente inféodée. – Voici que j'ai donné la première partie de ma vie de fortune et d'aventures, vie qu'on pourrait appeler une marqueterie de la Providence, vie d'une bigarrure telle que le monde en pourra rarement offrir de semblable. Elle commença follement, mais elle finit plus heureusement qu'aucune de ses circonstances ne m'avait donné lieu de l'espérer.
LES DEUX NEVEUX
On pensera que, dans cet état complet de bonheur, je renonçai à courir de nouveaux hasards, et il en eût été ainsi par le fait si mes alentours m'y eussent aidé; mais j'étais accoutumé à une vie vagabonde: je n'avais point de famille, point de parents; et, quoique je fusse riche, je n'avais pas fait beaucoup de connaissances. – Je m'étais défait de ma plantation au Brésil: cependant ce pays ne pouvait me sortir de la tête, et j'avais une grande envie de reprendre ma volée; je ne pouvais surtout résister au violent désir que j'avais de revoir mon île, de savoir si les pauvres Espagnols l'habitaient, et comment les scélérats que j'y avais laissés en avaient usé avec eux6.
Ma fidèle amie la veuve me déconseilla de cela, et m'influença si bien que pendant environ sept ans elle prévint mes courses lointaines. Durant ce temps je pris sous ma tutelle mes deux neveux, fils d'un de mes frères. L'aîné ayant quelque bien, je l'élevai comme un gentleman, et pour ajouter à son aisance je lui constituai un legs après ma mort. Le cadet, je le confiai à un capitaine de navire, et au bout de cinq ans, trouvant en lui un garçon judicieux, brave et entreprenant, je lui confiai un bon vaisseau et je l'envoyai en mer. Ce jeune homme m'entraîna moi-même plus tard, tout vieux que j'étais, dans de nouvelles aventures.
Cependant je m'établis ici en partie, car premièrement je me mariai, et cela non à mon désavantage ou à mon déplaisir. J'eus trois enfants, deux fils et une fille; mais ma femme étant morte et mon neveu revenant à la maison après un fort heureux voyage en Espagne, mes inclinations à courir le monde et ses importunités prévalurent, et m'engagèrent à m'embarquer dans son navire comme simple négociant pour les Indes-Orientales. Ce fut en l'année 1694.
Dans ce voyage je visitai ma nouvelle colonie dans l'île, je vis mes successeurs les Espagnols, j'appris toute l'histoire de leur vie et celle des vauriens que j'y avais laissés; comment d'abord ils insultèrent les pauvres Espagnols, comment plus tard ils s'accordèrent, se brouillèrent, s'unirent et se séparèrent, et comment à la fin les Espagnols furent obligés d'user de violence; comment ils furent soumis par les Espagnols, combien les Espagnols en usèrent honnêtement avec eux. C'est une histoire, si elle était écrite, aussi pleine de variété et d'événements merveilleux que la mienne, surtout aussi quant à leurs batailles avec les caribes qui débarquèrent dans l'île, et quant aux améliorations qu'ils apportèrent à l'île elle-même. Enfin, j'appris encore comment trois d'entre eux firent une tentative sur la terre ferme et ramenèrent cinq femmes et onze hommes prisonniers, ce qui fit qu'à mon arrivée je trouvai une vingtaine d'enfants dans l'île.
J'y séjournai vingt jours environ et j'y laissai de bonnes provisions de toutes choses nécessaires, principalement des armes, de la poudre, des balles, des vêtements, des outils et deux artisans que j'avais amenés d'Angleterre avec moi, nommément un charpentier et un forgeron.
En outre je leur partageai le territoire: je me réservai la propriété de tout, mais je leur donnai respectivement telles parts qui leur convenaient. Ayant arrêté toutes ces choses avec eux et les ayant engagé à ne pas quitter l'île, je les y laissai.
De là je touchai au Brésil, d'où j'envoyai une embarcation que j'y achetai et de nouveaux habitants pour la colonie. En plus des autres subsides, je leur adressais sept femmes que j'avais trouvées propres pour le service ou pour le mariage si quelqu'un en voulait. Quant aux Anglais, je leur avais promis, s'ils voulaient s'adonner à la culture, de leur envoyer des femmes d'Angleterre avec une bonne cargaison d'objets de nécessité, ce que plus tard je ne pus effectuer. Ces garçons devinrent très-honnêtes et très-diligents après qu'on les eut domtés et qu'ils eurent établi à part leurs propriétés. Je leur expédiai aussi du Brésil cinq vaches dont trois près de vêler, quelques moutons et quelques porcs, qui lorsque je revins étaient considérablement multipliés.
Mais de toutes ces choses, et de la manière dont 300 caribes firent une invasion et ruinèrent leurs plantations; de la manière dont ils livrèrent contre cette multitude de Sauvages deux batailles, où d'abord ils furent défaits et perdirent un des leurs; puis enfin, une tempête ayant submergé les canots de leurs ennemis, de la manière dont ils les affamèrent, les détruisirent presque touts, restaurèrent leurs plantations, en reprirent possession et vécurent paisiblement dans l'île7.
De toutes ces choses, dis-je, et de quelques incidents surprenants de mes nouvelles aventures durant encore dix années, je donnerai une relation plus circonstanciée ci-après.
Ce proverbe naïf si usité en Angleterre, ce qui est engendré dans l'os ne sortira pas de la chair8, ne s'est jamais mieux vérifié que dans l'histoire de ma vie. On pourrait penser qu'après trente-cinq années d'affliction et une multiplicité d'infortunes que peu d'hommes avant moi, pas un seul peut-être, n'avait essuyées, et qu'après environ sept années de paix et de jouissance dans l'abondance de toutes choses, devenu vieux alors, je devais être à même ou jamais d'apprécier touts les états de la vie moyenne et de connaître le plus propre à rendre l'homme complètement heureux. Après tout ceci, dis-je, on pourrait penser que la propension naturelle à courir, qu'à mon entrée dans le monde j'ai signalée comme si prédominante en mon esprit, était usée; que la partie volatile de mon cerveau était évaporée ou tout au moins condensée, et qu'à soixante-et-un ans d'âge j'aurais le goût quelque peu casanier, et aurais renoncé à hasarder davantage ma vie et ma fortune.
Qui plus est, le commun motif des entreprises lointaines n'existait point pour moi: je n'avais point de fortune à faire, je n'avais rien à rechercher; eussé-je gagné 10,000 livres sterling, je n'eusse pas été plus riche: j'avais déjà du bien à ma suffisance et à celle de mes héritiers, et ce que je possédais accroissait à vue d'œil; car, n'ayant pas une famille nombreuse, je n'aurais pu dépenser mon revenu qu'en me donnant un grand train de vie, une suite brillante, des équipages, du faste et autres choses semblables, aussi étrangères à mes habitudes qu'à mes inclinations. Je n'avais donc rien à faire qu'à demeurer tranquille, à jouir pleinement de ce que j'avais acquis et à le voir fructifier chaque jour entre mes mains.
Aucune de ces choses cependant n'eut d'effet sur moi, ou du moins assez pour étouffer le violent penchant que j'avais à courir de nouveau le monde, penchant qui m'était inhérent comme une maladie chronique. Voir ma nouvelle plantation dans l'île, et la colonie que j'y avais laissée, était le désir qui roulait le plus incessamment dans ma tête. Je rêvais de cela toute la nuit et mon imagination s'en berçait tout le jour. C'était le point culminant de toutes mes pensées, et mon cerveau travaillait cette idée avec tant de fixité et de contention que j'en parlais dans mon sommeil. Bref, rien ne pouvait la bannir de mon esprit; elle envahissait si tyranniquement touts mes entretiens, que ma conversation en devenait fastidieuse; impossible à moi de parler d'autre chose: touts mes discours rabâchaient là-dessus jusqu'à l'impertinence, jusque là que je m'en apperçus moi-même.
J'ai souvent entendu dire à des personnes de grand sens que touts les bruits accrédités dans le monde sur les spectres et les apparitions sont dus à la force de l'imagination et au puissant effet de l'illusion sur nos esprits; qu'il n'y a ni revenants, ni fantômes errants, ni rien de semblable; qu'à force de repasser passionnément la vie et les mœurs de nos amis qui ne sont plus, nous nous les représentons si bien qu'il nous est possible en des circonstances extraordinaires de nous figurer les voir, leur parler et en recevoir des réponses, quand au fond dans tout cela il n'y a qu'ombre et vapeur. – Et par le fait, c'est chose fort incompréhensible.
Pour ma part, je ne sais encore à cette heure s'il y a de réelles apparitions, des spectres, des promenades de gens après leur mort, ou si dans toutes les histoires de ce genre qu'on nous raconte il n'y a rien qui ne soit le produit des vapeurs, des esprits malades et des imaginations égarées; mais ce que je sais, c'est que mon imagination travaillait à un tel degré et me plongeait dans un tel excès de vapeurs, ou qu'on appelle cela comme on voudra, que souvent je me croyais être sur les lieux mêmes, à mon vieux château derrière les arbres, et voyais mon premier Espagnol, le père de VENDREDI et les infâmes matelots que j'avais laissés dans l'île. Je me figurais même que je leur parlais; et bien que je fusse tout-à-fait éveillé, je les regardais fixement comme s'ils eussent été en personne devant moi. J'en vins souvent à m'effrayer moi-même des objets qu'enfantait mon cerveau. – Une fois, dans mon sommeil, le premier Espagnol et le père de VENDREDI me peignirent si vivement la scélératesse des trois corsaires de matelots, que c'était merveille. Ils me racontaient que ces misérables avaient tenté cruellement de massacrer touts les Espagnols, et qu'ils avaient mis le feu aux provisions par eux amassées, à dessein de les réduire à l'extrémité et de les faire mourir de faim, choses qui ne m'avaient jamais été dites, et qui pourtant en fait étaient toutes vraies. J'en étais tellement frappé, et c'était si réel pour moi, qu'à cette heure je les voyais et ne pouvais qu'être persuadé que cela était vrai ou devait l'être. Aussi quelle n'était pas mon indignation quand l'Espagnol faisait ses plaintes, et comme je leur rendais justice en les traduisant devant moi et les condamnant touts trois à être pendus! On verra en son lieu ce que là-dedans il y avait de réel; car quelle que fût la cause de ce songe et quels que fussent les esprits secrets et familiers qui me l'inspirassent, il s'y trouvait, dis-je, toutefois beaucoup de choses exactes. J'avoue que ce rêve n'avait rien de vrai à la lettre et dans les particularités; mais l'ensemble en était si vrai, l'infâme et perfide conduite de ces trois fieffés coquins ayant été tellement au-delà de tout ce que je puis dire, que mon songe n'approchait que trop de la réalité, et que si plus tard je les eusse punis sévèrement et fait pendre touts, j'aurais été dans mon droit et justifiable devant Dieu et devant les hommes.
Mais revenons à mon histoire. Je vécus quelques années dans cette situation d'esprit: pour moi nulle jouissance de la vie, point d'heures agréables, de diversion attachante, qui ne tinssent en quelque chose à mon idée fixe; à tel point que ma femme, voyant mon esprit si uniquement préoccupé, me dit un soir très-gravement qu'à son avis j'étais sous le coup de quelque impulsion secrète et puissante de la Providence, qui avait décrété mon retour là-bas, et qu'elle ne voyait rien qui s'opposât à mon départ que mes obligations envers une femme et des enfants. Elle ajouta qu'à la vérité elle ne pouvait songer à aller avec moi; mais que, comme elle était sûre que si elle venait à mourir, ce voyage serait la première chose que j'entreprendrais, et que, comme cette chose lui semblait décidée là-haut, elle ne voulait pas être l'unique empêchement; car, si je le jugeais convenable et que je fusse résolu à partir… Ici elle me vit si attentif à ses paroles et la regarder si fixement, qu'elle se déconcerta un peu et s'arrêta. Je lui demandai pourquoi elle ne continuait point et n'achevait pas ce qu'elle allait me dire; mais je m'apperçus que son cœur était trop plein et que des larmes roulaient dans ses yeux.