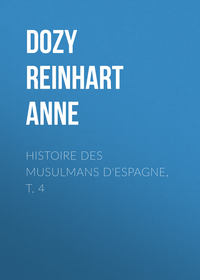Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Histoire des Musulmans d'Espagne, t. 4», sayfa 13
La nuit ayant étendu les ténèbres sur la terre en guise d’un voile immense, je buvais, à la lueur des flambeaux, le vin qui scintillait dans la coupe, lorsque soudain la lune se montra, accompagnée d’Orion. On eût dit une reine superbe et magnifique, voulant jouir des beautés de la nature, et se servant d’Orion comme d’un dais. Peu à peu d’autres étoiles étincelantes vinrent l’entourer, l’une à l’envi de l’autre; d’instant en instant la splendeur s’augmentait, et dans le cortège les Pléiades semblaient le drapeau de la reine.
Ce qu’elle est là-haut, je le suis ici-bas, entouré de mes nobles chevaliers et des belles jeunes filles de mon sérail, dont la noire chevelure ressemble à l’obscurité de la nuit, tandis que ces coupes resplendissantes sont pour moi des étoiles. Buvons, mes amis, buvons le jus de la treille, pendant que ces belles, s’accompagnant de la guitare, vont nous chanter leurs airs mélodieux295.
Puis le Sévillan récita encore un long poème, que Motamid avait composé pour apaiser le courroux de son père, irrité du désastre qui avait frappé son armée à Malaga par suite de la négligence de son fils qui la commandait.
A peine eut-il fini, que la toile de la tente devant laquelle il se trouvait par hasard, fut levée, et qu’un homme que l’on aurait reconnu pour le chef de la tribu rien qu’à son aspect vénérable, se montra à ses regards et lui dit avec cette élégance de diction et cette pureté d’accent, pour lesquelles les Bédouins ont toujours été renommés et dont ils sont excessivement fiers:
– Dites-moi donc, citadin que Dieu veuille bénir, de qui sont-ils, ces poèmes, limpides comme un ruisseau, frais comme une pelouse nouvellement arrosée par la pluie, tantôt tendres et suaves comme la voix d’une jeune fille au collier d’or, tantôt vigoureux et sonores comme le cri d’un jeune chameau?
– Ils sont d’un roi qui a régné en Andalousie et qui s’appelait Ibn-Abbâd, répondit l’étranger.
– Je suppose, reprit le chef, que ce roi régnait sur un petit coin de terre, et que, par conséquent, il pouvait consacrer tout son temps à la poésie, car quand on a d’autres occupations, on n’a pas le loisir de composer des vers comme ceux-là.
– Pardonnez-moi; ce roi régnait sur un grand pays.
– Et pourriez-vous me dire à quelle tribu il appartenait?
– Certainement; il était de la tribu de Lakhm.
– Que dites-vous? Il était de Lakhm? Mais il était de ma tribu alors!
Et ravi d’avoir trouvé une nouvelle illustration pour sa tribu, le chef, dans un élan d’enthousiasme, se mit à crier d’une voix retentissante:
– Debout, debout, gens de ma tribu! Alerte, alerte!
En un clin d’œil tous furent sur pied et vinrent entourer leur chef. Les voyant rassemblés:
– Ecoutez, leur dit-il, ce que je viens d’entendre, et retenez bien ce que je viens de graver dans ma mémoire; car c’est un titre de gloire qui s’offre à vous tous, un honneur dont vous avez tous le droit d’être fiers. Citadin, récitez encore une fois, je vous en prie, les poèmes de notre cousin.
Lorsque le Sévillan eut satisfait à ce désir et que tous les Bédouins eurent admiré ces vers avec le même enthousiasme que l’avait fait leur chef, celui-ci leur raconta ce qu’il avait entendu dire à l’étranger au sujet de l’origine des Beni-Abbâd, leurs alliés, leurs parents, puisqu’ils descendaient, eux aussi, d’une famille lakhmite qui parcourait autrefois le Désert avec ses chameaux, et dressait ses tentes là où les sables séparent l’Egypte de la Syrie; après quoi il leur parla de Motamid, le poète tour à tour gracieux ou sublime, le preux chevalier, le puissant monarque de Séville. Quand il eut fini, tous les Bédouins, ivres de joie et d’orgueil, montèrent à cheval pour se livrer à une brillante fantasia qui dura jusqu’aux premiers rayons de l’aurore. Puis le chef choisit vingt de ses meilleurs chameaux et en fit présent à l’étranger. Tous suivirent cet exemple dans la mesure de leurs moyens, et, avant que le soleil se fût levé tout à fait, le Sévillan se vit en possession d’une centaine de chameaux. Après l’avoir caressé, choyé, festoyé et honoré de toutes les manières, ces généreux fils du Désert consentirent à peine à le laisser partir quand le moment de se remettre en voyage fut arrivé pour lui, tant celui qui savait réciter les vers du roi poète qu’ils appelaient leur cousin, était devenu cher à leurs cœurs296.
Environ deux siècles et demi plus tard, alors que l’Espagne musulmane, autrefois si sceptique, s’était depuis longtemps jetée dans la dévotion, un pèlerin, portant bourdon et rosaire, parcourait le royaume de Maroc, afin de s’entretenir avec les pieux ermites et de visiter les lieux saints. Ce pèlerin, c’était le célèbre Ibn-al-Khatîb, le premier ministre du roi de Grenade. Arrivé dans la petite ville d’Aghmât, il s’achemina vers le cimetière, où reposaient Motamid et son épouse sous un tertre couvert de lotus. A l’aspect de ces deux tombeaux, délabrés par la vétusté et le défaut de soin, le vizir grenadin ne put retenir ses larmes et improvisa ces vers:
Je suis venu à Aghmât pour y accomplir un pieux devoir, pour m’agenouiller sur ta tombe! Ah! pourquoi ne m’a-t-il pas été donné de te connaître vivant et de chanter ta gloire, toi qui surpassais tous les rois en générosité, toi qui brillais comme un flambeau dans l’obscurité de la nuit? Qu’au moins il me soit permis de saluer respectueusement ton tombeau! L’élévation du terrain le distingue de ceux du vulgaire: ayant primé les autres hommes pendant ta vie, tu primes aussi ceux qui à tes pieds dorment du sommeil éternel. O sultan parmi les vivants, et sultan parmi les morts! jamais dans les siècles passés on n’a vu ton égal, et jamais, j’en suis convaincu, on ne verra dans les siècles futurs un roi qui te ressemble297.
Motamid, à coup sûr, ne fut pas un grand monarque. Régnant sur un peuple énervé par le luxe et ne vivant que pour le plaisir, il le serait devenu difficilement, lors même que son indolence naturelle et cet amour des choses extérieures, qui est le bonheur et l’infirmité des artistes, ne l’en eussent pas empêché. Mais nul autre n’avait dans l’âme tant de sensibilité, tant de poésie. Chez lui le moindre événement dans sa vie, la moindre joie ou le moindre chagrin, se revêtait aussitôt d’une forme poétique, et l’on pourrait écrire sa biographie, sa vie intérieure du moins, rien qu’avec ses vers, révélations intimes du cœur où se reflètent ces joies et ces tristesses que le soleil ou les nuages de chaque jour amènent ou remportent avec eux. Et puis, il eut la bonne fortune d’être le dernier roi indigène qui représentât dignement, brillamment, une nationalité et une culture intellectuelle, qui succombèrent, ou peu s’en faut, sous la domination des barbares qui avaient envahi le pays. Une sorte de prédilection s’attacha à lui, comme au plus jeune, au dernier né de cette nombreuse famille de princes poètes qui avaient régné sur l’Andalousie. On le regrettait plus que tout autre, presque à l’exclusion de tout autre, de même que la dernière rose de la saison, les derniers beaux jours de l’automne, les derniers rayons du soleil qui se couche, inspirent les regrets les plus vifs.
FIN DU QUATRIÈME ET DERNIER VOLUME
NOTES
Note A, p. 24
Quelques auteurs font mourir Yahyâ dans l’année 427 de l’Hégire, d’autres dans l’année 429. Le récit d’Ibn-Haiyân montre que la première date est la véritable. Cet auteur rapporte les propres termes dont s’est servi un soldat berber de Carmona, Abou-’l-Fotouh (ou Abou-’l-Fath) Birzélî, qui se trouvait parmi ceux qui se rendirent à Séville au temps de la fête des sacrifices de l’année 426 (c’est-à-dire, dans le dernier mois de cette année), et qui, dans le mois suivant, celui de Moharram 427, prit part au combat que les cavaliers sévillans livrèrent à Yahyâ près des portes de Carmona, combat qui se termina par la mort de Yahyâ. Il n’y a donc aucun doute sur l’année et sur le mois de la mort de ce prince; mais nous ne saurions indiquer le quantième du mois. Abd-al-Wâhid dit: dimanche, sept jours après le commencement de Moharram (c’est-à-dire le huitième jour de ce mois) de l’année 427; mais le huitième Moharram de l’année 427 tombe un mercredi et non un dimanche.
Au reste, le récit d’Ibn-Haiyân montre encore qu’au lieu de dire que Hichâm II fut de nouveau proclamé calife à Cordoue dans le mois de Moharram 429, Ibn-al-Athîr (Abbad., t. II, p. 34, l. 9) aurait dû dire: dans le mois de Moharram 427; car, puisqu’Ibn-Djahwar consentit seulement à le faire parce qu’il craignait d’être attaqué par Yahyâ (Abbad., t. I, p. 222, l. 28), il doit l’avoir fait nécessairement avant la mort de ce prince.
Ibn-Khaldoun (apud Hoogvliet, p. 28; j’ai corrigé le texte de ce passage dans mes Recherches, t. I de la 1re édition, p. 215 dans la note) s’est trompé gravement en parlant du rôle que Mohammed ibn-Abdallâh joua à cette époque.
Note B, p. 86
Ibn-Khâcân prétend qu’Ibn-Abd-al-barr a écrit cette lettre à Motadhid sur l’ordre de Mowaffac Abou-’l-djaich, c’est-à-dire de Modjéhid, prince de Dénia. Mais ce dernier étant mort en 436 de l’Hégire, et la prise de Silves ayant eu lieu en 443 ou dans l’année suivante, il doit y avoir une erreur dans cette assertion. La date de la prise de Silves ne saurait être douteuse. Cette ville doit avoir été conquise après la conquête de Niébla et de Huelva en 443 (voyez Abbad., t. I, p. 252, et comparez t. II, p. 210) et avant celle de Santa-Maria en 444 (voyez Abbad., t. II, p. 210, dern. ligne, et p. 123). D’ailleurs, Motamid, qui n’était né que dans l’année 431, ne pouvait pas commander l’armée de son père avant 436, époque de la mort de Modjéhid. Je crois donc qu’Ibn-Khâcân aurait dû nommer Alî, le fils et successeur de Modjéhid, ou peut-être quelque autre prince.
Note C, p. 95
Les circonstances essentielles de ce récit se trouvent dans un passage d’Ibn-Bassâm (Abbad., t. I, p. 250, 251), où il y a deux ou trois fautes à corriger. Nowairî (ibid., t. II, p. 129, 130) donne aussi de bons renseignements; seulement ce chroniqueur, sans parler d’inexactitudes d’une moindre importance, a eu le tort de nommer Carmona au lieu de Ronda. Les récits d’Ibn-Khaldoun (ibid., t. II, p. 210, 214, 215) me semblent confus et inexacts, surtout pour ce qui concerne les noms propres et les dates. – Voyez aussi Ibn-Haiyân, dans mon Introduction à la Chronique d’Ibn-Adhârî, p. 86.
Note D, p. 192
En traitant cette période, je ne me suis pas servi du livre qui porte le titre de Raudh al-mitâr (Abbad., t. II, p. 236 et suiv.). Maccarî, qui en a donné de longs extraits, semble y attacher de l’importance, parce qu’il est d’un auteur espagnol; mais cet Espagnol n’est pas ancien et il n’a fait que copier un écrivain asiatique. C’est ce qui résulte de la comparaison de l’article sur Yousof ibn-Téchoufîn chez Ibn-Khallicân, où l’on trouve de longs passages tirés d’une biographie de Yousof, intitulée al-Morib an sîrati meliki ’l-Maghrib, et qui a été écrite à Mosoul en 1183; car ces passages se retrouvent textuellement dans le Raudh al-mitâr, de sorte qu’il est certain que l’auteur de ce dernier ouvrage a copié l’anonyme de Mosoul. Or, quand il s’agit de l’histoire d’Espagne, il faut presque toujours se défier des récits qui ont été écrits en Asie. Ces récits, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’observer ailleurs298, proviennent ordinairement de voyageurs, de marchands, de colporteurs de bruits, et l’imagination n’y est pas étrangère, souvent même elle y joue un grand rôle. Celui dont il s’agit ne fait pas exception à la règle générale: écrit dans un langage extrêmement sentencieux et qui trahit chez l’auteur la prétention de vouloir rivaliser avec les anciens sages de l’Orient, il contient bien des choses qui sont invraisemblables en elles-mêmes et dont les chroniqueurs espagnols et africains ne savent rien.
Note E, p. 208
Les chroniques latines, si l’on en excepte le Chronicon Lusitanum (Esp. sagr., t. XIV, p. 418, 419), n’entrent dans aucun détail sur la bataille de Zallâca, et parmi les chroniques arabes, qui en parlent fort au long299, il y en a peu qui méritent une confiance entière. Quelques-unes se trompent même dans la date. La date véritable, vendredi 12 Redjeb 479, se trouve dans le Holal (Abbad., t. II, p. 197) et dans le Cartâs (p. 98), où on lit que ce jour répond au 23 octobre (1086), ce qui est vrai (comparez Annales Complut., p. 314, 315); mais d’autres auteurs se trompent, non-seulement dans le mois (car ils nomment Ramadhân au lieu de Redjeb), mais encore dans l’année. Abd-al-wâhid (p. 93, 94), par exemple, nomme l’année 480, et Ibn-al-Cardebous (Abbad., t. II, p. 23) l’année 481. C’est un phénomène bien singulier, attendu qu’il s’agit d’une bataille très-célèbre et qu’en Andalousie on disait l’année de Zallâca au lieu dire l’année 479300; mais le fait est qu’aucune des chroniques qui nous restent n’a été composée par un contemporain; elles sont du XIVe, du XIIIe, ou tout au plus du XIIe siècle; elles méritent donc peu de confiance. Joignez-y qu’à l’époque où elles s’écrivaient, les rhéteurs s’amusaient à fabriquer des lettres qu’ils supposaient écrites par des personnages historiques. Ce fait ne saurait être révoqué en doute; il en existe des preuves frappantes. L’auteur du Holal, par exemple, donne la lettre que Motamid écrivit à son fils Rachîd dans la soirée après la bataille. Elle n’est que de deux lignes (voyez Abbad., t. II, p. 199); mais l’auteur du Raudh al-mitâr (ibid., t. II, p. 248) la donne aussi, et chez lui elle est différente. Une troisième, enfin, se trouve chez Ibn-al-Khatîb (ibid., t. II, p. 176), et celle-là n’a pas moins de quinze lignes. Or, il faut nécessairement que deux de ces épîtres soient de fabrique moderne; peut-être le sont-elles toutes les trois. La prudence commande donc de se tenir en garde contre les pièces soi-disant officielles que présentent ces chroniques; aussi dois-je avouer que je doute de l’authenticité de la plupart des lettres que donne le Holal, et que le bulletin où Yousof raconte la bataille de Zallâca et qui se trouve dans le Cartâs, me paraît fort suspect.
Note F, p. 210-236
J’ai à justifier la chronologie que j’ai adoptée dans ce récit. A mon sens, Yousof arriva pour la seconde fois en Espagne dans le printemps de l’année 483 de l’Hégire, 1090 de notre ère, trois ans et demi après la bataille de Zallâca, assiégea Alédo pendant l’été, et s’empara de Grenade en novembre. Cependant Abou-’l-Haddjâdj Baiyâsî (cité par Ibn-Khallicân dans son article sur Yousof), l’auteur du Cartâs et celui du Holal donnent une autre chronologie; ils supposent que Yousof arriva pour la seconde fois en Espagne dans l’année 481 (1088) et qu’il assiégea Alédo301 dans cette année-là; que dans l’automne il retourna en Afrique; qu’il revint en Espagne pour la troisième fois l’année 483 (1090), et qu’alors il s’empara de Grenade302.
Contre cette manière de voir je dois observer, d’abord que les auteurs qui l’ont adoptée ne sont pas fort anciens (Abou-’l-Haddjâdj Baiyâsî écrivait au XIIIe siècle, et le Cartâs est du siècle suivant, de même que le Holal); ensuite qu’ils sont loin d’être toujours exacts303, et enfin qu’ils ne sont pas d’accord entre eux quand il s’agit de signaler les mois. Ainsi l’auteur du Cartâs affirme que Yousof arriva pour la seconde fois en Espagne dans le mois de Rebî Ier 481 (juin 1088), tandis que Baiyâsî dit qu’il y arriva dans le mois de Redjeb, c’est-à-dire en septembre ou en octobre.
D’un autre côté, les auteurs les plus anciens et les plus dignes de foi, ceux du XIIe siècle, sont d’accord pour placer le siège d’Alédo et la prise de Grenade dans la même année, c’est-à-dire dans l’année 483 (1090). Ibn-Câsim de Silves, par exemple, qui a écrit une histoire très-estimée de Motamid304, histoire dont Ibn-al-Abbâr nous a conservé des fragments, dit formellement qu’Alédo fut assiégé par Yousof et les princes andalous dans l’année 483305. Mohammed ibn-Ibrâhîm306 atteste que, lorsque Yousof fut arrivé en Espagne pour la seconde fois, il assiégea Alédo et s’empara de Grenade. Ibn-al-Cardebous, dans son Kitâb al-ictifâ307, dit la même chose, et il ajoute308 que, lorsque Yousof vint pour la troisième fois en Espagne, on était dans l’année 490 (1097). A ces témoignages, très-respectables à coup sûr, nous pourrions ajouter celui d’Ibn-al-Athîr309; seulement cet historien, qui écrivait à Mosoul, et qui, par conséquent, n’était pas toujours bien informé de l’histoire d’Espagne, se trompe quand il dit que le siége d’Alédo et la prise de Grenade eurent lieu un an après la bataille de Zallâca, c’est-à-dire en 480 (1087).
Quant à la date précise de la prise de Grenade, l’historien Ibn-aç-Çairafî, cité par Ibn-al-Khatîb310, dit que cet événement eut lieu le dimanche 14 Redjeb de l’année 483. Cette date soulève deux objections: d’abord le 14 Redjeb (26 août) tombait, non un dimanche, mais un jeudi; en second lieu, il est impossible que Yousof se soit emparé de Grenade dès le mois d’août, car, arrivé en Espagne au printemps, il assiégea Alédo pendant quatre mois311 et jusqu’à l’approche de l’hiver, comme l’assure l’auteur du Cartâs. A la place de: dimanche 14 Redjeb, je crois donc devoir lire: dimanche 14 Ramadhân, c’est-à-dire 10 novembre. Le 14 Ramadhân tombait réellement un dimanche dans l’année 483, et ces deux mois se confondent assez souvent. Plusieurs auteurs, par exemple, disent que la bataille de Zallâca eut lieu dans le mois de Ramadhân 479, tandis qu’elle se livra dans le mois de Redjeb. Il se pourrait que dans ce temps-là on se soit parfois servi d’abbréviations pour indiquer les mois, et dans ce cas, les mois de Redjeb et de Ramadhân, qui ont la même initiale, pouvaient aisément se confondre. Rien, du reste, ne s’oppose au changement que j’ai proposé. Baiyâsî et l’auteur du Cartâs disent que Yousof se rembarqua avant la fin de Ramadhân, c’est-à-dire avant le 26 novembre. Or, dans l’espace de seize jours, il pouvait facilement recevoir la visite des princes andalous et faire le voyage de Grenade à Algéziras.
FIN DES NOTES DU QUATRIÈME ET DERNIER VOLUME
CHRONOLOGIE DES PRINCES MUSULMANS DU XIe SIÈCLE
Séville. Les Beni-Abbâd.

Cordoue. Les Beni-Djahwar.

Les Hammoudites de Malaga.

Les Hammoudites d’Algéziras.

Grenade. Les Beni-Zîrî.

Carmona. Les Beni-Birzél.
D’après Ibn-Khaldoun (Abbad., t. II, p. 216), la liste de ces princes serait:

Ronda.

Moron.

Arcos.

Huelva. Les Becrites.

Niébla. Les Beni-Yahyâ.

Silves. Les Beni-Mozain.

Santa-Maria d’Algarve.

Mertola.

Badajoz.

Tolède.

Saragosse.

312Un récit très-circonstancié d’Ibn-Haiyân (apud Ibn-Bassâm, t. I, fol. 47 r. et v.) démontre que j’ai eu raison de dire (voyez mes Recherches, t. I, Appendice, nº XVII) qu’il n’y a eu à Saragosse qu’un seul roi de cette famille, à savoir Mondhir, et que c’est ce prince, et non pas son fils, qui a été assassiné en 1039.
La Sahla (capitale Albarracin). Les Beni-Razîn.

Alpuente. Les Beni-Câsim.

Valence.

Dénia.

Murcie.

Almérie.

FIN DE LA CHRONOLOGIE
LISTE DES OUVRAGES IMPRIMÉS ET MANUSCRITS DONT L’AUTEUR S’EST SERVI 312
Abbad. Scriptorum Arabum loci de Abbadidis editi a R. Dozy. Leyde, 1846.
Abd-al-wâhid, The History of the Almohades etc., ed. by R. Dozy. Leyde, 1847.
Abou-Ismâîl al-Baçrî, Fotouh as-Châm, éd. Lees, Calcutta, 1854, dans la Bibliotheca Indica.
Abou-’l-mahâsin, Annales, éd. Juynboll. Leyde, 1852 et suiv.
Aghânî. Alii Ispahanensis Liber Cantilenarum magnus, ed. Kosegarten. Greifswalde, 1840.
Ahmed ibn-abî-Yacoub, Kitâb al-boldân, man. de M. Muchlinski à Saint-Pétersbourg. M. Juynboll, fils, vient de donner une édition de cet ouvrage.
Akhbâr madjmoua, man. de Paris, nº 706. Voyez mon Introduction à la Chronique d’Ibn-Adhârî, p. 10-12. Je possède une copie de ce manuscrit.
Alvaro, Vita Eulogii, dans l’Esp. sagr., t. X; Epistolae, Indiculus luminosus, dans le même ouvrage, t. XI.
Annales Complutenses, dans l’Esp. sagr., t. XXIII.
Annales Compostellani, dans l’Esp. sagr., t. XXIII.
Annales Toledanos, dans l’Esp. sagr., t. XXIII.
Arîb, Histoire de l’Afrique et de l’Espagne, intitulée al-Bayâno ’l-mogrib, par Ibn-Adhârî (de Maroc), et fragments de la Chronique d’Arîb, publ. par R. Dozy. Leyde, 1848 et suiv.
Berganza, Antiguedades de Espana. Madrid, 1719.
Çâid de Tolède, Extrait de son Tabacât al-omam, man. de Leyde, nº 159.
Cartâs. Annales regum Mauritaniae ab Abu-l-Hasan Ali ben-Abdallâh ibn-abi-Zer’ Fesano conscripti, ed. Tornberg. Upsal, 1846.
Cazwînî, Cosmographie, éd. Wüstenfeld. Gœttingue, 1848.
Chahrastânî, Histoire des sectes, éd. Cureton. Londres, 1842.
Chronicon Adefonsi Imperatoris, dans l’Esp. sagr., t. XXI.
Chronicon Albeldense, dans l’Esp. sagr., t. XIII.
Chronicon Burgense, dans l’Esp. sagr., t. XXIII.
Chronicon de Cardena, dans l’Esp. sagr., t. XXIII.
Chronicon Complutense, dans l’Esp. sagr., t. XXIII.
Chronicon Compostellanum, dans l’Esp. sagr., t. XXIII.
Chronicon Conimbricense, dans l’Esp. sagr., t. XXIII.
Chronicon Iriense, dans l’Esp. sagr., t. XX.
Chronicon Lusitanum, dans l’Esp. sagr., t. XIV.
Edrisi, Géographie, traduite par Jaubert.
Espana sagrada, por Florez, Risco etc. 2ª edicion. Madrid, 1754-1850. 47 vol.
Euloge. Ses œuvres se trouvent dans Schot, Hispania illustrata, t. IV.
Fâkihî, Histoire de la Mecque, man. de Leyde nº 463. Voyez mon Catalogue, t. II, p. 170.
Hamâsa. Hamasae Carmina ed. Freytag. Bonn, 1828.
Historia Compostellana, dans l’Esp. sagr., t. XX.
Holal. Histoire du Maroc, man. de Leyde nº 24. Comparez Abbad., t. II, p. 182 et suiv.
Homaidî, Dictionnaire biographique, man. d’Oxford, Hunt 464.
Ibn-abî-Oçaibia, Histoire des médecins. J’ai fait copier le chapitre relatif aux médecins arabes-espagnols sur le man. de Paris, nº 673 suppl. ar., et M. Wright a eu la bonté de noter sur la marge de cette copie les variantes des deux man. d’Oxford, Hunt. 171 et Pocock. 356.
Ibn-Adhârî. Voyez Arîb.
Ibn-al-Abbâr, dans mes Notices sur quelques manuscrits arabes. Leyde, 1847-1851.
Ibn-al-Athîr, man. de Paris. M. Tornberg a eu la bonté de me prêter sa copie.
Ibn-al-Coutîa, man. de Paris nº 706. Voyez mon Introduction à la Chronique d’Ibn-Adhârî, p. 28-30. Je possède une copie de ce manuscrit.
Ibn-al-Khatîb, al-Ihâta fi tarîkhi Gharnâta, et l’abrégé de cet ouvrage: Marcaz al-ihâta bi-odabâi Gharnâta. B. man. de Berlin; E. man. de l’Escurial (plusieurs articles de ce man. ont été copiés pour moi par M. Simonet); G. man. de M. de Gayangos; P. man. de Paris. Voyez Abbad., t. II, p. 169-172, et mes Recherches, t. I, p. 293, 294.
Ibn-Badroun, Commentaire historique sur le poème d’Ibn-Abdoun, publ. par R. Dozy. Leyde, 1846.
Ibn-Bassâm, Dhakhîra. T. Ier. M. Jules Mohl possède ce volume, et il a eu la bonté de me le prêter. Ce man. appartient au même exemplaire que le 3e volume qui se trouve à Gotha. – T. II, man. d’Oxford, nº 749 du Catalogue d’Uri. – T. III, man. de Gotha, nº 266. M. de Gayangos possède aussi un manuscrit de ce volume, sur lequel M. Wright a bien voulu collationner pour moi les passages d’Ibn-Haiyân cités par Ibn-Bassâm. – Voyez sur Ibn-Bassâm et sa Dhakhîra, Abbad., t. I, p. 189 et suiv., et le Journ. asiat., février-mars 1861.
Ibn-Batouta, Voyages, éd. Defrémery et Sanguinetti. Paris, 1853 et suiv.
Ibn-Cotaiba, éd. Wüstenfeld. Gœttingue, 1850.
Ibn-Habîb. Voyez Tarîkh.
Ibn-Haiyân, man. d’Oxford, Bodl. 509, Catal. de Nicoll, nº 137. La copie que je possède de ce man. a été faite par moi sur celle de M. Wright. Voyez aussi Ibn-Bassâm.
Ibn-Hazm, Traité sur les religions, man. de Leyde nº 480. – Traité sur l’amour, man. de Leyde nº 927.
Ibn-Khâcân, Matmah, man. de Londres et de Saint-Pétersbourg. – Calâyid, man. de Leyde, nos 306 et 35.
Ibn-Khaldoun, Prolégomènes, éd. Quatremère, dans les Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale, t. XVI, XVII et XVIII. – Tome II (Histoire des Omaiyades d’Orient), man. de Leyde nº 1350, t. II. – Tome IV (Histoire d’Espagne), man. de Paris nº 742/4 suppl. ar., et de Leyde nº 1350, t. IV. – Histoire des Berbers, éd. de Slane; traduction française par le même.
Içtakhrî, Liber Climatum, ad similitudinem Cod. Gothani exprimendum curavit Mœller. Gotha, 1839.
Idatii Chronicon, dans l’Esp. sagr., t. IV.
Isidore de Béja, dans l’Esp. sagr., t. VIII. Comparez mes Recherches, t. I, p. 2 et suiv.
Isidore de Séville, Historia Gothorum, dans l’Esp, sagr., t. VI.
Khochanî, Histoire des cadis de Cordoue, man. d’Oxford, nº 127 du Catalogue de Nicoll. Je possède une copie de ce manuscrit.
Llorente, Noticias de las tres Provincias Vascongadas. Madrid, 1806.
Lucas de Tuy, Chronicon mundi, dans Schot, Hispania illustrata, t. IV.
Maccarî. Analectes sur l’histoire et la littérature des Arabes d’Espagne, par al-Makkari, publ. par MM. Dozy, Dugat, Krehl et Wright, Leyde, 1855-61.
Manuscrit de Meyá, dans les Memorias de la Academia de la Historia, t. IV.
Masoudî, Moroudj ad-dheheb, man. de Leyde nos 127 et 537 d.
Mobarrad, Câmil, man. de Leyde nº 587. Voyez mon Catalogue, t. I, p. 204, 205.
Mon. Sil. Monachi Silensis Chronicon, dans l’Esp. sagr., t. XVII.
Nawawî, Dictionnaire biographique, éd. Wüstenfeld. Gœttingue, 1842-47.
Notices sur quelques manuscrits arabes, par R. Dozy. Leyde, 1847-51.
Nowairî, Histoire d’Espagne. Je cite les pages du man. de Leyde nº 2 h, mais j’ai soigneusement collationné le man. de Paris nº 645, qui est beaucoup meilleur et qui comble plusieurs lacunes.
Paulus Emeritensis, De vita P. P. Emeritensium, dans l’Esp. sagr., t. XIII.
Pélage d’Oviédo, dans l’Esp. sagr., t. XIV.
Raihân al-albâb, man. de Leyde nº 415. Voyez mon Catalogue, t. I, p. 268, 269.
Râzî, traduction espagnole. Cronica del Moro Rasis, dans les Memorias de la Academia de la Historia, t. VIII. Comparez mon Introduction à la Chronique d’Ibn-Adhârî, p. 24, 25.
Recherches sur l’histoire et la littérature de l’Espagne pendant le moyen âge, par R. Dozy. 1re édition, Leyde, 1849, 2de édition, Leyde, 1860.
Rodrigue de Tolède, De rebus Hispanicis, dans Schot, Hispania illustrata, t. II. La meilleure édition de son Historia Arabum se trouve dans Elmacini Historia Saracenica, ed. Erpenius.
Sampiro, Chronicon, dans l’Esp. sagr., t. XIV.
Samson, Apologeticus, dans l’Esp. sagr., t. XI.
Sébastien, Sebastiani Chronicon, dans l’Esp. sagr., t. XIII.
Sota, Chronica de los principes de Asturias y Cantabria. Madrid, 1681.
Tabarî, Annales, éd. Kosegarten.
Tarîkh Ibn-Habîb, man. d’Oxford, Catalogue de Nicoll nº 127. Comparez mes Recherches, t. I, p. 32 et suiv.
Vita Beatae Virginis Argenteae, dans l’Esp. sagr., t. X.
Vita Johannis Gorziensis, dans Pertz, Monumenta Germaniae, t. IV des Scriptores.