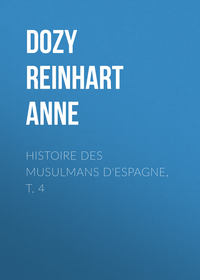Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Histoire des Musulmans d'Espagne, t. 4», sayfa 7
Une autre fois elle vit des femmes du peuple qui pétrissaient de leurs pieds nus le limon dont on voulait faire des briques, et se mit à pleurer. Son mari lui ayant demandé la cause de son chagrin:
– Ah! je suis bien malheureuse, lui dit-elle, depuis le jour où m’arrachant à la vie joyeuse et libre que je menais dans ma masure, tu m’as enfermée dans ce triste palais et chargée des lourdes chaînes de l’étiquette! Regarde donc ces femmes, là-bas, au bord de la rivière! Je voudrais comme elles pétrir le limon de mes pieds nus, mais, hélas! condamnée par toi à être riche et sultane, je ne le puis pas!
– Si fait, tu le pourras, lui répondit le prince en souriant.
Et à l’instant même il descendit dans la cour du palais et y fit apporter une énorme quantité de sucre, de cannelle, de gingembre et de parfumeries de toute espèce; puis, la cour étant entièrement couverte de ces ingrédients précieux, il les fit mouiller d’eau rose et pétrir à force de bras, si bien qu’ils formèrent une espèce de limon. Tout cela fait:
– Veuille descendre dans la cour avec tes suivantes, dit le prince à Romaiquia; le limon t’y attend.
La sultane y alla, et, s’étant déchaussée de même que ses suivantes, toutes se mirent à plonger leurs pieds, avec une gaîté folâtre, dans ce limon aromatique.
C’était là une fantaisie bien dispendieuse; aussi Motamid savait-il la rappeler au besoin à sa capricieuse épouse dont les désirs ne connaissaient pas de bornes. Un jour, ayant demandé une chose que le prince ne pouvait lui accorder:
– Ah! je suis bien à plaindre, s’écria-t-elle. Décidément je suis la plus malheureuse des femmes, car je prends Dieu à témoin que jamais tu n’as fait la moindre chose pour me plaire.
– Pas même le jour du limon? lui demanda Motamid d’une voix douce et tendre.
Romaiquia rougit et n’insista pas davantage123.
Force nous est d’ajouter que les ministres de la religion ne prononçaient jamais le nom de cette sémillante sultane qu’avec une sainte horreur. Ils la considéraient comme le plus grand obstacle à la conversion de son mari, sans cesse entraîné par elle, disaient-ils, dans un tourbillon de plaisirs et de voluptés, et si les mosquées étaient désertes le vendredi, ils en imputaient la faute à elle. Romaiquia riait de leurs clameurs; insouciante et étourdie, elle ne soupçonnait pas, la pauvrette, que ces hommes deviendraient redoutables un jour!124
Au reste, malgré son amour, Motamid continuait d’accorder à Ibn-Ammâr une large place dans son cœur. Une fois, étant loin de Romaiquia avec son ami, il lui écrivit une lettre dans laquelle il fit entrer ces six vers acrostiches:
Invisible à mes yeux, tu es toujours présente à mon cœur.
Ton bonheur puisse-t-il être infini comme le sont mes soucis, mes larmes et mes insomnies!
Impatient du frein quand d’autres femmes veulent me l’imposer, je me soumets docilement à tes moindres souhaits.
Mon vœu de chaque instant, c’est d’être à tes côtés. Ah! puisse-t-il être exaucé bientôt!
Amie de mon cœur, pense à moi et ne m’oublie pas, quelque longue que soit l’absence!
Doux nom que le tien! Je viens de l’écrire, je viens de tracer ces lettres chéries: Itimâd125.
Il termina sa lettre par ces mots: «Bientôt je viendrai te revoir, pourvu, toutefois, qu’Allâh et Ibn-Ammâr le veuillent bien.»
Ayant reçu connaissance de cette phrase, Ibn-Ammâr adressa ces vers à son ami:
Ah! mon prince, je n’ai jamais d’autre désir, moi, que de faire ce que vous voulez; je me laisse conduire par vous comme le voyageur nocturne se laisse guider par les éclairs éblouissants. Voulez-vous retourner auprès de celle qui vous est chère, montez alors sur un fin voilier, – je vous suis; – ou bien, sautez en selle, – je vous suis encore. Ensuite, quand, grâce à la protection divine, nous serons arrivés dans la cour de votre palais, vous me laisserez retourner seul à ma demeure, et vous-même, sans vous donner le temps de déposer votre épée, vous irez vous jeter aux pieds de la belle à la ceinture d’or; puis, rattrapant le temps perdu, vous l’embrasserez, vous la presserez contre votre poitrine, tandis que votre bouche et la sienne murmureront de douces paroles, de même que les oiseaux se répondent par des chants mélodieux au lever de l’aurore126.
Partageant son cœur entre l’amitié et l’amour, le jeune prince menait une vie charmante; mais elle fut troublée tout à coup: son père frappa Ibn-Ammâr d’une sentence d’exil. Ce fut pour les deux amis un coup de foudre; mais qu’y faire? Motadhid était inébranlable dans ses résolutions une fois prises. Ibn-Ammâr passa dans le Nord, et notamment à Saragosse, les tristes années de son exil, jusqu’à ce que Motamid, qui comptait alors vingt-neuf ans, succédât à son père127. Le prince s’empressa de rappeler auprès de lui l’ami de son adolescence, et lui laissa le choix entre les divers emplois du royaume. Ibn-Ammâr se décida pour le gouvernement de la province où il était né. Bien qu’il le vît à regret s’éloigner de sa personne, Motamid lui accorda néanmoins sa demande128; mais au moment où son ami lui disait adieu, les charmants souvenirs de son séjour à Silves et toutes ces premières émotions qui ne laissent aucune amertume dans le cœur se ranimaient en lui, et il improvisa ces vers:
Salue à Silves les endroits chéris que tu sais, ô Abou-Becr, et demande-leur s’ils ont gardé mon souvenir. Salue surtout le Charâdjîb, ce superbe palais dont les salles sont remplies de lions et de blanches beautés, de sorte que l’on se croirait tantôt dans un antre, tantôt dans un sérail129, et dis-lui qu’il y a ici un jeune chevalier qui en tout temps brûle du désir de le revoir. Que de nuits n’ai-je pas passées là, à côté d’une jeune beauté aux larges hanches, à la mince ceinture! Que de fois les jeunes filles blanches ou cuivrées m’y ont percé le cœur de leurs doux regards, comme si leurs yeux eussent été des épées ou des lances! Que de nuits n’ai-je pas passées aussi dans le vallon au bord de la rivière avec la belle chanteuse dont le bracelet ressemblait à la lune dans son croissant! Elle m’enivrait de toutes les manières, tantôt de ses regards, tantôt du vin qu’elle m’offrait, tantôt, enfin, de ses baisers. Puis, quand elle jouait sur sa guitare un air guerrier, je croyais entendre le cliquetis des épées et me sentais saisi d’une ardeur martiale. Délicieux moment surtout que celui où, ayant ôté sa robe, elle m’apparut svelte et flexible comme un rameau de saule! «La fleur, me disais-je alors, est sortie du bouton130.»
Ibn-Ammâr fit son entrée dans Silves entouré d’un cortége superbe et avec une pompe telle que Motamid lui-même, quand il était gouverneur de la province, n’en avait jamais déployé une pareille; mais il se fit pardonner cette bouffée d’orgueil par un noble acte de reconnaissance, car, ayant appris que le négociant qui l’avait secouru dans sa détresse alors qu’il n’était encore qu’un pauvre poète ambulant, vivait encore, il lui envoya un sac rempli de pièces d’argent. Ce sac était celui-là même que le négociant lui avait fait parvenir rempli d’orge; Ibn-Ammâr l’avait soigneusement conservé. Pourtant il ne dissimula point à son ancien bienfaiteur qu’il avait trouvé son présent un peu mesquin, car il lui fit dire ces paroles: «Si autrefois vous nous eussiez envoyé ce sac rempli de froment, nous vous l’aurions renvoyé rempli d’or131.»
Il ne resta pas longtemps à Silves. Ne pouvant vivre sans lui, Motamid le rappela à la cour, après l’avoir nommé premier ministre132.
X
Comme Motamid et son ministre aimaient avant tout la poésie, la cour de Séville devint le rendez-vous des meilleurs poètes de l’époque. Les rimailleurs n’avaient aucune chance d’y faire fortune, car Motamid était un critique sévère qui examinait avec soin chaque poème qu’on lui présentait et qui en pesait chaque expression, chaque syllabe133; mais quand il s’agissait d’un poète de talent, sa générosité ne connaissait pas de bornes. Un jour il entendit réciter ces deux vers:
La fidélité à tenir ses promesses est à présent une chose bien rare. Vous ne trouverez personne qui pratique cette vertu, personne même qui y songe. C’est quelque chose de fabuleux comme le griffon, ou comme ce conte qui dit qu’un poète reçut un jour un présent de mille ducats.
– De qui sont ces vers? demanda-t-il.
– D’Abd-al-djalîl, lui répondit-on.
– Eh quoi! s’écria-t-il alors, un de mes serviteurs, un bon poète, regarde un présent de mille ducats comme quelque chose de fabuleux?
Et à l’instant même il fit remettre mille ducats à Abd-al-djalîl134.
Une autre fois il s’entretenait avec un des poètes siciliens qui étaient venus à sa cour après que leur patrie eut été conquise par Roger le Normand, lorsqu’on lui apporta des pièces d’or qui sortaient de l’hôtel de la monnaie. Il en donna deux bourses au Sicilien; mais celui-ci, non content de ce cadeau, tout magnifique qu’il était, regardait d’un œil de convoitise une figurine en ambre, incrustée de perles, qui se trouvait dans la salle et qui représentait un chameau. «Seigneur, dit-il enfin, votre présent est superbe, mais il est lourd, et je crois qu’il me faudrait un chameau pour le transporter à ma demeure. – Le chameau est à toi,» lui répondit Motamid en souriant135.
En général, pourvu qu’on eût de l’esprit, on était sur de plaire à Motamid, fût-on poète ou autre chose, fût-on même voleur de grands chemins, témoin l’histoire du Faucon gris. Le Faucon gris – on ne le désignait que par ce sobriquet – avait été longtemps le plus grand voleur de l’époque, l’effroi et le fléau des habitants des campagnes; mais étant enfin tombé entre les mains de la justice, il fut condamné à être crucifié sur la grande route, afin que les paysans pussent être témoins de son supplice. Toutefois, comme il faisait une chaleur étouffante le jour où cet arrêt fut exécuté, la route était peu fréquentée. Au pied de la croix sur laquelle le voleur avait été cloué, se tenaient sa femme et ses filles. Elles pleuraient à chaudes larmes. «Hélas! disaient-elles, quand tu ne seras plus, nous devrons mourir de faim!» Or le Faucon gris était un homme très-compatissant, un cœur d’or, et la pensée que sa famille tomberait dans la misère lui fendait l’âme. Justement il vit arriver un marchand forain qui chevauchait sur un mulet chargé de pièces d’étoffe et d’autres marchandises qu’il allait vendre dans les villages voisins.
– Hé, seigneur, lui cria-t-il, je me trouve ici dans une position assez désagréable comme vous voyez, mais vous pourriez me rendre un grand service duquel vous profiteriez beaucoup vous-même.
– Comment cela? demanda l’autre.
– Vous voyez ce puits là-bas?
– Oui, je le vois.
– Fort bien! Sachez donc qu’au moment où j’ai eu la bêtise de me laisser prendre par ces maudits gendarmes, j’ai jeté cent ducats dans ce puits qui est à sec. Peut-être voudriez-vous bien avoir la complaisance de vous déranger pour les tirer de là; en ce cas je vous en laisserai la moitié. Voici ma femme et mes filles qui tiendront votre mulet jusqu’à ce que vous ayez fini.
Séduit par l’appât du gain, le marchand prit aussitôt une corde, en attacha un bout au bord du puits, et se laissa glisser ainsi jusqu’au fond.
– Alerte maintenant! dit alors le Faucon gris à sa femme; coupe la corde, prends le mulet et fuis au plus vite avec ces enfants!
Tout cela fut fait en un clin d’œil. Le marchand criait comme un forcené, mais comme la campagne était presque déserte, un temps assez considérable s’écoula avant qu’un passant vînt à son secours, et ce passant n’étant pas assez fort pour le tirer du puits, il fallut attendre jusqu’à ce qu’un second vînt l’aider. Arraché enfin à sa prison souterraine, le marchand dut répondre à ses libérateurs qui lui demandaient ce qu’il était allé faire dans ce puits. Il leur raconta donc sa mésaventure avec force imprécations contre le voleur qui l’avait si indignement trompé. Bientôt elle fut connue de toute la ville; elle parvint même aux oreilles de Motamid, qui ordonna de détacher le Faucon gris de sa croix et de le lui amener. Quand il fut arrivé en sa présence:
– Tu es bien certainement le plus grand fripon qui existe, lui dit-il, puisque même la perspective de la mort ne suffit pas pour te faire renoncer à tes mauvais tours.
– Ah! mon prince, lui répondit le voleur, si vous saviez comme moi quel délice c’est que de voler, vous jetteriez votre manteau royal aux orties et vous ne feriez que cela.
– Maudit coquin! s’écria le prince en riant aux éclats. Mais voyons, parlons sérieusement! Supposons que je te donne la vie, que je le rende la liberté, que je le mette en état de gagner ton pain d’une manière honorable, et que je t’assigne un traitement qui suffise à tes besoins, t’amenderas-tu alors, abandonneras-tu ton détestable métier?
– On fait beaucoup pour sauver sa vie, seigneur, même on s’amende. Tenez, vous serez content de moi!
Le Faucon gris tint sa parole. Nommé brigadier de gendarmerie, il inspira dorénavant autant d’effroi à ses anciens confrères, qu’il en avait inspiré jadis aux paysans136.
Au reste, Motamid menait joyeuse vie, sans trop s’occuper des affaires de l’Etat. «A mon avis, disait-il dans un de ses poèmes, être sage, c’est ne pas l’être137.» Les festins absorbaient une partie de son temps, et puisqu’il voulait se montrer galant chevalier, force lui était d’en consacrer le reste aux jeunes beautés de son sérail. Ce n’est pas qu’il eût cessé d’aimer Romaiquia; au contraire, il l’aimait toujours avec passion; mais comme selon le code bizarre qui régit l’amour dans les pays musulmans, on peut se passer quelques fantaisies sans devenir infidèle pour cela, il adressait aussi de temps en temps ses hommages à d’autres dames, sans que Romaiquia, sûre de régner en souveraine sur le cœur de son époux, y trouvât à redire. La belle Aimée était charmante, et quand il buvait à sa santé, le prince trouvait au vin plus de bouquet qu’à l’ordinaire138. Luna lui tenait compagnie alors qu’il étudiait les vers des anciens poètes ou qu’il écrivait les siens, et si le soleil s’avisait de jeter un regard indiscret dans le cabinet d’étude, elle était là pour l’intercepter; «car elle sait, disait le prince, que la lune seule peut éclipser le soleil139.» Plus prude, plus revêche, La Perle avait parfois des caprices; alors elle se mettait en colère, et il fallait que Motamid se donnât des peines infinies pour l’apaiser. Une fois qu’il s’était attiré son courroux, il lui écrivit pour lui présenter ses excuses. Elle lui répondit bien, mais sans placer son propre nom en tête de sa lettre, comme la coutume le voulait.
Hélas! elle ne m’a pas encore pardonné, dit alors le prince; autrement elle aurait mis son nom en tête de son billet. Elle sait que je l’adore, son nom, mais elle est si fâchée contre moi qu’elle ne veut pas l’écrire. «Quand il le verra, s’est-elle dit, il va le baiser. Eh bien, par Dieu! il ne le verra pas140.»
Quelle gentille garde malade que La Fée! Le prince priait Allah de lui accorder comme une faveur d’être constamment valétudinaire, pourvu qu’il ne manquât pas de la voir constamment à son chevet, cette gracieuse gazelle aux lèvres pourprées141.
On se tromperait, cependant, si l’on s’imaginait que Motamid négligeât entièrement de continuer l’œuvre de son père et de son aïeul. Quoiqu’il n’eût pas autant d’ambition qu’eux, il fit néanmoins ce qu’ils avaient essayé en vain de faire: dès la seconde année de son règne, il réunit Cordoue à son royaume.
Son père, il est vrai, lui avait frayé la route, et les circonstances le secondèrent admirablement. Six années auparavant, en 1064, le vieux président de la république, Abou-’l-Walîd ibn-Djahwar, s’était démis de ses fonctions en faveur de ses deux fils, Abdérame et Abdalmélic. Il avait confié à l’aîné tout ce qui regardait les finances et l’administration, et il avait donné au cadet, pour lequel il avait un grand faible, le commandement militaire142. Le cadet éclipsa bientôt son aîné; cependant tout alla bien tant que dura l’influence de l’habile vizir Ibn-as-Saccâ. Cet homme d’Etat inspirait du respect à tous les ennemis déclarés ou couverts de la république, et même à Motadhid. Aussi ce dernier comprit que, pour arriver à ses fins, il devait commencer par le faire tomber. Il tâcha donc de le rendre suspect à Abdalmélic ibn-Djahwar, et il y réussit. Ibn-as-Saccâ fut mis à mort, et cet événement eut pour la république les suites les plus fâcheuses. Les officiers et les soldats, qui avaient été fort attachés au vizir, donnèrent pour la plupart leur démission, tandis qu’Abdalmélic se rendait odieux à ses concitoyens par sa dureté et sa nonchalance. En outre, il semble avoir aboli peu à peu tout ce qui restait encore debout des institutions républicaines.
Le pouvoir d’Abdalmélic chancelait donc déjà, lorsque Mamoun de Tolède vint assiéger Cordoue dans l’automne de l’année 1070. N’ayant presque plus d’armée (sa cavalerie était réduite à deux cents hommes, et encore étaient-ils fort mal disposés), Abdalmélic demanda du secours à Motamid. Il obtint ce qu’il désirait: Motamid lui envoya des renforts très-considérables, et l’armée tolédane fut forcée de se retirer; mais Abdalmélic n’y gagna rien; au contraire, les chefs de l’armée sévillane, agissant d’après les ordres secrets de leur souverain, s’entendirent avec les Cordouans pour ôter le pouvoir à Abdalmélic et pour le donner au roi de Séville. Ce complot fut tramé dans le plus grand mystère, de sorte qu’Abdalmélic ne se doutait de rien. Dans la matinée du septième jour après le départ de Mamoun, il était sur le point de sortir pour faire la reconduite aux Sévillans, qui avaient annoncé qu’ils s’en retourneraient ce jour-là, lorsque des cris séditieux frappèrent son oreille. Il regarde, il voit son palais entouré par ses soi-disant auxiliaires et par le peuple. Presque au même instant on l’arrête, de même que son père et tout le reste de sa famille.
Motamid fut proclamé seigneur de Cordoue, et les Beni-Djahwar furent menés prisonniers à l’île de Saltès; mais le vieux Abou-’l-Walîd ne survécut que quarante jours à son infortune143.
Le roi poète parle de cette conquête comme s’il se fût agi de celle d’une beauté un peu hautaine.
J’ai obtenu d’emblée, disait-il, la main de la belle Cordoue, de cette fière amazone qui, le glaive et la lance à la main, repoussait tous ceux qui la recherchaient en mariage. A présent nous célébrons, elle et moi, nos noces dans son palais, tandis que les autres rois, mes rivaux rebutés, pleurent de rage et tremblent de crainte. Tremblez, et pour cause, vils ennemis! car bientôt le lion viendra fondre sur vous144.
Cependant Mamoun ne se tenait pas pour battu; au contraire, il était résolu à se rendre maître de Cordoue, quoi qu’il dût lui en coûter. Accompagné de son allié, Alphonse VI, il vint ravager les environs de la ville; mais il fut repoussé par le jeune gouverneur Abbâd, un fils de Motamid et de Romaiquia145. Alors Ibn-Ocâcha s’engagea à le mettre en possession de la ville qu’il convoitait. C’était un homme farouche et sanguinaire, un ancien bandit de la montagne, mais qui ne manquait pas de talents et qui connaissait bien Cordoue, où il avait déjà joué un rôle. Nommé gouverneur d’une forteresse, il se mit à former des intrigues et des complots à Cordoue, ce qui ne lui était pas difficile, car beaucoup de citoyens étaient mécontents de la marche des affaires. Le prince Abbâd donnait, il est vrai, de belles espérances, mais comme il était encore trop jeune pour gouverner par lui-même, le pouvoir était entre les mains du commandant de la garnison, Mohammed, fils de Martin, un chrétien d’origine à ce qu’il paraît. Or, cet homme, assez bon soldat du reste, était cruel, sanguinaire et débauché. Aussi les Cordouans le détestaient, et plusieurs d’entre eux ne se firent pas scrupule d’entrer en relations avec Ibn-Ocâcha. Cependant ce dernier ne réussit pas à tenir ses menées tout à fait secrètes. Un officier s’aperçut que l’ex-brigand venait souvent la nuit aux portes de la ville et qu’il avait alors des entretiens fort suspects avec des soldats de la garnison. C’est ce qu’il rapporta à Abbâd; mais ce prince ne fit pas grande attention à cet avis, et renvoya celui qui le lui donnait à Mohammed, fils de Martin. Celui-ci le renvoya, à son tour, à des officiers subalternes. En un mot, l’un se déchargeait sur l’autre des mesures à prendre, et personne ne fit son devoir.
Cependant Ibn-Ocâcha se tenait sans cesse aux aguets, et en janvier 1075, il profita, pour s’introduire avec ses hommes dans la ville, d’une nuit orageuse et extrêmement obscure, après quoi il marcha droit au palais d’Abbâd. Il n’y trouva pas de garde, et il était sur le point d’en enfoncer la porte, lorsque le prince, réveillé par le portier, vint lui barrer le passage avec une poignée d’esclaves et de soldats. Malgré son extrême jeunesse, il se défendit comme un lion, et il avait déjà forcé les assaillants à évacuer le vestibule, lorsque le pied lui glissa. Un homme de la bande fondit aussitôt sur lui et le tua. On laissa son cadavre dans la rue; il était presque nu, car, réveillé en sursaut, Abbâd n’avait pas eu le temps de s’habiller.
Ensuite Ibn-Ocâcha conduisit ses hommes à la maison du commandant. Celui-ci s’attendait si peu à être attaqué, qu’au moment même où l’on faisait irruption dans sa demeure, il regardait danser des almées. Moins brave qu’Abbâd, il se cacha lorsqu’il entendit le cliquetis des épées dans la cour; mais sa retraite ayant été découverte, il fut arrêté, et, dans la suite, tué.
Aux premiers rayons de l’aube, pendant qu’Ibn-Ocâcha courait de maison en maison afin de persuader aux nobles de faire cause commune avec lui, un imâm qui se rendait à la mosquée, vint à passer devant le palais d’Abbâd. Ses regards tombèrent sur un corps qui gisait là, nu et sans vie. Reconnaissant, non sans peine, dans ce cadavre souillé de boue celui du jeune prince, il lui rendit un pieux, un dernier honneur, en le couvrant de son manteau. A peine fut-il parti qu’Ibn-Ocâcha arriva au même endroit, entouré de cette tourbe qui, dans les grandes villes, pousse des cris d’allégresse à chaque révolution. Sur son ordre, la tête d’Abbâd fut détachée du cadavre et promenée par les rues sur la pointe d’une pique. A ce spectacle, les soldats de la garnison jetèrent leurs armes, et tâchèrent de sauver leur vie par une fuite précipitée. Ibn-Ocâcha rassembla alors les Cordouans dans la grande mosquée, et leur enjoignit de prêter serment à Mamoun. Bien qu’il y en eût plusieurs qui étaient sincèrement attachés à Motamid, la peur fut si grande et si générale, que tout le monde s’empressa d’obéir. Peu de jours après, Mamoun arriva en personne. En apparence, il fut très-reconnaissant envers Ibn-Ocâcha; il le combla d’honneurs et l’on eût dit qu’il lui accordait une confiance illimitée; mais en réalité, il haïssait et craignait cet ancien bandit endurci au crime et qui était homme à l’assassiner lui-même au besoin, avec autant de sang-froid qu’il avait fait égorger le jeune Abbâd. Aussi cherchait-il avidement un prétexte, une occasion, pour l’éloigner sans bruit, sans éclat, de son royaume. Ce dessein, il ne le cachait pas toujours à ses courtisans, et un jour qu’Ibn-Ocâcha venait de le quitter, il poussa un long soupir, et, le regard enflammé de colère, il murmura quelques paroles de mauvais augure; puis un ami d’Ibn-Ocâcha ayant osé dire quelque chose en sa faveur: «Laisse-là ces vains propos! lui dit Mamoun; celui qui ne respecte pas la vie des princes n’est pas fait pour les servir.»
Un mois plus tard (juin 1075), le sixième de son séjour à Cordoue, Mamoun mourut empoisonné… Un de ses courtisans fut accusé d’avoir commis ce crime; mais Ibn-Ocâcha y aurait-il été étranger? On a peine à le croire.
Que l’on se transporte maintenant à la cour de Séville et que l’on se figure la douleur de Motamid, alors qu’il reçut la nouvelle doublement fatale de la perte de Cordoue et de la mort de son fils, de son premier-né qu’il chérissait jusqu’à l’idolâtrie! Et pourtant il y eut dans ce noble cœur un sentiment qui parla plus haut que la douleur, plus haut surtout que le désir de la vengeance: ce fut un sentiment de profonde gratitude envers cet imâm qui avait eu la délicatesse de couvrir de son manteau le cadavre d’Abbâd. Il regrettait de ne pouvoir le récompenser, car il ne connaissait pas même son nom, et s’appropriant un vers qu’un ancien poète avait composé dans une occasion semblable: «Hélas! dit-il, j’ignore quel est celui qui a couvert mon fils de son manteau, mais je sais que c’est un homme noble et généreux146.»
Pendant trois ans, les efforts qu’il fit pour reconquérir Cordoue et venger la mort de son fils sur Ibn-Ocâcha, demeurèrent inutiles, jusqu’à ce qu’enfin il prît Cordoue d’assaut, le mardi 4 septembre 1078. Pendant qu’il entrait dans la ville par une porte, Ibn-Ocâcha en sortait par une autre; mais Motamid lança à sa poursuite des cavaliers qui réussirent à l’atteindre. Sachant qu’il n’avait pas de pardon à attendre de la part d’un père dont il avait fait égorger le fils, l’ancien brigand voulut au moins vendre chèrement sa vie et se rua sur ses ennemis comme un buffle en fureur; mais il succomba sous le nombre. Motamid fit clouer son cadavre sur une croix, avec un chien à côté, et la conquête de Cordoue fut suivie de celle de tout le pays tolédan qui s’étendait entre le Guadalquivir et le Guadiana147.
C’étaient de beaux succès, mais la médaille avait son revers. En comparaison des autres rois andalous, Motamid était un prince puissant; toutefois il n’était pas plus indépendant qu’eux; lui aussi était tributaire. D’abord il l’avait été de Garcia, troisième fils de Ferdinand et roi de Galice148, et il l’était d’Alphonse VI, depuis que celui-ci s’était emparé des royaumes de ses deux frères, Sancho et Garcia. Or, Alphonse était un suzerain fort incommode: ne se contentant pas d’un tribut annuel, il menaçait de temps en temps de s’approprier les Etats de ses vassaux arabes. Une fois, entre autres, il vint envahir, à la tête d’une nombreuse armée, le territoire de Séville. Une consternation indicible régnait parmi les musulmans, trop faibles pour se défendre. Seul le premier ministre, Ibn-Ammâr, ne désespérait pas. Il ne comptait point sur l’armée sévillane; essayer de vaincre avec elle les troupes chrétiennes, c’eût été une tentative chimérique; mais il connaissait Alphonse, car souvent il avait été à sa cour149; il le savait ambitieux, mais aussi à demi arabisé, c’est-à-dire facile à gagner pourvu que l’on connût ses goûts, ses caprices, ses fantaisies. C’était sur cela qu’il comptait, et, sans perdre de temps à organiser la résistance à main armée, il fit fabriquer un échiquier tellement magnifique qu’aucun roi n’en possédait un pareil. Les pièces en étaient d’ébène et de bois de sandal; elles étaient incrustées d’or. Muni de cet échiquier, il se rendit, sous un prétexte quelconque, au camp d’Alphonse, lequel le reçut fort honorablement, car Ibn-Ammâr était du petit nombre des musulmans qu’il estimait.
Un jour Ibn-Ammâr montra son échiquier à un noble castillan qui jouissait auprès d’Alphonse d’une grande faveur. Ce noble en parla au roi, et celui-ci dit à Ibn-Ammâr:
– De quelle force êtes-vous aux échecs?
– Mes amis sont d’opinion que je joue assez bien, lui répondit Ibn-Ammâr.
– On m’a dit que vous possédez un échiquier superbe.
– C’est vrai, seigneur.
– Pourrais-je le voir?
– Sans doute, mais à une condition: nous jouerons ensemble; si je perds, l’échiquier vous appartiendra; mais si je gagne, je pourrai exiger ce que je veux.
– J’y consens.
On apporta l’échiquier, et Alphonse, stupéfait de la beauté et de la finesse du travail, s’écria en faisant le signe de la croix:
– Bon Dieu! jamais je n’aurais cru que l’on pût parvenir à faire un échiquier avec tant d’art!
Puis, quand il l’eut suffisamment admiré:
– Qu’est-ce que vous disiez donc, seigneur? reprit-il; quelles étaient vos conditions?
Ibn-Ammâr les ayant répétées:
– Non, par Dieu! je ne joue pas quand l’enjeu m’est inconnu; vous pourriez me demander une chose que je ne serais pas à même de vous accorder.
– Comme vous voulez, seigneur, répondit froidement Ibn-Ammâr, et il ordonna à ses serviteurs de reporter l’échiquier dans sa tente.
On se sépara; mais Ibn-Ammâr n’était pas homme à se laisser rebuter si facilement. Sous le sceau du secret, il confia à quelques nobles castillans ce qu’il exigerait d’Alphonse au cas où il gagnerait la partie, et leur promit des sommes fort considérables s’ils voulaient le seconder. Séduits par l’appât de l’or et suffisamment rassurés sur les intentions de l’Arabe, ces nobles s’engagèrent à le servir; et quand Alphonse qui, de son coté, brûlait du désir de posséder le superbe échiquier, les consulta sur ce qu’il ferait, ils lui dirent: «Si vous gagnez, seigneur, vous posséderez un échiquier que chaque roi vous enviera, et dussiez-vous perdre, que pourrait-il vous demander, cet Arabe? S’il fait une demande indiscrète, ne sommes-nous pas là, ne saurons-nous pas le mettre à la raison?» Ils parlèrent si bien qu’Alphonse se laissa vaincre. Il fit donc avertir Ibn-Ammâr qu’il l’attendait avec son échiquier, et quand le vizir fut arrivé:
– J’accepte vos conditions, lui dit-il; jouons donc!
– Avec grand plaisir, lui répondit Ibn-Ammâr; mais faisons les choses dans les règles; permettez qu’un tel et un tel – et il nomma plusieurs nobles castillans – soient nos témoins.
Le roi y consentit, et dès que les nobles qu’Ibn-Ammâr avait nommés furent arrivés, le jeu commença.
Alphonse perdit la partie.
– Puis-je maintenant demander ce que je veux, comme nous en sommes convenus? demanda alors Ibn-Ammâr.
– Sans doute, répliqua le roi; voyons, qu’exigez-vous?
– Que vous retourniez dans vos Etats avec votre armée.
Alphonse pâlit. En proie à une excitation fiévreuse, il mesurait la salle à grands pas, se rasseyait, puis se remettait à marcher.
– Me voilà pris, dit-il enfin à ses nobles, et c’est vous qui en êtes la cause. Je craignais une demande de cette nature de la part de cet homme, mais vous me rassuriez, vous me disiez que je pouvais être tranquille; je cueille à présent le fruit de vos détestables conseils!