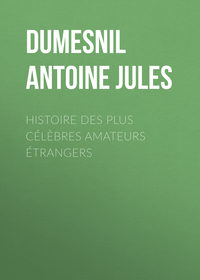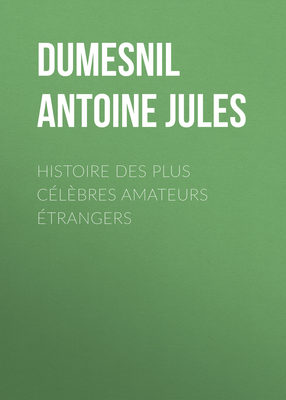Kitabı oku: «Histoire des Plus Célèbres Amateurs Étrangers», sayfa 18
AMATEURS HOLLANDAIS
CONSTANTIN HUYGENS,
UTENBOGARD 389 , LE BOURGMESTRE JEAN SIX
1596 – 1700
CHAPITRE XXXI
Originalité du génie de Rembrandt. – Accusations dirigées contre sa vie et son caractère, réfutées par ses liaisons avec les hommes les plus honorables de son temps. – Constantin Huygens, ses portraits par Van Dyck et Mireveldt. – Jean de Bisschop lui dédie la première partie de ses gravures de statues antiques. – Relations de Rembrandt avec C. Huygens; tableaux pour le stathouder Frédéric Henri. – Rembrandt donne un tableau à Huygens. – Le receveur Utenbogard, ami de Rembrandt et de Jean de Bisschop.
1596 – 1700
Si l'originalité dans les arts était à elle seule la marque la plus certaine du génie, aucun peintre ne pourrait être comparé à Rembrandt. Tandis que les maîtres les plus éminents des autres écoles, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, le Corrège, le Titien, Rubens, le Poussin, Lesueur, Velasquez et Murillo, laissent apercevoir, même dans leurs chefs-d'œuvre, l'influence, soit de l'antique, soit de leurs premières leçons, Rembrandt seul, sans aucun modèle antérieur, inaugure une manière à part, entièrement due à sa forte personnalité. L'idéal, tel que l'ont conçu les grands peintres italiens, lui manque absolument; il copie et rend la nature comme il la voit, sans se préoccuper de la beauté des formes, et ses figures peintes et gravées offrent de nombreux types, dans lesquels le laid, et même le difforme, ne craignent pas de se montrer. Toutefois, on ne saurait lui refuser une poésie qui lui est propre, et telle est la puissance magique de son génie, qu'elle force d'admirer tout ce que son pinceau a touché, tout ce que la fantaisie de sa pointe a produit. Pour les effets tirés de l'opposition de la lumière et des ombres, et pour l'emploi du clair-obscur, il n'a pas d'égal, et son coloris, d'un ton chaud et vigoureux, attire l'œil et lui plaît. Original dans le portrait, dans le paysage, dans la composition et l'exécution des scènes les plus opposées, telles que: la Leçon d'anatomie, la Garde de nuit, la Descente de croix ou le Bon samaritain; aussi étonnant dans ses gravures que dans ses tableaux, Rembrandt sera toujours considéré, tant que vivront ses ouvrages, comme un des chefs de la peinture et de la gravure. Ses œuvres, si éloignées du style des Italiens, attestent l'immense domaine de l'art, sa variété, sous la main et l'imagination de l'homme, sa beauté dans tous les genres. Sa manière plaît surtout à notre époque, peu portée à la recherche du beau idéal, et peut-être trop disposée en toutes choses au réalisme.
Les biographes contemporains de Rembrandt, Sandrart390, Houbraken391, et d'autres, tout en faisant l'éloge de son talent, ont beaucoup rabaissé son caractère. Copiées par leurs successeurs392, sans aucun examen, ainsi qu'il arrive presque toujours, ces assertions malintentionnées ont présenté l'artiste hollandais comme un homme plus que bizarre, irritable, avare à l'excès, menteur, et presque faussaire, pour mieux vendre ses ouvrages; maniaque, alchimiste jusqu'à la folie. Ces accusations nous ont toujours paru très-extraordinaires; nous ne pouvons mieux les comparer qu'aux anecdotes inventées à plaisir pour faire un roman de la vie de notre Lesueur. Si Rembrandt n'a pas été exempt de quelques-uns des défauts qu'on lui reproche, nous croyons qu'ils ont été singulièrement exagérés par l'envie et la haine, ces deux harpies qui s'attachent toujours à faire expier au génie sa supériorité. Grâce aux recherches de quelques amis des arts et de la vérité, qui ont remonté jusqu'aux sources les plus authentiques, la lumière commence à se faire sur la vie et le caractère de Rembrandt. De notre côté, nous oserons avancer que les investigations auxquelles nous nous sommes livré, nous permettent de réfuter, en grande partie, les tristes calomnies qui ont poursuivi la mémoire de l'artiste jusqu'à nos jours. Elles nous ont montré Rembrandt lié, jusqu'à l'intimité, avec les hommes les plus considérés et les plus recommandables de son temps, et jouissant lui-même de toute leur estime et de toute leur affection. Sans doute, on ne peut nier ni sa bizarrerie ni ses malheurs, dont la véritable cause ne nous paraît pas jusqu'ici avoir été expliquée d'une manière satisfaisante; mais ce n'est pas une raison suffisante pour faire de Rembrandt une sorte de personnage fantastique, ressemblant à son docteur Faust. Nous nous estimerions donc heureux si nous pouvions contribuer, pour notre faible part, à réhabiliter la mémoire, trop longtemps calomniée, de ce grand artiste.
Parmi les personnages dont les noms sont cités par les biographes de Rembrandt, nous en avons distingué trois, qui ont vécu avec lui sur le pied des sentiments les plus affectueux et des relations les plus honorables.
Le premier est Constantin Huygens, chevalier, seigneur de Zuylichem, le père de l'illustre physicien, et que la célébrité de son fils a un peu trop fait oublier. Il était cependant par lui-même remarquable à plus d'un titre: homme d'État distingué, il cultivait les lettres latines et hollandaises393, et il réunissait l'expérience des affaires au savoir et au goût des belles choses. Attaché, comme secrétaire et conseiller intime, aux stathouders Frédéric-Henri, Guillaume II et Guillaume III, il les servit avec dévouement, mais aussi, dit-on, sans flatterie.
Constantin Huygens aimait beaucoup les arts, et entretenait des relations avec les principaux maîtres de son temps. Van Dyck a fait son portrait, qui est gravé dans ceux de ses hommes illustres, et Huygens a célébré cette gracieuseté du peintre par le distique suivant:
Hugenium illustres inter mirare? Paranda
His umbris lucem quæ daret umbra fuit.
«Pourquoi vous étonner de trouver Huygens au milieu de ces hommes illustres? Ne fallait-il pas trouver une ombre qui fît mieux ressortir ces lumières?» Il a aussi célébré le génie de Van Dyck et son livre des portraits par deux autres distiques insérés dans ses œuvres latines394.
On trouve, dans le même ouvrage, l'épitaphe du peintre Mireveldt, dont il vante le talent, et qui, déjà mourant, avait peint son portrait, ainsi qu'il l'explique par un distique latin395.
On voit, en outre, qu'il était lié avec le peintre jésuite Daniel Seghers396, et qu'il professait la plus vive admiration pour les gravures sur cuivre et sur bois d'Albert Durer, qu'il a célébrées dans trois petites pièces latines397.
Constantin Huygens n'était pas moins sincère admirateur des ouvrages de l'antiquité que des tableaux de l'École hollandaise: c'est à lui que Jean de Bisschop (Episcopius) a dédié la première partie de son recueil de gravures de statues antiques398.
Dans cette dédicace, l'auteur considère Constantin Huygens comme un grand amateur d'art, et il l'appelle: Picturæ studiosus. Partisan de l'étude de l'antiquité, qu'il préfère à celle de la nature, Jean de Bisschop s'efforce de démontrer, en s'appuyant sur l'exemple de Michel-Ange, de Raphaël et du Poussin, que l'antiquité, ayant fait choix, dans la nature humaine, de tous les modèles les plus beaux, doit être considérée comme le fil d'Ariadne, qui peut seul guider les artistes.
La première partie de l'ouvrage se compose de cinquante planches gravées par lui-même, mais dessinées par différents artistes d'après les plus belles statues antiques, telles que: le Faune aux cymbales, l'Apollon du belvédère, le Laocoon, deux des fils de Niobé, l'Antinoüs, etc. Ces gravures ne sont accompagnées d'aucun texte explicatif, sauf la dédicace, en latin et en hollandais, qui expose le but que se proposait l'auteur. Il voulait initier ses compatriotes à la connaissance et à l'étude des plus beaux modèles que l'antiquité nous a laissés. Mais il est à regretter que Bisschop n'ait pas mieux rendu, avec son burin, la pureté des contours des statues qu'il copiait. Ses gravures sont molles et ne reproduisent pas bien l'effet de la sculpture antique, quoique, sous le rapport du dessin et de l'expression, elles ne manquent pas d'un certain mérite. – La dédicace d'un pareil ouvrage à Constantin Huygens prouve qu'il connaissait bien les œuvres de l'art antique, et qu'il était capable d'en apprécier la beauté.
D'un autre côté, ses relations avec Rembrandt montrent qu'il avait dignement apprécié le génie du peintre hollandais.
On sait que les princes de la maison d'Orange ont, de tout temps, recherché les œuvres de l'art. S'il entrait dans leur politique d'encourager celles écloses dans le pays qu'ils dirigeaient, on peut dire que leur inclination personnelle les y portait également. Placés à la tête du gouvernement d'une nation qui a vu naître et fleurir un si grand nombre de peintres remarquables, comment les stathouders auraient-ils pu ne pas partager le goût de leurs concitoyens pour les œuvres si variées, si naturelles et si brillantes de l'école hollandaise? Aussi s'appliquèrent-ils à réunir des tableaux des principaux maîtres. Rembrandt était trop connu, lorsqu'il vint s'établir à Amsterdam, en 1630, pour ne pas être signalé à l'attention des princes de Nassau. Ce fut, à ce qu'il paraît, Constantin Huygens, conseiller intime et secrétaire du stathouder Frédéric-Henri, qui servit d'intermédiaire entre le prince et l'artiste. On a publié, dans ces dernières années399, les lettres de Rembrandt adressées à Huygens, et relatives à deux des cinq tableaux que Rembrandt avait exécutés pour le stathouder.
Ces tableaux représentent une suite de sujets tirés de la Passion de Jésus-Christ; savoir: la Mise en croix, la Descente de croix, l'Ensevelissement, la Résurrection et l'Ascension. Les lettres de Rembrandt à Constantin Huygens n'ont rapport qu'à l'Ensevelissement et à la Résurrection, et ne parlent que de leur prix: on voit par la première que Rembrandt espérait obtenir de Son Altesse pas moins de mille florins, pour chacune de ces toiles; – «mais que si Son Altesse pense qu'elles ne méritent pas tant, elle lui en donnera moins, suivant son bon plaisir; se fiant au goût et à la discrétion de Son Altesse, il se contentera de cela avec reconnaissance.»
Le prix demandé par le peintre fut réduit à six cents florins, pour chaque tableau, et la seconde lettre à Huygens, écrite, dit Rembrandt, sur l'encouragement du receveur Utenbogard, dont nous allons bientôt parler, apprend que tout en acceptant ce prix, Rembrandt réclamait les intérêts, par la raison qu'on les avait payés à d'autres.
Enfin, dans la troisième lettre, la seule dont la date soit rapportée, et qui est écrite de la Haye, le 27 janvier 1639, Rembrandt dit à Huygens: «Monsieur le receveur Utenbogard est venu chez moi, comme j'étais occupé à emballer les deux tableaux. Il voulait d'abord les voir encore une fois. Il me dit que, s'il plaisait à Son Altesse, il voulait bien me faire le paiement en question sur sa recette. Ainsi, je vous prierais, monsieur, de faire en sorte que Son Altesse me paye ces deux tableaux, et que j'en reçoive l'argent au plus tôt, vu qu'il me serait extrêmement utile en ce moment.»
Ces lettres montrent, il est vrai, le désir très-vif qu'avait Rembrandt d'être payé promptement; mais il y a loin de là au reproche mérité d'avarice et de cupidité. Au contraire, on voit qu'il accepte la réduction du prix qu'il avait fixé, et qu'il ne réclame point contre le refus des intérêts.
Constantin Huygens, ou, comme on l'appelait à la cour, M. de Zuylichem, s'empressa de faire donner satisfaction au peintre. Dès le 17 février 1639, et sur son attestation, il lui fit délivrer, au nom du prince, une ordonnance de paiement de 1244400 florins, «pour les deux tableaux représentant, l'un l'Ensevelissement, l'autre la Résurrection de N. – S. Jésus-Christ, exécutés par lui et livrés à Son Altesse.» Ainsi, les intérêts ne furent point alloués.
Ces deux tableaux, avec les trois autres, après avoit fait partie pendant longtemps de la galerie de Dusseldorf, sont maintenant, avec un sixième du même maître, l'Adoration des bergers, à la Pinacothèque de Munich401.
Pour témoigner sans doute sa reconnaissance à M. de Zuylichem, Rembrandt voulut lui faire un tableau qu'il lui donna, ainsi qu'il résulte du commencement de sa lettre de la Haye, du 27 janvier 1639, ainsi conçue:
«Monsieur, – c'est avec un plaisir particulier que j'ai lu votre agréable missive du 14 de ce mois; j'y trouve votre bienveillance et votre affection, de sorte qu'avec l'affection cordiale que je vous porte de mon côté, je me trouve obligé de vous rendre service et amitié. C'est par suite de cette affection que, malgré vos réserves, je vous envoie la toile ci-jointe, espérant que vous ne la refuserez pas, car c'est le premier souvenir que je vous donne.» Cette lettre suffirait à elle seule pour réfuter le reproche d'avarice poussée à l'extrême que l'on a souvent adressé au peintre; car un avare ne donne point ce dont il espère tirer un profit. Bien qu'il fût lié avec M. de Zuylichem, auquel il devait plus d'un service, si ce que ses anciens biographes ont raconté de sa cupidité eût été vrai, Rembrandt n'aurait certainement pas fait, même à un ami, le cadeau d'une toile qu'il pouvait vendre très-cher. – On ignore également et le sujet de ce tableau et ce qu'il est devenu; mais les lettres que nous venons de citer prouvent l'affection cordiale que l'artiste portait à Constantin Huygens, et les bons offices que le grand seigneur s'efforçait de rendre au peintre.
Indépendamment des tableaux dont nous venons de parler, Rembrandt avait gravé un charmant portrait du prince Frédéric-Henri, alors qu'il n'était encore qu'enfant. On croit qu'il l'exécuta par l'entremise du poëte de Cats, précepteur du jeune prince, avec lequel il était lié, et dont il a également gravé un fort beau portrait402.
Le receveur Utenbogard, dont Rembrandt, dans ses lettres, invoque l'opinion à l'appui de sa réclamation des intérêts du prix de ses tableaux, et qu'il montre disposé à le payer sur sa recette, était un des amis de l'artiste, et n'estimait pas moins ses œuvres que M. de Zuylichem. Trésorier des états de Hollande pour le territoire d'Amsterdam, il employait une grande partie de sa fortune à réunir des objets rares et précieux, et principalement des gravures et des dessins. C'est à lui que Jean de Bisschop a dédié la seconde partie de ses Signorum veterum icones, et voici les deux raisons qu'il donne de cette courtoisie. La première, c'est parce que Utenbogard a mis à sa disposition, avec la plus grande bienveillance, toutes les belles choses qu'il possède: c'est donc un devoir pour lui de faire connaître au public où il a trouvé ce trésor. La seconde raison, c'est afin d'attester à tous que Utenbogard connaît parfaitement la valeur de toutes ces raretés (elegantiarum), et qu'il est doué d'un goût sûr, joint au désir de laisser voir ses collections à tous les amis de l'art. – Bisschop s'élève avec force contre ces collectionneurs soupçonneux et jaloux, qui, loin de communiquer aux autres ce qu'ils possèdent, en réservent la jouissance pour eux seuls. – «Quelle chose odieuse, quel aveuglement, s'écrie-t-il, n'est-ce point de moins estimer ce que l'on possède, par cela seul qu'un autre aura la même chose! Jouiriez-vous mieux de la chaleur du soleil, de la lumière du jour, de la douceur de l'air, de la fraîcheur d'une source, de l'usage d'une voie publique, parce que vous seriez appelé seul à en jouir?»
Rembrandt était aussi attaché au trésorier des états de Hollande qu'au conseiller intime du stathouder: il a fait son portrait, exécuté une belle gravure de sa maison de campagne, ce qui fait supposer que Utenbogard devait l'y recevoir, et il l'a représenté une seconde fois dans ses fonctions de receveur, dans le portrait appelé le Peseur d'or403.
CHAPITRE XXXII
Gloire de la Hollande après la paix de Munster. – L'hôtel de ville d'Amsterdam, bâti par Van Campen. – Jean Six, sa famille, son éducation. – Le poëte Vondel. – Le Mariage de Jason et de Creuse, tragédie de Six, avec une eau-forte de Rembrandt. – Portrait du bourgmestre. – Paysages de Rembrandt. – Le docteur Tulp, beau-père de Six, et la Leçon d'anatomie. – Gravures de tableaux modernes dédiées à Six par J. de Bisschop. – Obscurité des dernières années de Rembrandt. – Mort de Six.
1618 – 1700
C'était alors l'époque la plus glorieuse des annales de la Hollande: après une lutte acharnée de près d'un siècle, dans toutes les parties du monde, ce peuple, petit par le nombre, mais grand par l'amour de la patrie et de la liberté, venait de forcer le faible et incapable descendant de Charles-Quint à signer une paix humiliante, dans laquelle, en dépit de l'inquisition espagnole, il avait été obligé d'admettre la liberté de conscience, la liberté du commerce maritime et l'indépendance absolue des Provinces-Unies. La raison, la justice et la liberté, pour lesquelles cette poignée d'hommes indomptables avait combattu et souffert avec tant de persévérance, triomphaient enfin du despotisme uni à l'intolérance. Les états généraux de Hollande avaient ainsi réalisé le vœu de leur devise nationale: Concordia res parvæ crescunt.
La ville d'Amsterdam, en particulier, obtenait, par le traité de Munster, tous les avantages que ses hardis armateurs avaient souhaités le plus ardemment. Tandis qu'un des articles de la paix stipulait la fermeture de l'Escaut, et privait Anvers de son entrepôt maritime et de ses richesses, la cité d'Amsterdam voyait toutes les mers s'ouvrir à son commerce, d'autant plus florissant qu'il était devenu plus sûr par suite de l'abaissement de la puissance espagnole.
Aussi, presqu'au moment même où fut signée la célèbre paix de Westphalie, le conseil des bourgmestres d'Amsterdam résolut de faire construire un nouvel hôtel de ville, dont la fondation rappelât cet événement mémorable. Il voulut que sa grandeur et sa beauté fussent dignes d'une cité qui était alors considérée par toutes les autres, sans même en excepter Londres, comme la capitale maritime du monde entier. Le corps de ville d'Amsterdam s'était toujours distingué par son patriotisme. À la tête, pendant la guerre, du mouvement de résistance dirigé contre la tyrannie espagnole, il voulut, au jour du triomphe, honorer la mémoire des anciens magistrats municipaux qui, les premiers, avaient donné le signal de la résistance à l'oppression étrangère. Le conseil de ville fit donc graver sur la première pierre de l'édifice l'inscription suivante: «Le IV des calendes de novembre de l'an 1648, jour auquel fut terminée la guerre qui durait depuis plus de quatre-vingts ans, tant par terre que par mer, dans presque toutes les parties du monde, entre les peuples des Pays-Bas et les trois puissants rois Philippe d'Espagne; et après que la liberté de la patrie et la religion eurent été affermies sous les auspices des seigneurs bourgmestres Gerb. Pancras, Jacq. de Graef, Sib. Valckenier, Pierre Schaep, cette pierre fut posée par les fils et descendants desdits seigneurs bourgmestres, comme premier fondement de cet édifice404.»
Le conseil fit choix de l'architecte van Campen pour en diriger la construction. On sait que cet artiste s'est illustré par ce monument, dont la masse imposante donne une haute idée de la richesse et de l'importance de la ville d'Amsterdam. Sa distribution et sa décoration intérieures répondent à sa façade principale, et il a été orné de peintures et de sculptures par les artistes hollandais les plus renommés de cette époque.
Jean Six n'était encore que secrétaire de la ville d'Amsterdam, lorsque fut commencée l'érection du nouveau palais municipal. Mais il paraît certain qu'il fut chargé avec ses collègues de veiller à l'exécution des travaux.
Il était né à Amsterdam en 1618. Son père avait fondé ou augmenté le patrimoine de la famille par d'heureuses spéculations commerciales, et il transmit à son fils une grande fortune, jointe à une considération méritée. Le jeune homme voulut se montrer digne de jouir de ces avantages, et de prendre part à l'administration des affaires de sa ville natale. Il fit d'excellentes études, et comme la nature l'avait doué pour la poésie et les lettres d'une aptitude toute particulière, il fut bientôt cité parmi ses condisciples comme donnant les plus belles espérances. Il les réalisa pendant sa longue carrière, en cultivant les lettres, en vivant avec les artistes et en recherchant leurs œuvres.
Parmi les poëtes qu'il compta au nombre de ses amis, on cite l'illustre Vondel, le véritable créateur de la tragédie hollandaise, qui a également laissé dans d'autres genres des œuvres très-remarquables. La fermentation politique et religieuse qui agitait depuis longtemps les pays-Bas avait fait naître, comme il arrive presque toujours en pareille circonstance, des écrivains et des poëtes qui marchaient à la tête du mouvement national. Il ne nous appartient pas d'apprécier leur talent, encore moins de juger leur style, ne connaissant pas la langue hollandaise. Nous nous permettrons seulement de faire remarquer qu'un pays qui comptait à la fois au nombre de ses concitoyens Grotius, le fondateur du droit des gens européens, l'éloquent défenseur de la liberté des mers; Vondel, le poëte inspiré de tant de tragédies, d'odes et de satires; Christian Huygens, l'émule de Descartes et de Newton, et Rembrandt, l'incomparable maître du clair-obscur, un tel pays, disons-nous, n'avait rien à envier à aucun autre.
Le succès des tragédies de Vondel détermina sans doute Jean Six à composer sa pièce de Médée405; nous ignorons si elle fut représentée sur le théâtre construit par Van Campen, et dont l'inauguration avait eu lieu en 1637 par le Gisbert d'Amstel, le chef-d'œuvre le plus populaire de Vondel, dédié par lui à Grotius. Les critiques s'accordent à louer la pureté de style et la beauté des vers de Jean Six; quant à l'intérêt dramatique, basé sur l'amour dédaigné, la jalousie et la vengeance de Médée, il était en rapport avec les idées des amateurs de tragédie, vers le milieu du dix-septième siècle.
Ce qui, à notre point de vue, recommande mieux le souvenir de la tragédie de Six, c'est la part que prit Rembrandt à sa publication. Il composa, pour être mise en tête de cette pièce, une eau-forte, reproduisant à sa manière le sujet de la pièce. «Elle représente, dit M. Charles Blanc406, l'intérieur d'un temple orné de colonnes et rempli de figures, parmi lesquelles on distingue un groupe de musiciens. Sur la droite, entre deux colonnes, paraît la statue de Junon, au-devant de laquelle est un autel, où s'élève la fumée d'un sacrifice que le pontife du temple va faire à la déesse. Aux pieds du prêtre sont deux figures à genoux, celles de Creuse et de Jason, dont on célèbre le mariage. On remarque sur le premier plan, qui est presque tout entier dans l'ombre, un escalier à double rampe, vers lequel s'avance une figure qui paraît être celle de Médée. Elle est suivie d'un serviteur. Ce morceau, fini avec soin, est d'une belle ordonnance et d'un grand effet. On lit au bas, dans une petite marge, quatre vers hollandais qui commencent par ces mots: Creus en Jason hier… etc.; et vers la droite: Rembrandt F. 1648.»
Cette gravure est bien dans la manière du maître; mais les costumes et l'architecture du lieu de la scène ne laisseraient guère deviner, si on ne le savait d'avance, qu'il s'agit de la représentation d'un sujet tiré de l'histoire des temps fabuleux de la Grèce. Les personnages sont coiffés de cet énorme turban que l'artiste affectionnait tant, nous ne savons pourquoi, mais qu'il copiait sans doute sur ceux des juifs d'Amsterdam. Les colonnes du temple sont gothiques, avec des arceaux comme au moyen âge; un dais est suspendu au-dessus de la tête des époux; dans le fond à droite, deux fenêtres vitrées éclairent ce singulier spectacle, tandis que, sur le devant, deux rideaux, attachés à une tringle et presque entièrement ouverts, laissent voir toute cette cérémonie. Il paraît que Rembrandt composa cette gravure de pure fantaisie, et sans vouloir représenter une des scènes de la pièce de Six, dans laquelle, dit M. Ch. Blanc, le mariage de Jason avec Creuse n'est pas célébré sous les yeux des spectateurs. – Après tout, cette estampe, comme un certain nombre d'autres du maître, nous paraît plus curieuse que belle; mais elle prouve l'amitié que l'artiste portait à notre bourgmestre.
Une autre gravure, bien plus connue, attestera cette liaison tant que subsistera la planche: nous voulons parler du fameux portrait de Jean Six, une des plus étonnantes œuvres du maître, et dont les meilleures épreuves, déjà très-recherchées du temps de Mariette407, sont portées aujourd'hui dans les ventes à des prix fabuleux. Le bourgmestre, vêtu comme les Hollandais de son temps, avec un pourpoint, des culottes et des bas de soie noirs, est debout, tête nue, appuyé sur le soubassement d'une fenêtre gothique, ouverte derrière lui, de manière à présenter en avant ses pieds un peu écartés, tandis que son corps penché, ses épaules et sa tête entrent dans l'épaisseur de l'embrasure. Il tient dans ses deux mains un livre ou manuscrit, qu'il paraît lire avec la plus grande attention. Sur une table, à droite, on voit son manteau, son épée et son baudrier, et sur une chaise, en face de lui, des papiers entassés. Un tableau, caché à moitié par un rideau entr'ouvert, et dont il est difficile de distinguer le sujet, est appendu à la muraille, au-dessus de la table. Un épais rideau, à sa gauche, est tiré pour laisser pénétrer dans la chambre, par l'ouverture de la croisée, la vive lumière du jour. Les cheveux, la figure, le col de toile et ses glands, une partie du bras et du poignet gauche, se détachent en clair sur tout le reste de la personne et de l'appartement, qui sont entièrement dans l'ombre, à l'exception des papiers sur la chaise et du parquet. On lit cette inscription au bas de la planche: Jean Six, æt. 29, Rembrandt, 1647.
Ce n'est pas la seule fois que, dans ses gravures ou dans ses tableaux, Rembrandt ait représenté des personnages lisant, éclairés par la lumière qui entre dans une chambre par une ouverture placée derrière eux. On voit dans son œuvre, au Cabinet des estampes, un certain nombre de portraits exécutés de cette manière, tandis que les Deux philosophes en méditation, du musée du Louvre408, nous montrent la lumière éclairant l'un des tableaux directement en face, tandis que dans l'autre elle pénètre par derrière. Entrant ainsi dans la pièce où l'artiste plaçait ses personnages, la lumière, sous son pinceau comme sous sa pointe, produit ces merveilleux effets de clair-obscur, ces oppositions saisissantes d'ombre et de jour, qu'aucun autre n'est parvenu à égaler, et qui sont le cachet de son génie.
Nous ignorons à quelle circonstance est dû le portrait de Jean Six; la planche en fut-elle payée au graveur, ou celui-ci voulut-il laisser à son ami ce témoignage de son affection, comme nous l'avons vu donner un tableau à Constantin Huygens? Les renseignements manquent sur ce point. Mais il est certain qu'une étroite intimité unissait l'artiste et le bourgmestre. M. Scheltema409 cite, comme preuve de cette intimité, un album de Six, qui contient deux pages avec des esquisses de Rembrandt. Ce fait confirme toute la familiarité de leurs relations.
Dans le catalogue de l'œuvre de Rembrandt, «Gersaint410 raconte qu'un jour, Rembrandt étant à la campagne du bourgmestre, un valet vint les avertir que le dîner était prêt. Au moment où ils allaient se mettre à table, ils s'aperçurent qu'il n'y avait point de moutarde. Le bourgmestre ordonne au valet d'aller en chercher promptement dans le village. Rembrandt, qui connaissait la lenteur ordinaire de ce valet, et qui avait, lui, le caractère vif, paria avec son ami Six qu'il graverait une planche avant que ce domestique fût revenu. La gageure fut acceptée, et comme Rembrandt avait toujours des planches toutes prêtes au vernis, il en prit aussitôt une, et grava dessus le paysage qui se voyait du dedans de la salle où ils étaient. En effet, la planche fut achevée avant le retour du valet; Rembrandt gagna son pari.» Nous ignorons où Gersaint a pris cette anecdote; toujours est-il que parmi les paysages gravés par Rembrandt, il en est un qui porte le nom de Pont de Six.
On a dit411 que ce furent les petits voyages que faisait Rembrandt, de la ville d'Amsterdam à la campagne du bourgmestre Six, qui inspirèrent à ce grand peintre l'amour du paysage. Mais il visitait également le receveur Utenbogard à sa maison de campagne, dont il a laissé une vue gravée. On peut admettre aussi que Constantin Huygens l'aura reçu dans son habitation des champs, située au bord du canal, entre La Haye et Leyde, et qu'il a célébrée dans son poëme en hollandais, sous le nom de Hofwyck, c'est-à-dire fuite de la cour.
Rembrandt ne se montre pas moins surprenant dans le paysage que dans ses autres tableaux. Nous avons admiré, à l'exposition de Manchester, la vue d'une campagne au bord de la mer, dont l'aspect était saisissant de tristesse et de vérité. Mais ses paysages sont plus rares que ses autres œuvres.
Les lettres de l'artiste à Constantin Huygens, ses relations avec le receveur Utenbogard et le bourgmestre Six, l'anecdote racontée par Gersaint, tout réfute de la manière la plus péremptoire ce que dit Descamps412 du maître hollandais, avec une légèreté d'appréciation qui prouve bien qu'il ne comprenait pas le véritable génie de Rembrandt: – «Si ce peintre, dit-il, avait vécu avec des gens d'esprit, quelle différence n'aurions-nous pas trouvée dans ses ouvrages! Il aurait fait un plus beau choix de sujets, il y aurait mis plus de noblesse, il aurait perfectionné ce goût naturel, ce génie de peintre, dont chaque touche de pinceau et de pointe décèle en lui le caractère. Le bourgmestre Six a essayé, plus d'une fois, de mener Rembrandt dans le monde, sans pouvoir jamais l'obtenir; cet illustre ami avait eu la complaisance de se plier au caractère du peintre, pour acquérir sa confiance et le tirer de la mauvaise compagnie; mais Rembrandt ne changea point: il n'aimait que la liberté, la peinture et l'argent.» – Rembrandt ne changea point, et il eut grand'raison: s'il se fût mis à vouloir peindre avec plus de noblesse, dans la manière si vantée au siècle dernier et si fade des Lemoyne et des de Troy, ses œuvres seraient aujourd'hui reléguées aux derniers rangs, tandis que, grâce à la liberté qu'il a aimée, à la fantaisie qui a dirigé son pinceau et sa pointe, il est resté le chef de l'école hollandaise, et l'un des plus grands maîtres de l'art.