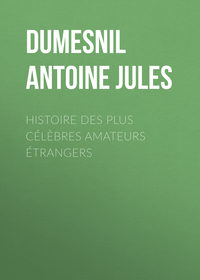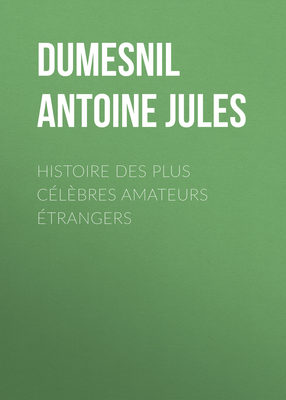Kitabı oku: «Histoire des Plus Célèbres Amateurs Étrangers», sayfa 17
CHAPITRE XXIX
Monuments décoratifs, peintures et cartons exécutés par Rubens pour l'entrée à Anvers de l'archiduc Ferdinand. – Inscriptions et vers latins composés par Gevaërts pour cette circonstance. – Description de quelques-unes des inventions exécutées par Rubens, ou sous sa direction. – Le prince Ferdinand va visiter Rubens malade de la goutte.
1635
Deux années avant la mort de Peiresc, Rubens avait été obligé, sans s'éloigner d'Anvers, de se remettre à faire de la peinture politique. L'infante Isabelle étant morte à Bruxelles, le 1er décembre 1633, le roi d'Espagne Philippe IV rentra en possession des Pays-Bas, que son aïeul Philippe II n'avait cédés à l'archiduc Albert et à sa femme que sous la réserve de retour à la couronne d'Espagne, dans le cas où ils ne laisseraient pas de postérité. Par suite de cette reprise de possession, Philippe IV, au commencement de 1634, avait donné le gouvernement général de ces provinces à son frère unique, le prince Ferdinand, jeune homme d'une grande espérance, qui était cardinal, et que, pour ce motif, on appelait le cardinal-infant. On était alors au plus fort de la guerre de Trente ans; les Suédois avaient envahi l'Allemagne, et ils luttaient avec avantage contre l'armée impériale. Le roi d'Espagne résolut d'envoyer l'infant au secours de son beau-frère, Ferdinand III, roi des Romains et de Hongrie, fils de l'empereur Ferdinand II, et qui commandait l'armée impériale. Les troupes espagnoles, ayant opéré leur jonction avec les impériaux, et occupé une forte position près de la ville de Nordlingen, y furent attaquées, le 5 septembre 1634, par les Suédois, sous la conduite de Gustave Horn, leur général en chef. Mais après un grand nombre d'attaques infructueuses, les Suédois furent mis dans une déroute complète. On attribua, en grande partie, le succès de cette journée aux dispositions prises par l'infant Ferdinand. Aussi, lorsqu'à la fin de l'année 1634 il vint à Bruxelles prendre possession de son gouvernement des Pays-Bas, cette capitale lui fit le plus brillant accueil.
Averti que ce prince se rendrait à Anvers au commencement du mois de mai 1635, le conseil communal de cette ville résolut de recevoir le vainqueur de Nordlingen avec le plus grand éclat, et de faire dresser des portiques et des arcs de triomphe dans les principales rues et places par lesquelles ce prince devait passer. Pour être certain de réussir, le sénat chargea Rubens de faire les plans de ces monuments décoratifs, d'en surveiller la construction et d'en décorer les diverses parties374. On ignore s'il reçut un programme, ou si le sénat voulut s'en rapporter à son imagination si féconde. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il représenta d'une manière remarquable, à l'aide de l'histoire et de l'allégorie, les principaux événements contemporains, qu'il sut rendre hommage aux vertus qu'on se plaisait à attribuer au jeune prince, et qu'il eut l'art de lui exposer avec son pinceau les vœux et les espérances de la ville d'Anvers. Aucun artiste, en Europe, ne pouvait être comparé à Rubens pour la composition de ces grandes machines, qui demandent une imagination pleine de ressources et une main qui exécute sans hésitation, et cependant d'une manière qui plaise à l'œil. Le chef de l'école d'Anvers possédait à un suprême degré ces deux éminentes qualités: jamais l'invention ne lui avait manqué; jamais l'exécution ne lui avait fait défaut. La galerie de Médicis, à Paris, les cartons de l'église de Loëches, près de Madrid, le plafond de White-Hall, à Londres, et cent autres grandes toiles, attestaient sa verve et son génie. Le choix du sénat d'Anvers était donc très-heureux.
Les gravures de Théodore de Tulden nous ont conservé la représentation de l'entrée solennelle de l'infant Ferdinand à Anvers, le 15 de mai 1635375. À juger les compositions de Rubens par les estampes, le maître dut justifier le choix de ses concitoyens, et déployer un talent aussi remarquable que varié. Il fit élever de nombreux monuments décoratifs dont il donna les plans, et il dessina ou peignit tous les ornements dont sa fantaisie se plut à les embellir.
À cette époque, le goût des inscriptions et des devises en vers latins était dans toute sa force. La ville d'Anvers aurait donc cru manquer au respect qu'elle devait au gouverneur général des Pays-Bas, au vainqueur de Nordlingen, si elle n'avait pas fait célébrer ses vertus et ses exploits, ainsi que les hauts faits du roi son frère, par un de ses poëtes. À Gevaërts, en sa double qualité de secrétaire de la ville et d'historiographe du roi, échut le soin de composer cette poésie lapidaire. Nul ne pouvait mieux que lui entrer dans les pensées du peintre, faire comprendre ses allégories, et exprimer en même temps les vœux et les espérances légitimes de la reine de l'Escaut. Gevaërts était d'ailleurs un latiniste de première force, très-capable de composer, dans la langue d'Ovide, d'Horace et de Virgile, les hexamètres et les distiques destinés à être inscrits à côté des dessins, cartons ou peintures de son ami.
Michel, dans son Histoire de Rubens376, a donné «la description des tableaux allégoriques appliqués aux arcs, temples et portiques triomphaux inventés et peints par l'artiste,» en citant un grand nombre de vers latins composés à cette occasion par Gevaërts. On jugera de l'importance de ces monuments éphémères, élevés en l'honneur de l'entrée du prince Ferdinand, par ce fait que, dans l'espace de quelques mois seulement, Rubens avait fait élever, sur ses plans, sept arcs et quatre portiques triomphaux, qu'il avait décorés de peintures, de statues, de bas-reliefs, de dorures et autres ornements, et dont quelques-uns présentaient un développement de quatre-vingts pieds de haut sur soixante-dix-huit de large. Tous les amis de l'art doivent profondément regretter que les tableaux ou cartons, soit en grisaille, soit autrement, peints par Rubens à cette occasion, n'aient pas été conservés; ou, s'ils existent encore à Anvers, qu'ils ne soient pas exposés avec les autres œuvres du maître. Nous croyons ne pas nous tromper en avançant que ces compositions ne devaient pas être inférieures, dans leur genre, aux magnifiques allégories de l'histoire de la vie de Marie de Médicis. Naturellement, les événements les plus mémorables du règne de Philippe IV, la victoire de Nordlingen, l'union de la maison d'Autriche à celle de Bourgogne, l'histoire des empereurs d'Allemagne et des rois d'Espagne, le triomphe de la religion catholique, ou, comme on disait alors, l'extirpation de l'hérésie, avaient fourni à Rubens l'inspiration de ses principaux sujets. Toutefois, nous en remarquons plusieurs qui sortaient de ce programme. D'abord, c'est l'Arcus monetalis, arc de triomphe à deux faces, dressé près de l'hôtel royal de la monnaie d'Anvers, haut de soixante pieds sur quarante de large. Rubens y avait fait allusion aux richesses métalliques que l'Espagne tirait alors des mines du Pérou. La partie supérieure représentait les montagnes du Potosi, sur lesquelles on voyait l'arbre au fruit d'or du jardin des Hespérides, avec cette inscription:
Prætium non vile laborum.
À droite et à gauche, les colonnes d'Hercule, surmontées des disques de la lune et du soleil, avec cette allusion à l'immense étendue de la monarchie espagnole:
Ultrà anni solisque vias,
Oceanumque ultrà.
À gauche, le principal fleuve du Pérou; à droite, le Rio de la Plata.
De l'autre côté de l'arc, Hercule terrassant l'hydre, et l'Espagne cueillant le fruit de l'arbre des Hespérides, avec le vers de Virgile:
…Uno avulso non deficit alter
Aureus.
Au-dessous, de chaque côté, des ouvriers occupés à travailler aux mines, et Vulcain préparant les métaux; au milieu, une suite de monnaies espagnoles, et un médaillon avec ces mots:
Auro, argento, æri.
L'idée de l'Arcus monetalis convenait bien à la riche cité d'Anvers, que son commerce avait mise en possession d'une partie des richesses métalliques exportées par l'Espagne de ses possessions d'Amérique. Mais Rubens fit élever un autre monument, qui répondait mieux aux espérances et aux vœux de ses concitoyens. On sait que, pendant les longues guerres qui désolèrent les Pays-Ras, les Hollandais, maîtres de la mer et jaloux de la prospérité d'Anvers, avaient fermé l'Escaut à l'entrée comme à la sortie des navires. Cette ville, qui avait été pendant plus d'un siècle le centre d'un commerce maritime beaucoup plus important que celui d'Amsterdam, se vit bientôt languir, tandis que sa rivale, grâce à la liberté des mers, prenait un immense développement. Le sénat d'Anvers ne pouvait pas rester indifférent à la décadence de la cité: il voulut sans doute que Rubens exprimât les plaintes de ses habitants au prince-gouverneur des Pays-Bas, dans une composition digne d'attirer son attention d'une manière toute particulière. Que Rubens se soit inspiré des vœux de ses compatriotes, ou que son imagination ait été au-devant de leurs désirs, toujours est-il qu'il fit élever, au pont Saint-Jean, un arc de triomphe d'ordre rustique, de soixante pieds de haut sur soixante-dix de large, représentant, selon les expressions de Michel377 «une machine marine, par la quantité de cascades paraissant découler des superficies et extrémités du bâtiment.» Au milieu de cet arc, un magnifique tableau ou carton du peintre montrait Mercure, ce dieu du négoce, posé sur un piédestal, à la manière de la statue de Jean de Bologne, avec cette variante plus bourgeoise que poétique, que si, d'une main, il tenait son caducéc, de l'autre il tendait une bourse vide à la ville d'Anvers, personnifiée à genoux aux pieds du prince Ferdinand, auquel elle paraissait adresser ces vers de Gevaërts:
Ne, precor, hinc volucres flectat Cyllenius alas,
O princeps, cultamque sibi ne deserat urbem
Et fugitiva meo redeant commercia Scaldi.
À la droite de la ville d'Anvers paraît un matelot oisif, endormi sur son ancre et sa barque renversée; à gauche, on voit l'Escaut, sous la figure d'un vieillard, les cheveux négligés, la tête couverte de roseaux, assis sur des filets et dormant sur son bras soutenu par une urne, pendant qu'un génie défait les chaînes dont ses jambes sont entravées, et qu'un navire se dispose à appareiller. Les autres parties de l'arc sont occupées par des divinités marines, des génies ailés, la Pauvreté et la Richesse, le tout avec ces vers de Gevaërts, qui exprimaient bien les sentiments des armateurs et des négociants d'Anvers:
Scaldim cum pedibus princeps dabit ire solutis,
Desuetas iterum pontum decurrere puppes;
Pauperies procul et pallens abscedit Egestas,
Nec durum ulterius tractabit nauta ligonem.
Aurea securis revocabit secula Belgis
Fernandus, priscumque decus, ditesque resumet,
Mercibus omnigenis, florens Antverpia cultus,
Largaque succedet fœcundo copia cornu…
Ce monument, élevé à l'Escaut, source de la richesse d'Anvers, eut un grand succès, et les riches négociants durent remercier leur illustre compatriote, ainsi que son élégant traducteur latin, d'avoir si bien défendu leurs intérêts les plus chers.
Mais aux yeux de la postérité, la plus remarquable des inventions exécutées par le peintre, dans cette circonstance, est certainement celle qui représente le Temple de Janus. Rubens, on le sait, était l'homme de la paix; il travailla toute sa vie à la rendre à sa patrie, et s'il ne fut pas assez heureux pour réussir complétement à éloigner la guerre des Pays-Bas, il fit de constants efforts pour atteindre ce but aussi utile que glorieux. La supériorité de son génie d'artiste, qui le fit choisir plusieurs fois comme négociateur entre les puissances belligérantes, sut admirablement profiter de l'entrée du prince Ferdinand, pour exprimer sur la toile ses vœux pour la paix, qu'il considérait, avec Gevaërts comme le plus grand des biens378.
Rubens fit donc élever, sous le nom de Temple de Janus, un portique d'ordre dorique, surmonté d'un dôme, avec le buste à double visage de ce dieu. De l'intérieur de l'édifice, Mars, sous la figure d'un soldat demi-nu, un bandeau sur les yeux, un glaive dans sa main droite, une torche allumée dans sa main gauche, pousse avec violence en dehors les portes du temple, que, d'un côté, Tisiphone, Mégère et une Harpie s'efforcent d'ouvrir avec lui; tandis que, de l'autre, la Paix, la Religion et l'Abondance, aidées par l'Amour, font de vains efforts pour les tenir fermées. Entre les colonnes, le peintre a représenté, avec un admirable contraste, à droite, les malheurs et les cruautés inséparables de la guerre; à gauche, la prospérité publique que donne la paix. D'un côté, c'est un soldat qui traîne par les cheveux une femme dont l'enfant est étendu à ses pieds; il est suivi de la Pauvreté, de la Discorde, de la Fureur et du Deuil; de l'autre, on voit les biens de la paix, l'Abondance, la Richesse et la Félicité publique. Les contrastes entre ces différentes figures sont réellement admirables, et bien qu'on ne puisse en juger qu'imparfaitement par les gravures de Théodore de Tulden, il est permis d'affirmer que Rubens y brille d'un génie d'autant plus grand que sa main n'a fait que rendre fidèlement les sentiments les plus intimes et les plus vrais de son âme.
Toute cette composition est accompagnée, comme les précédentes, des vers de Gevaërts. Le docte commentateur des pensées de Marc-Aurèle partageait assurément l'opinion de Rubens sur la barbarie de la guerre: aussi, ses vers expriment avec bonheur les vœux que toute la ville d'Anvers adressait au prince-gouverneur pour la fermeture du Temple de Janus.
O utinam, partis terraque marique triumphis
Belligeri claudas, Princeps, penetralia Jani!
Marsque ferus, septem jam pene decennia Belgas
Qui premit, Harpyæque truces, Luctusque Furorque
Hinc procul ad Thraces abeant, Scythosque recessus,
Paxque optata diu populos atque arva revisat.
«Plût à Dieu, Prince, que, grâce aux victoires par vous remportées sur terre et sur mer, vous puissiez fermer les portes du temple de Janus; que le cruel dieu de la guerre, qui depuis près de soixante-dix ans opprime la malheureuse Belgique, avec les Harpies féroces, le Deuil et la Fureur, soit enfin obligé de fuir chez les Thraces et dans les antres de la Scythie, et qu'à sa place, la Paix, appelée depuis si longtemps par nos vœux, revienne consoler les peuples et présider aux travaux des champs.»
Malheureusement, ces vœux ne furent pas exaucés de longtemps. La guerre et son cortége ordinaire d'injustices, de violences et d'atrocités, désola pendant un grand nombre d'années encore les Pays-Bas espagnols; et lorsque la paix de Westphalie fut signée à Munster, en 1648, elle stipula, au profit des Provinces-Unies, la fermeture de l'Escaut, et acheva de ruiner le commerce maritime d'Anvers.
Le prince Ferdinand se montra très-satisfait des inventions de Rubens. On raconte que l'artiste ne put assister à son entrée triomphale, parce qu'alors il se trouvait atteint d'une douloureuse attaque de goutte. L'infant, qui avait connu le peintre à Madrid, ayant appris la cause qui le retenait chez lui, s'empressa d'aller le visiter dans sa maison, et prit un grand plaisir à causer avec lui et à examiner ce que Rubens appelait son Panthéon, c'est-à-dire sa collection de tableaux, statues, médailles, pierres gravées, estampes et autres objets d'art et de curiosité379. Ce n'était pas la première visite que Rubens eût reçue d'un prince: en juin 1625, l'archiduchesse Isabelle, accompagnée de son premier ministre et généralissime, le marquis Spinola, et du prince Sigismond de Pologne, avait honoré Rubens de sa présence, alors qu'elle revenait victorieuse de Bréda, qu'elle avait réduite à se rendre après un siége opiniâtre de plus de dix mois. On sait aussi que la reine Marie de Médicis, passant par Anvers en 1631, s'empressa de venir voir le peintre dont le pinceau avait si brillamment retracé les principaux événements de sa vie.
CHAPITRE XXX
Dernières années de Rubens: il travaille tant que la goutte le lui permet. – Il s'occupe de la gravure de ses œuvres: sa manière de diriger ses élèves graveurs. – Portrait de Gevaërts peint par Rubens et gravé par Paul Pontius. – Mort de Rubens. – Son épitaphe par Gevaërts. – Règle de conduite observée par Rubens. – Rockox et Gevaërts. – Génie de Rubens: accord du bon et du beau.
1635 – 1640
Dans les années qui s'écoulèrent depuis le 15 mai 1635 jusqu'au 30 mai 1640, époque de sa mort, Rubens fut souvent atteint de la goutte et privé de la satisfaction de pouvoir travailler. Mais dès que la maladie lui laissait quelque répit, il ressaisissait ses pinceaux avec bonheur et se remettait à peindre avec son entrain habituel. La maladie contre laquelle il luttait ne paraît pas avoir affaibli son génie; car il a exécuté, dans cette dernière période de sa vie, des tableaux tout aussi remarquables que dans sa jeunesse. On cite, entre autres, le célèbre tableau du Martyre de saint Pierre, que Geldorp lui commanda pour Jabach, et qui fut donné par ce dernier à l'église des Saints-Apôtres de Cologne. On voit, par les lettres de Geldorp380, que Rubens termina cette toile dans le courant de 1638, et c'est un de ses plus beaux ouvrages. Ces mêmes lettres montrent qu'il était toujours accablé de commandes, auxquelles il avait peine à satisfaire. Aussi Sandrart a-t-il raison de dire, en terminant sa biographie de Rubens381: «On n'en finirait pas, s'il fallait énumérer tous les ouvrages de ce très-ingénieux artiste, puisque, indépendamment de la fécondité de son esprit, il était également doué d'une habileté de main telle, qu'il avait achevé un tableau en moins de temps qu'un autre aurait mis à l'ébaucher. Il travailla de cette sorte jusqu'à ce que la goutte étant venue l'affliger, il se vit contraint de renoncer aux grandes toiles; alors il se mit à peindre des sujets profanes, sacrés et champêtres sur des toiles d'une dimension médiocre et même petite.»
Selon Michel et les autres biographes, Rubens, pendant ses dernières années, se tint complétement à l'écart de la politique, bornant ses distractions, lorsque la goutte lui en laissait la possibilité, à faire, après avoir travaillé cinq ou six heures de suite, quelques promenades, soit à cheval, soit à pied, dans les faubourgs et sur les remparts d'Anvers, à recevoir à souper, dans la soirée, ses amis les plus intimes, parmi lesquels Rockox et Gevaërts n'étaient pas les derniers, et à passer la belle saison à sa terre de Steen, près de Malines. Jusqu'à ses derniers moments, Rubens cultiva les lettres: tout en travaillant, il se faisait lire les historiens, les poëtes et les moralistes grecs et latins, et principalement Plutarque et Sénèque, si l'on en croit son neveu Philippe382, de telle sorte qu'en maniant le pinceau, il trouvait encore moyen d'enrichir son esprit. Sa correspondance atteste, autant que ses tableaux, que la mythologie et l'histoire ancienne lui étaient aussi familières que la connaissance des événements contemporains et des principales langues modernes. On pourra se faire une idée de l'étonnante fécondité d'invention et d'exécution de Rubens par ce fait, que le catalogue de son œuvre383 énumère quatorze cent soixante et une compositions peintes par cet artiste infatigable; et encore faudrait-il, pour compléter ce chiffre formidable, ajouter ses dessins et les planches auxquelles il a travaillé.
On croit que Rubens s'occupa beaucoup de la gravure de ses œuvres pendant les dernières années de sa vie. Il avait créé à Anvers depuis longtemps une école de graveurs, qui ne le cédaient en rien à Érasme Quellinus et Van Dyck, ses meilleurs élèves en peinture. Il suffit de rapporter les noms de Lucas Vorsterman, Schelte et Boèce de Bolswert, Paul Pontius, Cornelius Galle, Pierre de Jode, Ægidius Sadler, François Van Vyngaerde, Hans Witdoueck, Guillaume Panneels, Pierre Soutman, Cornelius Wischer, Nicolas Lawers, Adrien Lommelin et Théodore de Tulden, pour montrer quelle activité régnait dans cette école. Tous les genres de gravure, au burin, à l'eau forte, sur bois, y étaient cultivés et y brillaient d'un vif éclat, grâce à la direction donnée par le maître et à l'aptitude supérieure des élèves. – «Comme Rubens s'était fait d'excellentes règles de clair-obscur, dit Mariette384, ses tableaux réussissaient parfaitement bien en gravure. Mais lorsqu'il se donnait la peine de conduire les graveurs, comme il l'a presque toujours fait, ses estampes ne le cédaient point à ses tableaux pour l'accord des ombres et de la lumière, surtout quand elles ont été exécutées par d'excellents graveurs, tels que Vorsterman, Bolswert et d'autres… Aucune des belles estampes de Rubens, qui ont été gravées de son vivant, ne l'ont été d'après ses tableaux, mais d'après des dessins très-terminés, ou d'après des grisailles peintes à l'huile en blanc et noir, qu'il avait l'art de préparer et d'amener à l'effet de clair-obscur que devait produire la gravure, qui ne tire de l'effet que de l'opposition du blanc et du noir… Bellori a écrit, dans sa vie de Van Dyck, que Rubens s'était souvent servi de cet élève pour lui préparer ces dessins et ces grisailles, et je suis fort porté à le croire: son pinceau délicat et facile y était tout à fait propre… Le beau génie de Rubens et sa parfaite intelligence, se manifestent pour le moins autant dans ses dessins que dans ses tableaux. Dans les plus légères esquisses, ce grand maître met une âme et un esprit qui dénotent la rapidité avec laquelle il concevait et exécutait ses pensées. Mais, lorsqu'il les met au net, alors, sans rien perdre de cet esprit, il y ajoute tout ce qu'un homme qui possédait, dans un éminent degré, les différentes parties de la peinture, et singulièrement celle du clair-obscur, était capable d'imaginer pour en faire des ouvrages accomplis.» – C'est dans cette manière qu'il composa, entre autres, le magnifique dessin gravé par Cornelius Galle, du titre ou frontispice de la seconde édition, publiée après sa mort par Gevaërts, des Icones imperatorum romanorum, de Goltzius. Rubens y a représenté, assis dans une espèce de portique, les pieds appuyés sur un autel votif, Jules César fondateur de l'empire romain, tenant dans sa main droite une Victoire, dans la gauche le globe du monde. D'un côté, plus bas, Constantin, portant l'étendard du Christ, de l'autre l'empereur Rodolphe, chef de la maison de Hapsbourg; au-dessous, des armes, des faisceaux, des rames, un gouvernail, et le serpent mordant sa queue et entourant un globe couronné, symbole de l'immortalité.
Vers 1630, Rubens avait fait le portrait de Gevaërts, qui a été gravé au burin par Paul Pontius. Le peintre a représenté son ami assis et travaillant dans son cabinet: de la main gauche, appuyée sur une table recouverte d'un tapis, il tient plusieurs feuillets d'un manuscrit, probablement celui de son commentaire sur Marc-Aurèle, dont le buste est placé sur la même table; il a sa plume dans la main droite. Au fond de la pièce, on aperçoit des livres sur une tablette: à droite, l'écusson de ses armoiries, au-dessous duquel est écrit en grec: « εἱς εαντον συνειλου.» Il a la tête nue et porte des moustaches; son cou est entouré d'une énorme fraise, et il est vêtu d'une robe très-ample, qui laisse voir sur sa poitrine une chaîne et un médaillon. Sa figure est calme, réfléchie, pleine d'expression et de mélancolie, comme il convient à un homme que la perte de ses affections les plus chères avait obligé à chercher des consolations dans l'étude de la philosophie stoïcienne385.
Après la mort de Rubens, arrivée le 30 mai 1640, ce fut Gevaërts, son ami de cœur, comme l'appelle Michel386, qui composa l'inscription destinée à son tombeau. Mais, par suite de circonstances sur lesquelles ce biographe ne s'explique pas, cette inscription resta dans l'oubli jusqu'en 1755, époque où elle fut placée, par le chanoine Van Parys, petit-neveu de Rubens par sa mère, sur le monument élevé à l'artiste dans une des chapelles de l'église de Saint-Jacques d'Anvers. À la différence d'un grand nombre d'autres épitaphes, qui attribuent aux morts des vertus et des qualités qu'ils n'ont jamais eues de leur vivant, celle de Rubens387 n'est que rigoureusement vraie lorsqu'elle dit de cet homme illustre:
…Qui, inter cæteras, quibus ad miraculum
Excelluit, doctrinæ, historiæ priscæ,
Omniumque bonarura artium
Et elegantiarum dotes,
Non sui tantum seculi, sed et omnis ævi
....
Pacis inter principes mox initæ
Fundamenta feliciter posuit…
On a vu que Nicolas Rockox ne survécut que quelques mois à Rubens, étant mort à Anvers le 12 décembre 1640. Quant à Gevaërts, le plus jeune des trois, il prolongea sa carrière jusqu'en 1666, et s'éteignit à Anvers en cultivant les lettres, à l'âge de soixante-treize ans.
On peut dire de Rockox et de Gevaërts que pendant tout le cours de leur existence ils s'appliquèrent constamment à mettre en pratique cette règle de conduite, que Rubens s'était imposée à lui-même388:
Publice et privatim, et prodesse multis, nocere nemini.
Pour être juste envers l'illustre chef de l'école flamande, la postérité doit ajouter qu'il ne s'est pas borné à rendre service, autant qu'il a pu, sans jamais faire tort à personne, mais que, par les qualités de son cœur et de son esprit, aussi bien que par les œuvres dues à son génie d'artiste, il a su de son temps, comme de nos jours, plaire à tous ceux qui aiment à rencontrer chez le même homme le rare et merveilleux accord du bon et du beau.