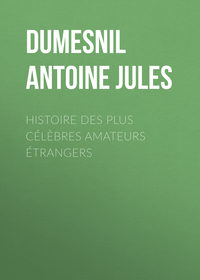Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Histoire des Plus Célèbres Amateurs Étrangers», sayfa 7
CHAPITRE XI
Voyage de Velasquez en Italie. – Ses études à Rome, tableaux qu'il exécute dans cette ville. – Accueil qu'il reçoit du roi à son retour. – Indication de quelques-uns de ses ouvrages.
1629 – 1631
La liaison qui s'était établie entre Velasquez et Rubens, pendant le séjour de ce dernier en Espagne, dut beaucoup profiter à l'élève de Pacheco. À cette époque, le peintre d'Anvers était dans toute sa gloire: la fécondité de son imagination, la facilité prodigieuse de son pinceau, l'éclat de son coloris, frappèrent, sans nul doute, son jeune émule, non moins que la variété de ses connaissances et la supériorité de son esprit. Comme Rubens avait fait un très-long séjour en Italie, et qu'il admirait avec passion les œuvres des maîtres de ce pays, et surtout celles du Titien, on doit croire qu'il engagea vivement le peintre espagnol à visiter cette contrée, pour y étudier, à la source même de la peinture chez les modernes, toutes les beautés de cet l'art. Depuis longtemps Velasquez, avait formé le projet de faire ce voyage; mais il lui fallait l'agrément du roi qui, après le lui avoir promis plusieurs fois143, ne pouvait se décider à le laisser s'éloigner. Après le départ de Rubens, Velasquez renouvela ses instances, et le roi finit par consentir. Il lui donna même pour son voyage quatre cents ducats d'argent (en plata), lui faisant payer deux années de son traitement. Le comte-duc, lorsque Velasquez vint pour prendre congé, ajouta deux cents autres ducats d'or, une médaille avec le portrait du roi, et un grand nombre de lettres de recommandation144.
Velasquez partit de Madrid, par ordre du roi, avec le marquis de Spinola, qui allait prendre le commandement des troupes espagnoles dans le duché de Milan. Il gagna Barcelone, où il s'embarqua le jour de Saint-Laurent (10 août) 1629, et vint aborder à Venise. Il y fut logé dans le palais de l'ambassadeur d'Espagne, qui l'admit à sa table, et le fit accompagner par ses domestiques, lorsqu'il sortait pour visiter la ville et ses environs, à cause des troubles qui agitaient alors l'Italie. Après un court séjour à Venise, il prit la route de Rome, par Ferrare, où, selon Palomino145, il ne s'arrêta que deux jours pour admirer les œuvres du Garofolo. Pacheco raconte qu'il se présenta dans cette ville, chez le cardinal Sachetti, légat du pape, et autrefois nonce en Espagne, auquel il remit une lettre d'introduction d'Olivarès. Le cardinal accueillit le peintre de Philippe IV avec empressement; il lui fit beaucoup d'instances pour qu'il logeât dans son palais, pendant le temps qu'il étudierait à Ferrare, et pour qu'il mangeât à sa table. Velasquez s'en excusa modestement, en disant qu'il ne mangeait pas aux heures ordinaires; mais que, néanmoins, si Son Éminence désirait être obéie, il changerait ses habitudes. Le cardinal ayant reçu cette réponse, envoya un gentilhomme espagnol, qui était à son service, avec ordre de se mettre à la disposition du peintre, de le faire servir de la même manière que s'il eût mangé à sa table, et de lui montrer les choses les plus curieuses de la ville. Informé que le départ de Velasquez devait avoir lieu le lendemain, le prélat ordonna de commander des chevaux et le fit accompagner pendant seize milles, jusqu'à un pays nommé Cento (la patrie du Guerchin). De là, Velasquez se dirigea, en toute hâte, vers Rome, en passant par Bologne et Lorète, mais sans s'y arrêter, et même sans se donner le temps de remettre aux cardinaux Ludovisi et Spada, qui se trouvaient dans la première de ces villes, les lettres de recommandation qui leur étaient adressées.
Arrivé à Rome, le peintre de Philippe IV fut reçu avec beaucoup de distinction par le cardinal Barberini, neveu du pape Urbain VIII, qui lui offrit un logement dans le palais du Vatican, et lui fit donner les clefs de plusieurs pièces, dont la principale était entièrement peinte à fresque de la main de Federigo Zucchero, avec des sujets tirés de l'Écriture sainte, parmi lesquels on voit Moïse devant Pharaon. Velasquez refusa de loger au Vatican, pour ne pas être seul; il se contenta d'accepter l'offre qui lui fut faite de donner l'ordre aux gardiens qu'on le laissât entrer sans difficulté, toutes les fois qu'il le voudrait, pour dessiner le Jugement dernier de Michel-Ange, ou les ouvrages de Raphaël; et il vint étudier souvent ces peintures, avec grand profit. Plus tard, charmé par la situation du palais ou Vigne des Médicis, sur la Trinité des Monts, et croyant ce site très-favorable à l'étude pendant le printemps, parce qu'il s'étendait sur la partie la plus élevée et la plus aérée de Rome, et qu'il s'y trouvait un grand nombre de statues antiques, il obtint la permission du grand-duc de Florence, par l'intermédiaire de l'ambassadeur d'Espagne, le comte de Monterey, de s'y établir. Il y passa deux mois, jusqu'à ce qu'une fièvre tierce l'eut obligé à chercher un refuge dans la maison du comte. Pendant cette indisposition, l'ambassadeur, beau-frère d'Olivarès, prit le plus grand soin du peintre favori du roi son maître, et de son premier ministre. Il lui envoya son médecin le visiter, et voulut supporter seul toutes les dépenses occasionnées par sa maladie. En outre, il donna l'ordre de lui procurer tout ce qu'il pourrait demander, vint le voir quelquefois, et envoya savoir souvent de ses nouvelles. Tel est le récit que Pacheco146 fait du premier voyage de son gendre et de son séjour à Rome. À part les études faites par Velasquez dans le Vatican, Pacheco ne mentionne d'autres peintures de son gendre que son propre portrait, donné à Pacheco lui-même, et un portrait sur toile de la reine de Hongrie, fille de Philippe III, que l'artiste fit à Naples, où il alla s'embarquer, et qui était destiné au roi d'Espagne147. Palomino et d'autres biographes disent que Velasquez fit à Rome le tableau de Joseph vendu par ses frères, et celui de Vulcain averti par Apollon de l'infidélité de Vénus148. Palomino ajoute149 que Velasquez emporta ces deux tableaux en Espagne, où il les offrit au roi, à son retour à Madrid, au commencement de 1631, après une absence de dix-huit mois. Le roi les reçut avec une grande satisfaction, et les fit placer au Buen Retiro, d'où le Joseph fut bientôt transporté à l'Escurial dans la salle du chapitre.
C'était d'après le conseil d'Olivarès que Velasquez s'était présenté chez le roi, pour le remercier de ce qu'il avait bien voulu tenir la promesse qu'il lui avait faite en partant, de ne se laisser pourtraire par aucun autre artiste pendant son absence. «Philippe IV, dit Pacheco150, se réjouit beaucoup de son retour, et la distinction ainsi que la générosité avec lesquelles le traita un si grand monarque sont à peine croyables. Il lui donna, dans sa galerie, un atelier dont il garda la clef, venant le voir peindre presque tous les jours. Mais ce qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer, c'est que le roi, lorsque l'artiste le peignit à cheval, posa, dans une seule séance, trois heures de suite, de son plein gré et avec une véritable bienveillance.»
Parmi les nombreuses récompenses que ce prince lui donna dans l'espace de six mois, Pacheco compte trois offices de secrétaires de la ville de Séville, qui furent octroyés au père de Velasquez, et dont chacun valait mille ducats par an. En moins de deux années, le peintre de Philippe IV reçut un office de garde-robe (guarda-ropa), et celui d'aide de la chambre (ayuda de camara), en 1638; l'honorant de la clef de chambellan, distinction fort enviée de beaucoup de cavaliers de l'habit (de Santiago et de Calatrava). «Pour moi, ajoute Pacheco151, à qui revient une si grande part de son bonheur, j'espère que, grâce au soin et à la ponctualité qu'il apporte chaque jour au service de Sa Majesté, il augmentera et améliorera son art, ainsi qu'il le mérite; et qu'il recevra les prix et les récompenses dus à son heureux génie, dont les qualités supérieures sauront le maintenir, sans aucun doute, à la hauteur où il s'est élevé maintenant.» Ces souhaits du bon Pacheco, qui terminent sa trop courte notice sur son élève et gendre, ont été pleinement réalisés. C'est à partir du retour de son premier voyage d'Italie, que Velasquez a exécuté ses plus beaux ouvrages: d'abord, ses portraits de cour, si brillants, si vrais, si originaux, si espagnols; ensuite, ses tableaux de scènes intérieures du palais, comme ses Meninas152, où les usages, les costumes et les personnages du temps sont rendus avec une perfection incroyable; ses compositions di mezzo carattere, comme son tableau de Las hilanderas153, délicieuse scène d'un naturel exquis, relevée par les plus charmants détails, et par une admirable disposition de la lumière; enfin, ses tableaux d'églises, ses paysages et ses Bodegones, scènes vulgaires dans le genre d'Adrien Brawer ou de Van Ostade, mais traitées, comme celles de Ribera, dans un style tout espagnol. L'ensemble de ces œuvres si diverses, mais toutes également remarquables, prouve que Philippe IV et son ministre ne s'étaient point trompés, lorsqu'à l'apparition du portrait de Gongora, ils avaient deviné le génie d'un grand maître.
CHAPITRE XII
Artistes italiens au service de Philippe IV. – Juan Bautista Crescencio. – Pompeo Leoni. – Le Panthéon de l'Escurial. – Le Buen Retiro. – Cosimo Lotti. – Baccio del Bianco. – Angel Michele Colonna et Agostino Mitelli. – Pietro Tacca et la statue équestre de Philippe IV.
1621 – 1665
Depuis Charles-Quint et Philippe II, l'Italie était en possession de fournir un grand nombre d'artistes à la cour d'Espagne. Parmi ceux qui furent employés avec honneur sous les règnes de Philippe III et de son fils, Juan Bautista Crescencio, que nous avons déjà indiqué, mérite une mention particulière. Il était d'une noble famille romaine, et frère du cardinal Crescenzi (Pietro Paolo). Il peignait d'une manière remarquable des fleurs et des fruits, et Palomino154 rapporte qu'il y avait de son temps, au palais de Madrid, une toile qui donnait une haute idée de son talent dans ce genre. Mais sa réputation, comme architecte, était beaucoup plus assurée, et c'est à cet art que son nom doit d'être parvenu jusqu'à nous. Le Baglione, dans sa notice sur Crescenzi155, rapporte qu'après avoir été fait, par Paul V, surintendant de la belle chapelle Pauline, à Sainte-Marie-Majeure, et de tous les autres travaux exécutés par ordre de ce pontife, il fut emmené en Espagne, en 1617, par le cardinal Zappada, qui le recommanda au roi Philippe III. Ayant présenté à ce prince quelques tableaux qui lui plurent, il fut admis à concourir, avec d'autres artistes, au plan des tombeaux des rois d'Espagne à l'Escurial. Le modèle de Crescenzi fut exposé avec les autres, dans la galerie de ce palais, et le roi l'ayant jugé le meilleur, le chargea de l'exécuter. Mais, comme il n'y avait sur les lieux ni matériaux de bonne qualité, ni ouvriers assez capables, Crescenzi retourna en Italie avec des lettres du roi adressées à différents princes. À Florence, il engagea Francesco Generino, sculpteur; à Rome, Pietro Gatto, Sicilien, graveur; Francuccio Francucci et Clemente Censore, fondeurs; Giuliano Spagna, Gio. Bat. Barnici, Siennois, et deux Flamands, doreurs. Revenu avec eux en Espagne, il mit la main à l'œuvre de la sépulture royale, qu'on a nommée Panthéon. C'est une chapelle souterraine, à laquelle on descend par soixante degrés: elle est entièrement privée de la lumière du jour. Sa forme est sphérique; en face de l'escalier est l'autel; au-dessus, un crucifix de bronze de Pietro Tacca, dont nous parlerons bientôt; tout autour, de magnifiques ornements encadrent les tombeaux des rois d'Espagne, depuis Charles-Quint. Chaque tombeau est séparé du plus rapproché par des doubles pilastres de brocatelle, au milieu desquels sont placés des anges qui tiennent des torchères, au nombre de trente, comme les tombeaux. L'œuvre est d'ordre corinthien, et les ornements en bronze, du Francucci et du Censore, sont enrichis d'or et d'argent.
Ce fut Pompeo Leoni, fils du graveur en médailles et sculpteur, Leone Leoni, d'Arezzo, dont nous avons raconté ailleurs156 la vie aventureuse, qui fit toutes les statues de ces tombeaux, ainsi qu'un grand nombre d'autres pour l'Escurial. Il avait également travaillé pour des particuliers, et l'on cite de lui la statue du duc de Lerme, faisant partie du tombeau de ce ministre de Philippe III, dans l'église de Saint-Paul, à Valladolid157.
Le Panthéon de l'Escurial, commencé vers 1619, ne fut achevé qu'en 1654. Sa consécration fut faite le 15 mars de cette année, avec la plus grande pompe, en présence du roi et de toute sa cour. Lorsque les corps de Charles-Quint, de son fils, de son petit-fils, et des reines qui avaient continué cette race royale, eurent été descendus dans la chapelle, et déposés, chacun à sa place, dans de magnifiques sarcophages de porphyre, un frère hiéronimite prononça une éloquente oraison funèbre, sur ce texte tiré d'Ézéchiel: «Ô vous, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur158.»
Pour récompenser les services de Crescenzi, Philippe IV l'honora de l'habit de Santiago et du titre de marquis de La Torre, et le nomma surintendant des travaux faits dans les palais et Alcazars. Suivant le Baglione, ce fut Crescenzi qui donna le plan du Buen Retiro, d'ordre dorique, que le comte-duc fit bâtir et qu'il offrit au roi, presque aussitôt après son avénement à la couronne. Ce prince fit à ce palais quelques augmentations, et il éleva en outre, au milieu des agréables jardins qui l'entourent, les deux pavillons appelés les Hermitages de Saint-Antoine et de Saint-Paul, qu'il fit décorer de fresques. – Nous ignorons si Crescenzi fut également l'architecte de l'église de Saint-Isidore, construite par ordre de Philippe IV, et qui est, encore aujourd'hui, le monument religieux le plus imposant de Madrid. – Selon Palomino, le Crescenzi mourut dans cette ville en 1660, à l'âge de soixante-cinq ans environ, et le Baglione ajoute qu'il fut enterré en grande pompe dans l'église del Carmine.
Cosimo Lotti, peintre, architecte et ingénieur, était un Florentin, élève de Bernardino Poccetti, qui fut d'abord employé par le grand-duc Cosme II, à restaurer les fontaines de sa villa de Pratolino, et spécialement toutes les statues et figures que l'eau fait mouvoir. Il exécuta ensuite pour les jardins du palais Pitti, des groupes, une barque et d'autres jets d'eau qui paraissaient de merveilleuses inventions à cette époque. En 1628, Philippe IV désirant ajouter un théâtre au palais du Buen Retiro, demanda au duc de Toscane un artiste capable, non-seulement de donner le plan et de diriger la construction de cet édifice, mais aussi d'inventer et de faire mouvoir les décorations et les machines nécessaires aux représentations. Le grand-duc, après avoir consulté Giulio Parigi, architecte alors en grande réputation à Florence, choisit Cosimo Lotti, et lui proposa de se rendre en Espagne, ce que celui-ci accepta, emportant avec lui quelques-unes de ses inventions. Dès qu'il fut arrivé à Madrid, le roi s'empressa de lui faire commencer la construction du théâtre. Cosimo le disposa attenant au palais, de telle sorte, que de l'appartement du roi, on avait la vue de toute la scène, et que l'on pouvait également bien voir et entendre les comédies. Comme le fond de la scène s'ouvrait sur la campagne, l'architecte put facilement y disposer les dessous et les gradins pour manœuvrer les machines. Il réussit tellement bien, que pour faciliter après lui les changements de décorations, il composa un livre orné de dessins et contenant toutes les explications nécessaires. Le roi lui avait accordé un traitement considérable, et lui avait donné un logement dans les dépendances du palais159.
Carducho160 décrit en ces termes une représentation donnée par Cosimo Lotti devant la cour, et dans laquelle il fut témoin d'une des plus singulières inventions de cet ingénieur. – «Devant les fenêtres des voûtes de l'appartement du roi, on avait disposé, dit-il, un théâtre portatif en planches, pour donner une représentation des machines, dans laquelle Cosimo Lotti, fameux ingénieur florentin, envoyé par le grand-duc de Toscane au service de Sa Majesté, a donné une exhibition de ses étonnantes et admirables inventions. Pour montrer son talent, lorsqu'il fut arrivé, il fit une tête de satyre, d'un travail remarquable, laquelle avec un air féroce, remue les yeux, les oreilles, les cheveux, et ouvre la bouche avec tant de force et en poussant un tel cri, qu'elle épouvante et frappe de stupeur quiconque n'a pas été averti à l'avance. C'est ainsi, qu'en ma présence, un homme qui ne s'attendait pas à cet horrible cri, fut pris d'une telle frayeur, qu'il se précipita d'un bond à plus de quatre pas. On ignore si la tête qu'avait fabriquée Albert le Grand était aussi étonnante que celle-ci. Cosimo donna une représentation au palais, où l'on voyait la mer agitée d'une telle manière, et avec un tel effet, que ceux qui en étaient témoins furent obligés de sortir avec le mal de cœur (collo stomaco alterato), comme s'ils eussent été réellement sur mer, ainsi qu'il parut chez plusieurs dames, de celles qui assistèrent à cette fête.»
Ce n'est pas tout: Cosimo ayant offert au roi sa fameuse tête de satyre, la reine la fit voir à quelques-unes de ses dames, en leur inspirant la crainte que cette tête ne fût une invention surnaturelle, qui avait la faculté d'espionner la conduite et les paroles des courtisans, pour tout rapporter au roi ou à elle-même. Cette explication leur inspira une telle frayeur, qu'elles n'osaient plus se risquer à parler, afin de n'être point entendues par cette tête161.
Philippe IV fut tellement satisfait des représentations données par Cosimo Lotti, qu'il lui fit cadeau des machines et des costumes employés dans l'une d'elles. L'artiste voulut appeler alors le public à juger de ses étonnantes inventions. Il fit payer un droit d'entrée, et gagna, dit Baldinucci162, plus de deux mille écus. Cosimo ne se bornait pas à diriger les représentations théâtrales: il composait des pièces burlesques, et jouait lui-même, avec beaucoup de succès, les personnages les plus ridicules de ses pièces. Il conserva longtemps l'emploi d'ingénieur du roi d'Espagne, et mourut à Madrid dans un âge avancé.
Pour le remplacer, en 1650, ce prince demanda un autre artiste au grand-duc de Toscane, qui lui envoya Baccio del Bianco, élève de Jean Bilivert, peintre, ingénieur et architecte, comme Cosimo Lotti. Il dessinait très-facilement à la plume, et réussissait à faire des charges ou caricatures, dont la vue, selon Baldinucci163, amusait beaucoup le grand-duc Cosme III. Baccio quitta Florence le 8 décembre 1650, et s'achemina par Gênes, où il fut reçu avec honneur par les Spinola, qui le logèrent dans leur palais pendant un mois, en attendant que le temps lui permît de s'embarquer pour Alicante. Baccio mit ce séjour à profit, en dessinant à la plume sur parchemin, pour ses illustres hôtes, une Suzanne au bain avec les vieillards, figures qui avaient une palme de hauteur. À son départ, il reçut de nombreux cadeaux, entre autres du velours et du drap pour monter sa garde-robe. Arrivé à Madrid, il eut bientôt gagné les bonnes grâces du roi, par son talent à disposer les décorations de son théâtre, et à faire mouvoir les machines. S'il faut en croire Baldinucci, les plus grands seigneurs de la cour ne dédaignaient pas de l'aider eux-mêmes à faire marcher, et à changer les décorations à son coup de sifflet. Une comédie représentée à l'aide de ces auxiliaires, eut un tel succès, qu'il fallut la répéter trente-six fois de suite, et le roi, en témoignage de toute sa satisfaction, s'empressa d'offrir à Baccio mille ducats d'or. Lors de l'incendie du palais de Madrid, notre ingénieur se distingua par sa présence d'esprit, et sauva les bâtiments voisins, en faisant la part du feu. Le roi l'ayant chargé de reconstruire ce qui avait été brûlé, il poussa les travaux avec une grande activité, en sorte qu'au bout de six mois, tout était complètement réparé. Il dessina aussi pour le roi des jardins, dans le goût de ceux du palais Pitti ou de la villa Pratolino, près de Florence. Il avait su gagner la bienveillance de don Louis de Haro, qui était alors premier ministre de Philippe IV, et ce favori ne dédaigna pas de venir souvent le voir, pendant plusieurs maladies qu'il fit à Madrid. Après avoir passé six années au service de Philippe IV, Baccio mourut des suites d'une saignée, et l'on crut alors que cette opération avait été faite avec un fer empoisonné, à l'instigation d'un de ses ennemis164.
Palomino rapporte165, qu'à son second voyage en Italie, exécuté en 1648, Velasquez, en passant par Bologne, conclut un arrangement avec Angel Michele Colonna et Agostino Mitelli, pour les engager à venir en Espagne. Passeri166, qui a consacré à ces deux artistes une notice détaillée, et qui a dû être mieux informé, attribue au prince-cardinal, Jean-Charles de Médicis, la conduite de la négociation qui attacha ces deux artistes au service de Philippe IV. Ils étaient tous deux Bolonais, et liés de la plus étroite amitié, à ce point qu'ils travaillèrent toute leur vie ensemble et aux mêmes ouvrages, sans le moindre nuage. Mitelli peignait des ornements et des perspectives d'architecture, et Colonna y disposait des figures. Ils excellaient dans ce genre de travail, qu'ils préparaient de concert et exécutaient en commun, et bientôt leur réputation s'étendit par toute l'Italie. Ils peignirent d'abord à Bologne, ensuite à Modène, à Florence et à Rome, à Forli et dans beaucoup d'autres lieux, églises, cloîtres, couvents, palais, villas. Dans toutes ces entreprises, ils montrèrent quelle puissance pouvait avoir une si complète union. Mitelli en a laissé un touchant témoignage à Bologne, dans les fresques dont il couvrit toute une grande cour de la maison de son camarade Colonna, et qui représentaient des perspectives et des ornements dus à la fantaisie de son imagination167. Le même artiste peignit également un grand nombre de décorations pour les pièces représentées à Bologne: comme aussi des tableaux à la gouache, dont les figures furent peintes par son fils, qui ne manquait pas de talent dans ce genre.
Lorsque Mitelli et Colonna furent entrés au service du roi d'Espagne, la première œuvre qu'ils entreprirent fut une façade dans le jardin de ce prince, avec trois perspectives peintes à la voûte, dans le palais même à Madrid. Dans la première, ils représentèrent la Chute de Phaéton; dans la seconde, l'Aurore, et dans la troisième, la Nuit. Ils peignirent ensuite dans le même palais une grande salle octogone avec tant de verve, une si grande richesse d'ornements, une fantaisie d'invention si capricieuse, que Philippe IV, charmé de ce beau travail, allait les voir à l'œuvre deux fois par jour, et quelquefois même montait sur l'échafaudage où ils peignaient, et causait avec eux familièrement, traitant, disait-il, comme on le devait, avec honneur et bienveillance, ces braves Italiens. Lorsque ce travail fut terminé, le roi, pour montrer sa grande satisfaction, voulut donner dans cette salle sa première audience de réception à l'ambassadeur de France, le duc de Grammont, qui venait lui demander pour Louis XIV la main de l'infante Marie-Thérèse d'Autriche. Protégés par le marquis d'Heliche, fils de don Louis de Haro, les deux Bolonais furent employés ensuite au Buen Retiro, où ils peignirent la voûte d'une loge. Ils en décorèrent les murailles latérales avec des ornements d'architecture, qu'ils disposèrent en perspective fuyante, selon les règles de l'art, avec les proportions convenables, et ils y introduisirent des jeux d'enfants et de satyres, avec des guirlandes de fleurs, de fruits et différents ornements, imitant des bas-reliefs et des feuillages. Au milieu de la voûte, où ils avaient peint une vue du ciel, ils représentèrent l'Aurore enlevant Céphale. Le Mitelli peignit ensuite un casino pour le même marquis d'Heliche, et ce fut le dernier ouvrage créé par son ingénieux pinceau; car, surpris par une grave maladie, il ne tarda pas à succomber à Madrid, en 1660, à l'âge de cinquante et un ans, laissant dans ce pays son ami Colonna, seul et inconsolable. Le Mitelli a gravé à l'eau-forte des fantaisies et des caprices, ainsi qu'un livre de frises et autres ornements d'architecture, estimé des maîtres en cet art168.
Un autre artiste italien, plus célèbre que les précédents, Pietro Tacca169, de Carrare, sculpteur, fut également occupé par les rois Philippe III et Philippe IV, mais sans aller en Espagne. Il fut élève de Jean de Bologne, et après le départ pour la France, en 1601, de son camarade Pietro Francavilla, il occupa la première place dans l'atelier de son maître, devenu vieux, et lui rendit les plus importants services. Sous la direction de cet illustre artiste, le Tacca ne tarda pas à acquérir une grande habileté pour le dessin, le modelé, le moulage et surtout la fonte des métaux; car Jean de Bologne aimait à exécuter ses ouvrages en bronze. Après sa mort, arrivée à Florence le 14 août 1608, le Tacca fut jugé digne de le remplacer, comme statuaire en titre du grand-duc Cosme II, emploi dont il reçut le brevet officiel l'année suivante. À partir de cette époque, il put à peine suffire aux commandes qui lui arrivaient, non-seulement de l'Italie, mais de toutes les parties de l'Europe. Jean de Bologne avait commencé, en 1604, le cheval sur lequel devait être placée la statue de notre roi Henri IV: ce fut le Tacca qui termina le cheval et la statue. Cet ouvrage était entièrement achevé en 1611; il fut envoyé en France, par Livourne, le 30 avril 1613, mais il ne parvint à Paris que vers la fin de juin 1614. Le piédestal en marbre, destiné à recevoir la statue, avait été décoré de bas-reliefs exécutés par le Florentin Francesco di Bartolommeo Bordoni, sur les dessins du Cigoli. La reine Marie de Médicis, dans une lettre du 10 octobre 1614, remercia le Tacca, au nom du roi son fils et au sien, de la belle statue de bronze qu'elle venait de recevoir, «laquelle était digne, disait-elle, de celui qu'elle représentait.» – Cette statue, l'une des meilleures du statuaire, après avoir fait l'ornement du Pont-Neuf pendant cent soixante-dix-huit années, n'a pas trouvé grâce devant la barbarie révolutionnaire de 1793.
Le Tacca fut également chargé de terminer la statue équestre de Philippe III, que son maître avait laissé inachevée. Elle fut envoyée en Espagne en 1616, mais sans que le Tacca quittât Florence; il la confia aux soins d'un de ses parents, Antonio Guidi, qui avait déjà conduit en France celle de Henri IV. Douze ans plus tard, Olivarès ayant voulu faire couler en bronze une statue équestre colossale de Philippe IV, auquel il avait décerné le nom de Grand, fit écrire par ce prince à madame de Lorraine, pour obtenir du grand-duc, son mari, l'autorisation de charger le Tacca de cette entreprise. Ce prince, non-seulement y consentit, mais il voulut faire lui-même les frais de cette statue, qu'il se réserva d'offrir au roi d'Espagne. Le Tacca reçut donc l'ordre de cesser tout autre travail, et de mettre la main à ses modèles. Il les avait déjà fort avancés, soit en cire, soit en terre, lorsqu'on lui représenta qu'il serait fort agréable au roi, de ne point voir le cheval dans la pose de ceux de toutes les autres statues équestres; c'est-à-dire, non comme s'il marchait au pas, mais comme s'il était lancé au galop et se cabrait. Avant d'étudier cette pose, alors toute nouvelle et qui passait pour impossible à exécuter, le Tacca voulut avoir un modèle en petit du cheval et du cavalier dans cette attitude. Sachant que Rubens était alors à Madrid, il écrivit dans cette ville, pour qu'il lui fût envoyé de la main de cet artiste. Au bout de quelques semaines, on lui adressa une toile d'environ une brasse et demie, sur laquelle étaient représentés le cheval et la personne du roi, peints, d'après nature, de la main même de Rubens. Non satisfait de ce premier modèle, le Tacca, pour mieux rendre encore la ressemblance de Philippe IV, redemanda un nouveau portrait de ce prince, de grandeur naturelle, du pinceau du même artiste, portrait qui lui fut également envoyé170.
Restait l'exécution du cheval et de la statue, de grandeur colossale. Nous avons déjà dit qu'on regardait alors comme impossible de faire tenir en l'air, en se cabrant sur ses pieds de derrière, un cheval portant le poids énorme d'une masse de bronze, trois ou quatre fois plus grande que nature. Les gens du métier étaient unanimes pour dire que, dans cette attitude, le cheval portant à faux, ne pourrait se tenir en équilibre avec son cavalier. Le Tacca partageait cette appréhension, car, pour résoudre la difficulté, il n'hésita pas à s'adresser au célèbre Galilée, le plus savant mathématicien et géomètre de sa patrie et de son siècle. Cet homme illustre suggéra au sculpteur un moyen facile de résoudre le problème, sans qu'il y parût, et sans nuire à la beauté de l'œuvre: il fit poser les jambes de derrière du cheval sur un plan carré, établi de biais, à l'un des côtés duquel il fixa une poutre ou forte barre de fer, qui s'étendait dans presque toute la longueur du cheval, et s'enfonçait en terre, pour empêcher que la tête et les pieds de devant n'entraînassent et ne fissent renverser la partie postérieure du cheval ainsi que le cavalier171. Le Tacca, de son côté, combina le poids des diverses parties de son groupe, de manière à en équilibrer l'assiette. La statue, étant heureusement terminée, fut exposée à Florence dans la maison de l'artiste, au grand étonnement de ses envieux, et à l'admiration de tout le public. Mais le pauvre sculpteur ne jouit pas longtemps de sa gloire; il mourut presque aussitôt après l'achèvement de son œuvre, le 26 octobre 1640. Baldinucci172 donne à entendre que sa fin fut hâtée par les contrariétés qu'il éprouvait depuis longtemps de la part d'un des ministres du grand-duc. Il fut inhumé avec honneur à l'Annunziata, dans la même chapelle et dans le même lieu que son maître Jean de Bologne173.
Ce fut son fils aîné Ferdinand, qui avait étudié la sculpture et la fonte sous la direction de son père, qui fut chargé de conduire la statue équestre de Philippe IV à Madrid. Il l'offrit au roi d'Espagne, au nom du grand-duc, et la plaça, en 1641, sur le piédestal qui lui avait été préparé devant la façade principale du Buen Retiro, d'où elle a été éloignée en 1844, pour être reportée sur la place spacieuse, en face du palais de Philippe V. À cette époque, on a ajouté deux bas-reliefs, disposés sur les principaux côtés du piédestal. L'un représente Philippe IV donnant une médaille à Velasquez; l'autre rappelle la protection que ce prince accordait aux beaux-arts174.