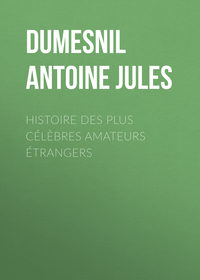Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Histoire des Plus Célèbres Amateurs Étrangers», sayfa 8
Si la statue du Tacca ne peut plus aujourd'hui exciter l'étonnement que causa, lors de son exhibition, la vue d'un cavalier porté sur un cheval qui se cabre, elle mérite encore de fixer l'attention des amateurs, à cause de ses belles formes et du fini de son exécution. Que ce soit Rubens ou Velasquez qui en ait donné le modèle au statuaire florentin, toujours est-il que celui-ci à parfaitement rendu l'idée du maître. Aussi, ce groupe peut passer pour un des meilleurs, en ce genre, que les modernes aient coulé en bronze jusqu'à ce jour.
CHAPITRE XIII
Principaux artistes espagnols, du temps de Philippe IV. – José Ribera. – Francisco Herrera le vieux et son fils; Francisco Collantès; Alonso Cano; don Bartolomè Estevan Murillo; Juan Martines Muntañès.
1621 – 1665
Si Philippe IV et son ministre appelaient en Espagne des artistes étrangers et les comblaient d'honneurs et de richesses, ils encourageaient, avec un empressement plus vif encore et une faveur plus marquée, les artistes espagnols dont le talent pouvait rehausser l'éclat de ce règne. Velasquez est un exemple frappant de la protection extraordinaire que le roi et son favori aimaient à répandre sur les hommes d'un véritable mérite; mais cet exemple n'est pas le seul à citer.
Ribera, bien qu'il ne vécût pas en Espagne, et que son caractère fougueux semblât le tenir éloigné de la faveur royale, ressentit néanmoins les effets de la bienveillance de Philippe et d'Olivarès. On sait qu'il s'était fixé à Naples, où son talent le mit bientôt en grande réputation. Le comte de Monterey, beau-frère d'Olivarès, vice-roi, le logea dans son palais, lui fit de nombreuses commandes pour son maître, et lui procura dans Naples même des travaux considérables. Ribera exécuta plusieurs tableaux pour le comte, et ce seigneur les fit placer ensuite dans le couvent des Augustines qui portait son nom, à Salamanque. Il y avait, parmi ces ouvrages, une très-belle Conception, un Saint Augustin et un Saint Janvier175. Mais, ce qui fait encore plus d'honneur au vice-roi, c'est que la faveur qu'il accordait à Ribera ne l'empêcha pas de prendre sous sa protection spéciale le timide Dominiquin. On sait que l'Espagnolet et ses partisans voulaient obliger, par leurs menaces, l'artiste bolonais à laisser inachevée la coupole du trésor de Saint-Janvier, qu'il s'était obligé d'achever dans un délai fixé, ainsi que nous l'avons raconté ailleurs176. Mais, après le remplacement de Monterey par le duc de Médina de las Torres, le Zampieri, persécuté et dominé par la peur d'être assassiné, s'enfuit furtivement de Naples, et laissa le champ libre à ses ennemis177. Lanfranc, qui le remplaça en 1641 dans les travaux de la coupole de Saint-Janvier, pour gagner les bonnes grâces du duc, fit le portrait de sa femme178; mais bientôt Ribera reprit le dessus et régna en maître à Naples, jusqu'à sa mort, arrivée dans cette ville en 1656. Cet artiste excellait à rendre les scènes vulgaires à la manière du Carravage, son maître. Mais, lorsqu'il voulait s'élever jusqu'à la représentation de sujets tirés de l'Ancien ou du Nouveau Testament, son style rappelait trop les types grossiers qui lui servaient de modèles. Aussi, malgré l'éclat d'un coloris vigoureux, ses grandes compositions manquent complètement d'idéal, défaut à peu près général à toute l'école espagnole.
Francisco de Herrera, surnommé le Vieux, peintre, architecte et statuaire en bronze, naquit à Séville, et, selon Palomino179, fut élève de Pacheco; il a beaucoup travaillé dans cette ville, où il resta jusqu'en 1640. On a raconté180 qu'il avait été accusé de fabrication de fausse monnaie, et que le roi Philippe IV, en considération de son tableau de Saint-Hermenegildo, dans l'église de ce nom, à Séville, lui avait fait grâce, dans une excursion qu'il fit en 1624 à travers l'Andalousie. Quoi qu'il en soit, Herrera quitta Séville en 1640, et vint se fixer à Madrid, où il travailla beaucoup pour les églises, les couvents et l'Escurial. Palomino donne une indication détaillée de ses œuvres. Il peignait à fresque avec une facilité singulière, qui rappelle quelquefois la manière du Tintoret. Herrera empâtait tellement ses toiles, que ses figures paraissent comme perdues au milieu de la couleur; mais son coloris, sombre et vigoureux, donne une haute idée de son talent181. Il a gravé lui-même quelques-unes de ses compositions. Herrera le Vieux mourut à Madrid, en 1656, laissant un fils, qui fut peintre du roi, architecte et inspecteur principal (maestro mayor), des œuvres royales.
Ce fils était un artiste d'un grand talent, comme son père; il avait étudié à Rome, et il excellait à peindre des sujets de pêche, ce qui lui avait fait donner dans cette ville le surnom de l'Espagnol aux poissons. Revenu dans sa patrie, il se livra presque exclusivement, comme les autres artistes de ce pays, à la peinture des sujets religieux. En sa qualité d'architecte, il fit un grand nombre de retables pour les principaux autels des églises de Séville et de Madrid, et les ornements dont il les décora furent extrêmement admirés. Il les enrichissait aussi de ses tableaux, et celui qui passe pour son meilleur ouvrage, Saint-Hermenegildo, fut peint et placé par lui dans le retable du maître-autel des Carmélites déchaussées de Madrid182.
Il ne paraît pas que Herrera le Jeune ait été dans les bonnes grâces du comte-duc, si l'on ajoute foi à l'anecdote suivante, racontée par Palomino183. Olivarès l'avait fait avertir qu'il viendrait voir ses tableaux, et lui avait demandé d'exposer les meilleurs, afin qu'il pût en choisir quelques-uns, ce que le peintre s'était empressé de faire. Cependant, le comte-duc étant venu, se mit à les critiquer, et en choisit d'autres que le peintre estimait moins bons. Blessé de cette manière d'agir, Herrera le Jeune peignit un singe qui, se trouvant au milieu d'un parterre de fleurs, parmi lesquelles brillent de magnifiques roses, préfère cueillir une tête de chardon qui le rend fier et joyeux. L'artiste avait composé ce tableau dans l'intention de l'offrir au comte-duc. Mais, un de ses amis, don Antonio de Soto-Mayor, qui était fort prudent, dit Palomino, lui représenta les fâcheuses conséquences qui pourraient en résulter pour lui; il résolut donc de garder cette toile, et d'offrir à Olivarès un autre ouvrage. Suivant Palomino, Herrera le Jeune mourut à Madrid, en 1685, à l'âge de soixante-trois ans184.
Francisco Collantès, né à Madrid, fut un excellent paysagiste; mais ses vues de la campagne ne se bornaient pas à la représentation de la nature morte: il savait les animer par des scènes tirées de l'Écriture sainte. C'est ainsi qu'il peignit pour le Buen Retiro une Résurrection des Morts, traitée d'une manière vigoureuse, et dans laquelle il s'est inspiré de la vision d'Ézéchiel. «On y voit, dit le Catalogue du musée de Madrid, où ce tableau est maintenant exposé185, sur un fond tout couvert de grandes fabriques en ruine, dont les débris sont semés sur le sol, la terrible scène de la fin du monde et de l'anéantissement de l'humaine grandeur. Les cadavres abandonnent leurs sépulcres, enveloppés de leurs linceuls, et dirigent leurs regards étonnés vers l'éclat sinistre qui apparaît dans le ciel.» Ce tableau, selon Palomino186, rempli d'imagination, est exécuté avec une grande habileté. Suivant le même biographe, Collantès peignait aussi des scènes familières de boutiques et de cabarets (bodegoncillos); et il déclare en avoir vu plusieurs excellentes entre les mains d'un amateur. Francisco Collantès mourut à Madrid, en 1656, à l'âge de cinquante-sept ans.
Parmi les artistes espagnols qui vécurent du temps de Philippe IV, Palomino cite encore Pedro Obregon, élève de Carducho, Bartolommeo Roman, Juan Van der Hamer y Léon et Juan de la Curte, tous de Madrid. Mais, comme aucun ouvrage de ces peintres n'est exposé au Real Museo, nous nous bornerons à indiquer leurs noms, en renvoyant à Palomino pour avoir quelques explications sur leurs travaux.
Nous nous arrêterons sur un artiste, peintre, sculpteur et architecte, et l'une des gloires de l'école espagnole, dont le nom et les œuvres ne sont point ignorés de ce côté des Pyrénées.
Alonso Cano naquit à Grenade, en 1600, et apprit les éléments d'architecture de Michel Cano, son père; plus tard, il étudia la peinture à Séville, dans l'atelier de Pacheco, peut-être avec Velasquez, où il ne passa que neuf mois; il alla ensuite continuer ses études dans l'école de Juan de Castillo, d'autres disent de Herrera le Vieux. Dès l'âge de vingt-quatre ans, il peignit à Séville plusieurs tableaux pour des couvents et des églises. Il fit, à la même époque, pour la ville de Nebrijà, dans la cathédrale, un grand retable, pour lequel il exécuta de sa main trois statues en bois plus grandes que nature, qui lui firent beaucoup d'honneur; tellement, que des artistes flamands vinrent copier celle de la Vierge, pour la reproduire dans leur pays187. Sa réputation parvint bientôt à la cour, et le comte-duc le fit venir à Madrid. C'est alors que, placé sur un plus vaste théâtre, il donna des preuves d'un génie aussi vigoureux qu'original. Un de ses premiers ouvrages, fut le célèbre tableau du Miracle du puits de Saint-Isidore, placé dans le second compartiment du maître-autel de l'église paroissiale de cette ville; «peinture, dit Palomino, exécutée avec tant de grâce, dessinée et coloriée avec tant de beauté, qu'elle est elle-même un vrai miracle.» Voulant lui témoigner sa haute satisfaction, Philippe IV le nomma, en 1628, sur la recommandation d'Olivarès, inspecteur ou architecte principal (maestro major) des œuvres royales, et bientôt après il lui conféra le titre de peintre du roi, en le choisissant comme maître de dessin de l'infant don Balthazar Carlos. Palomino188 raconte, en outre, que ce prince le nomma chanoine minor de la cathédrale de Grenade, canonicat qui valait une prébende ou bénéfice ecclésiastique, et qu'il répondit au chapitre qui lui faisait des remontrances sur le peu d'instruction de l'artiste: «Si ce peintre était un savant, qui sait s'il ne pourrait pas devenir archevêque de Tolède? Je puis faire des chanoines autant et comme il me plaît; mais Dieu seul peut faire un Alonso Cano.» Les œuvres de ce maître étaient répandues dans toute l'Espagne, particulièrement dans l'Andalousie, à Valence, à Tolède, Alcala de Henarès et à Grenade où il mourut, en 1676, à soixante-seize ans. Le musée de Madrid en possède un certain nombre, qui donnent une haute idée de son génie. Moins fougueux que Ribera, moins suave que Murillo, il brille par une grande pureté de dessin, une naïveté toute naturelle, un ordre et une harmonie qu'on ne saurait trop admirer.
Don Bartolomeo Estevan Murillo, est également au nombre des artistes qui rendirent célèbre le règne de Philippe IV. Il naquit en 1613 à Pilas, ville éloignée de cinq lieues de Séville, et fut élève de Juan de Castillo. Ayant appris de ce maître tout ce qu'il pouvait enseigner, pour s'exercer la main189 et s'habituer aux grandes compositions, il se mit à peindre pour le commerce, et fit une suite de tableaux destinés, comme cargaison, à l'Amérique. Il passa ensuite à Madrid, où, avec la protection de Velasquez, il put visiter plusieurs fois toutes les peintures remarquables, alors en très-grand nombre, que renfermait l'Escurial, et celles qui se trouvaient dans les autres palais du roi et dans les collections particulières. Il copia beaucoup d'ouvrages de Titien, Rubens, Van Dyck, exercice qui lui fut fort utile pour améliorer son coloris: il ne dédaigna pas non plus de dessiner les statues que renfermaient les palais royaux. Enfin, il étudia sous la direction de Velasquez, dont la grande manière et la correction lui furent très-profitables. Il retourna ensuite à Séville, où il passa la plus grande partie de sa vie. Nous ne trouvons nulle part que ses débuts, comme ceux de Velasquez, aient été encouragés soit par le roi, soit par Olivarès. Murillo n'a jamais visité l'Italie; c'est donc, comme notre Lesueur, un artiste entièrement de son pays. Aussi, Palomino, très-fier, en bon Espagnol, du génie du chef de l'école de Séville, fait remarquer, avec satisfaction, que les artistes de son pays n'avaient pas besoin de quitter leur patrie pour trouver les tableaux, les fresques, les statues, les gravures et les livres les plus remarquables, à l'aide desquels il leur était facile d'acquérir toutes les connaissances qu'un artiste peut désirer. – Nous n'avons point à faire ici l'éloge de Murillo: son génie brille d'un vif éclat au-dessus de presque tous les peintres, ses compatriotes. On peut même dire qu'il n'a pas d'égal en Espagne, dans les grandes compositions tirées de la Bible, de l'Évangile ou de la Vie des saints, telles que son Moïse frappant le rocher; sa Multiplication des pains dans le désert, et son Extase de saint Antoine de Padoue190. Il est incomparable pour rendre l'état extatique qu'il prête à plusieurs de ses saints, comme aussi pour éclairer et représenter les scènes de visions miraculeuses. L'ordre de ses compositions, l'harmonie qui règne dans toutes leurs parties, la douceur, la suavité, la transparence de son pinceau, font des tableaux de ce grand artiste des œuvres à part dans l'art espagnol, où l'on rencontre quelquefois l'idéal exprimé avec la sublimité des Italiens les plus purs. Mais ce n'est pas cette qualité qu'il faut chercher dans ses ouvrages; elle n'est qu'une rare exception chez cet artiste, et quoique ses types ne soient pas aussi vulgaires que ceux représentés par ses compatriotes, on y rencontre presque toujours la nature espagnole dans toute sa vérité. Murillo exécuta ses œuvres les plus remarquables de 1660 à 1685, alors qu'il était dans toute la maturité de l'âge et du talent, et bien qu'il appartienne par ses commencements au règne de Philippe IV, on peut dire que c'est surtout sous son successeur qu'il a donné les plus grandes marques de son génie.
Sans vouloir établir une comparaison entre Velasquez et Murillo, et rabaisser l'un aux dépens de l'autre, ce que nous croirions indigne du respect que l'on doit à deux hommes d'une si prodigieuse supériorité, nous ne pouvons nous empêcher de dire que le talent de Murillo fut beaucoup moins varié que celui de son maître. – Tandis que Velasquez excelle à la fois dans le portrait, le paysage, les scènes familières et triviales, les représentations de sujets di mezzo carattere, tels que ses Hilanderas et ses Meninas, enfin les tableaux de sainteté, Murillo a concentré presque tout son génie à peindre des sujets chrétiens, entraîné sans doute à la recherche de l'idéal, qui l'éloignait des choses de ce monde. Aussi, a-t-on dit avec justesse191: «que Velasquez est le peintre de la terre et Murillo le peintre du ciel.» Mais quelle gloire, pour un seul règne, d'avoir possédé ces deux artistes, accompagnés de Ribera et d'Alonzo Cano, et d'avoir également profité du génie de Rubens! Il faut remonter aux plus grandes époques de l'art en Italie, pour retrouver une semblable réunion d'hommes de génie. Sans doute, Philippe IV et son ministre ne créèrent pas ces talents prodigieux; mais, comme les Médicis à Florence, comme Jules II et Léon X à Rome, comme plus tard Louis XIV et Colbert en France, ils contribuèrent puissamment, par des encouragements donnés à propos, au développement extraordinaire que l'art de la peinture prit en Espagne pendant la première moitié du dix-septième siècle, et à l'éclat qu'il répandit sur ce pays.
Bien que la statuaire ne brillât pas au même degré, il ne faut pas oublier néanmoins que la sculpture en bois fut également très-cultivée sous Philippe IV. La construction et l'ornementation des magnifiques retables des cathédrales, des églises et des couvents, permettaient aux artistes d'y placer, comme le fit plusieurs fois Alonzo Cano, des statues de saints, de la Vierge, du Christ en croix et d'autres œuvres de cet art particulier à l'Espagne, que Palomino et les autres auteurs de ce pays appellent la Talla. Parmi les artistes qui se livraient avec un véritable talent à ce genre de sculpture, on doit citer en première ligne Juan-Martinès Muntañès, de Séville. Si l'on en croit la tradition, ce tallador ne se bornait pas à travailler le bois; il était également fondeur en bronze, et c'est à lui qu'on attribue, ainsi que nous l'avons rapporté, les modèles en petit de la statue équestre de Philippe IV, que le Tacca exécuta en grand à Florence, comme on l'a vu plus haut192. Palomino193 cite de Muntañès une statue de Jésus-Christ, nommée la Passion, qui se trouvait de son temps (1653-1726), dans le couvent royal de la Merci de Séville, «laquelle, dit-il, a une telle expression de douleur, qu'elle réchauffe la dévotion des cœurs les plus tièdes…» Il cite également d'autres figures de ce maître, dont il fait un si grand éloge. Mais nous devons faire remarquer, qu'il en est de Muntañès comme de tous les autres statuaires espagnols, dont aucun ouvrage n'est inspiré soit par la mythologie, soit par l'histoire grecque ou romaine. L'illustre Berruguète travailla bien à Rome sous la direction de Bramante, et avec le Sansovino, au premier modèle en cire qui ait été fait du Laocoon pour le jeter en bronze194; mais, rentré en Espagne, il abandonna toute tradition de l'antiquité, pour traiter exclusivement des sujets autorisés par la religion catholique, et cet exemple a été suivi par tous les sculpteurs espagnols jusque vers le milieu du dernier siècle. Muntañès mourut à Séville en 1640.
Tels étaient les principaux artistes espagnols du temps de Philippe IV, et l'on voit que si le roi et son ministre honoraient Velasquez d'une faveur toute spéciale, ils ne repoussaient point les autres, et se montraient disposés à protéger tous ceux qui donnaient des marques d'un véritable talent.
CHAPITRE XIV
Disgrâce du comte-duc d'Olivarès. – Histoire de son fils naturel Julien, d'après le père Camillo Guidi. – Velasquez reste fidèle au comte-duc. – Portrait inachevé de Julien.
1643 – 1645
Ce n'est pas sans exciter autour de soi des haines profondes et des inimitiés irréconciliables, qu'on arrive au pouvoir suprême, et qu'on est assez fort ou assez habile pour le conserver pendant un grand nombre d'années. Indépendamment des causes naturelles qui font que l'homme est disposé à considérer son maître comme son ennemi, les événements qui se succèdent avec le cours des années, l'imprévu qui joue un si grand rôle dans ce monde, sont autant d'éléments qui conspirent contre la durée de toute puissance humaine. À une époque et dans un pays où l'influence des grandes familles existait encore dans toute sa force, des rivalités, d'autant plus à craindre qu'aucun grand pouvoir public ne venait en amortir le choc, s'ajoutaient à ces causes générales d'opposition. Sous un roi absolu, il suffit, pour obtenir le premier rang, de gagner la faveur du prince: de là les intrigues, les menées, les influences souterraines qui assiégeaient les rois d'Espagne, depuis que Charles-Quint avait de fait aboli les anciennes cortès. Olivarès le savait bien; aussi, pour assurer son crédit, avait-il pris soin d'éloigner de Philippe IV toutes les personnes, même la reine Isabelle, qu'il soupçonnait de vouloir tenter de ruiner sa faveur. Depuis qu'il avait épargné au roi tout embarras, toute préoccupation de gouvernement, le comte-duc, engagé dans des guerres difficiles et placées sur des théâtres éloignés, avait vainement lutté contre les attaques de ses ennemis. Il avait laissé perdre successivement à l'Espagne: en Orient, les royaumes d'Ormuz, de Gon et de Fernambouc, et tous les pays adjacents à cette vaste côte; de plus, tout le Brésil, l'île de Terceira, le royaume de Portugal, la principauté de Catalogne, le comté de Roussillon, toute la Comté de Bourgogne, de Dôle et de Besançon, Hesdin et Arras en Flandre, un grand nombre de places dans le Luxembourg et Brisach en Alsace. En outre, les royaumes de Naples, de Sicile et le duché de Milan, pressurés par des exactions intolérables, ne tenaient plus à l'Espagne que par force. Sur mer, la marine espagnole n'avait pas été mieux traitée, et l'on estimait à plus de deux cents le nombre des navires, galions et autres, enlevés et détruits, dans l'Océan et la Méditerranée, par les Hollandais, les Anglais et les Français. L'Espagne était accablée d'impôts de toutes sortes, et les populations, fatiguées de tant de désastres, aspiraient à un changement de maître195. Cependant, toutes ces causes réunies d'impopularité n'auraient peut-être pas amené la chute du favori, s'il ne s'était pas compromis lui-même aux yeux du roi, de la haute noblesse espagnole, et particulièrement de sa propre famille, en reconnaissant comme son fils légitime un enfant naturel, qu'il croyait avoir eu dans sa jeunesse. Voici en quels termes le Père Camille Guidi, religieux dominicain, résident à la cour de Madrid pour le duc de Modène, raconte cette histoire, qui a tout l'intérêt d'un roman196: «…Le troisième et peut-être le plus douloureux effet pour le comte de sa disgrâce inattendue, est la misérable condition dans laquelle reste son bâtard légitime, lequel avait été jugé indigne de cette grandeur à laquelle son père putatif l'avait élevé. Et, parce que cette histoire est un événement qui excite la plus grande curiosité qui puisse parvenir jusqu'à un esprit désireux d'anecdotes singulières, il m'a paru convenable de renfermer en quelques lignes ce qui aurait besoin d'un livre tout entier, pour pouvoir en faire connaître exactement toutes les circonstances. Douze ans avant de devenir le favori du roi, le comte, se trouvant à Madrid, s'amouracha d'une femme qui tenait le premier rang parmi les courtisanes d'amour. Cette dame, bien qu'appartenant à la noblesse, ne fut pas exempte des persécutions qu'endurent sans relâche dans cette cour les personnes d'une éclatante beauté. Pour obtenir, à Madrid, la possession des belles, même des plus grandes dames, on ne connaît d'autre moyen que l'emploi de l'or. À cette époque, don Francisco di Valcaz, alcade di cela, et de la cour, ce qui est ce qu'on peut désirer de mieux parmi les plus hautes judicatures de ce pays, jouissait d'une grande autorité et d'immenses richesses. Quoique marié, il entretint à ses frais la maison et la personne de la dame, et, à l'aide d'une profusion d'argent, de bijoux et de cadeaux de toutes sortes, il se fit l'unique possesseur de son lit. Le comte, qui payait alors le tribut à la fragilité humaine, eut un caprice pour cette femme. Un fils naquit, lequel fut réputé fils de l'alcade, par la raison que la plante avait poussé sur le terrain qu'il avait acheté avec son argent. Mais, parce qu'il s'était aperçu que d'autres que lui labouraient son champ sans vergogne, il abandonna volontiers au public cet enfant, qu'en conscience, il ne considérait pas comme sien. À son baptême, le garçon fut nommé Julien, et il fut entretenu au moyen des profits illicites de la mère, et très-mal élevé. Arrivé à l'âge de dix-huit ans, sa mère étant morte, il se trouva aussi sans père. Désespéré du malheur de sa naissance, il supplia l'alcade de le reconnaître pour son fils, afin qu'il ne restât pas dans le monde privé de père et sans nom, protestant qu'il n'avait aucune prétention à sa succession, mais qu'à l'aide du seul nom de Julien de Valcaz, il pourrait gagner son pain avec l'épée. L'alcade ne consentit à cette proposition qu'au moment de mourir, pour donner satisfaction à l'opinion du monde, plutôt qu'aux réclamations de sa conscience; car il savait que la naissance du jeune homme pouvait être attribuée non-seulement au comte, mais à beaucoup d'autres.
«Sous ce nom de Julien de Valcaz, le garçon passa aux Indes, où, par suite d'un grand nombre de méfaits commis au Mexique, il fut condamné aux galères. Mais, parce que le vice-roi était très-liè avec l'alcade qui s'était reconnu son père, il obtint facilement grâce. Il revint à Madrid; mais, n'ayant pas de quoi vivre, il passa en Flandre et en Italie, pour y servir comme simple soldat, et il rentra en Espagne à l'âge de vingt-cinq ans. Son esprit était vif, mais sa manière de vivre était si dégradée que, fréquentant les cabarets, il ne put jamais oublier le mauvais lieu où il était né.
«Cependant, le comte avait perdu tout espoir d'avoir des héritiers de son nom197. Il se souvint alors que Julien était né à l'époque où il courait après les femmes, et on ignore comment il se laissa persuader qu'il était son fils. Le bruit s'en répandit dans Madrid; c'est pourquoi Julien étant sur le point d'épouser dona Isabelle, d'Anvers, dont les portes n'étaient jamais fermées, même aux plus vils taverniers, elle protesta… qu'il fît bien attention à ce qu'il allait faire, parce qu'il courait un bruit de sa descendance du comte d'Olivarès, et qu'elle ne voulait pas l'engager dans un mariage disproportionné à sa position. Mais Julien ne tint aucun compte de ces observations, et le mariage fut célébré par le curé de la paroisse, dans la maison de la mère d'Isabelle.
«En 1641, dans le mois de novembre, à l'improviste et à la stupéfaction du monde entier, le comte, avec l'approbation du roi, reconnut par acte public et authentique Julien pour son fils. Dans le même acte, il ne le nomme plus Julien, mais don Enrico Felippe di Guzmano, héritier du comté d'Olivarès, et, en outre, du duché de San-Lucar, quand il plairait au roi, en considération de ses services, de l'en investir; car le titre de duc de Castille ne se confère pas sans l'investiture.
«Le comte fit part de cette déclaration aux ambassadeurs et aux grands d'Espagne. Cette base établie, non sans dégoût et mortification de la part de tous ceux de sa famille, il voulut marier son nouveau fils avec une des principales héritières d'Espagne. Il jeta les yeux sur la première dame du palais, dona Giovanna di Velasco, fille du connétable de Castille, lequel ne le cède à personne en noblesse, puisqu'il se vante de compter parmi ses ancêtres cinq quartiers royaux.
«Pour conclure ce mariage, il était nécessaire de rompre le premier, et déjà on avait rempli toutes les formalités à Rome, auprès du pape, lequel donna tous pouvoirs à l'évêque d'Avila, pour conduire cette grave négociation. La femme réclama, et fit, par protestations et assignations, tous les actes juridiques qui pouvaient démontrer que son mariage était parfaitement valable. Mais le bon évêque fut d'une opinion contraire, par cette seule raison que le curé (qui avait béni le mariage), n'était pas l'ordinaire de la femme, le mariage ayant été célébré dans la maison de la mère, qui dépendait d'une paroisse différente de celle de sa fille, laquelle vivait ailleurs, séparée du domicile de sa mère.
«À ces raisons, les théologiens d'une conscience nette répondirent que la fille n'ayant pas été émancipée par sa mère, parce qu'on ne les considère jamais comme émancipées à moins qu'elles ne soient établies, on ne pouvait pas comprendre que le domicile de la mère fût différent de celui de la fille; c'est pourquoi le curé très-légitime de la mère, était également celui très-légitime de la fille; d'où la conséquence que le mariage était très-valable. Néanmoins, l'autorité du favori prévalut sur la raison du fait, et le mariage fut solennellement rompu.
«Le comte s'appliqua ensuite avec la plus grande ardeur à négocier le mariage de son bâtard reconnu avec la fille du connétable, et, finalement, en dépit du père et de tous ses parents, il l'obtint.
«On reconnut, dans cette circonstance, la bassesse des âmes adulatrices, puisque tous les grands de la cour, tous les fonctionnaires, tous les nobles allèrent donner la bienvenue à don Enrique, le traitèrent d'Excellence, et lui présentèrent tous ces compliments qui appartiennent plutôt aux rois qu'à des vassaux. Mais le personnage paraissait tellement ridicule, que n'étant pas accoutumé aux grandeurs, il allait se heurtant, sans aucun discernement, contre les choses les plus abjectes; d'où les Italiens disaient que don Enrique était un Matassin habillé en roi d'Espagne.
«Le connétable devint fort triste de s'être fait des ennemis de tous ses parents, qui ne voulaient plus le voir. On donna à don Enrique une maison si magnifique et si riche, qu'aucun grand d'Espagne n'en avait jamais eu de pareille. De somptueux cadeaux affluèrent de tous les royaumes et de toutes les provinces. Le plus remarquable fut celui du duc de Médina de Las Torres, alors vice-roi de Naples, qui dépassa la valeur de deux cent cinquante mille écus. À Saragosse, on donna l'habit d'Alcantara à don Enrique, avec une commande de dix mille écus. Il fut nommé gentilhomme de la chambre du roi, avec la promesse de la présidence du conseil des Indes, arrachée à cette fin au comte de Castille, pour rendre plus acceptable la convenance de le faire précepteur de l'héritier présomptif de la couronne. Au milieu de toutes ces flatteries, la haine contre don Enrique était si véhémente, qu'on n'oublia jamais la bassesse de ses habitudes, et que le peuple disait publiquement de lui:
«La reconnaissance de sa filiation et son mariage exaspérèrent la famille du marquis del Carpio, parce qu'elle enlevait la succession d'Olivarès au véritable héritier déjà reconnu, don Luis de Haro, cavalier d'une intelligence extraordinaire et d'une capacité supérieure.»
Tel est le récit du père dominicain; et bien que nous ayons retranché plusieurs passages intraduisibles pour un lecteur français qui veut être respecté, on voit que le bon moine ne brille pas précisément par la charité chrétienne.
Ainsi qu'il le raconte, don Luis de Haro, neveu du comte-duc, que la légitimation de Julien privait de l'héritage de cet oncle, se ligua avec la reine Isabelle, la nourrice, le confesseur du roi et toute la camarilla, pour demander le renvoi du favori. Il ne paraît pas que Philippe IV ait fait grande résistance; il céda, et envoya en exil le ministre tout-puissant depuis plus de vingt-deux années. Mais, comme ce prince était incapable de porter lui-même le fardeau du gouvernement, il le remit immédiatement entre les mains de don Luis de Haro, qui le conserva jusqu'à la mort du monarque.