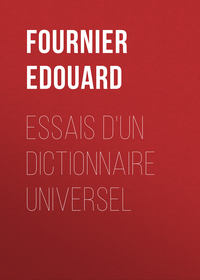Kitabı oku: «Essais d'un dictionnaire universel», sayfa 11
MARIN. ine. adj. qui vient de la mer, qui appartient à la mer. Les Anciens appelloient les Tritons des Dieux marins. Ce fut un monstre marin qui fit périr Hypolite. On peignoit le char de Neptune attelé de chevaux marins. Il y a des veaux marins; des chiens & des loups marins. Le sel marin est celui qui se fait de l'eau de la mer, qui est de figure cubique, & le plus fort de tous les sels.
La carte marine, ou hydrographique, est celle qui sert pour la conduite des vaisseaux, où sont marquez les rumbs des vents, les côtes, les rades, & les bancs de sable.
On dit qu'un homme a le pied marin, quand il est accoûtumé à l'air & à la fatigue de la mer, quand il a été long-temps sur les vaisseaux.
La trompette marine, est un instrument qui n'a qu'une grosse & longue corde de boyau, tenduë sur un chevalet, & qu'on touche avec un archet; elle a le corps triangulaire, & elle imite fort bien le son des trompettes ordinaires. Voyez trompette.
La Marine. s. f. est la science de la navigation, ou l'art de naviger dont les Anciens n'ont rien laissé par écrit avant l'invention de la boussole. On tient que la marine est la science qui approche le plus de la perfection. Pierre Nonius est un célébre Mathématicien Portugais, qui le premier en a écrit deux livres en l'année 1530. à l'occasion de quelques doutes que lui proposa Martin Alphonse Sosa: en suite Pierre Medina Espagnol; & en 1606. André Garcia Cespedes fit imprimer Regimiento de la navigation: en 1608. Simon Stevin Mathématicien du Prince d'Orange. En 1620. Willebrordus Snellius a fait imprimer son Typhys Batavus. En 1631. Adrianus Metius a écrit de l'art de naviger par le globe. En 1640. le Pere Fournier Jesuite a écrit de l'hydrographie. En 1661. le Pere Riccioli & le Pere Gaspard Schotus Jesuites en ont donné quelques traitez dans leurs Œuvres; & en 1666. le Sieur Denis Hydrographe & Professeur à Dieppe, Rodericus Zamoranus, Pierre Appian, Rodericus Crescentius, Augustinus Cæsareus, Robert Dutlé, Jacques Colomb, Jean Janson, & le Pere Mersene Minime en ont fait quelques traitez; le dernier qui en a écrit est le Pere Deschales Jesuite, des œuvres duquel ceci est tiré en faveur de ceux qui s'adonnent à la navigation, que maintenant on cultive heureusement en France. Les Livres ordinaires de marine qu'ont les pilotes sont les Routiers de Pierre de Medine, de Manuel Figueirido, le miroir, le tresor, la colomne de la mer, le flambeau de la navigation dressé par Guillaume Jeanszoon.
On appelle des marchandises marinées, lorsqu'elles sont imbuës & soüillées de l'eau de la mer.
Mariné. En termes de blason, se dit des animaux dépeints sur les écus, qui ont la moitié du corps de poisson. Il portoit de gueules au cerf estropié (ou qui n'a point de pieds) mariné d'or.
Marinette. s. f. Vieux mot qui signifioit autrefois la pierre d'aimant, & même la boussole qui en est touchée, parce qu'elle servoit principalement à la marine. Voyez Boussole.
MASCARET. s. f. terme de navigation: C'est un reflus violent de la mer qui remonte impetueusement dans la riviére de Dordogne, qui fait le même effet sur cette riviére que celui qu'on appelle la Barre sur la Seine. Les Naturalistes ont de la peine à expliquer cette sorte de reflus, qui est particulier à ces deux riviéres.
MASCARADE. s. f. Troupe de personnes masquées qui vont danser & se divertir, sur tout en la saison du Carnaval. Cette compagnie a fait une jolie mascarade, a dansé une espece de ballet. Ce mot vient de l'Italien mascarata, dérivé de l'Arabe Mascara, qui signifie raillerie, bouffonnerie. Ménage.
Mascarade est aussi un titre que quelques Poëtes ont donné à des vers qu'ils ont fait pour les personnages de ces petites danses ou ballets.
Mascarade, se dit aussi d'une personne mal mise, ou mal proprement ajustée, comme si elle vouloit se déguiser, & aller en masque. Cette femme affecte des ornemens, des parures extravagantes, & hors de mode; c'est une vraye mascarade. Les chevaux l'ont tellement éclaboussée qu'elle avoit le visage comme une vraye mascarade.
Mascarade, se dit aussi d'une vaine pompe & cérémonie, d'un appareil éclatant qui ébloüit le sot peuple, et dont les sages ne sont point touchez. Démocrite traitoit tout le genre humain de mascarade, se mocquoit de ses vanitez & mascarades. On le dit aussi de ceux qui trompent sous apparence d'honnêteté, qui déguisent leurs sentimens. Les hypocrites sont des continuelles mascarades.
MASSORE. s. f. Terme de Théologie. C'est un travail fait sur la Bible par quelques sçavans Rabbins pour en empêcher l'alteration. Buxtorfe la définie une Critique d'un texte Hebreu, que les anciens Docteurs Juifs ont inventée, par le moyen de laquelle on a compté les versets, les mots, & les lettres de texte, & l'on en a marqué toutes les diversitez; car le texte des Livres sacrez étoit autrefois écrit tout d'une suite, sans aucune distinction de Chapitres, ni de versets, ni même de mots; de maniére que tout un Livre n'étoit qu'un mot continu à la maniére des Anciens, dont on voit encore plusieurs manuscrits Grecs & Latins, écrits de cette sorte. Ce mot ne signifie que tradition, comme si cette critique n'étoit autre chose qu'une tradition que les Juifs avoient reçûë de leurs peres. On tient que ce sont les Juifs d'une école fameuse qu'ils avoient à Tiberiade qui ont fait, ou du moins commencé cette Massore, comme dit Elias Levita. Aben Esra les fait Auteurs des Points & des accens qui sont dans le texte Hebreu qu'on a aujourd'hui, qui servent de voyelles. Les Arabes ont fait aussi la même chose sur leur Alcoran, que les Massoretes sur la Bible. Il y a une grande & une petite Massore imprimées à Venise & à Bâle avec le texte Hebreu en different caractére. Voyez là-dessus le P. Morin & le P. Simon, Buxtorfe dans le Commentaire Massoretique qu'il a intitulé Tiberias. On appelle Massoretes ces Auteurs qui ont travaillé à la Massore, & l'exemplaire Massoretigue est le texte Hebreu dont on se sert aujourd'hui.
MAST. s. m. grand arbre posé dans les Vaisseaux, où on attache les vergues & les voiles pour recevoir le vent nécessaire à la navigation. Il y en a quatre dans les grands Vaisseaux, quelquefois on y en ajoûte un cinquiéme qui est un double artimon. Le grand mast, ou le mast de maître est le principal mast du Vaisseau; le second s'appelle de misaine, mast de bourset, ou mast d'avant, qui est entre le grand mast & la prouë; le troisiéme l'artimon, qui est entre le grand mast & la pouppe; & le quatriéme beaupré, qui est couché sur l'esperon à la prouë. Le mast de contremisaine, ou petit artimon est sur l'arriére dans les galions, Naos, ou grands Vaisseaux. Le grand mast jusqu'à la premiére hune est ordinairement égal à la quille du Vaisseau.
On appelle aussi mâts les brisures ou divisions des mâts qui sont posez les uns sur les autres: le grand mast & celui de misaine en ont chacun trois, le grand mast, le mast de hune, qui est au dessus & tout d'une piéce, & le mast de perroquet qui est sur celui de hune; & au dessus encore est le bâton du pavillon, ce qui fait quelquefois plus de trente-quatre toises. L'artimon qu'on appelle aussi mast de foule, & le beaupré n'ont qu'une brisure chacun, on l'appelle de perroquet, & non de hune. Le grand mast est posé au milieu du premier pont ou franc tillac, & descend au fond de cale, sur la contrequille; il n'est pas tout à fait perpendiculaire, mais il panche du côté de la pouppe à proportion de sa hauteur depuis deux jusqu'à six pieds. Sa plus grande grosseur est au franc tillac, & il va en diminuant par haut & par bas du tiers de sa grosseur. Le mast de misaine passe à travers le château d'avant au dessus de l'estrave, à l'extrêmité de l'escarlingue. Le mast de beaupré est enchassé par le bout d'embas sur le premier pont dans le mast de misaine. Le mot de mast en est François, en Allemand, en Flamand & en Anglois la même chose; l'Italien dit masto, & l'Espagnol mastel.
Mast gemellé ou jumellé, est celui qui est fortifié par plusieurs piéces de bois qui y sont étroitement jointes, qu'on appelle jumelles ou gaburons, ou costons. On l'appelle aussi mast reclampé, renforcé, ou surlié, & s'il est enté par le haut, on le nomme mast affusté, ajusté. On dit aller à mâts & à cordes, ou se mettre à sec, quand on a abaissé toutes les voiles & les vergues pour éviter la furie du vent.
Les bateaux navigeans sur les riviéres ont aussi un mast par où passe le cable, qui sert à les tirer avec des chevaux.
Mast, se prend quelquefois pour un Vaisseau. Il y avoit cent mâts dans cette armée, c'est à dire, cent vaisseaux. On voit une forest de mâts dans le port d'Amsterdam.
On appelle aussi mâts dans un camp les piéces de bois qui servent à soûtenir les tentes.
En termes de blason on appelle un mast desarmé, quand il est peint sans voiles.
MEDIASTIN. s. m. terme d'anatomie; c'est une continuation de la membrane qui s'appelle pleure, laquelle est tenduë sous toutes les côtes & enferme la région moyenne ou vitale, autrement nommée le thorax. Quand cette membrane est arrivée au milieu de la poitrine, elle se double de part & d'autre, & va de l'épine du dos au brechet séparant le côté droit d'avec le gauche, & c'est ce qu'on appelle vulgairement le mediastin, qui s'étend en longueur depuis les clavicules jusqu'au diaphragme, & en hauteur depuis l'os de la poitrine jusqu'au corps des vertebres, il soûtient les visceres, de peur qu'ils ne tombent d'un côté ni d'autre.
MEDIN, terme de relations, c'est une monnoye de Turquie, d'argent fin qui vaut dix-huit deniers monnoye de France, ou deux aspres de Turquie. Il y a aussi des Medins de Barbarie, qui est une monnoye Africaine dont Bodin fait mention.
MENEAU. s. m. terme d'architecture; c'est la séparation des ouvertures des fenêtres ou grandes croisées. Autrefois on faisoit de gros meneaux & croisillons de pierre au milieu des croisées qui défiguroient tout un bâtiment. Les meneaux ou croisillons doivent avoir quatre ou cinq pouces d'épaisseur.
MESOLABE. s. m. instrument de Mathematique inventé par les Anciens pour trouver méchaniquement deux moyennes proportionnelles, lesquelles on n'a pû faire encore géometriquement; il est composé de trois parallelogrames qu'on fait mouvoir dans une coulisse jusqu'à certaines intersections. Sa figure est décrite dans Eutocius en ses Comm. sur Archimede.
Mesplat. adj. Terme d'artisan, qui se dit des piéces des ouvrages qui ont plus d'épaisseur d'un côté que d'autre, & particuliérement des piéces de bois de sciage.
METACARPE. s. m. Terme d'anatomie. C'est une partie du squelet qui contient quatre os de la paume de la main, situez entre ceux du poignet & ceux des doigts: on l'appelle aussi avant-poignet, & c'est ce qui forme la paume de la main: les Latins l'appellent post brachiale.
METAPHYSIQUE. s. f. Derniére partie de la Philosophie dans laquelle l'esprit s'éleve au dessus des êtres créez & corporels, s'attache à la contemplation de Dieu, des Anges & des choses spirituelles, & juge des principes de toutes connoissances par abstraction & détachement des choses materielles. Aristote a écrit plusieurs Livres de Métaphysique. Descartes a laissé plusieurs méditations métaphysiques incomparables. On l'appelle aussi Théologie naturelle, & c'est comme le tronc ou la racine de toutes les sciences; son objet est l'être en général en tant qu'il est séparé de toute matiére, soit réellement, soit par la pensée. M. Duhamel prétend que ce nom a été forgé par les sectateurs d'Aristote, & qu'il lui a été tout à fait inconnu.
Metaphysiquement. adv. D'une maniére métaphysique élevée au dessus de la matiére & des êtres sensibles. Il y a des choses qu'on ne peut concevoir que métaphysiquement.
Metatarse. s. m. Terme de Medecine. C'est une partie du squelet de l'homme, qui compose la partie mitoyenne du petit pied, & qui contient cinq os entre le talon & les arteils.
METOPE. s. m. Terme d'Architecture. C'est l'intervalle ou quarré qu'on laisse entre les trigliphes de la frise de l'ordre dorique, il represente l'endroit où aboutissent les solives ou poutrelles d'un bâtiment: ces quarrez sont quelquefois emplis d'ornement, comme de têtes de bœuf, & autres choses qui servoient aux sacrifices des Payens.
Metopion. s. m. Est un arbre qui naît en Afrique vers l'Ethiopie, d'où, selon Pline, distile sur le sable la gomme de l'ammoniac; mais Pline se trompe, & l'ammoniac est un sel & non une gomme. Dioscoride dit que Metopion est une plante de Syrie, d'où distile le galbanum.
Metoposcopie. s. f. Art qui enseigne à connoître le temperament & les mœurs des personnes par la seule inspection des traits du visage. Ce n'est qu'une partie de la physionomie, parce que celle-ci fonde ses conjectures sur toutes les parties du corps. L'une & l'autre sont fort incertaines. Le mot est Grec & signifie inspection du visage.
MEZZANIN. s. m. terme de Marine. C'est un arbre ou troisiéme mast qu'on met quelquefois sur la Mediterranée, dans les Galeres entre l'arbre de mestre & la pouppe, qui est garni de sa voile.
Mezzanine. s. f. Est un terme qui se trouve employé par quelques Architectes, pour signifier une entre-solle.
Mezeline. s. f. Est une sorte d'étoffe mêlée de soye & de laine.
Mezeau. s. m. Vieux mot qui signifioit autrefois ladre, d'où on a fait mezelerie, qui a signifié ladrerie; il vient de l'Italien mezzo, qui veut dire pourri, gâté, corrompu, Ménage: d'autres le dérivent de miser & miseria, & de misellus.
Mezaraique. adj. Terme de Medecine, qui se dit des veines du mesentere qui succent le chyle des intestins pour le porter au foye: on les appelle aussi mesenteriques.
Mezail. s. m. Terme de Blason, qui se dit du devant, ou plûtôt du milieu du devant du heaume qui s'avance à l'endroit du nez, & comprend le nazal & le ventail; de là vient que les Princes & grands Seigneurs portent leurs timbres ayant le mezail tarré ou tourné de front, c'est à dire, le mezail paroissant également éloigné des oreilles. Ce mot vient du Grec messon. Borel.
Mezereon. s. m. terme de Pharmacie: c'est une plante medicinale qu'on appelle thimælea, qui porte le granum gnidium, que plusieurs confondent avec la laureole, dont les Apoticaires font des pilules qui sont si violentes & dangereuses dans les purgations, que les Arabes l'appellent lyon de la terre, ou herbe qui fait les femmes veuves: les Païsans appellent son fruit poivre de montagne, à cause qu'étant seche il ressemble au poivre, & qu'il est si piquant au goût qu'on ne le sçauroit souffrir tout seul.
Microscope s. m. Terme d'Optique. C'est une lunette qui sert à découvrir les moindres parties des plus petits corps de la nature, parce qu'elle grossit les objets extraordinairement. Il s'en fait de plusieurs façons, les uns avec quatre verres qui ont un tuyau long d'un pied; d'autres avec une petite lentille grosse comme une tête d'épingle qui font un fort bel effet. L'Inventeur du Microscope est le même que celui qui a inventé le Telescope, appellé Zacharias Jansen ou Joanides; on attribuë à M. Hugenes l'invention de celui qui est fait avec une petite lentille, & néanmoins on trouve que le Pere Maignan Minime en a parlé long-temps auparavant dans le 4. tome de son Cours Philosophique, &c.
N
NAVIRE. s. m. Terme de Marine, Vaisseau de haut bord pour aller sur la Mer avec des voiles; on le dit en général de toutes sortes de grands Vaisseaux, à la réserve des Galéres, on l'appelle aussi simplement Bord, ou Vaisseau, & ce mot est le plus en usage. Ce Port est capable de tant de Navires. Les Navires sont à l'ancre en une telle Rade. Navire de guerre, Navire marchand. On dit armer, équipper, fretter un Navire. La grandeur d'un Navire s'estime par son port, qui est de tant de tonneaux, dont chacun pese deux milliers. On distingue aussi les Navires du premier, du second, du troisiéme, du quatriéme & du cinquiéme rang selon la grandeur de leur quille, leur port ou capacité, le nombre de leurs ponts, ou des canons dont ils sont montez. Les Navires sont réputez meubles par le titre dix du Livre second de l'Ordonnance de la Marine; ils peuvent être néanmoins vendus par decret, si leur port est au dessus de dix tonneaux, suivant les formalitez du tître quatorziéme du même Livre; ils ne laissent pas d'être réputez immeubles à l'égard des hypotecques seulement; mais ils ne doivent point de lods & ventes, & ils ne sont point sujets au retrait lignager, ni à la licitation à l'égard des combourgeois. Les affiches des criées s'appliquent au grand mast du Vaisseau, & au parquet de l'Admirauté. Tout Navire allant en guerre ou en long cours doit être consideré en ces trois parties, la Bourgeoisie à qui appartient le Vaisseau, qu'elle doit fournir avec bons apparaux, armes & artillerie; l'Equipage qui consiste aux gens de guerre & Mariniers, pages, garçons & gourmettes; le Victuailleur qui fournit les victuailles, les poudres, boulets, cloüages, chaînes, carreaux, grenades, & tout ce qu'on nomme armement, & chez les Levantins sartie. Le Navire est composé de plusieurs parties qui seront expliquées à leur ordre; ce mot vient du Latin Navis. Plusieurs croient que Janus a été l'inventeur des Navires, à cause qu'il y en avoit de marquées sur le revers des plus anciennes monnoyes de Gréce, de Sicile & d'Italie, suivant le témoignage d'Athenée.
On dit au feminin la Navire d'Argo, en parlant de ce fameux Vaisseau qui le premier traversa la mer de la Gréce pour aller à la conquête de la Toison d'or sous la conduite de Jason, & de cinquante-quatre Argonautes.
Le plus fameux Navire de l'Antiquité est celui de Ptolomée Philopator, qui étoit long de 280. coudées, large de 38. haut de 48. & qui du haut de la pouppe jusqu'à la mer en avoit 54. Il portoit 400. rameurs, 400. matelots, & 3000. soldats; celui qu'il fit pour naviger sur le Nil étoit long d'une demi stade, & large de 30. coudées, mais ce n'est rien en comparaison du Navire d'Hieron construit sous la conduite d'Archimede, de la fabrique duquel Moschion, au rapport de Snellius, a écrit un Livre entier; on y employa le bois destiné à faire 60. Galéres, & 300. Ouvriers sans les manœuvres; le dedans étoit si bien distribué, qu'il y avoit une loge particuliére pour chacun des rameurs, des matelots, des soldats & passagers: il y avoit aussi plusieurs salles à manger, chambres, promenoirs, galeries, jardins, viviers, fours, écuries, moulins, un Temple de Venus, des bains, des salles de conference, &c. Outre cela il y avoit un rempart de fer, huit tours, deux en prouë, deux en pouppe, les autres sur les côtez, avec des murs & bastions, sur lesquels il y avoit plusieurs machines de guerre, dont une entr'autres jettoit une pierre du poids de trois cens livres, ou une fléche de douze coudées, à la portée de six cens pas, avec plusieurs autres merveilles admirables dont Athenée fait mention.
En termes de blason on appelle un Navire équippé, & habillé d'argent ou de gueules, & de sable, quand les agreils sont de ces émaux.
NAZAL. s. m. Terme de Blason, qui s'est dit de la partie supérieure de l'ouverture d'un casque ou heaume qui tomboit sur le nez du Chevalier quand il l'abaissoit; il est opposé à ventaille, qui est la partie inferieure.
Nazard. s. m. C'est un des jeux de l'orgue dont les tuyaux sont de plomb, & d'environ cinq ou six pieds; ce jeu est bouché, & ses tuyaux sont à cheminée accordez à la douziéme de la montre. Il y a aussi un second nazard qui est à l'octave du précédent, & une quarte du nazard.
Nazard, ou nazillard, se dit d'une personne qui parle du nez, & sur le ton du jeu d'orgue qu'on appelle nazard.
Nazarde. s. f. Chiquenaude que l'on donne sur le bout du nez. On dit d'un homme ridicule & timide, qu'il a un nez à camouflets & à nazardes.
Nazarder. v. act. donner des nazardes. Les pages, les écoliers se nazardent les uns les autres.
Nazeaux. s. m. Ouvertures du nez des animaux, particuliérement des chevaux, qui leur servent à la respiration. On ouvre les nazeaux aux chevaux qui ont de la peine à respirer. Ovide dit, que les chevaux du Soleil soufloient le feu par les nazeaux. On appelle proverbialement un fanfaron, un fendeur de nazeaux.
Naziller. v. n. parler du nez, d'où vient le mot de nazillard, qui ne parle pas distinctement. Il y a des Ordres de Religieux qui affectent de naziller en chantant, qui croyent que cela est plus devot.
On dit en termes de chasse, que le sanglier se foüille, ventroüille & nazille dans la bouë.
NEPHRETIQUE. adj. & subst. Maladie causée ordinairement par quelque pierre ou gravier qui se forme dans les reins. La colique nephretique est une douleur qui provient de cette cause; on la sent dans les reins & sur les boyaux; & elle est plus cruelle que toutes les autres coliques: ce mot est dérivé du Grec nephros, qui signifie le Rein.
Nephretique, est aussi une pierre précieuse, ou espéce de jaspe, qui ordinairement est mêlée de blanc, de jaune, de bleu, & de noir, & en cela elle differe de l'heliotrope, parce qu'on y découvre ces couleurs quand on la veut polir; ce qui n'arrive pas à l'heliotrope.
Il y a aussi un bois qu'on appelle nephretique, qui vient des Indes, qui étant rappé ou fendu en petits morceaux, & infusé dans l'eau, la teint en sorte qu'elle paroît d'or à travers le jour, & d'un bleu foncé à contre jour. La pierre girasole fait le même effet.
NICOTIANE. s. f. Tabac, Petun, herbe à la Reine. Ce sont les noms qu'on donne à une herbe qui vient de l'Amerique, qui desseiche le cerveau, & fait éternuer, à qui on donne diverses préparations pour la prendre en poudre par le nez, ou en machicatoire par la bouche, ou en fumée avec une pipe. Nicod l'envoya en France pendant qu'il étoit Ambassadeur en Portugal en 1560. & il lui a donné son nom, comme il témoigne lui-même dans son Dictionaire. Il dit qu'elle a une merveilleuse vertu contre toutes les playes, dartres, ulceres, & Noli me tangere. Catherine de Medicis la voulut faire appeller Medicée, de son nom; de là vient qu'on l'appelle encore en plusieurs lieux herbe à la Reine. Elle étoit venuë originairement de la Floride, où quelques-uns disent qu'on l'appelloit Petun.
NIL. s. m. Fleuve qui traverse une grande partie de l'Afrique, il s'employe dans la langue en cette phrase proverbiale; c'est un homme obscur qui cache son logis, il est aussi inconnu que la source du Nil, parce que cette source a été inconnuë jusqu'à ce dernier siécle; elle est dans un territoire que les Habitans appellent abavi, ou sacahala, c'est à dire, le pere des eaux; ce Fleuve sort de deux fontaines éloignées de trente pas, chacune de la grandeur d'un de nos puits. Les Habitans qui sont Payens adorent la plus grande, & lui offrent plusieurs sacrifices de vaches, dont ils mangent la chair comme sainte, & ils laissent les os dans un endroit destiné pour cela, qui font maintenant une montagne assez considerable; ces Habitans s'appellent Agaus dans le Royaume de Goyam à douze degrez de latitude Septentrionale, & 55. de longitude; c'est dans une plaine d'environ trois quarts de lieuë, enfermée de montagnes; au sortir de là il entre en un petit lac, puis il se perd sous terre par l'espace d'une portée de mousquet, & à trois journées de sa source: il est assez large & profond pour porter des Vaisseaux, mais à cent pas plus loin il passe à travers des rochers, en sorte qu'on le passe aisément sans se moüiller le pied; on y navige avec des bateaux de natte bien serrées: il reçoit trois riviéres assez grandes nommées Gema, Linquetil & Brantil; & quand il est sorti du lac de Dambea, qui a cinquante lieuës de large, il reçoit de trés-grands fleuves, comme le Gamara, Abea, Baixo & Aquers; & enfin prés de l'Egypte le Tacase. Il y a deux principales cataractes ou saults; à la deuxième il tombe dans un profond abîme, le bruit s'en entend à trois lieuës de là. L'eau est poussée avec tant de violence qu'elle fait une arcade, sous laquelle elle laisse un grand chemin; où on peut passer sans être moüillé, & où il y a des siéges taillez dans le roc pour reposer les voyageurs. La premiére catadoupe ou cataracte du Nil est d'environ cinquante pieds; la seconde est trois fois plus haute. On dit qu'Albuquerque eut dessein de faire un traité avec les Abissins pour détourner le Nil, & le faire jetter dans la mer Rouge, afin de rendre les campagnes d'Egypte stériles, & que pour empêcher cela le Turc paye tribut au grand Negus; mais c'est une fable, & la chose est entiérement impossible. Alexandre consulta l'Oracle de Jupiter Ammon pour apprendre où étoit cette source, Sesostris, Ptolemée, la firent chercher inutilement. Cambises, à ce que dit Strabon, employa une armée pour la chercher. Lucain témoigne que Cesar disoit qu'il eût quitté la guerre Civile s'il eût été assuré de la trouver. Saint Augustin & Théodoret ont cru que c'étoit le Fleuve appellé Geon, qui arrousoit le Paradis terrestre, & qui alloit par dessous la mer Rouge renaître en Afrique. Ce que dessus est extrait de l'histoire écrite en Portugais par le Reverend Pere Balthasar Tellés Jesuïte. Isaac Vossius a écrit de l'Origine du Nil, & des autres Fleuves, & en attribuë la source & le débordement aux pluyes abondantes en ce païs là en Eté. Monsieur de la Chambre attribuë la cause de sa cruë au nitre dont le lit de ce Fleuve est plein, qu'il dit être cause d'une vehemente fermentation, mais il se trompe.
Nille, ou Nigle, ou Nelle, terme de blason, qui se dit d'une espéce de croix ancrée, beaucoup plus étroite & plus menuë qu'à l'ordinaire. Il y en a qui confondent Nille & Anille. Voyez croix Nillée.
NOLI me tangere, terme Latin. C'est un nom que donnent les Médecins à un ulcére malin qui vient au visage.
Nolis & Nolissement. s. m. Termes de Marine, ils signifient sur la Méditerranée la même chose que fret & affrettement sur l'Ocean. On dit aussi sur l'Ocean naulage, pour dire le fret des Navires qu'on louë pour aller en guerre, ou pour courir le bon bord; & on dit noliger & nauliser, pour dire loüer & fretter. Tout ces mots viennent du Latin naulum.
NOMBRE. s. m. quantité discrete, assemblage de plusieurs corps separez, considerez comme s'ils occupoient une certaine étenduë. Euclide le définit une multitude composée de plusieurs unitez. La quantité continuë est l'objet de la géometrie, la quantité discrette, celui de l'Arithmetique, ou de la science des nombres: ce mot vient du Latin numerus.
Dieu a tout fait en nombre, poids & mesure. 2. Diophante a bien écrit des nombres. Il a été commenté par Gaspard Bachet de Meziriac, qui a fait aussi des problêmes pour deviner les nombres qu'un autre a pensé. Les mystéres des nombres de Pithagore avoient plus de vanité que de solidité, aussi bien que toutes les allégories que plusieurs Docteurs en ont voulu tirer. Voyez le traité des nombres du Sieur Freniel inseré dans les mémoires de l'Academie des sciences, où il en fait voir plusieurs belles propriétez.
Nombre, signifie particuliérement le premier caractére d'une suite de chifres, qui ne contient que des unitez; c'est un nombre simple. On commence à compter par nombre, dixaine, centaine, mille, &c. Le nombre binaire, ternaire, centenaire, se dit des caractéres qui marquent ces quantitez.
Nombre pair est celui qui se peut diviser en deux parties égales. Tout nombre pair multiplié par un nombre pair fait un nombre pair.
Nombre impair qui ne se peut diviser également sans fraction, qui est plus grand d'une unité que le pair. La somme de deux nombres impairs fait un nombre pair.
Nombre Pairement pair, est celui qu'un nombre pair mesure par un nombre pair, comme deux fois quatre c'est huit, ce huit est un nombre pairement pair.
7. Nombre pairement impair, celui qu'un nombre pair mesure par un nombre impair; quatre multiplié par cinq fait vingt, nombre pairement impair.
Nombre premier, ou primitif, est celui qui ne peut être mesuré que par la seule unité: comme 19. 29. dans la division desquels en quelque partie qu'on les divise, il reste toûjours une unité.
Nombre composé, est celui qui se peut diviser en plusieurs parties égales, qui peut être mesuré par d'autres nombres.
Nombre parfait, est celui qui est égal aux parties qui le composent, si on les ajoûte ensemble, comme 6. est parfait, parce qu'il égale la somme de 1. 2. 3. qui sont ses parties.
Nombre sourd, ou irrationnel, est un nombre qui n'a pas de proportion avec un autre.
Nombres cosiques. Terme d'Algebre: ce sont les diverses puissances d'un nombre multiplié plusieurs fois par lui-même. Racine, quarré, cubique quarré de quarré, cubo cubique, &c. sont des nombres cosiques.
Nombre entier, est celui qui n'est point divisé, qui est sans fraction.
Nombre rompu, c'est un nombre divisé en plusieurs parties, ou fractions, qu'on écrit avec deux rangs de chifres, divisez par une barre, dont celui de dessus est le numerateur, celui de dessous le dénominateur.
Nombre poligone, en termes d'algebre signifie un nombre à plusieurs angles qui se forme par des nombres en progression Arithmetique ou égale; en telle sorte que s'ils étoient arrangez & marquez en points, ils feroient une figure à plusieurs angles. Par exemple, si on marque un point en haut, & deux en bas, cela fera un triangle, & le nombre de trois fera un trigone: Si on marque deux en haut & deux en bas, cela fera un quadrangle, ou nombre quarré, qui fera quatre. Ce qui arrive quand la progression va seulement par un ou deux: mais si la difference des nombres est de trois, elle fera un pentagone, si elle est de quatre un exagone; si elle est de cinq un eptagone, & ainsi du reste. Voyez l'Algebre du P. Malebranche, où les propriétez de ces nombres sont bien expliquées.
Nombre, en termes de Palais, & en plusieurs Arts, se dit aussi d'une quantité incertaine, indéterminée. Quand on dit j'ai été mille fois chez lui, on prend un nombre certain pour un incertain; un nombre rond c'est cent ou mille, &c. Nous n'étions pas nombre, c'est à dire, nous n'étions pas assez pour juger, pour tenir Chapitre, & déliberer: il faut ceder au nombre, à la force, à la pluralité. Dans les grands Corps, la plûpart ne servent que de nombre. Il a nombre d'envieux: il a un nombre innombrable d'écus. On dit mettre au nombre, ou du nombre, pour dire dans le rang, dans la liste, dans le Catalogue; on l'a mis au nombre des Saints. Il est du nombre des exilez. Il s'est mis du nombre, pour dire il s'est mis dans la troupe. On dit aussi dans le blazon, des étoilles, des fleurs de lys sans nombre, quand l'écu en est chargé sans qu'il y ait de nombre prescrit.