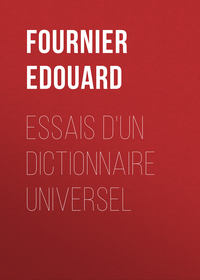Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Essais d'un dictionnaire universel», sayfa 13
Les oreilles des Animaux sont faites diversement. Le Veau marin & toutes les especes de lezards & de serpens n'ont point du tout d'oreilles externes; le singe & le porc-épic les ont applaties contre la tête comme les hommes; il y a une espece de Baleine qui a l'ouverture de l'oreille sur les épaules. Les taupes ont le conduit de l'oreille fermée par une petite peau qui s'ouvre comme une paupiére. La tortuë, le cameleon aussi bien que la plûpart des poissons, ont le conduit de l'oreille tout à fait bouché.
Les bruits, les tintoins, les bourdonnemens sont des maladies des oreilles. Quand on dit qu'un homme a l'oreille dure, c'est à dire, honnêtement qu'il est sourd.
Les Incas du Perou se faisoient particuliérement remarquer par leurs oreilles, dont la largeur étoit si prodigieuse qu'elle est incroyable. Ils accordoient aux Capitaines qui les avoient bien servis, comme un grand privilege la permission de se percer les oreilles, à condition que le trou n'en seroit pas la moitié si grand que celui de l'Inca, & on leur donnoit même la mesure du trou, afin qu'il ne fût pas plus grand que le privilege portoit. Ils y portoient des pendans d'oreille attachez à deux filets, longs d'un quart d'aune, & gros d'environ la moitié d'un doigt, ce qui les fit appeller par les Espagnols orejones, c'est à dire, hommes à grandes oreilles. Cette coûtume de se percer les oreilles étoit aussi en usage chez les Indiens d'Orient, dont il est fait mention ci-aprés au mot Pendans d'oreille.
Oreille en termes de Musique, se dit du jugement que l'oreille fait des sons. Cet homme danse bien, il a l'oreille fine, juste, delicate, il observe la cadence. Cet homme n'a point d'oreille, ne distingue pas les tons & les mesures. On dit aussi des Orateurs & des Poëtes qu'ils doivent avoir de l'oreille, pour dire qu'ils doivent observer la cadence de leurs Vers, de leurs périodes, éviter les cacophonies. Un Ancien a dit que le jugement de l'oreille étoit fort rigoureux.
On dit en ce sens d'un discours, des paroles, qu'elles blessent, qu'elles choquent les oreilles, quand elles déplaisent. Les ordures blessent les oreilles chastes. Les barbarismes choquent les oreilles des gens polis. Les belles paroles n'écorchent point l'oreille. Les grands ont les oreilles delicates, se choquent de peu de chose. La Musique charme, flatte, chatoüille l'oreille. Il y a bien des gens qui se laissent prendre par l'oreille, charmer par une belle voix, persuader par un beau discours. On dit aussi qu'une chose sonne mal aux oreilles, quand elle est odieuse, quand on en a mauvaise opinion. On dit qu'un homme a l'oreille d'un Prince, d'un Ministre, pour dire qu'il en a de favorables audiences, & tant qu'il veut; qu'il lui souffle, qu'il lui corne aux oreilles quelque chose, pour dire qu'il fait tant qu'il le persuade. Il lui a dit un mot à l'oreille, pour dire qu'il lui a donné un avis secret.
A Syracuse il y a un lieu qu'on appelle l'oreille de Denis le Tiran, c'est un trou qui perce dans une montagne, & qui fait qu'on entend en haut tout ce qui se dit en bas, quoi qu'à une grande distance.
On dit que la gelée, le vent, la grêle ont donné sur l'oreille aux fruits, au bleds, pour dire qu'ils en ont été endommagez, qu'ils baissent l'oreille. On dit aussi d'un chapeau, qu'il baisse l'oreille, pour dire que les bords ne le soûtiennent pas bien; qu'il fait le clabaud: c'est une métaphore tirée des chiens de chasse qui ont de grandes oreilles pendantes.
Oreille de cochon, est la partie du cochon la plus delicate pour manger en ragoût.
Oreille de Parisien est un petit ouvrage de Patisserie fait de bœuf fort épicé, enveloppé d'une pâte legere en forme d'oreille, qu'on appelle autrement rissolle.
Oreilles du cœur sont deux petites parties ou ouvertures du cœur faites en forme d'oreilles, dont la droite aboutit à la veine cave, & la gauche à l'entrée de l'artere veineuse. Elles servent à recevoir le sang, & à en faire la circulation dans le cœur; l'oreille gauche du cœur se dilate, quand le cœur se resserre pour en faire sortir le sang.
Oreille en terme de mer se dit des voiles Latines qui sont triangulaires, qu'on appelle oreilles de liévre ou à tiers point à la difference de celles qui sont à trait quarré. On appelle aussi les oreilles ou les pattes d'un ancre.
Oreille en termes d'Artisans, se dit aussi de deux petites avances qu'on applique au bord d'une écuelle pour la tenir plus facilement. Une écuelle à oreilles.
On appelle aussi oreille la partie d'un cercle de fer qui est au haut d'un chauderon dans laquelle l'anse est mobile; & dans un minot la partie du cintre où sont attachez les deux bouts de la potence.
On appelle aussi oreille les deux grosses dents d'un peigne qui sont aux extrêmitez, qui conservent les autres.
On appelle oreilles d'un cadenas, ses ouvertures dans lesquelles son anse est mobile.
Oreille se dit aussi du bord replié d'un livre, quand on veut y faire quelque marque pour retrouver aisément quelque endroit singulier, ou l'endroit où on en est demeuré en le lisant, cela arrive aussi aux livres frippez, qu'on a beaucoup maniez avec peu de soin.
Oreille se dit aussi de cette petite courroye où se termine le quartier du soulier, qui sert à y attacher des rubans, ou des boucles pour le serrer.
Oreille en terme d'Organistes, se dit de deux petites plaques de plomb que l'on soude sur les tuyaux à côté de leur bouche ou lumiére, qu'on abaisse ou qu'on releve pour faire des sons plus graves ou plus aigus: ils les nomment ainsi, parce qu'il semble qu'elles écoutent si les tuyaux sont d'accord.
On appelle en termes de Blason oreilles deux petites pointes qui sont au haut des grandes coquilles, comme celles de S. Jaques.
On appelle oreilles d'abricots des abricots confits dont on a ôté les noyaux, & dont on a rejoint les deux moitiez, en sorte que l'extrêmité de l'une n'aille qu'au milieu de l'autre, ce qui represente une espece d'oreille.
Oreille d'ours est une petite fleur printaniére qui pare agréablement un parterre, quand on la sçait bien disposer: car il y en a de plusieurs couleurs. Cette herbe est une espece de saniclet qui a les feüilles grandes comme le plantain, & roulées dans le bourgeon: elles ont certains replis ou bords fort artistement faits, on l'appelle en Latin Ursi auricula, ou dentaria minor, ou lunaria sanicula, ou artritica.
Oreille d'âne, est aussi un nom qu'on donne à la grande consolide qui est une plante fameuse en Medecine. Voyez Consolide.
Oreille de Rat, ou de souris, est le nom d'une plante qu'on appelle en Latin pilosella, c'est une espece de mouron, elle rampe toûjours par terre, & a des feüilles disposées en étoile, couvertes de poils blancs, ses tiges aussi rampantes ressemblent à de petites cordes souples rondes & veluës, qui prennent racine & poussent des branches nouvelles. Ses fleurs sont jaunes, qui à leur maturité s'envolent en bourre; ses racines sont déliées, & pourtant difficiles à arracher. Si on coupe la plante, elle rend du lait: son suc est astringeant, constipe le bêtail, & le fait mourir. Mathiole.
Oreille se dit proverbialement en ces phrases: Un chien hargneux a toûjours les oreilles déchirées, pour dire que les gens quérelleux sont sujets à être battus. On dit que les murs ont des oreilles, pour dire qu'on a beau parler secretement & à l'oreille, il y a toûjours quelque espion qui écoute, &c.
On dit qu'un homme se fait tirer l'oreille, pour faire quelque chose, quand il la fait à regret, ce qui se dit par allusion à une coûtume qu'avoient les Romains d'amener par l'oreille en justice, ceux qui ne vouloient pas y venir rendre témoignage d'une action qu'ils avoient vûë, lors de laquelle on leur pinçoit, & on leur tiroit l'oreille, afin qu'ils se souvinssent du fait, dont on voit plusieurs témoignages dans Plaute, Virgile, & Horace, &c.
OREILLÉ. ée. adj. terme de Blason qui se dit des dauphins, lorsque leurs oreilles sont d'un émail different de leurs corps; on le dit aussi des grandes coquilles, quand elles ont des oreilles aussi d'émail different.
ORGUE. s. f. & autrefois masculin. C'est le plus grand & le plus harmonieux de tous les instrumens de Musique qui est particuliérement eu usage dans les Eglises, pour célébrer l'Office Divin avec plus de solemnité. On fait pourtant dans les maisons particuliéres quelques orgues portatives, qu'on nomme cabinets d'orgues, mais dans les Eglises, on appelle buffet d'orgues cette construction de menuiserie qui enferme toute la machine. Le grand Buffet sert pour le grand jeu, qu'on appelle le grand corps, & le petit buffet pour le petit jeu qu'on nomme le positif. Ce mot vient du Latin organum.
L'orgue est composée de plusieurs tuyaux qui reçoivent le vent de gros soufflets, lequel est distribué par un sommier & par le moyen de plusieurs registres, qui ouvrent & ferment les ouvertures de ces tuyaux; & il y entre selon qu'on appuye les doigts sur les differentes touches du clavier.
On appelle accompagnement en l'orgue les divers jeux qu'on touche pour accompagner le Dessus, comme sont le bourdon, la montre, la flûte, le prestant, &c. Ceux de la grande orgue sont differents de ceux du positif.
La plûpart des piéces qui composent l'orgue sont expliquées à leur ordre alphabetique: on dira seulement ici que le chassis est une des principales piéces de l'orgue, parce qu'on enchasse dedans l'ais du sommier sur lequel on pose les tuyaux; on applique sur la table du sommier des tringles d'épaisseur de membrure, qu'on appelle Barreaux, éloignées les unes des autres de deux doigts, pour faire place à 48. Raynures ou crans ou graveures, sur lesquelles on met des chappes ou des ais qui les couvrent, & dans l'intervalle vuide de ces Raynures, on fait entrer des Régles planettes & mobiles en forme de lattes, qu'on nomme Registres, on perce ces trois piéces vis à vis l'une de l'autre, pour donner passage au vent dans les tuyaux, lesquels on applique sur le plus haut de ces trous, & cet assemblage s'appelle le sommier de l'orgue. On appelle le secret de l'orgue une layette ou quaisse, où est reçû & réservé le vent de la souflerie, pour le distribuer par les sous-papes au sommier qui est derriére. Vitruve nomme le sommier canon musical.
On appelle le tamis, la piéce de bois percée, à travers laquelle passent les tuyaux de l'orgue, & qui les tient en état.
L'orgue a deux ou trois & quelquefois quatre ou cinq claviers, dans les grands Buffets: ils sont divisez en plusieurs touches ou marches, comme ceux de l'Epinette & du clavessin. Chaque octave doit avoir 13. marches, & le clavier harmonique parfait en doit avoir 19. Une orgue a pour le moins 2000. tuyaux tant dans le grand Buffet que dans le positif, & elle a jusqu'à 8. octaves d'étenduë depuis le tuyau de 32. pieds jusqu'à celui d'un demi-pied. Ces tuyaux sont de bois, d'étain, ou de plomb. Il y a des tuyaux à anche & des tuyaux ouverts & d'autres bouchez, où on remarque que le tuyau bouché descend deux fois plus bas que celui qui est deux fois plus long, & qui est ouvert, parce que l'air qui y entre, & qui en sort, a deux fois autant de chemin à faire. Les tuyaux à cheminée sont ceux qui ont un petit tuyau soûdé au bout d'en haut d'un plus grand.
Les simples jeux de l'orgue sont, la montre, le premier & le second bourdon, le prestant & la doublette, le flageolet, & le nazard, la flutte d'allemand, la tierce, la fourniture, la grosse cimbale, la seconde cimbale, le cornet, le larigot, la trompette, le clairon, le cromorne, la régale ou la voix humaine, la pédale, la trompette & la flûte de pédale, sans compter le tremblant qui n'est qu'une modification des jeux.
De ces jeux on en fait plusieurs composez, qu'on varie en une infinité de façons. On appelle le plein jeu de l'orgue celui qui est composé de la montre, du bourdon, du 16. & du 8. pieds, du prestant & de la doublette, de la fourniture & de la tierce. Les facteurs d'orgue y ajoûtent d'autres jeux, ou en retranchent suivant leur different genie, ou la dépense qu'on y veut faire.
On appelle le temperament de l'orgue une diminution du ton majeur d'un comma, dont on augmente le ton mineur par une espece d'équation pour les rendre plus justes. L'invention de l'orgue est fort ancienne: Vitruve en décrit une dans son dixiéme livre. L'Empereur Julien a fait une Epigramme à sa loüange. Saint Jerôme fait mention d'une orgue qui avoit 12. souflets, dont la layette étoit faite de deux peaux d'Elephant, & on l'entendoit de mille pas: il dit qu'il y en avoit une en Jerusalem qu'on entendoit du Mont des Olives.
On appelle aussi orgue le lieu de l'Eglise où sont les orgues. Il est allé aux orgues entendre le Sermon. Ce mot vient du Latin organum. Salomon de Caux dit que le premier Auteur qui a écrit de l'orgue est Heron Alexandrin dans ses Pneumatiques. Le Pere Mersenne a fait une ample description de l'orgue aussi bien que Salomon de Caux. Le Begue a fait imprimer plusieurs piéces d'orgue, qui font voir comme on en peut mêler les jeux agréablement.
Orgues en termes de guerre est une machine composée de plusieurs gros canons de mousquet, attachez ensemble, dont on se sert pour défendre les brêches & autres lieux qu'on attaque, parce qu'on tire par leur moyen plusieurs coups tout à la fois.
Orgues est aussi une espece de herse, avec laquelle on ferme les portes des Villes attaquées: ce sont plusieurs grosses piéces de bois qu'on laisse tomber d'en haut, & qui ne sont point attachées l'une à l'autre par aucune traverse, comme sont les herses ordinaires, ou Sarrasines.
Orgues en termes de Marine sont des trous & ouvertures qui passent au travers du bordage d'un Vaisseau le long des tillacs ou des sabords qui servent de goutiéres pour l'écoulement des eaux: on les appelle autrement dalots.
ORIFLAME. s. f. les Anciens le faisoient masculin. Etendart de l'Abbaye de Saint Denys. Quelques-uns ont dit qu'elle étoit semée de flammes d'or, d'où elle avoit pris son nom. Elle differoit de la Banniére de France qui étoit d'un velours violet ou bleu celeste à deux endroits semez de fleurs de lys d'or plus plein que vuide. Elle étoit aussi differente en la forme, parce que celle de France étoit toute quarrée sans aucunes découpures par le bas, non plus que les autres banniéres, au lieu que l'Oriflame étoit attachée au bout d'une lance en guise de gonfanon, qui d'abord étoit pendu sur le tombeau de Saint Denys, & ne servoit que pour l'Abbaye. Il étoit mis entre les mains de son Avoüé qui étoit le Comte de Vexin, pour défendre les biens de l'Eglise & du Monastére, c'étoit une espece de labarum ou de gonfanon, ou de banniére comme en avoient toutes les autres Eglises, qui étoit fait de rouge & de soye de couleur de feu qu'on nommoit cendal ou samit vermeil, qui avoit trois queuës, ou fanons, & étoit entouré de houppes de soye verde, &c.
P
PEAGE. s. m. Il s'est dit autrefois en général de toutes sortes d'impôts, qui se payoient sur les marchandises, qu'on transportoit d'un lieu à un autre: maintenant il se dit d'un Droit qu'on prend sur les voitures des marchandises pour l'entretien des grands chemins. La plûpart des Seigneurs s'attribuent des droits de péage sur leurs terres, sous prétexte d'entretenir les chemins, les ponts & chaussées. Anciennement ceux qui tenoient ce droit, devoient rendre les chemins seurs, & répondre des vols faits aux passans. Cela s'observe encore en quelques endroits d'Angleterre & d'Italie, où il y a des gardes qu'on appelle stationnaires, établis pour la seureté des Marchands, & entre autres à Terracine sur le chemin de Rome à Naples. Anciennement si un homme étoit détroussé en chemin public & entre deux soleils, le Seigneur Haut-Justicier qui levoit le péage, étoit obligé de le rembourser. Il y a une Ordonnance de mille cinq cens septante portant abolition de tous péages établis depuis cent ans sur la riviére de Loire. La plûpart des péages sont de pures usurpations. L'Ordonnance de 1552. enjoint aux Seigneurs qui ont droit de péage, d'entretenir les ponts & passages. Le péage est appellé de divers noms dans les Coûtumes & les Ordonnances. On le nomme Barrage aux entrées des Bourgs & des Villes, Pontenage aux passages des ponts, Billete ou Brunchiere aux passages de campagne, où on a mis pour signal un petit billot de bois attaché à une branche, on l'appelle quelquefois coûtume ou droit établi sans titre, quelquefois prevôté ou menu droit casuel, & quelquefois travers, qui est un droit qui ne se paye que sur la frontiére. Ce mot vient de paagium, abregé de passagium selon Vossius cité par Ménage: d'autres disent de pedagium qu'on trouve aussi chez les Auteurs Latins. Borel le dérive de pagus ou pais.
PEAGER. s. m. Fermier du péage, qui exige & fait payer ce droit. Les Péagers doivent mettre des billetes, des tableaux & pancartes en lieu éminent, pour faire connoître les droits qui sont dûs.
PEAUTRE s. m. le gouvernail d'un vaisseau. On dit proverbialement à des importuns qu'on veut chasser loin de soy: Allez au peautre: Je l'ay bien envoyé au peautre, je l'ay bien envoyé promener.
PEAUTRÉ en termes de Blason se dit de la queuë des poissons, lorsqu'elle est d'autre couleur que le corps, parce qu'elle est en effet le gouvernail des poissons: Il portoit d'argent au dauphin versé de sable, allumé, barbé & peautré d'or.
PEIGNE. s. m. petit instrument qui sert à décrasser & à nettoyer la tête, à arranger les cheveux, & à les tenir proprement. Il est fait d'un morceau de bois, d'ivoire, de corne, ou d'écaille de tortuë, divisé en plusieurs dents, ou petites ouvertures qui donnent passage aux cheveux. Les peignes font la principale garniture d'une toilette, d'une trousse, un étuy, une brosse à peignes: les Dames se coiffent avec les peignes: Les Courtisans fanfarons ont toûjours un peigne à la main. Les Tyrans ont eu aussi des peignes de fer, pour tourmenter les Martyrs en leur déchirant la peau: Les grosses dents d'un peigne s'appellent les oreilles. Ce mot vient du Latin pectem.
Peigne se dit aussi de l'instrument avec lequel on carde, on démêle la laine, la bourre, la soye. Un peigne de Cardeur est un morceau de bois chargé d'une infinité de petites pointes recourbées de fil de fer.
Peigne de Tisserand est une espece de chassis, ou treillis qui a un grand nombre de petites divisions ou ouvertures, dans chacune desquelles on passe les fils de la chaîne qui doit former la longueur de la piéce de la toile, ou de l'étoffe: elles servent à les soûtenir, & à laisser passer la navette qui porte les fils qui doivent être en travers. Les peignes de velours ont soixante ou quatre-vingt portées.
Peigne de jable se dit chez les Tonneliers des morceaux de douve amenuisez par un bout, & qui entrent à force dans les cerceaux pour réparer un jable rompu.
Peignes en termes de Manége sont des gratelles farineuses qui viennent aux paturons du cheval, & qui font hérisser le poil sur la couronne.
Peigne se dit figurément en choses morales: Il faut donner encore un coup de peigne à cet ouvrage; pour dire, il le faut revoir pour le polir davantage. On dit aussi qu'un Satirique a donné un coup de peigne à quelqu'un; pour dire qu'il en a fait quelque description maligne, qu'il l'a rendu ridicule.
Peigne de Venus, est une plante medicinale, que les Medecins appellent pecten Veneris, & autrement scandix, qui est ainsi nommée, parce qu'elle a plusieurs cornets disposez comme un peigne à peigner le lin. Sa tige est haute d'un demi pied, ses feüilles semblables aux pastenates sauvages, ou à la camomille. Elle jette plusieurs petits bouquets de fleurs blanches & menuës à la cime de ses branches, d'où sortent plusieurs petits becs ou aiguilles séparées les unes des autres, & disposées comme un peigne de Cardeur.
On dit proverbialement d'un homme qui est en mauvaise humeur, ou en colere, qu'il tueroit volontiers un Mercier pour un peigne.
PEIGNER. v. act. décrasser sa tête, démêler, ou arranger ses cheveux avec un peigne: Les Courtisans sont toûjours bien peignez & bien frisez; c'est l'épithete ordinaire que donne Homere à tous ses Grecs.
Peigner signifie figurément rendre bien propre & bien ajusté: Cet ouvrage est bien peigné, on y a mis la derniére main, il est fort poli & orné: Voilà un jardin bien peigné, dont on a grand soin, il est fort propre & fort net.
On dit aussi en contre-sens que deux Harengeres se sont peignées, quand elles se sont prises aux cheveux, décoiffées, égratignées. On dit aussi que le chat a peigné le chien, quand il lui a donné quelques coups de griffes.
PEIGNÉ. ée. part. pass. & adj. On dit de la laine peignée, du chamvre peigné, lorsqu'ils ont passé par les mains des Cardeurs, ou qu'ils ont eu quelque autre préparation pour les nettoyer.
PEIGNIER. s. m. Marchand & Artisan qui vend, ou qui fait des peignes.
PEIGNOIR. s. m. linge qu'on met sur ses épaules tandis qu'on est à sa toilette, qu'on se peigne: Les femmes en deshabiller ont de beaux peignoirs à dentelles.
PEIGNURES. s. f. pl. cheveux qui tombent quand on se peigne: Les perruques ne se faisoient autrefois que de peignures.
PELLICAN. s. m. oiseau aquatique qui approche de la forme d'un heron, dont le cry ressemble au braire de l'âne, d'où vient que les Grecs l'ont appellé onocrotalos. On tient qu'il aime si fort ses petits, qu'il meurt pour eux, & se déchire l'estomach pour les nourrir. On en dit plusieurs fables, & on en fait l'hieroglyphe de l'amour paternelle.
Pellican est un vaisseau de Chymie fait ordinairement de verre avec des anses creuses & percées, qui sert à faire plusieurs distillations des liqueurs par circulation; & à les réduire dans leurs plus petites parties.
Pellican est aussi un ferrement dont se servent les Chirurgiens pour arracher des dents.
Pellican est aussi un nom qu'on donne à une ancienne piéce d'artillerie, qui est un quart de coulevrine portant six livres de boulet. Voyez Hanzelet.
PENDULE. s. m. poids attaché à une corde, ou à une verge de fer, lequel étant agité une fois, fait plusieurs vibrations jusqu'à ce qu'il se soit remis en repos. Les vibrations du pendule contiennent un espace de temps parfaitement égal. Un pendule de trois pieds huit lignes & demie marque les secondes, & en Musique la mesure égale ou binaire. Galilée a le premier écrit & fait des observations sur le mouvement du pendule. On a trouvé par le moyen du pendule qu'un corps pesant en tombant, parcourt en une seconde de temps, un espace de quinze pieds & un pouce, mesure de Paris. On se peut servir du pendule comme d'une mesure invariable & universelle pour les lieux les plus éloignez & les siécles les plus reculez, par le moyen d'une vibration qu'on aura trouvée être précisément d'une seconde de temps selon le mouvement du Soleil: car si par exemple on trouve que le pied horaire (c'est ainsi que Monsieur Huggens appelle la troisiéme partie de ce pendule à secondes) étant comparé au pied de Paris, soit, comme il est en effet, en proportion de 864. à 881. il sera aisé de faire la réduction de toutes les autres mesures du monde à ces mêmes pieds par le calcul. Mouton Chanoine de Lion a fait aussi un beau traité de mensura posteris transmittenda, sur le même principe.
PENDULE. s. f. est une horloge de nouvelle invention qu'on fait avec un pendule qui en régle le mouvement égal par le moyen d'une ligne cycloïde, qu'on dit être inventée par M. Huggens, qui a fait un trés-beau Volume de horologio oscillatorio imprimé en 1673.
PENES ou PESNES en termes de mer se dit des bouchons d'étouppe attachez à un manche, qui servent aux calfateurs à goudronner un vaisseau, & le suifver & brayer.
PENNAGE. s. m. Terme de Fauconnerie. Tout ce qui couvre le corps de l'oiseau de proye. Pennage blond, roux, noir, baglé, fleuri, turturin, cendré, &c. Selon les diverses couleurs que les oiseaux portent en leur robbe. L'oiseau a quatre sortes de pennage: 1. le duvet qui est comme la chemise de l'oiseau proche sa chair; 2. la plume menuë qui couvre tout son corps; 3. les vanneaux qui sont les grandes plumes de la premiére jointure des aîles; 4. les pennes qui s'étendent jusqu'à la penne du bout de l'aîle qu'on appelle le cerceau.
PENNES ou PANNES, terme de Fauconnerie. Sont les longues plumes des aîles, celles de la queuë s'appellent balay. Les pennes croisées sont une marque de la bonté de l'oiseau. Toutes les pennes des aîles ont leurs noms, une, deux, trois, quatre, cinq, les rameaux & le cerceau; les pennes du balay pareillement, le milieu, la deux, la trois, &c. Les oiseaux ont 12. pennes à la queuë. Ce mot vient de penna.
Pennes se dit aussi des petites plumes qu'on met au bout d'une fléche, ou d'un matras pour les faire aller droit, d'où est venu le mot de trait bien empenné, & un matras desempenné. Les pennes se faisoient avec des plumes d'oye ou de gruë.
Penne, ou Pennache, en termes de Blason se dit des plumes d'oiseau qu'on met sur le Chapeau pour orner la tête, quand on les peint sur des écus: De Marolles porte d'azur à l'épée d'argent; la garde en haut d'or, accôtée de deux pennes ou pennaches adossées du second, c'est à dire, d'or.
Penne en termes de Marine est le point, ou le coin des voiles Latines, ou à tiers point.
PENNON. s. m. Etendart à longue queuë, qui appartenoit autrefois à un simple Gentilhomme: c'est proprement un guidon à mettre sur une tente. Il est opposé à banniére qui étoit quarrée: car quand on faisoit quelqu'un Banneret, la cérémonie étoit de couper la queuë de son pennon, d'où est venu un ancien Proverbe: Faire de pennon banniére; pour dire, passer à une nouvelle dignité. Il y a encore à Lion des Compagnies des quartiers qu'on appelle Pennonages, & leurs Chefs s'appellent Capitaines Pennons. Ce mot vient du Latin Pannus, parce que ces banniéres étoient autrefois faites de drap, ou d'autre riche étoffe, qui étoient comprises sous le même genre.
Pennon généalogique, est en termes de Blason un écu rempli de diverses alliances des Maisons desquelles un Gentilhomme est descendu, qui sert à faire ses preuves de noblesse. Il comprend les armes du pere & de la mere, ayeul & ayeule, bisayeul & bisayeule: il est composé de huit, de seize, de trente-deux quartiers, &c. sur quoi on dresse l'Arbre généalogique.
PIED. s. m. Partie double de l'animal, qui lui sert à se soûtenir & à marcher. L'homme & les oiseaux n'ont que deux pieds. La plûpart des animaux terrestres ont quatre pieds. La plûpart des insectes ont cent pieds, c'est à dire, un grand nombre. Les serpens n'ont point de pieds, ils rampent sur la terre. Les Marchands font accroire que les oiseaux de Paradis n'ont point de pieds, ce sont eux qui les coupent.
Les écrevisses ont douze pieds. Les araignées, les mittes, les polypes ont huit pieds. Les mouches, les sauterelles, les papillons ont six pieds. Les singes, les loups, la marmote marchent sur les pieds de derriére.
En Autourserie on dit le pied d'un vautour & d'un éprevier, au lieu qu'en Fauconnerie on dit la main de l'oiseau, du faucon.
Pied en tant qu'il appartient à l'homme, se marie avec plusieurs mots en diverses significations. On dit, lâcher le pied, pour dire, reculer, se défendre mal; gagner au pied, pour dire, prendre la fuite. On dit aussi qu'on ne peut mettre un pied devant l'autre, pour dire, être foible, ne pouvoir marcher. On dit, mettre pied à terre, pour dire, descendre de cheval; avoir le pied à l'étrier, pour dire, être prêt à partir. On dit aussi, trouver pied, prendre pied: Il y a pied là, lors qu'on trouve le fonds de la riviére, & qu'il n'est pas besoin d'y nager. On dit aussi, examiner un homme depuis les pieds jusqu'à la tête, l'armer de pied en cap. On dit aussi, qu'il sent le pied de Messager, pour dire qu'il pue; & on appelle pieds pourris, ceux qui ont toûjours les pieds dans l'eau, comme ceux qui conduisent les trains de bois flotté. On dit qu'un homme a le pied marin, pour dire qu'il supporte aisément la fatigue de la mer, qu'il ne s'y trouve point mal. On appelle pied plat un rustre, un paysan qui a des souliers tout unis. Prendre au pied levé, c'est à dire, sur le champ, sans delai. Avoir le pied bot, c'est un nom général qu'on donne à un pied estropié ou mal tourné, soit qu'il soit tourné en dedans, ce que les Latins appellent varus; soit qu'il soit tourné en dehors, ce que les mêmes appellent valgus. Avoir des cors aux pieds, c'est à dire, des calus ou des durillons. Porter le pied en avant, tourner bien le pied, attendre de pied ferme. Un appartement de plain pied; & au figuré un galand de plain pied.
Pied fourché se dit des animaux qui ont le pied fendu en deux seulement, comme les bœufs, les cochons, les moutons, les chévres, &c. Les Hebreux n'osoient manger la chair que des animaux qui avoient le pied fourché, & qui ruminoient. Le Pied fourché, est aussi une ferme d'un impôt qu'on léve aux portes de quelques Villes sur les animaux au pied fourché qui s'y consomment. La ferme du Pied fourché est differente de celle du Pied rond. On appelle des pieds de cochon assaisonnez des bas de soye. On appelle petits pieds la volaille, le menu gibier. Les Ecrivains appellent une écriture menuë & mal faite, des pieds de mouche.
Pied de cheval, c'est la partie de la jambe depuis la Couronne jusqu'au bas de la corne. Le pied gauche s'appelle le pied du montoir, & le droit, le pied hors du montoir. On dit qu'un cheval a le pied gras, quand il a la corne foible & mince, lors qu'il est difficile à ferrer; qu'il a le pied usé, qu'il a le pied mauvais, qu'il a le pied dérobé, lors qu'il a peu de corne, ou qu'il l'a usée pour avoir marché pied nud, c'est à dire, déferré; qu'il a le pied comble, lors que sa sole est arrondie par dessous, & qu'il a besoin d'un fer vouté.
Pied neuf se dit d'un cheval à qui la corne est revenuë, aprés que le sabot lui est tombé, auquel cas il ne vaut rien que pour le labour. Le petit pied est un os spongieux renfermé dans le milieu du sabot, & qui a toute la forme du pied. On dit aussi, remettre un cheval sur le bon pied, galoper sur le bon pied, quand on le fait aller uniment & sur les mêmes pieds qu'il a commencé de partir. On dit aussi, parer le pied d'un cheval, pour dire, enlever la corne du cheval avec un boutoir autant qu'il est nécessaire pour le bien ferrer.
Pied se dit aussi des plantes & des arbres: Il a tant de pieds d'œüillets, tant de pieds d'anemones: Il a tant de pieds d'arbres fruitiers dans ce jardin, tant de pieds d'arbres dans cette forest. On appelle pieds corniers les gros arbres qui sont dans les encoignures des ventes qui se font dans les forêts, & qui se marquent par le Garde-marteau. Pied cornier, se dit aussi des longues piéces de bois qui sont aux encoignures des pans de charpente. On le dit aussi des quatre principales piéces qui font l'assemblage du bateau d'un carosse, qui soûtiennent l'imperiale, & où on attache les mains, où on passe les soûpentes.