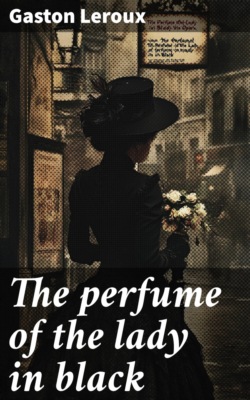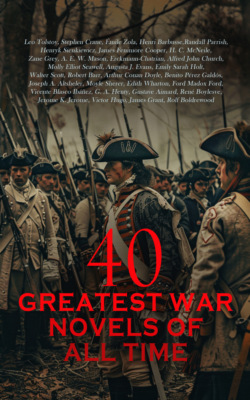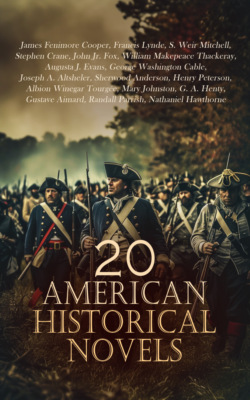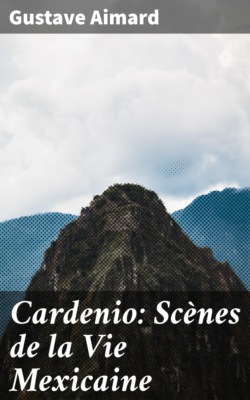Kitabı oku: «Le Montonéro», sayfa 18
XVIII
LE TOLDO
En quittant la salle de réception, Émile Gagnepain s'était dirigé vers le toldo habité par la marquise de Castelmelhor et sa fille; en agissant ainsi, le jeune homme obéissait à un pressentiment qui lui disait que, dans ce qui s'était passé devant lui, une sombre comédie avait été jouée par don Pablo, et que la facilité avec laquelle il avait consenti à laisser partir ses captives cachait une perfidie.
Ce pressentiment était devenu tellement vif dans l'esprit du jeune homme, il avait à ses yeux si bien revêtu les apparences de la réalité, que bien que rien ne vint corroborer cette pensée de trahison, il en avait acquis la certitude morale et aurait au besoin affirmé sa réalité.
Entraîné malgré lui et contre sa volonté dans une suite d'aventures fort désagréables pour un homme qui, comme lui, était venu chercher en Amérique cette liberté de mouvements et cette tranquillité d'esprit que son pays, bouleversé par les factions, lui refusait, le jeune homme avait fini, ainsi que cela arrive toujours, par s'intéresser à cette position anormale que les circonstances lui avaient faite et à suivre les diverses péripéties de la lutte étrange dans laquelle il se trouvait jeté avec l'anxiété fébrile d'un homme qui voit se dérouler devant lui les scènes d'un drame émouvant. De plus sans qu'il y eût pris garde, un sentiment qu'il n'essayait pas d'analyser avait sourdement germé dans son cœur; ce sentiment avait grandi à son insu, presque insensiblement, et avait fini par acquérir une force telle, que le jeune homme, qui commençait à s'effrayer de la nouvelle situation dans laquelle son esprit se trouvait placé tout à coup, désespérait de l'arracher de son cœur, et de même que toutes les natures, non pas faibles, mais insouciantes, n'osant s'interroger sérieusement et sonder le gouffre qui s'était ainsi ouvert dans son âme, il se laissait nonchalamment entraîner par le courant qui l'emportait, jouissant du présent sans songer à l'avenir, et se disant que, le moment de la catastrophe arrivé, il serait temps assez de faire face au péril et de prendre un parti quelconque.
A peine avait-il fait quelques pas dans le camp que, en tournant la tête, il aperçut don Santiago Pincheyra à quelques pas derrière lui.
Le montonero marchait nonchalamment, les bras derrière le dos, les regards vagues, sifflotant une zambacueca entre ses dents, ayant enfin toute la démarche d'un homme désœuvré qui se promène; mais le peintre ne s'y trompa pas: il comprit que don Pablo, empêché par ses hôtes, auxquels il était tenu de faire les honneurs du camp, avait délégué son frère, afin de suivre ses mouvements et lui rendre compte de ses démarches.
Le jeune homme ralentit peu à peu le pas, sans affectation, et, pivotant tout à coup sur les talons, il se trouva nez à nez avec don Santiago.
– Eh! fit-il, en feignant de l'apercevoir, quelle charmante surprise, señor, vous avez donc laissé à votre frère don Pablo le soin de traiter les officiers espagnols.
– Comme vous le voyez, señor, répondit l'autre assez, interloqué et ne sachant trop quoi répondre.
– Et vous vous promenez, sans doute?
– Ma foi oui; entre nous, cher señor, ces réceptions d'étiquette m'ennuient; je suis un homme simple, moi, vous le savez.
– ¡Caray! Si je le sais, dit le Français d'un air narquois; ainsi, vous êtes libre?
– Mon Dieu oui, complètement.
– Eh bien! Je suis charmé que vous soyez parvenu à vous dépêtrer de ces étrangers si fiers et si hautains; c'est bien heureux pour moi que vous soyez libre, et je vous avoue que je ne comptais guère sur le plaisir de vous rencontrer si à point.
– Vous me cherchiez donc? fit don Santiago avec étonnement.
– Certes, je vous cherchais; seulement, vu les circonstances présentes, je n'espérais pas, je vous le répète, réussir à vous rencontrer.
– Ah! Pourquoi donc me cherchiez-vous ainsi?
– Voilà, cher seigneur, comme je sais de longue main, que vous êtes un de mes meilleurs amis, j'avais l'intention de vous demander un service.
– Me demander un service, à moi?
– Parbleu! A qui donc, excepté votre frère don Pablo et vous, je ne connais personne à Casa-Trama.
– C'est vrai, vous êtes forastero étranger.
– Hélas, oui! Tout ce qu'il y a de plus forastero.
– Voyons le service? demanda le montonero, complètement trompé par la feinte bonhomie du jeune homme.
– Voici ce dont il s'agit, répondit celui-ci avec un sang-froid imperturbable, seulement je vous prie de me garder le secret, car la chose intéresse d'autres personnes et, par conséquent, est assez grave.
– Ah, ah! fit don Santiago.
– Oui, reprit le jeune homme en baissant affirmativement la tête, vous me promettez le secret, n'est-ce pas?
– Sur mon honneur.
– Merci, me voilà tranquille; je vous avouerai donc que je commence à m'ennuyer terriblement à Casa-Trama.
– Je comprends cela, répondit le montonero, en hochant la tête.
– Je voudrais partir.
– Qui vous en empêche?
– Mon Dieu, une foule de raisons; d'abord les deux dames que vous savez.
– C'est juste, dit-il avec un sourire.
– Vous ne me comprenez pas.
– Comment cela?
– Dame! Vous semblez supposer que je désire demeurer près d'elles, tandis que ce sont elles, au contraire, qui s'obstinent à exiger que je demeure ici.
Le montonero lança à la dérobée un regard soupçonneux à son interlocuteur, mais le Français était sur ses gardes, son visage semblait de marbre.
– Bien. Continuez, fit-il au bout d'un instant.
– Vous savez que j'assistais à l'entrevue.
– Parbleu! Puisque je vous y ai conduit moi-même; vous étiez assis auprès du secrétaire.
– Le señor Vallejos, c'est cela: un bien aimable cavalier; eh bien! Ces dames sont sur le point de quitter Casa-Trama. Don Pablo consent à leur départ.
– Vous voudriez partir avec elles?
– Vous n'y êtes pas; je voudrais partir c'est vrai, mais pas avec elles; puisqu'elles s'en vont sous l'escorte des officiers étrangers, je leur deviens inutile.
– En effet!
– Donc, elles n'auront plus de prétexte pour m'empêcher de me séparer d'elles.
– C'est vrai! Alors?
– Alors, je désire que vous me fassiez accorder par votre frère, à moins que vous ne préfériez me le donner vous-même, un sauf-conduit pour traverser en sûreté vos lignes et regagner au plus vite le Tucumán que je n'aurais jamais dû quitter.
– C'est bien réellement pour retourner au Tucumán que vous désirez un sauf-conduit?
– Pour quelle raison serait-ce donc?
– Je ne sais pas; mais mon frère… Il s'arrêta subitement avec un embarras mal dissimulé.
– Votre frère? insinua le jeune homme.
– Rien, je m'étais trompé; ne faites pas, je vous prie, attention à mes paroles, et n'attachez pas à ce que je vous dis un sens qui me saurait être vrai; je suis sujet à commettre souvent des erreurs.
– Y a-t-il des difficultés à ce que vous m'accordiez ce sauf-conduit?
– Je n'en vois pas; cependant, je n'oserais le faire, sans en prévenir mon frère.
– Qu'à cela ne tienne, je n'ai nullement l'intention de quitter le camp sans son autorisation; si vous voulez, nous irons le trouver ensemble.
– Vous êtes donc pressé de partir?
– Jusqu'à un certain point, il vaudrait mieux, je crois, que je pusse m'éloigner sans voir ces dames et avant elles; de cette façon, j'éviterais la demande qu'elles ne manqueront pas de m'adresser de les accompagner.
– Cela vaudrait mieux, en effet.
– Allons donc trouver votre frère, afin de terminer cela le plus tôt possible.
– Soit.
Ils se dirigèrent vers le toldo de don Pablo; mais, à moitié route à peu près le Français s'arrêta en se frappant le front.
– Qu'avez-vous? lui demanda don Santiago.
– J'y songe, nous n'avons pas besoin d'aller ensemble; vous arrangerez cette affaire beaucoup mieux que moi; pendant que vous serez là-bas, je préparerai tout pour mon départ, de sorte que je pourrai me mettre en route aussitôt après votre retour.
Le jeune homme parlait avec une si grande bonhomie, sa figure respirait si bien la franchise et l'insouciance, que don Santiago, malgré toute sa finesse, y fut trompé.
– C'est cela, dit-il; pendant que je serai près de mon frère, faites vos préparatifs; je n'ai pas besoin de vous.
– Cependant, si vous le préférez, peut-être serait-il plus convenable que je vous accompagnasse?
– Non, non, c'est inutile; dans une heure je serai à votre toldo avec le sauf-conduit.
– Je vous remercie d'avance.
Les deux hommes se serrèrent la main et se séparèrent, don Santiago se dirigeant vers la maison de son frère, qui était aussi la sienne, et le Français suivant en apparence le chemin qui le devait conduire à l'habitation qui lui avait été assignée; mais aussitôt que le partisan eut tourné l'angle de la plus prochaine rue, Émile, après s'être assuré qu'un nouvel espion n'était pas attaché à ses pas, changea immédiatement de direction et reprit celle de la demeure des deux dames.
Pincheyra avait logé ses captives dans un toldo isolé à une des extrémités du camp, toldo, adossée à une montagne taillée presque à pic, et qui pour cette raison le rassurait sur les probabilités d'une fuite. Ce toldo était du reste partagé en plusieurs compartiments, propres et meublé avec tout le luxe que comportait l'endroit où il se trouvait.
Deux femmes indiennes avaient été par le partisan attachées au service des deux dames, non seulement comme domestiques, mais surtout pour les surveiller et lui rendre compte de ce qu'elles disaient et faisaient; car, malgré les dénégations de don Pablo, la marquise et sa fille, bien que traitées avec le plus grand respect et en apparence complètement libres de leurs actions, étaient bien réellement prisonnières et elles n'avaient pas tardé à s'en apercevoir.
Ce n'était qu'avec de grandes précautions, et pour ainsi dire à la dérobée, que le jeune peintre parvenait à les voir et à échanger avec elles quelques mots sans témoins.
Les domestiques rôdaient sans cesse autour de leurs maîtresses, furetant, écoutant et regardant, et si par hasard elles s'éloignaient, la sœur de don Santiago, qui affectait de témoigner une vive amitié pour les étrangères, venait s'installer chez elles sans façon et y demeurait presque toute la journée, les fatiguant de ses caresses étudiées et des témoignages menteurs d'une amitié qu'elles savaient parfaitement être fausse.
Cependant grâce à Tyro, dont le dévouement ne se ralentissait pas, et qui avait su se mettre au mieux dans l'esprit des deux Indiennes, Émile était parvenu à se débarrasser à peu près d'elles; le Guaranis avait trouvé le moyen de les attirer par de petits présents, et à les mettre jusqu'à un certain point dans les intérêts de son maître, qui, de son côté, n'arrivait jamais au toldo sans leur offrir quelque bagatelle; il ne restait donc que la sœur de Pincheyra. Mais ce jour-là; après avoir, le matin, fait une longue visite aux dames, elle s'était retirée afin d'assister au repas que son frère donnait aux officiers étrangers, et pour remplir a leur égard ses devoirs de maîtresse de maison, soin dont elle n'avait pu se dispenser.
La marquise et sa fille étaient donc, pour quelque temps du moins, délivrées de leurs espionnes, maîtresses de leur temps et libres jusqu'à un certain point de se concerter avec le seul ami qui ne les eût pas abandonnées, sans craindre que leurs paroles fussent répétées à l'homme qui avait si indignement trahi à leur égard les lois de l'hospitalité et méconnu le droit des gens.
A quelques pas du toldo, le jeune homme se croisa avec Tyro, qui, sans lui parler, lui fit comprendre, par un signe muet, que les dames étaient seules.
Le jeune homme entra.
La marquise et sa fille, tristement assises auprès l'une de l'autre, lisaient dans un livre de prières.
Au bruit que fit Émile en franchissant le seuil de la porte, elles relevèrent vivement la tête.
– Ah! fit la marquise dont le visage s'éclaira aussitôt. C'est vous enfin, don Emilio.
– Excusez-moi, madame, répondit-il, je ne puis que fort rarement me rendre auprès de vous.
– Je le sais, comme nous vous êtes surveillé, en butte aux soupçons. Hélas! Nous n'avons échappé aux révolutionnaires que pour tomber aux mains d'hommes plus cruels encore.
– Auriez-vous à vous plaindre des procédés de don Pablo Pincheyra ou de quelqu'un des siens, madame?
– Oh! répondit-elle avec un sourire ironique, don Pablo est poli, trop peut-être avec moi? Oh, mon Dieu! Qu'ai-je fait pour être ainsi en butte à ces persécutions!
– Avez-vous vu mon serviteur, ce matin, madame. Je vous demande pardon de vous interroger ainsi, mais le temps me presse.
– Est-ce de Tyro dont vous me parlez?
– De lui-même, oui, madame.
– Je l'ai vu un instant.
– Il ne vous a rien dit?
– Peu de chose; il m'a annoncé votre visite, en ajoutant que, sans doute, vous auriez d'importantes nouvelle à m'apprendre, aussi mon désir de vous voir était-il vif; dans la position où ma fille et moi nous nous trouvons, tout est pour nous matière à espérance.
– J'ai, en effet, madame, de graves nouvelles à vous annoncer; mais je ne sais comment le faire.
– Pourquoi donc? s'écria doña Eva en fixant sur lui ses grands yeux avec une expression indéfinissable: craignez-vous de nous affliger, señor don Emilio?
– Je crains, au contraire, señorita, de faire entrer dans votre cœur un espoir qui ne se réalisera pas.
– Que voulez-vous dire? Parlez, señor, au nom du ciel! interrompit vivement la marquise.
– Ce matin, madame, plusieurs étrangers sont entrés à Casa-Trama.
– Je le sais, caballero; c'est à cette circonstance que je dois de ne pas avoir près de moi le garde du corps en courette qu'on a jugé convenable de me donner, c'est-à-dire la sœur du señor don Pablo Pincheyra.
– Connaissez-vous ces étrangers, madame?
– Votre question a lieu de me surprendre, caballero. Depuis mon arrivée ici, vous savez que c'est à peine s'il m'a été permis de faire quelques pas hors de cette misérable choza.
– Excusez-moi, madame; je vais mieux préciser ma question: avez-vous entendu parler d'un certain don Sebastiao Vianna?
– Oui, oui! s'écria doña Eva en joignant les mains avec joie; don Sebastiao est un des aides de camp de mon père.
Le visage du jeune homme s'assombrit.
– Ainsi, vous êtes sûre de le connaître? reprit-il.
– Certes, répondit la marquise. Comment, ma fille et moi, ne connaîtrions-nous pas un homme qui est notre parent éloigné et qui a servi de parrain à ma fille?
– Alors, madame, je me trompais, et les nouvelles que je vous apporte sont réellement de bonnes nouvelles pour vous; j'ai eu tort de tant hésiter à vous les annoncer.
– Comment cela?
– Parmi les étrangers arrivés ce matin à Casa-Trama, il en est un chargé de réclamer votre mise en liberté immédiate, de la part du marquis de Castelmelhor, votre époux, madame, votre père, señorita; cet étranger se nomme don Sebastiao Vianna, porte le costume d'officier portugais et est, dit-il, aide de camp du général marquis de Castelmelhor; je dois reconnaître que don Pablo Pincheyra s'est en cette circonstance conduit en véritable caballero; après avoir nié que vous fussiez ses prisonnières, il a noblement refusé la somme proposée pour votre rançon, et s'est engagé à vous remettre aujourd'hui même aux mains de don Sebastiao, qui doit, sous son escorte, vous reconduire à votre mari.
Il y eut un instant de silence; la marquise était pâle, ses sourcils froncés à se joindre sous l'effort d'une pensée intérieure et ses regards fixes dénotaient chez elle une émotion contenue avec peine; doña Eva, au contraire, rayonnait: l'espoir de la liberté illuminait ses traits d'une auréole de bonheur.
Le jeune homme regardait la marquise sans rien comprendre à cette émotion dont il cherchait vainement la cause; enfin elle reprit la parole.
– Êtes-vous bien certain, caballero, dit-elle, que l'officier dont vous parlez se nomme don Sebastiao Vianna?
– Parfaitement, señora, je l'ai plusieurs fois entendu nommer devant moi; d'ailleurs il me serait de toute impossibilité d'inventer ce nom que jamais, avant aujourd'hui, je n'avais entendu prononcer.
– C'est vrai, et pourtant ce que vous me dites est tellement extraordinaire que je vous avoue que, malgré moi, je n'ose y croire et que je redoute un piège.
– Oh! Ma mère! s'écria doña Eva d'un ton de reproche, don Sebastiao Vianna, l'homme le plus loyal et le plus…
– Qui vous assure ma fille, interrompit vivement la marquise, que cet homme soit réellement don Sebastiao?
– Oh, madame! fit le jeune homme.
– Caballero, don Sebastiao était, il y a deux mois à peine, en Europe, répondit la marquise d'un ton péremptoire.
Cette parole tomba comme la foudre au milieu de la conversation, et glaça subitement l'espoir dans le cœur de la jeune fille.
Au même instant un coup de sifflet résonna au dehors.
– Tyro m'avertit, dit Émile, que quelqu'un vient de ce côté, je ne puis demeurer davantage. Quoi qu'il arrive, ne vous abandonnez pas au désespoir, feignez d'accepter, quelles qu'elles soient, les propositions qui vous seront faites; tout est préférable pour vous à demeurer plus longtemps ici; moi, de mon côté, je veillerai; à bientôt, courage! Comptez sur moi!
Et sans attendre la réponse que les deux dames se préparaient sans doute à lui faire, le jeune homme s'élança hors du toldo.
Tyro, qui guettait son apparition, le saisit vivement par le bras et l'entraîna derrière le toldo.
– Regardez, lui dit-il.
Le peintre se pencha avec précaution, et il aperçut don Pablo Pincheyra, sa sœur, l'officier portugais et trois ou quatre autres personnes qui se dirigeaient vers l'habitation des dames.
– Hum! fit-il, il était temps.
– N'est-ce pas? Mais je veillais, heureusement.
– Viens, Tyro, retournons chez moi; don Santiago doit m'attendre.
– Vous lui avez donné rendez-vous?
– Oui.
– Eh bien! Vous avais-je trompé, mi amo?
– Non, certes; ce que j'ai vu a surpassé mon attente. Mais quel est donc ce don Sebastiao?
Le Guaranis répondit par un ricanement de mauvais augure.
– Il y a quelque chose, n'est-ce pas? demanda Émile avec inquiétude.
– Avec les Pincheyras, il y a toujours quelque chose, mi amo, reprit l'Indien à voix basse; mais nous voici à votre toldo, soyez prudent.
– Avertis les Gauchos que, probablement, nous partons aujourd'hui; prépare tout pour que nous soyons en mesure.
– Nous partons?
– Je l'espère.
– Oh! Alors, tout n'est pas encore perdu.
Ils entrèrent dans le toldo, il était désert, don Santiago n'avait pas encore paru.
Tandis que Tyro allait avertir les Gauchos de lacer et de seller leurs chevaux et de ramener les mules de charge du corral, le jeune homme se mit avec une rapidité fébrile à faire ses préparatifs.
Aussi, lorsque une demi-heure plus tard, don Santiago entra dans le toldo, le regard soupçonneux qu'il jeta autour de lui ne lui révéla aucun indice qui pût lui faire soupçonner que le Français ne s'était pas mis à la besogne aussitôt après l'avoir quitté.
– Ah, ah! fit le jeune homme en le voyant, soyez le bienvenu, don Santiago, surtout si vous m'apportez mon sauf-conduit.
– Je vous l'apporte, répondit laconiquement don Santiago.
– Pardieu! Il faut avouer que vous êtes un ami précieux; don Pablo n'a pas fait de difficultés?
– Aucunes.
– Allons, il est définitivement fort aimable pour moi, ainsi je puis partir.
– Oui, à deux conditions.
– Ah! Il y a des conditions, et quelles sont-elles?
– La première est que vous partirez tout de suite et sans voir personne, ajouta-t-il en pesant avec soin sur le dernier membre de phrase.
– Mes gens?
– Vous les emmènerez avec vous; que voulez-vous que nous en fassions ici?
– C'est juste; eh bien! Mais cette condition me plaît extraordinairement, vous savez que je désire surtout partir sans prendre congé de qui que ce soit; tout est donc pour le mieux. Voyons maintenant la seconde condition, si elle est comme la première, je ne doute pas que je l'accepte sans observation.
– La voici: don Pablo désire que je vous escorte, avec une dizaine de cavaliers, jusqu'à quelques lieues d'ici.
– Ah! fit le jeune homme.
– Cela vous déplaît-il?
– A moi? répondit en riant Émile, qui déjà avait repris son sang-froid; pourquoi cela me déplairait-il? Je suis, au contraire, fort reconnaissant à votre frère de cette nouvelle gracieuseté. Il craint sans doute que je m'égare dans le dédale inextricable de ces montagnes, ajouta-t-il avec une pointe d'ironie.
– Je ne sais pas; il m'a ordonné de vous escorter: j'obéis, voilà tout.
– C'est juste et surtout extraordinairement logique.
– Ainsi, vous acceptez ces deux conditions?
– Avec reconnaissance.
– Alors nous partirons quand vous voudrez.
– Je voudrais vous répondre, tout de suite; malheureusement, je suis obligé d'attendre mes chevaux qui ne sont pas encore arrivés du corral.
– Il n'est pas encore tard, ainsi il n'y a pas de temps de perdu.
– Maintenant que nous sommes d'accord, si nous buvions un gatro d'aguardiente5.
– Ma foi, ce sera avec plaisir, señor.
Le Français prit une bota et versa de l'eau-de-vie dans deux gobelets en corne.
– A votre santé, dit-il en buvant.
– A votre heureux voyage, répondit don Santiago.
– Merci.
Un bruit de pas de chevaux se fit entendre au dehors.
– Voici vos animaux qui arrivent.
– Alors, nous serons prêts dans quelques instants. Si vous voulez, pendant que nous chargeons, prévenez les hommes qui doivent vous accompagner.
– Ils sont prévenus, ils nous attendent aux retranchements.
Tyro et les Gauchos se mirent alors, aidés par Émile et don Santiago, à charger les deux mules et à seller les chevaux.
Le Français, habitué à voyager dans ces contrées, n'avait que fort peu de bagages: il n'emportait jamais avec lui que les choses les plus indispensables.
Une demi-heure plus tard, la caravane se mettait en marche au petit pas, accompagnée par don Santiago qui la suivait à pied en fumant sa cigarette et causant amicalement avec le jeune homme.
Ainsi que l'avait dit le montonero, une dizaine de cavaliers attendaient aux retranchements.
Le Pincheyra enfourcha sa monture, donna l'ordre au départ, les gardiens ouvrirent la barrière et la petite troupe quitta le camp en bon ordre.