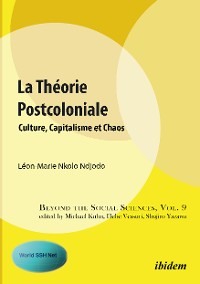Kitabı oku: «La Théorie Postcoloniale», sayfa 3
Dé-fondations conceptuelles
Loin d’être uniquement matérielles, les forces qui composent la dialectique historique sont aussi théoriques, parce que les forces intellectuelles sont aussi des forces concrètes, pratiques, vivantes, réelles, au sens où le soutenait K. Marx. Ceci pour dire qu’une conceptualisation pertinente de l’imaginaire africain « postcolonial » est indissociable d’une discussion approfondie des mutations qui ont marqué le monde de la pensée, à la fin du XXe siècle. Ces mutations transparaissent dans le postmodernisme (Vattimo, 1987 ; Maffesoli, 2010) ; la French Theory (Derrida, 1967 ; Foucault, 1969) ; les Cultural studies (Hall, 2008 ; Said, 2003) ; les Subaltern studies (Bhabha, 2007 ; Spivak, 2009) ; le mouvement de la négritude (Senghor, 1964 ; Césaire, 2004) ; l’école de la créolité, des écritures migrantes, diasporiques ou métasporiques (Des Rosiers, 2013) ; les philosophies et esthétiques culturelles de la « double conscience » (Gilroy, 2003) ; le courant des « épistémologies du Sud » et des « savoirs endogènes » (De Souza Santos, 2013) ; la pensée postcoloniale (Bayart, 1989) et son renouveau dans le débat sur la décolonialité.
Ces courants de pensée couronnent l’entreprise d’ébranlement des fondements intellectuels de la modernité, débutée entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle à travers le dadaïsme, le cubisme et l’antihumanisme de F. Nietzsche, E. Husserl et de M. Heidegger. Ils forment le puissant parti des « anti-Lumières » (Sternhell, 2006) hostiles à toute pensée des fondements. Déraciné et montrant une grande aversion pour l’idéologie moderne du progrès, l’homme « postmoderne » (tout comme sa réplique « postcoloniale ») est un sujet flottant, déterritorialisé, désaffilié et hybride. Semblable au rhizome, ou au corps lisse sans organes de G. Deleuze, il s’adapte ingénieusement, à travers ruses incessantes et métamorphoses opportunistes, aux formes globalisées de l’économie, de l’art et de la culture.
Or, appliquée aux questions africaines, la tradition moderne de l’hégélianisme et du marxisme fournit sa base critique à notre analyse8. Cette tradition met en cause le pouvoir dissolvant de l’argent dans l’art. Elle souligne la puissance d’aliénation de l’argent, cette « prostituée » qu’évoquait K. Marx, et qui, une fois érigée en but unique de l’existence humaine et en médiateur universel de la vie sociale, réconcilie les contraires : le bien et le mal, la vertu et le vice, le beau et le laid, le noble et le méprisable, la culture et la barbarie (Marx, 1996).
L’art postcolonial africain symbolise parfaitement cette puissance corrosive du capital. Il porte les aspirations utopiques du nouveau sujet ayant émergé des fondations du capitalisme néolibéral en cours d’édification en Afrique : le sujet pléonexique (Dufour, 2011 ; Mbele, 2015).
Il s’agit d’un étrange individu à la soif inextinguible des richesses, à l’appétit sans bornes pour les possessions matérielles, et à la volonté de puissance implacable. Adepte de l’eugénisme social, théoricien exalté de la réussite individuelle et de l’enrichissement instantané et vertigineux, le pléonexe africain manie avec dextérité les poncifs de l’idéologie libre-échangiste promue par les institutions financières internationales (FMI, BM, OMC) : « Etat de droit », « droits de l’homme », « bonne gouvernance », « société civile », « flexibilité », « compétitivité », « transparence », etc. (Laïdi, 2004 ; Cohen-Tanuggi, 1985 ; Nkolo Foé, 2013). Manipulateur de symboles, ce sophiste parfait excelle dans l’art oratoire (Nkolo Foé, 2008 : 65-76). Cynique absolu, il dédaigne l’accumulation par le travail auquel il préfère la spéculation boursière. Défenseur ardent de la financiarisation de l’économie et de la cybernétisation des rapports sociaux, il possède l’arrogance et l’impudeur de ceux qui se situent au-dessus de toute norme : morale, sociale, familiale, juridique, philosophique, religieuse, esthétique. Convaincu du caractère messianique de sa mission d’enracinement du néolibéralisme dans les sociétés africaines, ce sans-gêne ne s’embarrasse d’aucun principe régulateur autre que le lucre. Démesurément ambitieux, n’ayant pour unique maître que l’instinct, le Calliclès africain de l’époque postcoloniale montre une parfaite insolence à l’égard des grandes figures de la pensée, de la morale, de l’histoire, de la tradition. Son goût immodéré pour l’argent issu de la corruption et du crime fait de ce nouveau sujet un homo venalis. Disciple de R. Rorty et de F. V. Hayek, il identifie sans honte ses intérêts particuliers d’élite indigène servile à ceux de l’oligarchie capitaliste mondiale9.
En tant que forme spécifique de créativité, l’art africain « postcolonial » relaie les besoins de cette nouvelle classe de fripons apparue dans les années 1990. Ce temps, il faut le rappeler, fut celui de l’application des sévères mesures d’ajustement structurel à l’Afrique noire. Les conséquences de cet imperium du marché guidé par les règles de la gouvernance d’entreprise furent désastreuses : disparition du faible tissu industriel construit aux premières heures des indépendances ; montée exponentielle du chômage ; déflations dans la fonction publique ; privatisation des grandes entreprises d’État et des services publics de transport, d’eau, d’électricité, de santé, d’éducation ; écrasement du monde paysan ; augmentation vertigineuse du prolétariat urbain ; paupérisation massive aggravée par une explosion démographique sans précédent dans l’histoire du continent depuis les grandes déportations de l’époque esclavagiste ; creusement abyssal des inégalités sociales et économiques. Consécutivement à ces chocs douloureux, les restructurations de la conscience furent phénoménales, la face postcoloniale se voulant la plus marquante.
Or, nous semble-t-il, des formes d’imaginations africaines de soi différentes sont opposables à cette créativité atomisée. Pour une part, elles puisent leur pouvoir instituant dans la fin de non-recevoir adressée par la raison et les peuples à la pléonexie, cette plaie de l’âme que Platon abhorrait de toutes ses forces. Elles renouent par ailleurs avec la grande invite faite aux peuples opprimés par F. Fanon, celle de « sortir de la nuit » du capitalisme impérial (Fanon, 2002)10. Il s’agit de la tâche urgente pour les arts et les cultures d’Afrique, du préalable au renouvellement des vies africaines. Cette tâche utopique se résout dans une vision cosmétique (cosmos/esthétique) du monde qui, non seulement rendra de nouveau l’œil africain sensible à la beauté du diamant bien plus qu’à son utilité économique (Marx, 1996), mais encore rendra-t-elle belle la vie africaine, c’est-à-dire libre, épanouissante, équilibrée et puissante.
Vers un monde rééquilibré
Cette étude sur les imaginations esthétiques et les formations culturelles dans l’Afrique noire contemporaine est sous-tendue par une thèse fondamentale. Elle est la suivante : l’imagination culturelle dite « postcoloniale » est la forme d’inventivité propre aux sociétés néocoloniales de l’époque néolibérale ; elle accompagne et légitime au niveau de la conscience africaine la phase actuelle d’insertion violente de l’Afrique dans le marché mondial.
De cette thèse découle trois affirmations capitales.
La première est que le flottement de la culture-monde contemporaine correspond aux formes déterritorialisées et anonymes du capitalisme multinational de la fin du XXe siècle ; ce flottement culturel signe une forme spécifique, mais non moins brutale, d’hégémonisme incarné par l’Empire (euro-nippo-américain) : multiculturel, d’apparence cosmopolite et riche en opportunités individuelles et en destruction des structures collectives, il représente, aux yeux de ses idéologues, la nouvelle figure de l’Esprit (Mbembe, 2010 : 45). Il s’ensuit – c’est la deuxième grande affirmation – que le flottement d’une partie de l’Afro-culture contemporaine ratifie la nature débridée et subalterne des régimes d’exploitation capitalistes en vigueur dans les nations de la périphérie ; à travers la notion « d’hybridité », l’art postcolonial africain consacre l’insertion clandestine de l’Afrique dans la modernité. En troisième lieu, et comme conclusion finale, une telle réinsertion frangée de l’Afrique dans le monde moderne n’est aucunement envisageable pour les philosophies et esthétiques africaines de la liberté. Pour ces systèmes de la liberté, la réémergence au monde de l’Afrique, avec en prime la reformulation de ses arts et de ses cultures, n’est possible que par l’effort de clarification et d’unification de sa conscience (Nkrumah, 1976). C’est le point de départ en vue de la constitution de l’Afrique comme centre autonome de civilisation et de culture (Towa, 2010). Seul un replacement collectif11des énergies créatives africaines dans l’optique de synthèses culturelles neuves est à même de dépasser la fausse et coloniale opposition de l’ancien et du nouveau, du Soi et de l’Autre, de l’Afrique et du monde, de l’art et de la vie. La production sculpturale d’Ousmane Sow porte symboliquement l’empreinte de cette vision utopique.
L’orientation qu’on y donne épouse la dynamique heuristique de notre ouvrage, composé de quatre chapitres. Le chapitre I donne un aperçu global des questions traitées dans le volume, avec un trait particulier sur les différentes ruptures esthétiques et culturelles qui ont marqué l’évolution de la sensibilité esthétique occidentale. Le chapitre II prend en charge l’une des figures canoniques du poststructuralisme, M. Foucault, et étudie les réappropriations et réadaptations esthétisantes dont sa pensée fut l’objet dans des cercles africains hantés par la question des « épistémologies du Sud » et des « savoirs locaux » ; il aborde la problématique du récit, de la narration, de l’invention, bref de l’esthétisation du discours des sciences sociales africaines contemporaines. Le chapitre III traite du thème de l’obscénité et de la vulgarité dans les œuvres d’art de l’Afrique noire postcoloniale et, à partir des écrits d’A. Césaire et de F. Fanon, conclue sur les faibles possibilités créatives et émancipatrices du grotesque en Afrique. Le chapitre IV, enfin, clôt la discussion par un questionnement sur le lien essentiel entre culture et libération ; il permet, par une ré-exploration des vues d’A. Césaire et de M. Towa, d’invalider la thèse cosmopolite, en réalité ségrégationniste, de l’hybridité culturelle présentée comme solution à la crise des arts et des cultures de l’Afrique contemporaine et du monde. Ce chapitre parle – comme l’ensemble du livre – d’un monde rééquilibré, de développement pacifique et de prospérité partagée pour un destin commun entre l’Afrique et le monde12.
1 En Afrique, comme dans le monde, le système de l’art et de la culture obéit désormais au principe de la liquéfaction typique de la matière aqueuse.
2 Plus qu’une disposition temporelle fondée sur des référents chronologiques, le terme « postcolonie » inventée par A. Mbembe (A. Renaut, 2009 : 174) renvoie à la trajectoire historique spécifique des peuples récemment sortis de l’expérience coloniale, et dont le régime propre est la production incontinente de l’impudeur.
3 Nous devons à Flora Amabiamina une excellente synthèse sur le thème du pittoresque dans le roman postcolonial africain de Yambo Ouologuem, Sony Labou Tansi, Alain Mabanckou, Léonora Miano, etc. (Amabiana, 2015 : 122-153).
4 C’est la perspective défendue par Garvey, Nkrumah, Césaire, Fanon, Cabral et Towa.
5 Ainsi en est-il de ce que certains présentent comme la « dérive pornographique » dans les arts africains. La réduction du désir à la sexualité et la réduction de la sexualité elle-même au rapport sexuel, c’est-à-dire à la satisfaction de la simple impulsion biologique est, en des traits forts, le schéma des musiques populaires africaines contemporaines.
6 La tradition attribue la paternité de cette « Société des ambianceurs et des personnes élégantes » (Sape) au chanteur Papa Wemba (1949-2016). L’élégance masculine y est célébrée dans la surenchère vertigineuse des marques prestigieuses.
7 L’étude des productions culturelles traditionnelles des peuples fang, moundang, peuhl, bamiléké, bamoun de l’Afrique centrale serait susceptible d’éclairer ce point.
8 Nous pensons surtout à W. Benjamin, L. Goldmann et H. Lefebvre. Expurgés de leur gangue foucaldienne, les travaux d’A. Gramsci sur la force révolutionnaire de la culture seraient à réexplorer.
9 La distinction entre les options « postcoloniale » et « néocoloniale » se produit à ce niveau : l’une avalise le nouvel ordre oligarchique mondial avec son humanisme déflaté (l’Empire), tandis que l’autre le combat au nom de la parfaite égalité réelle des femmes, des hommes et des peuples.
10 Tout le sens de l’inversion produite par A. Mbembe apparaît ici. Par l’expression « sortir de la nuit », F. Fanon appelait le monde noir à recommencer une nouvelle histoire de l’homme, autrement dit à ne surtout pas produire un mimétisme obscène de l’Europe capitaliste par l’accélération des rythmes productifs. Usant de la même formule, Mbembe appelle, au contraire, à l’intensification de l’exploitation par la codification et la moralisation de l’exclusion économique et sociale sur le continent africain (Mbembe, 2000 : 92-93 ; Mbembe 2010 : 206).
11 C’est la question du panafricanisme.
12 La notion de « communauté de destin partagée pour l’humanité » a récemment été développée par les stratèges chinois, dans l’optique d’imprimer la reconfiguration de la globalisation vers davantage d’ouverture et d’égalité. Elle semble désormais admise par la communauté mondiale. Au moment où la Chine, la plus grande nation du Sud, se hisse à la puissance mondiale, Xi Jinping déclare : « Dans le monde d’aujourd’hui, tous les pays sont interdépendants et partagent un futur commun. Nous devons renouveler notre attachement aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies, construire un nouveau modèle de relations internationales dessinant une coopération mutuellement bénéfique, et créer une communauté de destin partagée pour l’humanité » (Xi, 2017 : 571). Les principes de ce nouvel ordre mondial sont : l’égalité entre les nations, la consultation extensive et la compréhension mutuelle, le respect de la souveraineté des nations et de leur intégrité territoriale, la non-interférence dans les affaires internes des nations, le droit pour chaque nation de suivre son propre modèle de développement et sa propre voie du progrès, le dialogue, la coopération, le partenariat, la non-confrontation. Ce monde est nécessairement harmonieux, beau, esthétique et écologique.
1
Mutations esthétiques et culturelles
Que ne suis-je pas né autre chose
Qu’un pauvre joueur de Mvet ? […]
Malgré tout oui malgré tout
J’accomplirai passionnément la mission ingrate
Que les Morts et les Dieux m’ont confiée
De divertir les hommes en les instruisant
(René Philombe)
Dès ses débuts entre le XVe et le XVIe siècle, la modernité cherche à répondre à la grande idée de civilisation portée par l’aristocratie et la bourgeoisie de l’Europe. L’art se trouve au cœur de cette idée qui fait du beau une dimension essentielle de l’œuvre de culture humaine et de polissage des mœurs. L’art européen donne la priorité au rationalisme, à l’universalisme des formes et à l’humanisme des constructions, tentant ainsi de produire, selon le vœu de Kant, Hegel et Baudelaire, la libre conciliation de la raison et du sentiment.
Or, après cinq siècles de progrès ininterrompu, l’esthétique postmoderniste brise cet équilibre au nom du principe de dé-civilisation. Sous l’impulsion d’A. Artaud, S. Beckett, G. Bataille, H. Pinter, G. Deleuze, M. Maffesoli, l’art exprime désormais le sauvage et le chaos qui gisent au fond d’une civilisation moderne désormais marquée du sceau de la folie, de la déraison, de la violence, de la mort, de la sexualité transgressive. Parallèlement à ce phénomène d’ensauvagement esthétique, l’art devient une pure marchandise. C’est ce dont témoigne l’œuvre d’A. Warhol complètement immergée dans l’univers de la publicité. Tout objet devient art. D’importantes mutations se produisent dans le monde esthétique. Elles soulèvent la question décisive du destin de l’art dans la civilisation marchande contemporaine. Sur le plan africain, l’esthétique « postcolonialiste » prolonge la quête postmoderniste du primitif en mettant l’accent sur la subalternité, l’obscénité et l’indétermination des formes culturelles africaines contemporaines. En interrogeant la nature fragmentée et hybride de la créativité africaine actuelle, ce sont véritablement les répercussions du capitalisme globalisé sur les arts du monde noir que nous analysons. Pour finir, il s’agit d’une réflexion critique sur les manifestations esthétiques du néolibéralisme dans les sociétés « postmodernes » et « postcoloniales » (Tonda, 2005).
I. Modernité esthétique et civilisation des mœurs
Avant toute discussion de fond sur la postmodernité et la postcolonialité, disons au préalable un mot sur la modernité esthétique. Les notions de raison, de sensibilité et de totalité constituent le cœur du projet moderne. En outre, historiquement la modernité s’est présentée comme un processus de civilisation des mœurs, mené sous la triple conduite de l’aristocratie, de la bourgeoisie commerçante et de la bourgeoisie industrielle.
1. Le rationalisme esthétique classique et l’esprit aristocratique européen
A la Renaissance, la rationalité s’impose comme le principe fondamental de l’art et de l’esthétique. Sous les formes excentriques du baroque, la raison dicte en réalité ses règles. Cela n’échappe pas à L. de Vinci qui lie raison et beauté, connaissance et contemplation du monde. Pour le génial esprit, la pénétration rationnelle de la nature n’est légitime que si l’œil et le sens humains accèdent à la jouissance et au plaisir procurés par la contemplation esthétique du monde. Le projet scientifique trouve sa validation propre dans l’intention esthétique qui l’anime secrètement. Si l’ignorance et la superstition sont si méprisables, c’est bien parce que, tranche L. de Vinci, elles sont laides. L’enjeu sous-jacent au savoir ne peut dès lors se limiter au simple pouvoir, c’est-à-dire à la pure domination technique et matérielle du monde1 ; il s’étend à la possibilité offerte à l’homme d’apprécier sous l’angle de la qualité et de la forme les objets qui tombent sous son empire. L. de Vinci exalte la finalité esthétique de la connaissance scientifique, l’union gracieuse de la logique et de l’esthétique. Sur un ton solennel, il déclare : « Aux ambitieux que ni le don de la vie ni la beauté du monde ne préoccupent, il est imposé comme châtiment qu’ils gaspillent la vie et ne possèdent ni les avantages ni la beauté du monde » (Vinci, 1942 : 15 ». Convaincu que « l’amour de quoi que ce soit est issu de la connaissance » (Vinci, 1942 : 55), l’Italien prodigue ce conseil serein : « Observe la lumière et considère sa beauté » (Vinci, 1942 : 27).
Au siècle suivant, le projet cartésien de réformation de la pensée formule un idéal similaire relatif à la dimension esthétique de la connaissance scientifique. En assimilant l’anarchie architecturale et urbanistique des villes allemandes du XVIIe siècle au désordre de l’esprit qui se conduit sans règle et sans discipline, R. Descartes laisse entendre que le discours de la méthode est indissociable d’un principe du bon goût (Descartes, 1997). Ce qui caractérise le classicisme, c’est la soumission des œuvres d’art aux lois strictes de la raison, cette dernière étant rapportée aux principes d’ordre, de cohérence, de mesure, de proportion, d’égalité, de moralité. Pour l’époque classique, l’art et la science partagent un répertoire topologique commun fondé sur la mobilisation des lois objectives et universelles de la pensée. Plus encore, l’artiste, obéissant aux lois logiques de la pensée, agit à la manière d’un ingénieur. Ce n’est sans doute pas un hasard si le génie universel de L. de Vinci, par exemple, recouvrait des domaines de l’esprit aussi divers que la philosophie, la science, l’art, la technique, l’ingénierie2.
Il importe néanmoins de se rappeler que loin d’être le résultat d’un développement abstrait de l’esprit, le rationalisme esthétique classique n’était lui-même qu’un aspect spécifique du processus social complexe par lequel les hommes d’Occident entreprirent, entre le XVIe et le XVIIe siècle, de s’affranchir des conduites impulsives et des attitudes spontanées au profit du raffinement et de la politesse. Ils se réclamaient d’un nouveau monde urbain, cosmopolite et humaniste, le monde de la civilisation et de la culture.
Ces hommes avaient cessé de s’identifier au Moyen-âge, à ses mœurs brutales et primitives, à son esprit de clocher, à son art gothique fade et peu disposé au renouvellement. Ainsi, les bâtisseurs des cathédrales de l’époque moderne naissante tentaient d’introduire dans leurs techniques de constructions les plus récentes découvertes de l’astronomie, de la physique, de l’alchimie, de la géométrie ou de la philosophie. Ils se voulaient libres, affranchis du vieux carcan médiéval, et résolument tournés vers la raison et la fraternité humaine en tant que valeurs humaines universelles. Professant la tolérance et le sécularisme, certains se disaient francs-maçons. Alors que sur le plan politique, le roi imposait aux quelques féodalités encore rebelles le pouvoir unificateur et centralisateur de l’État, la puissance économique des noblesses médiévales s’écroulait au profit d’une nouvelle classe d’aristocrates de cour. Curialisée, voire domestiquée par la monarchie, l’ancienne noblesse guerrière se montrait dorénavant docile et courtoise. C’est ainsi que se produisit dans la modernité naissante une modification drastique de l’économie psychologique, philosophique, scientifique, affective, esthétique et culturelle des hommes en faveur de la retenue et de la conduite rationnelle fondée sur la réflexion (Elias, 1973 ; Elias, 1985). L’aristocratie servait désormais de pointe au progrès historique. Elle incarnait le besoin impérieux de nouveauté et de mode. La modernité se définissait par l’innovation incessante (Lipovetsky, 1987).