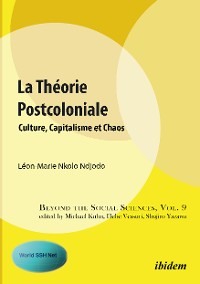Kitabı oku: «La Théorie Postcoloniale», sayfa 5
3. Primitivisme, néo-traditionalisme et exaltation techno-magique
Après avoir détruit la raison critique moderne au moyen de l’herméneutique, la pensée européenne pouvait tranquillement amorcer son tournant primitiviste. Assez paradoxalement, ce néo-traditionalisme s’effectue sous l’impulsion d’un poststructuralisme fasciné par le technicisme et qui, sur le plan esthétique, réconcilie les œuvres d’art avec l’univers de la folie et de la schizophrénie.
Au milieu du XXe siècle, A. Artaud dénonce, dans les accents les plus obscurs, l’ordre rationnel et civilisateur. Dramaturge nietzschéen, A. Artaud accorde au sauvage une place éminente. Pour cet artiste qui fit l’expérience terrible de l’effondrement psychique, le théâtre permet avant tout le déchaînement des instincts, la destruction de tout ordre, la transgression des interdits moraux, sociaux, religieux, philosophiques par la perversion et le déferlement sanglant de la violence crue. Le théâtre est une scène de cruauté qu’A. Artaud assimile à la peste, maladie hideuse et contagieuse, figure du Mal qui, au Moyen-âge, suscitait l’effroi et l’horreur (Artaud, 1964 : 44-45). La liste des dramaturges à avoir emprunté le chemin de l’ensauvagement du théâtre et du primitivisme esthétique, à la suite du tourmenté A. Artaud, est longue : S. Beckett, B. Wilson, H. Pinter, T. Stoppard, D. Reardon, D. Mercer, D. Edgar, etc. (Gauthier, 2002). Des poètes du surréalisme comme Apollinaire, Breton et Dali ou le grand cubiste Picasso s’engagèrent, eux aussi, dans cette rébellion de l’art contre la rationalité moderne.
Sur un plan purement philosophique, M. Foucault, qui marchait sur les traces d’A. Artaud, réhabilite la figure du fou à l’époque moderne. Il présente cette tranche historique comme le lieu d’une folie enfin libérée du carcan offert par le rationalisme classique. Dans l’Histoire de la folie à l’âge classique, les références de M. Foucault à l’œuvre de Nerval, Sade, Artaud, artistes de l’égarement de la raison, sont innombrables (Foucault, 1972). Son vibrant éloge de la folie se double d’une assimilation du processus de rationalisation moderne à des techniques punitives destinées au contrôle social (Foucault, 1975). Les sciences humaines, en particulier la psychiatrie, sont pourfendues par Foucault qui, par-là, met G. Deleuze et F. Guattari sur le chemin d’une raison déchue de son pouvoir royal. Chez ces penseurs, la critique de la modernité passe par une contestation des cadres de référence de la psychanalyse freudienne coupable, à leurs yeux, d’avoir opté pour la neutralisation de l’inconscient. En le libérant, en détraquant le désir, c’est la vie entière que G. Deleuze et F. Guattari entendent détraquer conformément à leur slogan : « Nous sommes des barbares » (Deleuze, Guattari, 1975). Philosophes de la dislocation, ils se reconnaissent dans les œuvres destructrices d’A. Artaud ou de S. Dali. En identifiant l’art au désir, G. Deleuze et F. Guattari visent à le rendre « machinique » en traçant, suivant le vœu de J.-F. Lyotard (1974), des configurations puissantes d’« intensités » de plaisir autonomes et complexes.
En réalité, de telles connexions, reconnexions et superpositions de jouissance trahissent la fascination des maîtres de subversion poststructuralistes pour le technicisme et les progrès de l’électronique, de l’informatique, de la robotique et même de la génétique. Ils raisonnent en termes de « programmations », de « logiciels », de « combinaisons » et d’« arrangements ». Ce n’est pas un hasard si l’un des thèmes favoris de la doxa poststructuraliste a toujours été l’exaltation d’une humanité cryogénique faite de sujets biotechnologiques téléchargeables sur les réseaux virtuels, des sujets interchangeables, ré-incarnables, voguant à une vitesse supersonique d’une galaxie à une autre et enjambant les univers. L’idée d’une méga-machine dotée d’une conscience universelle et d’un pouvoir d’action illimitée en termes de prévision, d’anticipation ou de projection dans des univers parallèles, ou même de pénétration de l’esprit humain à des fins de manipulation des gens, participe de cette aura techno-magique du poststructuralisme. La pensée postmoderne consacre cette volonté techniciste (Nkolo Foé, 2008 : 131)11. Le lancement par le cinéma hollywoodien de la saga des Stars Wars, dans les années 1970, accrédite pleinement cette nouvelle imagination culturelle préoccupée par le mariage insolite de la magie et de la technologie12. Une civilisation virtuelle émerge fondée sur la puissance des images et le règne du superficiel.
4. Plateaux postmodernes
Dans le second tome de Capitalisme et schizophrénie (1980), G. Deleuze et F. Guattari entonnent un hymne à la surface tout en se montrant allergiques à l’idée moderne de profondeur avec ses corrélats de l’essence, du sens, du concept, de l’authenticité (Jameson, 1991 : 49-60). Le goût postmoderne pour les surfaces et les modèles esthétiques errants, intensifs et schizophréniques provient de cette méfiance marquée du poststructuralisme pour l’intérieur des êtres. Superficiels, types particuliers d’écriture, les modèles esthétiques postmodernes répliquent l’univers du marketing des signes et des logos publicitaires, des marques et des griffes commerciales, des modes éphémères (Lipovetsky, 1983 ; Vattimo, 1985).
Or, écriture composée de signifiants vides (Barthes, 1953 et 1972), les textes culturels postmodernes renvoient à de pures images vierges de contenu (Fulchignoni, 1972). Dans le contexte cybernétique actuel d’éclipse de la nature et de disparition du référent, ces images sont privées de tout ancrage historique. Pour autant, le postmodernisme n’est pas un anhistoricisme ; il développe plutôt une vision déformée de l’histoire réduite en tas de fragments et transformée en flashs archaïques. Parfois, cet archaïsme n’est pas dénué de comique – comme dans Les Visiteurs magistralement joués par Jean Reno et Christian Clavier. Lorsqu’elle met en scène, comme dans Avatar, un héros extraterrestre se dressant contre l’injustice au confluent d’univers spatio-temporels parallèles, la régression archaïque postmoderne prend une forme tragique. Privé de cohérence et d’objectivité, le sujet postmoderne dés-historicisé occupe des « positions » changeantes (Foucault, 1969), habite des « lieux » fluctuants (Deleuze, 1967 : 299-335). La migration géographique sert de marqueur identitaire évanescent pour ce sujet anarchique et topologique (Eboussi Boulaga, 2005 : 9-17)13.
Les géographies nomades sont, du fait de leur virtualité, un cadre excellent d’échange des textes, des paratextes et intertextes culturels postmodernes (Aliana, 2015 ; Ondoua, 2016). Digitalisé et sans frontières fixes, l’espace virtuel postmoderne forme un « hyperespace » (Jameson, 1991) labile et fluide saturé de milliers d’applications informatiques (whatsapp, Youtube, imo, viber, twitter, instagram…) avec leur flot ininterrompu d’émoticônes. Dans ces univers abstraits qui sont ceux des Pokémons entretenus par le quatuor GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazone)14, l’inventivité, la créativité et le goût rationnellement construit sont remplacés par la satisfaction instinctive, intensive et schizophrénique. Conformément au vieux principe de Cl. Lévi-Strauss sur le travail du chercheur, l’artiste postmoderne pratique bel et bien le bricolage (Lévi-Strauss, 1974). Obéissant à la loi de la fragmentation, il ne se préoccupe ni de l’œuvre, ni du chef-d’œuvre, ni du style. Une question surgit pourtant : à quelle logique économique et sociale répond le bricolage esthétique postmoderne ?
5. La logique culturelle du capitalisme tardif
La modernité avait tracé pour l’art et la culture une sphère propre, autonome, pure, où l’esprit pouvait paisiblement s’occuper de beauté, de vérité et de liberté, loin du tumulte du monde. L’art et la culture appartenaient, par conséquent, au monde de l’esprit rationnel poursuivant les fins dernières, au monde de l’idéalité, ce monde ne pouvant être confondu avec celui des basses affaires humaines régi par les égoïsmes, les passions financières, le profit économique. Le postmodernisme renverse ce postulat de la nature spirituelle, rationnelle et autonome de l’art. Au nom de la délégitimation, les œuvres d’art gagnent l’univers prosaïque de la marchandise pour devenir des produits de consommation courante proposés à un public de consommateurs culturels. La marchandisation de l’art et de la culture est le trait véritablement distinctif de la postmodernité (Jameson, 1991 : 22). Il s’agit de l’époque au cours de laquelle la valeur d’usage des œuvres d’art, leur signification humaine, disparaît complètement au profit de leur valeur d’échange, leur signification marchande15. C’est l’ère de la marchandise comme unique forme culturelle.
Un tel déclassement de la valeur d’usage de l’objet n’a pu se produire qu’à une époque, les années 1960-1970, où le capitalisme devenu multinational, avait pu enfin s’affranchir des contraintes imposées par l’État-nation, réalisant par conséquent la colonisation par le marché de la totalité de l’espace économique et social. K. Polanyi a bien étudié ce processus d’absorption de la société par le marché débuté dans l’Angleterre industrielle des années 1830, et qui s’était accompagné de la rétrogradation brutale des autres formes de l’échange humain, comme le don ou le troc, au bénéfice de l’échange profitable. La compétition entre individus s’imposait comme la norme suprême au détriment d’autres formes de conduites telles que la coopération, le partage, l’altruisme, l’amour, l’amitié, la convivialité. De là naquit cette idée, capitale pour la compréhension de l’évolution des sociétés occidentales modernes, de la naturalité de l’échange marchand (Polanyi, 1983)16.
Après la Seconde Guerre mondiale, le capitalisme connut un nouvel essor fondé, cette fois-ci, sur la révolution informatique, numérique et communicationnelle. Cette révolution conférait un rôle croissant à la publicité et au marketing, tout en misant sur un nouveau mode de gestion managériale des entreprises (Deneault, 2013). Autrefois basé sur l’équilibre garanti par l’État entre capital et travail au sein de l’entreprise, le compromis fordiste était brusquement interrompu avec la fin des Trente Glorieuses et le déclin de l’État social. Libre de toute contrainte, devenu fluide, déterritorialisé et anonyme, le capital se mondialisait à une vitesse phénoménale. Le « nouvel esprit du capitalisme » dématérialisé, l’esprit de la finance internationale, se reconnaissait par la relance à des proportions inédites du processus de l’accumulation mondiale du capital (Amin, 1976 ; Chiapello et Boltansky, 1999). Il était apparu une nouvelle donne économique internationale régie par le libre-échange des biens, des informations, des services et des capitaux (Reich, 1993). Elle marquait la naissance du « capitalisme postmoderne » (Vakaloulis, 2001)17.
Des institutions internationales assuraient le bon fonctionnement de la nouvelle architecture économique mondiale : FMI, BM, OMC, OCDE, BAD, etc. Elles veillaient à l’établissement de règles contraignantes sur la déréglementation, l’ouverture des marchés (capitaux, matières premières, marchandises, main-d’œuvre…), la suppression des barrières douanières et tarifaires à travers des traités de libre-échange (APE, AECG, CETA, TTIP…), la privatisation des assurances et des secteurs publics de la santé, de l’éducation, de l’eau, de l’énergie et des transports. Ces organisations internationales encourageaient la détaxation et la dés-imposition du capital, l’allongement des retraites, le prolongement de la durée du travail, l’affaiblissement sinon le démantèlement des syndicats. Elles promouvaient la baisse des charges sociales pour les entreprises, l’importation, tantôt illégale tantôt légale, de la main-d’œuvre immigrée, la contractualisation généralisée du travail, la flexibilisation des parcours académiques et professionnels (LMD)18, la juridicisation intégrale des rapports sociaux, le redéploiement de l’État vers des missions de surveillance et de police (Cohen-Tanuggi, 1985 ; Zaki, 2004). Sur le plan politique, ces organisations internationales préconisaient la « bonne gouvernance », le respect des « droits de l’homme », la « démocratie », la montée de la « société civile19 ». Du point de vue des mœurs et des habitudes culturelles, elles veillaient au respect des « minorités » et des « modes de vies » alternatifs (Onana Bekada, 2015 : 240-255).
C’est donc dans ce contexte général d’hégémonie mondiale du capitalisme financier que l’artiste contemporain exerce sa créativité. Guidé avant tout par le profit, il rompt avec l’idéalisme esthétique moderne pour réaliser la jonction de l’art et du marché. Les œuvres d’A. Warhol expriment bien ce mélange des univers de la création et du commerce. De fait, « la production esthétique s’est de nos jours intégrée à la production des marchandises en général… » (Jameson, 1991 : 37). Impliqué dans un ensemble de structures institutionnelles (gouvernements, fondations, mécènes, entreprises, bourses de valeurs), l’art appartient désormais au cycle économique de la consommation. On consomme des œuvres d’art, des livres par exemple, comme on consomme des confiseries ; la culture se vend et s’achète au centre commercial (Baudrillard, 1970 : 18-22).
Au fond, le postmodernisme parachève le processus de décomposition marchande de l’art entamé dans la seconde moitié du XXe siècle. T. Adorno expliquait cette décomposition par l’industrialisation massive de la culture avec pour conséquence l’introduction de l’art dans une zone grise hostile aux identifications ou aux oppositions art/non-art, beau/laid, culture d’élite/culture de masse (Adorno, 1989). Ce populisme esthétique typique de la société administrée contaminait même l’univers de la mode, le génie d’un couturier comme Y. Saint-Laurent ayant consisté pour l’essentiel à casser les codes de la Haute Couture en ramenant l’art dans la « rue » (Lipovetsky, 1987). Le postmodernisme tire les plus grandes conséquences de cet abaissement culturel sur fond de méfiance à l’égard des styles, des écoles et des avant-gardes artistiques du modernisme20. Dans la phase financière de son développement, le capitalisme traite les œuvres d’art comme des actions et des titres cotés en bourse. En définitive, le postmodernisme, c’est la « logique culturelle du capitalisme tardif » : l’expression culturelle, esthétique et idéologique spécifique au stade suprême de la mondialisation du capitalisme, la phase financière (Jameson, 1991)21.
Reflet du capital financier disséminé, le postmodernisme affiche une esthétique fragmentée, désarticulée et aléatoire orientée vers le dégradé, le kitsch22. Sceptique à l’égard de tout projet politique alternatif global au capitalisme, il cultive la haine de la révolution sociale et lui préfère les « transformations locales » et les « transformations partielles » (Foucault, 2008). En réalité, l’anti-utopisme postmoderne n’est qu’un néo-utopisme libertaire parfaitement adapté aux besoins de la société mondiale de consommation (Nkolo Foé, 2008 ; Clouscard, 2009 ; Dufour, 2011). En Afrique, et dans le Tiers-monde en général, ce libertarisme favorable à la globalisation porte un nom : le « postcolonialisme ».
III. Le palimpseste culturel postcolonial
Dans le sens de la reproduction des systèmes-mondes, le postcolonialisme est l’avatar du postmodernisme dans les pays sous-développés de la périphérie capitaliste23. La théorie postcoloniale sollicite les idéologies de la différence logique, historique et culturelle, combinant critique de la modernité « eurocentrique » et éloge de la globalisation ultralibérale vectrice de métissage culturel. En Afrique noire, le discours postcolonial exalte les catégories sociales « marginalisées » (femmes, enfants, fous, vagabonds, brigands, prisonniers, paysans), les formes de vie « minoritaires » (cultures LGBT). Sur le plan esthétique, il opte pour le régime de l’impudeur.
1. Le régime de l’impudeur
Le régime impudique de l’art africain contemporain débute dans la littérature africaine des années 1970-1980 autour des figures à l’instar de Y. Ouologuem, A. Kourouma et S. Labou Tansi (Nkolo Ndjodo, 2015 : 48-103). Ces derniers inaugurent, en Afrique noire, le courant de l’art honteux dont l’écrivain, romancier et poète congolais, A. Mabanckou, est un des grands héritiers24.
Mémoires d’un porc-épic livre le récit truculent d’un porc-épic, double nuisible d’un homme, dont il se charge de réaliser les basses œuvres : meurtres, empoisonnements, envoûtements, etc. A. Mabanckou malmène la phrase, fait exploser les règles de la syntaxe. Son style incontinent se veut éruptif. Mais à la différence d’A. Césaire qui était animé par une profonde vision utopique, l’écriture d’A. Mabanckou sécrète la vulgarité par jets incessants. Les procédés narratifs se tordent sous l’implacable loi de l’indécence. L’anti-héros, le porc-épic, double nuisible de Kibandi, prend plaisir aux jeux des autres animaux qui lui rappellent « ceux des humains, surtout lorsque ces anthropoïdes se distrayaient avec leurs crottes de nez, se grattaient les parties génitales, reniflaient par la suite leurs doigts avant d’exprimer aussitôt leur dégoût » (Mabanckou, 2006 : 20).
Sous une satire mordante de la religion chrétienne se glisse une pique obscène. Voici ce que voit le porc-épic dans la Bible :
[Des] paroles rapportées dans un gros livre que les hommes à la peau blanche ont amené ici à l’époque lointaine où les habitants de ce pays couvraient leur sexe ridicule à l’aide de peau de léopard ou de feuilles de bananiers et ignoraient que derrière l’horizon habitaient d’autres peuples différents d’eux, que le monde s’étendait aussi au-delà des mers et des océans (Mabanckou, 2006 : 21).
Une particularité forte de la littérature postcoloniale est l’art de moquer les Africains à partir de leurs traits physiques (le sexe, les fesses, l’anus) ou de leurs traits psychologiques, intellectuels et moraux (l’ignorance, la fourberie, la gourmandise, la concupiscence). Au cours de ses tribulations, le porc-épic ne manque pas de « secou[er] la poussière qui recouvrait [son] ventre et [son] derrière » (Mabanckou, 2006 : 38) ; il raille le « chimpanzé mâle et ses testicules qui pendouillent comme des gourdes pleines de vin de palme » (Mabanckou, 2006 : 41), sans oublier le grincheux gouverneur qui « détaillait comment [le porc-épic] déféquai[t] tout au long de la journée » (Mabanckou, 2006 : 55). A. Mabanckou décrit la puanteur excrémentielle de l’Afrique noire, royaume des pets, des défécations, des fellations, des éjaculations (Mabanckou, 2006 : 67, 103, 113, 126, 157). Cette Afrique puante aux « pets les plus sonores » doit être abandonnée. La fuite s’impose.
En quête d’une nouvelle utopie, le romancier se fait poète. Dans Tant que les arbres s’enracineront dans la terre, l’échappée hors du terroir crasseux démarre par un deuil inaugural, celui de la mère du poète. Cette mort symbolise la mort de l’Afrique-mère. Le poète décide alors de construire « la légende de l’errance » (Mabanckou, 2007 : 11), parce que, clame-t-il, « mon destin [est] celui d’un migrateur » (Mabanckou, 2007 : 11). Dans « Présages », le tout premier poème du recueil, A. Mabanckou vante le globalisme de l’abolition des frontières et de la contraction de l’espace, celui de l’enchevêtrement des mondes. Ce décloisonnement ne se réalise pas sans douleur :
La distance se dilue
dans la géographie de l’urgence
La douleur côtoie les eucalyptus
qui bordent les terres lointaines (Mabanckou, 2007 : 19).
L’errance implique une certaine souffrance due au départ, à l’abandon des racines qui ne plongent plus dans le sol natal. Le poète se lamente :
Voici la patrie toute nue
avec une lune rachitique
crucifiée au faîte de l’incertitude (Mabanckou, 2007 : 21).
Le soleil des nations a pâli ; celles-ci ne forment plus que des monuments sombres du passé, des poussières épaisses de l’histoire en passe de céder la place au mobilisme universel des êtres apatrides et des communautés exiliques :
La patrie toute nue
au pied de la mémoire
De loin, son ombre esseulée qui avance
jusqu’à la frontière de l’errance
Elle bute encore contre le gypse coriace de l’amnésie (Mabanckou, 2007 : 22).
La patrie africaine n’est plus qu’un souvenir triste à chasser de la mémoire de ses fils. Il faut hâter le mouvement vers l’horizon infini, il faut marcher et ne point s’arrêter :
Marcher
La halte est à mille lieux d’ici (Mabanckou, 2007: 30).
L’Afrique, patrie nue, est une « somme de semailles dévastées », « un amas de pierres » rocailleuses, des vents qui tourbillonnent, une terre dédaignée par les pluies, frappée par l’avarice des saisons (Mabanckou, 2007 : 32-34). Pays maudit, l’Afrique est peuplée de silhouettes, d’ombres, de squelettes. Infinie est l’amertume de ses fils :
Et ces silhouettes debout
ombres parmi les ombres
…
Ces silhouettes qui défilent
ombres après ombres
…
Ces voix nocturnes dans les buissons
Ces troupeaux de cerfs
Qui brament le long de la rivière
Ces squelettes de passereaux
qui se raccrochent désespérément sur les fils barbelés
Toutes ces silhouettes
ombres après ombres
Voici la patrie toute nue (Mabanckou, 2007 : 35-37).
A ces formes sorties du temps de l’Apocalypse, semble-t-il, le poète préfère la douleur de l’exil. Comme sa propre mère traversant les glaçantes et silencieuses prairies de la mort, il rompt tout lien avec le terroir originel, il brise la chaine des généalogies. Il s’écrie :
Un tonnerre s’est abattu sur la crête de l’arbre
Généalogique
Tu as plié un genou
puis l’autre… (Mabanckou, 2007 : 73)
Violemment opposé au retour césairien au pays natal, Mabanckou, l’être de la transhumance, mime F. Fanon :
Et puis je repartirai
Je marcherai dans la forêt
J’écarterai les lianes sèches
pour déboucher sur une clairière
…
Je marcherai
Je m’arrêterai de temps à autre
devant une pierre
pour affiner ma solitude épuisée
…
Je marcherai le jour
Je marcherai la nuit
J’irai
…
Ainsi soit-il… (Mabanckou, 2007 : 82-86)25
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.