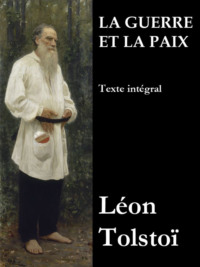Kitabı oku: «La Guerre et la Paix (Texte intégral)», sayfa 27
XV
À huit heures du matin, Koutouzow se rendit à cheval à Pratzen, à la tête de la quatrième colonne, celle de Miloradovitch, qui allait remplacer les colonnes de Prsczebichewsky et de Langeron descendues dans les bas-fonds. Il salua les soldats du premier régiment et donna l’ordre de se mettre en marche, montrant par là son intention de commander en personne. Il s’arrêta au village de Pratzen. Le prince André, excité, exalté, mais calme et froid en apparence, comme l’est généralement un homme qui se sent arrivé au but ardemment désiré, faisait partie de la nombreuse suite du général en chef. La journée qui commençait serait, il en était sûr, son Toulon ou son pont d’Arcole. Le pays et la position de nos troupes lui étaient aussi connus qu’ils le pouvaient être à tout officier supérieur de notre armée; quant à son plan stratégique, inexécutable à présent, il l’avait complètement oublié. Suivant en pensée le plan de Weirother, il se demandait, à part lui, quels seraient les coups du hasard et les incidents qui lui permettraient de mettre en évidence sa fermeté et la rapidité de ses conceptions.
À gauche, au pied de la montagne, dans le brouillard, des troupes invisibles échangeaient des coups de fusil. «Là, se disait-il, se concentrera la bataille, là surgiront les obstacles, et c’est là, qu’on m’enverra avec une brigade ou une division, et que, le drapeau en main, j’avancerai, en culbutant tout sur mon passage!» si bien qu’en voyant défiler devant lui les bataillons, il ne pouvait s’empêcher de se dire: «Voici peut-être justement le drapeau avec lequel je m’élancerai en avant!»
Sur le sol s’étendait un givre léger, qui fondait peu à peu en rosée, tandis que dans le ravin tout était enveloppé d’un brouillard intense; on n’y voyait absolument rien, surtout à gauche, où étaient descendues nos troupes et d’où partait la fusillade. Le soleil brillait de tout son éclat au-dessus de leurs têtes, dans un ciel bleu foncé. Au loin devant elles, sur l’autre bord de cette mer blanchâtre, se dessinaient les crêtes boisées des collines; c’était là que devait se trouver l’ennemi. À droite, la garde s’engouffrait dans ces vapeurs, ne laissant après elle que l’écho de sa marche; à gauche, derrière le village, des masses de cavalerie s’avançaient pour disparaître à leur tour. Devant et derrière s’écoulait l’infanterie. Le général en chef assistait au défilé des troupes à la sortie du village: il avait l’air épuisé et irrité. L’infanterie s’arrêta tout à coup devant lui, sans en avoir reçu l’ordre, évidemment à cause d’un obstacle qui barrait la route à sa tête de colonne:
«Mais dites donc enfin qu’on se fractionne en bataillons et qu’on tourne le village, dit Koutouzow sèchement au général qui s’avançait. Comment ne comprenez-vous pas qu’il est impossible de se développer ainsi dans les rues d’un village quand on marche à l’ennemi?
– Je comptais précisément, Votre Excellence, me reformer en avant du village.»
Koutouzow sourit aigrement.
«Charmante idée vraiment que de développer votre front en face de l’ennemi!
– L’ennemi est encore loin, Votre Haute Excellence. D’après la disposition…
– Quelle disposition? S’écria-t-il avec colère. Qui vous l’a dit?… Veuillez faire ce que l’on vous ordonne.
– J’obéis, dit l’autre.
– Mon cher, dit Nesvitsky à l’oreille du prince André, le vieux est d’une humeur de chien.»
Un officier autrichien, en uniforme blanc avec un plumet vert, aborda en ce moment Koutouzow et lui demanda, de la part de l’Empereur, si la quatrième colonne était engagée dans l’action.
Koutouzow se détourna sans lui répondre; son regard tombant par hasard sur le prince André, il s’adoucit, comme pour le mettre en dehors de sa mauvaise humeur.
«Allez voir, mon cher, lui dit-il, si la troisième division a dépassé le village. Dites-lui de s’arrêter et d’attendre mes ordres, et demandez-lui, ajouta-t-il en le retenant, si les tirailleurs sont postés et ce qu’ils font… ce qu’ils font?» murmura-t-il, sans rien répondre à l’envoyé autrichien.
Le prince André, ayant dépassé les premiers bataillons, arrêta la troisième division et constata en effet l’absence de tirailleurs en avant des colonnes. Le chef du régiment reçut avec stupéfaction l’ordre envoyé par le général en chef de les poster; il était convaincu que d’autres troupes se déployaient devant lui et que l’ennemi devait être au moins à dix verstes. Il ne voyait en effet devant lui qu’une étendue déserte, qui semblait s’abaisser doucement et que recouvrait un épais brouillard. Le prince André revint aussitôt faire son rapport au général en chef, qu’il trouva au même endroit, toujours à cheval et lourdement affaissé sur sa selle, de tout le poids de son corps. Les troupes étaient arrêtées, et les soldats avaient mis leurs fusils la crosse à terre.
«Bien, bien,» dit-il.
Et se tournant vers l’Autrichien, qui, une montre à la main, l’assurait qu’il était temps de se remettre en marche, puisque toutes les colonnes du flanc gauche avaient opéré leur descente:
«Rien ne presse, Excellence, dit-il en bâillant… Nous avons bien le temps!»
Au même moment, ils entendirent derrière eux les cris des troupes, répondant au salut de certaines voix, qui s’avançaient avec rapidité le long des colonnes en marche. Lorsque les soldats du régiment devant lequel il se tenait crièrent à leur tour, Koutouzow recula de quelques pas et fronça le sourcil. Sur la route de Pratzen arrivait au galop un escadron de cavaliers de diverses couleurs, dont deux se détachaient en avant des autres; l’un, en uniforme noir, avec un plumet blanc, montait un cheval alezan à courte queue; l’autre, en uniforme blanc, était sur un cheval noir. C’étaient les deux empereurs et leur suite. Koutouzow, avec l’affectation d’un subordonné qui est à son poste, commanda aux troupes le silence, et, faisant le salut militaire, s’approcha de l’Empereur. Toute sa personne et ses manières, subitement métamorphosées, avaient pris l’apparence de cette soumission aveugle de l’inférieur, qui ne raisonne pas. Son respect affecté sembla frapper désagréablement l’empereur Alexandre, mais cette impression fugitive s’effaça aussitôt, pour ne laisser aucune trace sur sa jeune figure, rayonnante de bonheur. Son indisposition de quelques jours l’avait maigri, sans rien lui faire perdre de cet ensemble réellement séduisant de majesté et de douceur, qui se lisait sur sa bouche aux lèvres fines et dans ses beaux yeux bleus.
S’il était majestueux à la revue d’Olmütz, ici il paraissait plus gai et plus ardent. La figure colorée par la course rapide qu’il venait de faire, il arrêta son cheval, et, respirant à pleins poumons, il se retourna vers sa suite aussi jeune, aussi animée que lui, composée de la fleur de la jeunesse austro-russe, des régiments d’armée et de la garde. Czartorisky, Novosiltsow, Volkonsky, Strogonow et d’autres en faisaient partie, et causaient en riant entre eux. Revêtus de brillants uniformes, montés sur de beaux chevaux bien dressés, ils se tenaient à quelques pas de l’empereur. Des écuyers tenaient en main, tout prêts pour les deux souverains, des chevaux de rechange aux housses brodées. L’empereur François, encore jeune, avec le teint vif, maigre, élancé, raide en selle sur son bel étalon, jetant des regards anxieux autour de lui, fit signe à un de ses aides de camp d’approcher. «Il va sûrement lui demander l’heure du départ,» se dit le prince André, en suivant les mouvements de son ancienne connaissance. Il se souvenait des questions que Sa Majesté Autrichienne lui avait adressées à Brünn.
La vue de cette brillante jeunesse, pleine de sève et de confiance dans le succès, chassa aussitôt la disposition morose dans laquelle était l’état-major de Koutouzow: telle une fraîche brise des champs, pénétrant par la fenêtre ouverte, disperse au loin les lourdes vapeurs d’une chambre trop chaude.
«Pourquoi ne commencez-vous pas, Michel Larionovitch?
– J’attendais Votre Majesté,» dit Koutouzow, en s’inclinant respectueusement.
L’Empereur se pencha de son côté comme s’il ne l’avait pas entendu.
«J’attendais Votre Majesté, répéta Koutouzow, – et le prince André remarqua un mouvement de sa lèvre supérieure au moment où il prononça: «j’attendais»… – Les colonnes ne sont pas toutes réunies, sire.»
Cette réponse déplut à l’Empereur; il haussa les épaules et regarda Novosiltsow, comme pour se plaindre de Koutouzow.
«Nous ne sommes pourtant pas sur le Champ-de-Mars, Michel Larionovitch, où l’on attend pour commencer la revue que tous les régiments soient rassemblés, continua l’Empereur, en jetant cette fois un coup d’œil à l’empereur François comme pour l’inviter, sinon à prendre part à la conversation, au moins à l’écouter; mais ce dernier ne parut pas s’en préoccuper.
«C’est justement pour cela, sire, que je ne commence pas, dit Koutouzow à haute et intelligible voix, car nous ne sommes pas à une revue, nous ne sommes pas sur le Champ-de-Mars.»
À ces paroles, les officiers de la suite s’entre-regardèrent. «Il a beau être vieux, il ne devrait pas parler ainsi,» disaient clairement leurs figures, qui exprimaient la désapprobation.
L’Empereur fixa son regard attentif et scrutateur sur Koutouzow, dans l’attente de ce qu’il allait sans doute ajouter. Celui-ci, inclinant respectueusement la tête, garda le silence. Ce silence dura une seconde, après laquelle, reprenant l’attitude et le ton d’un inférieur qui demande des ordres:
«Du reste, si tel est le désir de Votre Majesté?» dit-il.
Et appelant à lui le chef de la colonne, Miloradovitch, il lui donna l’ordre d’attaquer.
Les rangs s’ébranlèrent, et deux bataillons de Novgorod et un bataillon du régiment d’Apchéron défilèrent.
Au moment où passait le bataillon d’Apchéron, Miloradovitch s’élança en avant; son manteau était rejeté en arrière et laissait voir son uniforme chamarré de décorations. Le tricorne orné d’un immense panache posé de côté, il salua crânement l’Empereur en arrêtant court son cheval devant lui.
«Avec l’aide de Dieu, général! Lui dit celui-ci.
– Ma foi, sire, nous ferons tout ce que nous pourrons,» s’écria-t-il gaiement, tandis que la suite souriait de son étrange accent français.
Miloradovitch fit faire volte-face à son cheval et se retrouva à quelques pas en arrière de l’Empereur. Les soldats, excités par la vue du tsar, marchaient en cadence d’un pas rapide et plein d’entrain.
«Enfants! Leur cria tout à coup Miloradovitch, oubliant la présence de son souverain et partageant lui-même l’élan de ses braves, dont il avait été le compagnon sous le commandement de Souvarow… enfants! Ce n’est pas le premier village que vous allez enlever à la baïonnette!
– Prêts à servir,» répondirent les soldats.
À leurs cris, le cheval de l’Empereur, le même qu’il montait pendant les revues en Russie, eut comme un frisson d’inquiétude. Ici, sur le champ de bataille d’Austerlitz, surpris du voisinage de l’étalon noir de l’Empereur François, il dressait les oreilles au bruit inusité des décharges, sans en comprendre la signification, et sans se douter de ce que pensait et ressentait son auguste cavalier.
L’Empereur sourit, en désignant à un de ses intimes les bataillons qui s’éloignaient.
XVI
Koutouzow, accompagné de ses aides de camp, suivit au pas les carabiniers.
À une demi-verste de distance, il s’arrêta près d’une maison isolée, une auberge abandonnée sans doute, située à l’embranchement de deux routes qui descendaient toutes deux la montagne et qui étaient toutes deux couvertes de nos troupes.
Le brouillard se dissipait, et on commençait à distinguer les masses confuses de l’armée ennemie sur les hauteurs d’en face. On entendait un feu très vif à gauche dans le vallon. Koutouzow causait avec le général autrichien; le prince André pria ce dernier de lui passer la longue-vue.
«Voyez, voyez, disait l’étranger, voilà les Français!» Et il indiqua, non un point éloigné, mais le pied de la montagne qu’ils avaient devant eux.
Les deux généraux et les aides de camp se passèrent fiévreusement la longue-vue. Une terreur involontaire se peignit sur leurs traits: les Français, qu’on croyait à deux verstes, s’étaient dressés inopinément devant eux!
«C’est l’ennemi!… Mais non!… Mais certainement!… Comment est-ce possible?» dirent plusieurs voix…
Et le prince André voyait à droite monter à la rencontre du régiment d’Apchéron une formidable colonne de Français, à cinq cents pas de l’endroit où ils se tenaient.
«Voilà l’heure! Se dit-il… Il faut arrêter le régiment, Votre Haute Excellence!» À ce moment, une épaisse fumée couvrit tout le paysage, une forte décharge de mousqueterie retentit à leurs oreilles, et une voix haletante de frayeur s’écria à deux pas: «Fini, camarades, fini!…» Et, comme si un ordre émanait de cette voix, des masses énormes de soldats refoulés, se poussant, se bousculant, passèrent en fuyant, au même endroit, où, cinq minutes auparavant, ils avaient défilé devant les empereurs. Essayer d’arrêter cette foule était une folie, car elle entraînait tout sur son passage. Bolkonsky résistait avec peine au torrent et ne comprenait que vaguement ce qui venait d’arriver. Nesvitsky, rouge et hors de lui, criait à Koutouzow qu’il allait être fait prisonnier, s’il ne se portait pas en arrière. Koutouzow, immobile, tira son mouchoir et s’en couvrit la joue d’où le sang coulait. Le prince André se fraya un passage jusqu’à lui:
«Vous êtes blessé? Lui dit-il avec émotion.
– La plaie n’est pas là, mais ici!» dit Koutouzow, en pressant son mouchoir sur sa blessure et en désignant les fuyards.
«Arrêtez-les!» s’écria-t-il.
Mais, comprenant aussitôt l’inutilité de cet appel, il piqua des deux, et, prenant sur la droite au milieu d’une nouvelle troupe de fuyards, il se vit entraîné avec elle en arrière.
Leur masse était si serrée qu’il lui était impossible de s’en dégager. Dans cette confusion les uns criaient, les autres se retournaient et tiraient en l’air. Koutouzow, parvenu enfin à sortir du courant, se dirigea avec sa suite, terriblement diminuée, vers l’endroit d’où partait la fusillade. Le prince André, faisant des efforts surhumains pour le rejoindre, aperçut sur la descente, à travers la fumée, une batterie russe, qui n’avait pas encore cessé son feu et vers laquelle se précipitaient des Français. Un peu, au-dessus d’elle se tenait immobile l’infanterie russe. Un général s’en détacha et s’approcha de Koutouzow, dont la suite se réduisait à quatre personnes. Pâles et émues, ces quatre personnes se regardaient en silence.
«Arrêtez ces misérables!» dit Koutouzow au chef de régiment. Et, comme pour le punir de ces mots, une volée de balles, semblable à une nichée d’oiseaux, passa en sifflant au-dessus du régiment et de sa tête. Les Français attaquaient la batterie, et, ayant aperçu Koutouzow, ils tiraient sur lui. À cette nouvelle décharge, le commandant de régiment porta vivement la main à sa jambe; quelques soldats tombèrent, et le porte-drapeau laissa échapper le drapeau de ses mains: vacillant un moment, il s’accrocha aux baïonnettes des soldats; ceux-ci se mirent à tirer sans en avoir reçu l’ordre.
Un soupir désespéré sortit de la poitrine de Koutouzow.
«Bolkonsky, murmura-t-il d’une voix de vieillard affaibli et en lui montrant le bataillon à moitié détruit, que veut donc dire cela?»
À peine avait-il prononcé ces mots, que le prince André, le gosier serré par des larmes de honte et de colère, s’était jeté à bas de son cheval et se précipitait vers le drapeau.
«Enfants, en avant!» cria-t-il d’une voix perçante. «Le moment est venu!» se dit-il, en saisissant la hampe et écoutant avec bonheur le sifflement des balles dirigées contre lui. Quelques soldats tombèrent encore.
«Hourra!» s’écria-t-il, en soulevant avec peine le drapeau.
Et courant en avant, persuadé que tout le bataillon le suivait, il fit encore quelques pas; un soldat, puis un second, puis tous s’élancèrent à sa suite en le dépassant. Un sous-officier s’empara du précieux fardeau, dont le poids faisait trembler le bras du prince André, mais il fut tué au même moment. Le reprenant encore une fois, André continua sa course avec le bataillon. Il voyait devant lui nos artilleurs: les uns se battaient, les autres abandonnaient leurs pièces et couraient à sa rencontre; il voyait les fantassins français s’emparer de nos chevaux et tourner nos canons. Il en était à vingt pas, les balles pleuvaient et fauchaient tout autour de lui, mais ses yeux rivés sur la batterie ne s’en détachaient pas. Là, un artilleur roux, le schako enfoncé, et un Français se disputaient la possession d’un refouloir; l’expression égarée et haineuse de leur figure lui était parfaitement visible; on sentait qu’ils ne se rendaient pas compte de ce qu’ils faisaient.
«Que font-ils? Se demanda le prince André. Pourquoi l’artilleur ne fuit-il pas, puisqu’il n’a plus d’arme, et pourquoi le Français ne l’abat-il pas? Il n’aura pas le temps de se sauver, que le Français se souviendra qu’il a son fusil! En effet, un second Français arriva sur les combattants, et le sort de l’artilleur roux, qui venait d’arracher le refouloir des mains de son adversaire, allait se décider. Mais le prince André n’en vit pas la fin. Il reçut sur la tête un coup d’une violence extrême, qu’il crut lui avoir été appliqué par un de ses voisins. La douleur était moins sensible que désagréable, dans ce moment où elle faisait une diversion à sa pensée:
«Mais que m’arrive-t-il? Je ne me tiens plus? Mes jambes se dérobent sous moi.» Et il tomba sur le dos. Il rouvrit les yeux, dans l’espoir d’apprendre le dénouement de la lutte des deux Français avec l’artilleur, et si les canons étaient sauvés ou emmenés. Mais il ne vit plus rien que bien haut au-dessus de lui un ciel immense, profond, où voguaient mollement de légers nuages grisâtres. «Quel calme, quelle paix! Se disait-il; ce n’était pas ainsi quand je courais, quand nous courions en criant; ce n’était pas ainsi, lorsque les deux figures effrayées se disputaient le refouloir; ce n’était pas ainsi que les nuages flottaient dans ce ciel sans fin! Comment ne l’avais-je pas remarquée plus tôt, cette profondeur sans limites? Comme je suis heureux de l’avoir enfin aperçue!… Oui! Tout est vide, tout est déception, excepté cela! Et Dieu soit loué pour ce repos, pour ce calme!…»
XVII
À neuf heures du matin, au flanc droit, que commandait Bagration, l’affaire n’était pas encore engagée. Malgré l’insistance de Dolgoroukow, désireux de n’en point assumer la responsabilité, il lui proposa d’envoyer demander les ordres du général en chef. Vu la distance de dix verstes qui séparait les deux ailes de l’armée, l’envoyé, s’il n’était pas tué, ce qui était peu probable, et s’il parvenait à découvrir le général en chef, ce qui était très difficile, ne pourrait revenir avant le soir; il en était bien convaincu.
Jetant un regard sur sa suite, les yeux endormis et sans expression de Bagration s’arrêtèrent sur la figure émue, presque enfantine de Rostow. Il le choisit.
«Et si je rencontre Sa Majesté avant le général en chef, Excellence? Lui dit Rostow.
– Vous pourrez demander les ordres de Sa Majesté,» dit Dolgoroukow, en prévenant la réponse de Bagration.
Après avoir été relevé de sa faction, Rostow avait dormi quelques heures et se sentait plein d’entrain, d’élasticité, de confiance en lui-même et en son étoile, et prêt à tenter l’impossible.
Ses désirs s’étaient accomplis: une grande bataille se livrait; il y prenait part, et de plus, attaché à la personne du plus brave des généraux, il était envoyé en mission auprès de Koutouzow, avec chance de rencontrer l’Empereur. La matinée était claire, son cheval était bon. Son âme s’épanouissait toute joyeuse. Longeant d’abord les lignes immobiles des troupes de Bagration, il arriva sur un terrain occupé par la cavalerie d’Ouvarow; il y remarqua les premiers signes précurseurs de l’attaque; l’ayant dépassé, il entendit distinctement le bruit du canon et les décharges de mousqueterie, qui augmentaient d’intensité à chaque instant.
Ce n’était plus un ou deux coups solitaires qui retentissaient à intervalles réguliers dans l’air frais du matin, mais bien un roulement continu, dans lequel se confondaient les décharges d’artillerie avec la fusillade et qui se répercutait sur le versant des montagnes, en avant de Pratzen.
De légers flocons de fumée, voltigeant, se poursuivant l’un l’autre, s’échappaient des fusils, tandis que des batteries s’élevaient de gros tourbillons de nuages, qui se balançaient et s’étendaient dans l’espace. Les baïonnettes des masses innombrables d’infanterie en mouvement brillaient à travers la fumée et laissaient apercevoir l’artillerie avec ses caissons verts, qui se déroulait au loin comme un étroit ruban.
Rostow s’arrêta pour regarder ce qui se passait: où allaient-ils? Pourquoi marchaient-ils en tous sens, devant, derrière? Il ne pouvait le comprendre; mais ce spectacle, au lieu de lui inspirer de la crainte et de l’abattement, ne faisait au contraire qu’augmenter son ardeur.
«Je ne sais ce qui en résultera, mais à coup sûr ce sera bien,» se disait-il.
Après avoir dépassé les troupes autrichiennes, il arriva à la ligne d’attaque… C’était la garde qui donnait.
«Tant mieux! Je le verrai de plus près.»
Plusieurs cavaliers venaient à lui en galopant. Il reconnut les uhlans de la garde, dont les rangs avaient été rompus et qui abandonnaient la mêlée. Rostow remarqua du sang sur l’un d’eux.
«Peu m’importe,» se dit-il. À quelques centaines de pas de là, il vit arriver au grand trot sur sa gauche, de façon à lui couper la route, une foule énorme de cavaliers, aux uniformes blancs et scintillants, montés sur des chevaux noirs. Lançant son cheval à toute bride, afin de leur laisser le champ libre, il y serait certainement parvenu, si la cavalerie n’avait pressé son allure; il la voyait gagner du terrain et entendait le bruit des chevaux, et le cliquetis des armes se rapprochait de plus en plus de lui. Au bout d’une minute à peine, il distinguait les visages des chevaliers-gardes qui allaient attaquer l’infanterie française: ils galopaient, tout en retenant leurs montures.
Rostow entendit le commandement: «Marche! Marche! Donné par un officier qui lançait son pur-sang ventre à terre. Craignant d’être écrasé ou entraîné, Rostow longeait leur front au triple galop, dans l’espoir de traverser le terrain qu’il avait en vue, avant leur arrivée.
Il craignait de ne pouvoir éviter le choc du dernier chevalier-garde, dont la haute taille contrastait avec sa frêle apparence. Il aurait été immanquablement foulé aux pieds, et son Bédouin avec lui, s’il n’avait eu l’heureuse inspiration de faire siffler son fouet devant les yeux de la belle et forte monture du chevalier-garde: elle tressaillit et dressa les oreilles; mais, à un vigoureux coup d’éperon de son cavalier, Bédouin releva la queue et, tendant le cou, s’élança encore plus rapide. À peine Rostow les avait-il distancés qu’il entendit crier: «Hourra!» et, se retournant, il vit les premiers rangs s’engouffrer dans un régiment d’infanterie française, aux épaulettes rouges. L’épaisse fumée d’un canon invisible les déroba aussitôt à sa vue.
C’était cette brillante et fameuse charge des chevaliers-gardes tant admirée des Français eux-mêmes! Avec quel serrement de cœur n’entendit-il pas raconter, plus tard, que de toute cette masse de beaux hommes, de toute cette brillante fleur de jeunesse, riche, élégante, montée sur des chevaux de prix, officiers et junkers, qui l’avaient dépassé dans un galop furieux, il ne restait que dix-huit hommes!
«Mon heure viendra, je n’ai rien à leur envier, se disait Rostow en s’éloignant. Peut-être vais-je voir l’Empereur.»
Atteignant enfin notre infanterie de la garde, il se trouva au milieu des boulets, qu’il devina plutôt qu’il ne les entendit, en voyant les figures inquiètes des soldats et l’expression grave et plus contenue des officiers.
Une voix, celle de Boris, lui cria tout à coup:
«Rostow! Qu’en dis-tu? Nous voilà aux premières loges! Notre régiment a été rudement engagé!»
Et il souriait de cet heureux sourire de la jeunesse, qui vient le recevoir le baptême du feu. Rostow s’arrêta:
«Eh bien! Et quoi?
– Repoussés!» répondit Boris, devenu bavard.
Et là-dessus il lui raconta comment la garde, voyant des troupes devant elle et les ayant prises pour des Autrichiens, le sifflement des boulets leur avait prouvé bientôt qu’ils formaient la première ligne et qu’ils devaient attaquer.
«Où vas-tu? Lui demanda Boris.
– Trouver le commandant en chef.
– Le voilà! Lui répondit Boris en lui indiquant le grand-duc Constantin à cent pas d’eux, en uniforme de chevalier-garde, la tête dans les épaules, les sourcils froncés, criant et gesticulant contre un officier autrichien, blanc et blême.
– Mais c’est le grand-duc, et je cherche le général en chef ou l’Empereur, dit Rostow en s’éloignant.
– Comte, comte, lui cria Berg, en lui montrant sa main enveloppée d’un mouchoir ensanglanté, je suis blessé au poignet droit, et je suis resté à mon rang! Voyez, comte, je suis obligé de tenir mon épée de la main gauche! Dans ma famille tous les «Von Berg» ont été des chevaliers!»
Et Berg continuait à parler que Rostow était déjà loin.
Franchissant un espace désert, pour ne pas se trouver exposé au feu de l’ennemi, il suivit la ligne des réserves, en s’éloignant par là du centre de l’action. Tout à coup devant lui et sur les derrières de nos troupes, dans un endroit où l’on ne pouvait guère supposer la présence des Français, il entendit tout près de lui une vive fusillade.
«Qu’est-ce que cela peut être? Se demanda-t-il. L’ennemi sur nos derrières?… C’est impossible, – et une peur folle s’empara de lui à la pensée de l’issue possible de la bataille… – Quoi qu’il en soit, il n’y a pas à l’éviter, il faut que je découvre le général en chef, et, si tout est perdu, il ne me reste qu’à mourir avec eux.»
Le noir pressentiment qui l’avait envahi se confirmait chaque pas qu’il faisait sur le terrain occupé par les troupes de toute arme derrière le village de Pratzen.
«Que veut dire cela? Sur qui tire-t-on? Qui tire? Se demandait Rostow en rencontrant des soldats russes et autrichiens qui fuyaient en courant pêle-mêle.
– Le diable sait ce qui en est! Il a battu tout le monde! Tout est perdu! Lui répondirent en russe, en allemand, en tchèque tous ces fuyards, comprenant aussi peu que lui ce qui se passait autour d’eux.
– Qu’ils soient rossés, ces Allemands!
– Que le diable les écorche, ces traîtres!» répondit un autre.
– Que le diable emporte ces Russes!» grommelait un Allemand.
Quelques blessés se traînaient le long du chemin. Les jurons, les cris, les gémissements se confondaient en un écho prolongé et sinistre. La fusillade avait cessé, et Rostow apprit plus tard que les fuyards allemands et russes avaient tiré les uns sur les autres.
«Mon Dieu! Se disait Rostow, et l’Empereur qui peut, d’un moment à l’autre, voir cette débandade!… Ce ne sont que quelques misérables sans doute! Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas; il faut les dépasser au plus vite!»
La pensée d’une complète déroute ne pouvait lui entrer dans l’esprit, malgré la vue des batteries et des troupes françaises sur le plateau de Pratzen, sur le plateau même où on lui avait enjoint d’aller trouver l’Empereur et le général en chef.