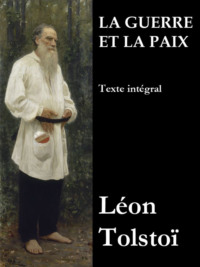Kitabı oku: «La Guerre et la Paix (Texte intégral)», sayfa 28
XVIII
Aux environs du village de Pratzen, pas un chef n’était visible. Rostow n’y aperçut que des troupes fuyant à la débandade. Sur la grande route, des calèches, des voitures de toute espèce, des soldats russes, autrichiens, de toute arme, blessés et non blessés, défilèrent devant lui. Toute cette foule se pressait, bourdonnait, fourmillait et mêlait ses cris au son sinistre des bombes lancées par les bouches à feu françaises des hauteurs de Pratzen.
«Où est l’Empereur? Où est Koutouzow?» demandait-il au hasard sans obtenir de réponse.
Enfin, attrapant un soldat au collet, il le força à l’écouter: «Hé! L’ami! Il y a longtemps qu’ils sont tous là-bas, qu’ils ont filé en avant,» lui répondit le soldat en riant.
Lâchant ce soldat, évidemment ivre, Rostow arrêta un domestique militaire, qui lui semblait devoir être écuyer d’un personnage haut placé. Le domestique lui raconta que l’Empereur avait passé en voiture sur cette route une heure auparavant à fond de train, et qu’il était dangereusement blessé. «C’est impossible, ce n’était pas lui, dit Rostow. – Je l’ai vu de mes propres yeux, répondit le domestique avec un sourire malin. Il y a assez longtemps que je le connais: combien de fois ne l’ai-je pas vu à Pétersbourg. Il était très pâle, dans le fond de sa voiture. Comme il les avait lancés ses quatre chevaux noirs, Ilia Ivanitch! On dirait que je ne le connais pas, ces chevaux, et que l’Empereur peut avoir un autre cocher qu’Ilia Ivanitch!
– Qui cherchez-vous? Lui demanda, quelques pas plus loin, un officier blessé… le général en chef? Il a été tué par un boulet dans la poitrine, devant notre régiment!
– Il n’a pas été tué, il a été blessé! Dit un autre.
– Qui? Koutouzow? Demanda Rostow.
– Non, pas Koutouzow… comment l’appelle-t-on?… Enfin qu’importe! Il n’en est pas resté beaucoup de vivants. Allez de ce côté, vous trouverez tous les chefs réunis au village de Gostieradek.»
Rostow continua son chemin au pas, ne sachant plus que faire, ni à qui s’adresser. L’Empereur blessé! La bataille perdue!… Suivant la direction indiquée, il voyait au loin une tour et les clochers d’une église. Pourquoi se dépêcher? Il n’avait rien à demander à l’Empereur, ni à Koutouzow, fussent-ils même sains et saufs.
«Prenez le chemin à gauche, Votre Noblesse; si vous allez tout droit, vous vous ferez tuer.»
Rostow réfléchit un instant et suivit la route qu’on venait de lui signaler comme dangereuse.
«Ça m’est bien égal! L’Empereur étant blessé, qu’ai-je besoin de me ménager?»
Et il déboucha sur l’espace où il y avait eu le plus de morts et de fuyards. Les Français n’y étaient pas encore, et le peu de Russes qui avaient survécu l’avaient abandonné. Sur ce champ gisaient, comme des gerbes bien garnies, des tas de dix, quinze hommes tués et blessés; les blessés rampaient pour se réunir par deux et par trois, et poussaient des cris qui frappaient péniblement l’oreille de Rostow; il lança son cheval au galop pour éviter ce spectacle des souffrances humaines. Il avait peur, non pas pour sa vie, mais peur de perdre ce sang-froid qui lui était si nécessaire et qu’il avait senti faiblir en voyant ces malheureux.
Les Français avaient cessé de tirer sur cette plaine désertée par les vivants; mais, à la vue de l’aide de camp qui la traversait, leurs bouches à feu lancèrent quelques boulets. Ces sons stridents et lugubres, ces morts dont il était entouré lui causèrent une impression de terreur et de pitié pour lui-même. Il se souvint de la dernière lettre de sa mère et se dit à lui-même: «Qu’aurait-elle éprouvé en me voyant ici sous le feu de ces canons?»
Dans le village de Gostieradek, qui était hors de la portée des boulets, il retrouva les troupes russes, quittant le champ de bataille en ordre, quoique confondues entre elles. On y parlait de la bataille perdue, comme d’un fait avéré: mais personne ne put indiquer à Rostow où étaient l’Empereur et Koutouzow. Les uns assuraient que le premier était réellement blessé; d’autres démentaient ce bruit, en l’expliquant par la fuite du grand-maréchal comte Tolstoï, pâle et terrifié, que l’on avait vu passer dans la voiture de l’Empereur. Ayant appris que quelques grands personnages se trouvaient derrière le hameau à gauche, Rostow s’y dirigea, non plus dans l’espoir de rencontrer celui qu’il cherchait, mais par acquit de conscience. À trois verstes plus loin, il dépassa les dernières troupes russes, et, à côté d’un verger séparé de la route par un fossé, il vit deux cavaliers. Il lui sembla connaître l’un deux, qui portait un plumet blanc; l’autre, sur un magnifique cheval alezan, qu’il crut aussi avoir déjà vu, arrivé au fossé, éperonna sa monture et, lui rendant la bride, le franchit légèrement; quelques parcelles de terre jaillirent sous les sabots du cheval, et alors, lui faisant faire volte-face, il franchit de nouveau le fossé et s’approcha respectueusement de son compagnon, comme pour l’engager à suivre son exemple. Celui auquel il s’adressait fit un geste négatif de la tête et de la main, et Rostow reconnut aussitôt son Empereur, son Empereur adoré, dont il pleurait la défaite.
«Mais il ne peut pas rester là, tout seul, au milieu de ce champ désert!» se dit-il. Alexandre tourna la tête, et il put apercevoir ces traits si profondément gravés dans son cœur. L’Empereur était pâle; ses joues étaient creuses, ses yeux enfoncés; mais la douceur et la mansuétude, empreintes sur sa figure, n’en étaient que plus frappantes. Rostow était heureux de le voir, heureux de la certitude que sa blessure n’était qu’une invention sans fondement, et il se disait qu’il était de son devoir de lui transmettre sans plus tarder le message du prince Dolgoroukow.
Mais, comme un jeune amoureux ému et tremblant, qui n’ose donner cours à ses rêveries passionnées de la nuit, et cherche avec effroi un faux fuyant, afin de retarder le moment du rendez-vous si ardemment désiré, Rostow, en présence de son désir réalisé, ne savait s’il lui fallait s’approcher de l’Empereur ou si cette tentative ne serait pas inconvenante et déplacée.
«J’aurais peut-être l’air, se disait-il, de profiter avec empressement de ce moment de solitude et d’abattement. Une figure inconnue peut lui être désagréable, et puis, que lui dirai-je, quand un regard de lui suffit pour m’ôter la voix?
Les paroles qu’il aurait dû prononcer lui expiraient sur les lèvres, d’autant plus qu’il leur avait donné un tout autre cadre, l’heure triomphante d’une victoire, ou le moment où, étendu sur son lit de douleur, l’Empereur le remercierait de ses exploits héroïques, et où, lui mourant, il ferait à son souverain bien aimé l’aveu de son dévouement, si noblement confirmé par sa mort.
«Et d’ailleurs que lui demanderais-je? Il est quatre heures du soir, et la bataille est perdue! Non, non, je ne m’approcherai pas de lui: je ne dois pas interrompre ses pensées. Il vaut mieux mourir mille fois que d’en recevoir un regard courroucé.»
Il s’éloigna donc tristement, le désespoir dans l’âme, en se retournant toujours pour suivre les mouvements de son souverain.
Il vit le capitaine Von Toll s’approcher de l’Empereur et l’aider à franchir à pied le fossé et à s’asseoir ensuite sous un pommier. Toll resta debout à côté de lui, en lui parlant avec chaleur. Ce spectacle remplit Rostow de regrets et d’envie, surtout lorsqu’il vit l’Empereur, portant une main à ses yeux, tendre l’autre à Toll.
«J’aurais pu être à sa place,» se dit-il. Et, ne pouvant retenir les larmes qui coulaient de ses yeux, il continua à s’éloigner, ne sachant à quoi se décider ni de quel côté se diriger. Son désespoir était d’autant plus violent, qu’il s’accusait de faiblesse. Il aurait pu, il aurait dû s’approcher. C’était le moment ou jamais de faire preuve de dévouement, et il n’en avait pas profité. Il tourna bride et revint à l’endroit où il avait aperçu l’Empereur, et où il n’y avait plus personne. Une longue file de charrettes et de fourgons passait lentement, et Rostow apprit d’un des conducteurs que l’état-major de Koutouzow était non loin du village, et qu’ils s’y rendaient. Il les suivit.
À cinq heures du soir, la bataille était perdue sur tous les points. Plus de cent bouches à feu étaient tombées au pouvoir des Français.
Tout le corps d’armée de Prsczebichewsky avait mis bas les armes. Les autres colonnes, ayant perdu la moitié de leurs hommes, se repliaient en troupes débandées.
Le reste des colonnes de Langeron et de Doktourow se pressait confusément autour des étangs et des écluses du village d’Auguest.
Sur ce point seul, à six heures du soir, continuait encore le feu de l’ennemi, qui, ayant placé des batteries à mi-côte de la hauteur de Pratzen, tirait sur nos troupes en retraite.
Doktourow et d’autres à l’arrière-garde, reformant leurs bataillons, se défendaient contre la cavalerie française qui les poursuivait. Le jour tombait. Sur l’étroite chaussée d’Auguest, pendant une longue série de paisibles années, le bon vieux meunier, en bonnet de coton, avait jeté ses lignes dans l’étang, pendant que son petit-fils, ses manches de chemise retroussées, s’amusait à plonger la main dans le grand arrosoir où frétillaient les poissons argentés; sur cette même chaussée, sous l’œil du paysan morave en bonnet de fourrure, en habit gros bleu, d’énormes chariots avaient longtemps passé au pas, amenant au moulin de riches gerbes de froment et remportant de gros sacs d’une farine blanche et légère dont la fine poussière voltigeait en l’air; et maintenant on y voyait une foule égarée, affolée, se pressant, se heurtant, s’écrasant sous les pieds des chevaux, les roues des fourgons, des avant-trains, et foulant aux pieds les mourants, pour aller se faire tuer quelques pas plus loin.
Toutes les dix secondes, un boulet ou une grenade tombait et éclatait au milieu de cette foule compacte, tuant et couvrant de sang tous ceux qu’ils atteignaient. Dologhow, déjà officier, blessé à la main, seul avec ses dix hommes et son chef à cheval, représentait tout ce qui restait du régiment. Entraînés par la masse, ils s’étaient frayé un chemin jusqu’à l’entrée de la chaussée, où ils s’étaient vus arrêtés par le cheval d’un avant-train, qui était tombé et qu’il fallait dégager. Un boulet tua un homme derrière eux, un second en frappa un autre devant, et le sang jaillit sur Dologhow. La foule se rua en avant avec désespoir et s’arrêta de nouveau.
«Le salut est au delà de ces cent pas; rester ici c’est la mort!» voilà ce que tout le monde disait.
Dologhow, qui avait été refoulé au milieu, parvint jusqu’au bord de la digue, et courut sur la faible couche de glace qui recouvrait l’étang.
«Voyons! Tourne par ici, cria-t-il au canonnier. Elle tient…!» La glace le supportait effectivement, mais elle craquait et cédait sous ses pas, et il était évident que, sans attendre le poids du canon et de cette foule, elle allait s’enfoncer sous lui. On le regardait, on se pressait sur les bords, sans se décider à l’imiter. Le commandant du régiment, à cheval, leva le bras, ouvrit la bouche pour lui parler, lorsqu’un boulet siffla si bas au-dessus de toutes ces têtes terrifiées, qu’elles s’inclinèrent, et quelque chose tomba. C’était le général qui s’affaissait dans une mare de sang! Personne ne le regarda, personne ne songea à le relever!
«Sur la glace! Sur la glace! N’entends-tu pas! Tourne, tourne,» crièrent plusieurs voix; les gens ne savaient pas encore même pourquoi ils criaient ainsi.
Un des derniers avant-trains s’y engagea, et la foule se précipita sur la glace, qui craqua sous l’un des fuyards; son pied s’enfonça dans l’eau; en faisant un effort pour le retirer, il y tomba jusqu’à la ceinture. Les plus proches hésitèrent, l’homme de l’avant-train arrêta son cheval, tandis que derrière continuaient les cris: «En avant! En avant sur la glace;» et des hurlements de terreur retentirent de toutes parts. Les soldats, entourant le canon, tiraient et battaient les chevaux pour les forcer à avancer. Les chevaux partirent, la glace s’effondra d’un seul bloc, et quarante hommes disparurent. Cependant les boulets ne cessaient de siffler et de tomber avec une sinistre régularité, tantôt sur la glace, tantôt dans l’eau, et de décimer cette masse vivante, qui avait envahi la digue, les étangs et leurs rives.
XIX
Pendant ce temps, le prince André gisait toujours au même endroit sur la hauteur de Pratzen, serrant dans ses mains un morceau de la hampe du drapeau, perdant du sang et poussant à son insu des gémissements plaintifs et faibles comme ceux d’un enfant.
Vers le soir, ses gémissements cessèrent: il était sans connaissance. Tout à coup il rouvrit les yeux, ne se rendant pas compte du temps écoulé et se sentant de nouveau vivant et souffrant d’une blessure cuisante à la tête:
«Où est-il donc ce ciel sans fond que j’ai vu ce matin et que je ne connaissais pas auparavant?…» Ce fut sa première pensée. «… Et ces souffrances aussi m’étaient inconnues! Oui, je ne savais rien, rien jusqu’à présent. Mais où suis-je?»
Il écouta et entendit le bruit de plusieurs chevaux et de voix qui s’avançaient de son côté. On parlait français. Il ne tourna pas la tête. Il regardait toujours ce ciel si haut au-dessus de lui, dont l’azur insondable apparaissait à travers de légers nuages.
Ces cavaliers, c’étaient Napoléon et deux aides de camp. Bonaparte avait fait le tour du champ de bataille et donné des ordres pour renforcer les batteries dirigées sur la digue d’Auguest; il examinait maintenant les blessés et les morts abandonnés sur le terrain.
«De beaux hommes! Dit-il à la vue d’un grenadier russe, étendu sur le ventre, la face contre terre, la nuque noircie et les bras déjà raidis par la mort.
– Les munitions des pièces de position sont épuisées, sire! Lui dit un aide de camp, envoyé des batteries qui mitraillaient Auguest.
– Faites avancer celles de la réserve, répondit Napoléon en s’éloignant de quelques pas et en s’arrêtant à côté du prince André, qui serrait toujours la hampe mutilée dont le drapeau avait été pris comme trophée par les Français.
– Voilà une belle mort!» dit Napoléon.
Le prince André comprit qu’il était question de lui et que c’était Napoléon qui parlait; mais ses paroles bourdonnèrent à son oreille sans qu’il y attachât le moindre intérêt, et il les oublia aussitôt. Sa tête était brûlante; ses forces s’en allaient avec son sang, et il ne voyait devant lui que ce ciel lointain et éternel. Il avait reconnu Napoléon, – son héros; – mais dans ce moment ce héros lui paraissait si petit, si insignifiant en comparaison de ce qui se passait entre son âme et ce ciel sans limites! Ce qu’on disait, qui s’était arrêté près de lui, tout lui était indifférent, mais il était content de leur halte; il sentait confusément qu’on allait l’aider à rentrer dans cette existence qu’il trouvait si belle, depuis qu’il l’avait comprise autrement. Il rassembla toutes ses forces pour faire un mouvement et pour articuler un son; il remua un pied et poussa un faible gémissement.
«Ah! Il n’est pas mort? Dit Napoléon. Qu’on relève ce jeune homme, qu’on le porte à l’ambulance!»
Et l’Empereur alla à la rencontre du maréchal Lannes qui, souriant, se découvrit devant lui et le félicita de la victoire.
Bientôt le prince André ne se souvint plus de rien; la douleur causée par les efforts de ceux qui le soulevaient, les secousses du brancard et le sondage de sa plaie à l’ambulance lui avaient de nouveau fait perdre connaissance. Il ne revint à lui que le soir, pendant qu’on le transportait à l’hôpital avec plusieurs autres Russes blessés et prisonniers. Pendant ce trajet, il se sentit ranimé et put regarder ce qui se passait autour de lui et même parler.
Les premiers mots qu’il entendit furent ceux de l’officier français chargé d’escorter les blessés:
«Arrêtons-nous ici: l’Empereur va passer; il faut lui procurer le plaisir de voir ces messieurs.
– Bah! Il y a tant de prisonniers cette fois… une grande partie de l’armée russe… il doit en avoir assez, dit un autre.
– Oui! Mais pourtant, reprit le premier en désignant un officier russe blessé, en uniforme de chevalier-garde, celui-là est, dit-on, le commandant de toute la garde de l’empereur Alexandre!»
Bolkonsky reconnut le prince Repnine, qu’il avait rencontré dans le monde à Pétersbourg. À côté de lui se tenait un jeune chevalier-garde de dix-neuf ans, également blessé.»
Bonaparte, arrivant au galop, arrêta court son cheval devant eux:
«Qui est le plus élevé en grade?» demanda-t-il en voyant les blessés.
On lui nomma le colonel prince Repnine.
«Êtes-vous le commandant du régiment des chevaliers-gardes de l’empereur Alexandre?
– Je ne commandais qu’un escadron.
– Votre régiment a fait son devoir avec honneur!
– L’éloge d’un grand capitaine est la plus belle récompense du soldat, répondit Repnine.
– C’est avec plaisir que je vous le donne, dit Napoléon. Qui est ce jeune homme à côté de vous?»
Repnine nomma le lieutenant Suchtelen.
Napoléon le regarda en souriant:
«Il est venu bien jeune se frotter à nous?
– La jeunesse n’empêche pas le courage, murmura Suchtelen d’une voix émue.
– Belle réponse, jeune homme; vous irez loin!»
Pour compléter ce spectacle de triomphe, le prince André avait été aussi placé, sur le premier rang, de façon à frapper forcément le regard de l’Empereur, qui se souvint de l’avoir déjà aperçu sur le champ de bataille.
«Et vous, jeune homme, comment vous sentez-vous, mon brave?»
Le prince André, les yeux fixés sur lui, gardait le silence. Tandis que, cinq minutes auparavant, le blessé avait pu échanger quelques mots avec les soldats qui le transportaient, maintenant, les yeux fixés sur l’Empereur, il gardait le silence!… Qu’étaient en effet les intérêts, l’orgueil, la joie triomphante de Napoléon? Qu’était le héros lui-même, en comparaison de ce beau ciel, plein de justice et de bonté, que son âme avait embrassé et compris…? Tout lui semblait si misérable, si mesquin, si différent de ces pensées solennelles et sévères qu’avaient fait naître en lui l’épuisement de ses forces et l’attente de la mort!
Les yeux fixés sur Napoléon, il pensait à l’insignifiance de la grandeur, à l’insignifiance de vie, dont personne ne comprenait le but, à l’insignifiance encore plus grande de la mort, dont le sens restait caché et impénétrable aux vivants!
«Qu’on s’occupe de ces messieurs, dit Napoléon sans attendre la réponse du prince André, qu’on les mène au bivouac et que le docteur Larrey examine leurs blessures. Au revoir, prince Repnine!» Et il les quitta, les traits illuminés par le bonheur.
Témoins de la bienveillance de l’Empereur envers les prisonniers, les soldats qui portaient le prince André, et qui lui avaient enlevé la petite image suspendue à son cou par sa sœur, s’empressèrent de la lui rendre; il la trouva subitement posée sur sa poitrine au-dessus de son uniforme, sans savoir par qui et comment elle y avait été remise.
«Quel bonheur ce serait, pensa-t-il en se rappelant le profond sentiment de vénération de sa sœur, quel bonheur ce serait, si tout était aussi simple, aussi clair que Marie semble le croire! Comme il serait bon de savoir où chercher aide et secours dans cette vie, et ce qui nous attend après la mort!… Je serais si heureux, si calme si je pouvais dire: Seigneur, ayez pitié de moi!… Mais à qui le dirais-je? Ou cette force incommensurable, incompréhensible, à laquelle je ne puis ni m’adresser, ni exprimer ce que je sens, est le grand Tout, ou bien c’est le néant, ou bien c’est ce Dieu qui est renfermé ici dans cette image de Marie! Rien, rien n’est certain, sinon le peu de valeur de ce qui est à la portée de mon intelligence et la majesté de cet inconnu insondable, le seul réel peut-être et le seul grand!»
Le brancard fut emporté, et, à chaque secousse, il sentait une douleur intense, augmentée par la fièvre et le délire qui s’emparaient de lui. Il revoyait son père, sa sœur, sa femme, ce fils qui allait lui naître, la petite et insignifiante personne de Napoléon, et toutes ces images passaient et repassaient sur l’azur de ce ciel bleu et profond, qui se mêlait à toutes ses fiévreuses hallucinations. Il lui semblait déjà jouir à Lissy-Gory de la vie de famille calme et tranquille, lorsqu’apparaissait tout à coup à ses yeux un petit Napoléon, dont le regard indifférent, heureux du malheur d’autrui, le pénétrait de doute et de souffrance… et il se tournait vers son ciel idéal, qui seul lui promettait l’apaisement! Vers le matin, tous ces rêves se mêlèrent et se confondirent dans les ténèbres et le chaos d’un état d’inconscience complète, qui, selon l’avis de Larrey (médecin de Napoléon), devait se terminer par la mort plutôt que par la guérison.
«C’est un sujet nerveux et bilieux, dit Larrey, il n’en réchappera pas!» Et le prince André fut confié, avec quelques autres blessés qui ne laissaient plus d’espoir, aux soins des habitants du pays.