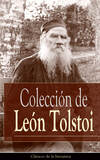Kitabı oku: «La Guerre et la Paix (Texte intégral)», sayfa 6
XVI
C’était la vérité. Pierre n’avait pas eu le loisir de se choisir encore une carrière, par suite de son renvoi de Pétersbourg à Moscou pour ses folies tapageuses. L’histoire racontée chez les Rostow était authentique. Il avait, de concert avec ses camarades, attaché l’officier de police sur le dos de l’ourson!
De retour depuis peu de jours, il s’était arrêté chez son père, comme d’habitude. Il supposait avec raison que son aventure devait être connue et que l’entourage féminin du comte, toujours hostile à son égard, ne manquerait pas de le monter contre lui. Malgré tout, il se rendit le jour même de son arrivée dans l’appartement de son père et s’arrêta, chemin faisant, dans le salon où se tenaient habituellement les princesses, pour leur dire bonjour. Deux d’entre elles faisaient de la tapisserie à un grand métier, tandis que la troisième, l’aînée, leur faisait une lecture à haute voix.
Son maintien était sévère, sa personne soignée, mais la longueur de son buste sautait aux yeux: c’était celle qui avait feint d’ignorer la présence d’Anna Mikhaïlovna. Les cadettes, toutes deux fort jolies, ne se distinguaient l’une de l’autre que par un grain de beauté, qui était placé chez l’une juste au-dessus de la lèvre et qui la rendait fort séduisante. Pierre fut reçu comme un pestiféré. L’aînée interrompit sa lecture et fixa sur lui en silence des regards effrayés; la seconde, celle qui était privée du grain de beauté, suivit son exemple; la troisième, moqueuse et gaie, se pencha sur son ouvrage pour cacher de son mieux le sourire provoqué par la scène qui allait se jouer et qu’elle prévoyait. Elle piqua son aiguille dans le canevas et fit semblant d’examiner le dessin, en étouffant un éclat de rire.
«Bonjour, ma cousine, dit Pierre, vous ne me reconnaissez pas?
– Je ne vous reconnais que trop bien, trop bien!
– Comment va le comte? Puis-je le voir? Demanda Pierre avec sa gaucherie habituelle, mais sans témoigner d’embarras.
– Le comte souffre moralement et physiquement, et vous avez pris soin d’augmenter chez lui les souffrances de l’âme.
– Puis-je voir le comte? Répéta Pierre.
– Oh! Si vous voulez le tuer, le tuer définitivement, oui, vous le pouvez. Olga, va voir si le bouillon est prêt pour l’oncle; c’est le moment,» ajouta-t-elle, pour faire comprendre à Pierre qu’elles étaient uniquement occupées à soigner leur oncle, tandis que lui, il ne pensait évidemment qu’à lui être désagréable.
Olga sortit. Pierre attendit un instant, et, après avoir examiné les deux sœurs:
«Si c’est ainsi, dit-il en les saluant, je retourne chez moi, et vous me ferez savoir quand ce sera possible.»
Il s’en alla, et la petite princesse au grain de beauté accompagna sa retraite d’un long éclat de rire.
Le prince Basile arriva le lendemain et s’installa dans la maison du comte. Il fit venir Pierre:
«Mon cher, lui dit-il, si vous vous conduisez ici comme à Pétersbourg, vous finirez très mal: c’est tout ce que je puis vous dire. Le comte est dangereusement malade; il est inutile que vous le voyiez.»
À partir de ce moment, on ne s’inquiéta plus de Pierre, qui passait ses journées tout seul dans sa chambre du second étage.
Lorsque Boris entra chez lui, Pierre marchait à grands pas, s’arrêtait dans les coins de l’appartement, menaçant la muraille de son poing fermé, comme s’il voulait percer d’un coup d’épée un ennemi invisible, lançant des regards furieux par-dessus ses lunettes et recommençant sa promenade en haussant les épaules avec force gestes et paroles entrecoupées.
«L’Angleterre a vécu! Disait-il en fronçant les sourcils et en dirigeant son index vers un personnage imaginaire. M. Pitt, traître à la nation et au droit des gens, est condamné à…»
Il n’eut pas le temps de prononcer l’arrêt dicté par Napoléon, représenté en ce moment par Pierre. Il avait déjà traversé la Manche et pris Londres d’assaut, lorsqu’il vit entrer un jeune et charmant officier, à la tournure élégante. Il s’arrêta court. Pierre avait laissé Boris âgé de quatorze ans et ne se le rappelait plus; malgré cela, il lui tendit la main en lui souriant amicalement, par suite de sa bienveillance naturelle.
«Vous ne m’avez pas oublié? Dit Boris, répondant à ce sourire. Je suis venu avec ma mère voir le comte, mais on dit qu’il est malade.
– Oui, on le dit; on ne lui laisse pas une minute de repos,» reprit Pierre, qui se demandait à part lui quel était ce jeune homme.
Boris voyait bien qu’il ne le reconnaissait pas; mais, trouvant qu’il était inutile de se nommer et n’éprouvant d’ailleurs aucun embarras, il le regardait dans le blanc des yeux.
«Le comte Rostow vous invite à venir dîner chez lui aujourd’hui, dit-il après un silence prolongé, qui commençait à devenir pénible pour Pierre.
– Ah! Le comte Rostow, s’écria Pierre joyeusement; alors vous êtes son fils Élie. Figurez-vous que je ne vous reconnaissais pas. Vous rappelez-vous nos promenades aux montagnes des Oiseaux en compagnie de MmeJacquot, il y a de cela longtemps?
– Vous vous trompez, reprit Boris sans se presser et en souriant d’un air assuré et moqueur. Je suis Boris, le fils de la princesse Droubetzkoï. Le comte Rostow s’appelle Élie et son fils Nicolas, et je n’ai jamais connu de MmeJacquot.»
Pierre secoua la tête et promena ses mains autour de lui, comme s’il voulait chasser des cousins ou des abeilles.
«Ah! Dieu! Est-ce possible? J’aurai tout confondu; j’ai tant de parents à Moscou… Vous êtes Boris, … oui, c’est bien cela… enfin c’est débrouillé! Voyons, que pensez-vous de l’expédition de Boulogne? Les Anglais auront du fil à retordre, si Napoléon parvient seulement à traverser le détroit. Je crois l’entreprise possible, … pourvu que Villeneuve se conduise bien.»
Boris, qui ne lisait pas les journaux, ne savait rien de l’expédition et entendait prononcer le nom de Villeneuve pour la première fois.
«Ici, à Moscou, les dîners et les commérages nous occupent bien autrement que la politique, répondit-il d’un air toujours moqueur: je n’en sais absolument rien et je n’y pense jamais! Il n’est question en ville que de vous et du comte.»
Pierre sourit de son bon sourire, tout en ayant l’air de craindre que son interlocuteur ne laissât échapper quelque parole indiscrète; mais Boris s’exprimait d’un ton sec et précis sans le quitter des yeux.
«Moscou n’a pas autre chose à faire; chacun veut savoir à qui le comte léguera sa fortune, et qui sait s’il ne nous enterrera pas tous? Pour ma part, je le lui souhaite de tout cœur!
– Oui, c’est très pénible, très pénible, balbutia Pierre, qui continuait à redouter une question délicate pour lui.
– Et vous devez croire, reprit Boris en rougissant légèrement, mais en conservant son maintien réservé, que chacun cherche également à obtenir une obole du millionnaire…
– Nous y voilà! Pensa Pierre.
– Et je tiens justement à vous dire, pour éviter tout malentendu, que vous vous tromperiez singulièrement en nous mettant, ma mère et moi, au nombre de ces gens-là. Votre père est très riche, tandis que nous sommes très pauvres; c’est pourquoi je ne l’ai jamais considéré comme un parent. Ni ma mère, ni moi, ne lui demanderons rien et n’accepterons jamais rien de lui!»
Pierre fut quelque temps avant de comprendre; tout à coup il saisit vivement, et gauchement comme toujours, la main de Boris, et rougissant de confusion et de honte:
«Est-ce possible? S’écria-t-il, peut-on croire que je… ou que d’autres…?
– Je suis bien aise de vous l’avoir dit; excusez-moi. Si cela vous a été désagréable, je n’ai pas eu l’intention de vous offenser, continua Boris en rassurant Pierre, car les rôles étaient intervertis. J’ai pour principe d’être franc… Mais que dois-je répondre? Viendrez-vous dîner chez les Rostow?…»
Et Boris, s’étant ainsi délivré d’un lourd fardeau et tiré d’une fausse situation en les passant à un autre, était redevenu charmant comme d’habitude.
«Écoutez-moi, dit Pierre tranquillisé, vous êtes un homme étonnant. Ce que vous venez de faire est bien, très bien! Vous ne méconnaissez pas, c’est naturel… il y a si longtemps que nous ne nous étions vus… encore enfants… Donc, vous auriez pu supposer… je vous comprends très bien; je ne l’aurais pas fait, je n’en aurais pas eu le courage, mais tout de même c’est parfait. Je suis enchanté d’avoir fait votre connaissance. C’est vraiment étrange, ajouta-t-il en souriant après un moment de silence, vous avez pu supposer que je… et il se mit à rire. – Enfin nous nous connaîtrons mieux, n’est-ce pas? Je vous en prie…» et il lui serra la main. Savez-vous que je n’ai pas vu le comte? Il ne m’a pas fait demander… il me fait de la peine comme homme, mais que faire?… Ainsi, vous croyez sérieusement que Napoléon aura le temps de faire passer la mer à son armée?»
Et Pierre se mit à développer les avantages et les désavantages de l’expédition de Boulogne.
Il en était là lorsqu’un domestique vint prévenir Boris que sa mère montait en voiture; il prit congé de Pierre, qui lui promit, en lui serrant amicalement la main, d’aller dîner chez les Rostow. Il se promena longtemps encore dans sa chambre, mais cette fois sans s’escrimer contre des ennemis imaginaires; il souriait et se sentait pris, sans doute à cause de sa grande jeunesse et de son complet isolement, d’une tendresse sans cause pour ce jeune homme intelligent et sympathique, et bien décidé à faire plus ample connaissance avec lui.
Le prince Basile reconduisait la princesse, qui cachait dans son mouchoir son visage baigné de larmes.
«C’est affreux, c’est affreux, murmurait-elle, mais malgré tout je remplirai mon devoir jusqu’au bout. Je reviendrai pour le veiller; on ne peut pas le laisser ainsi…, chaque seconde est précieuse. Je ne comprends pas ce que ses nièces attendent. Dieu aidant, je trouverai peut-être moyen de le préparer… Adieu, mon prince, que le bon Dieu vous soutienne!
– Adieu, ma chère,» répondit négligemment le prince Basile.
«Ah! Son état est terrible, dit la mère à son fils, à peine assise dans sa voiture; il ne reconnaît personne.
– Je ne puis, ma mère, me rendre compte de la nature de ses rapports avec Pierre.
– Le testament dévoilera tout, mon ami, et notre sort en dépendra également.
– Mais qu’est-ce qui vous fait supposer qu’il nous laissera quelque chose?
– Ah! Mon enfant, il est si riche, et nous sommes si pauvres!
– Cette raison ne me paraît pas suffisante, je vous l’avoue, maman…
– Mon Dieu, mon Dieu, qu’il est malade!» répétait la princesse.
XVII
Lorsque Anna Mikhaïlovna et son fils avaient quitté la comtesse Rostow pour faire leur visite, ils l’avaient laissée seule, plongée dans ses réflexions et essuyant de temps en temps ses yeux pleins de larmes. Enfin elle sonna.
«Il me semble, ma bonne, dit-elle en s’adressant d’un ton sévère à la fille de chambre qui avait tardé à répondre à l’appel, que vous ne voulez pas faire votre service; c’est bien! Je vous chercherai une autre place!»
La comtesse avait les nerfs agacés; le chagrin et la pauvreté honteuse de son amie l’avaient mise de fort mauvaise humeur, ce qui se traduisait toujours dans son langage par le «vous» et «ma bonne».
«Pardon, madame, murmura la coupable.
– Priez le comte de passer chez moi.»
Le comte arriva bientôt en se dandinant et s’approcha timidement de sa femme:
«Oh! Ah! Ma petite comtesse, quel sauté de gelinottes au madère nous aurons! Je l’ai goûté, ma chère. Aussi ai-je payé Taraska mille roubles, et il les vaut.»
Il s’assit à côté de sa femme, passa une main dans ses cheveux et posa l’autre sur ses genoux d’un air vainqueur.
«Que désirez-vous, petite comtesse?
– Voilà ce que c’est, mon ami; mais quelle est cette tache? Lui dit-elle en posant le doigt sur son gilet. C’est sans doute le sauté de gelinottes? Ajouta-t-elle en souriant. Voyez-vous, cher comte, il me faut de l’argent.»
La figure du comte s’allongea.
«Ah! Dit-il, chère petite comtesse!»
Et il chercha son portefeuille avec agitation.
«Il m’en faut beaucoup… cinq cents roubles, reprit-elle, en frottant la tache avec son mouchoir de batiste.
– À l’instant, à l’instant! Hé, qui est là? Cria-t-il, avec l’assurance de l’homme qui sait qu’il sera obéi et qu’on s’élancera tête baissée à sa voix. Qu’on m’envoie Mitenka!»
Mitenka était le fils d’un noble et avait été élevé par le comte, qui lui avait confié le soin de toutes ses affaires; il fit son entrée à pas lents et mesurés, et s’arrêta respectueusement devant lui.
«Écoute, mon cher, apporte-moi, – et il hésita, – apporte-moi sept cents roubles, oui, sept cents roubles; mais fais attention de ne pas me donner des papiers sales et déchirés comme l’autre fois. J’en veux de neufs; c’est pour la comtesse.
– Oui, je t’en prie, Mitenka, qu’ils soient propres, dit la comtesse avec un soupir.
– Quand Votre Excellence désire-t-elle les avoir? Car vous savez que… du reste soyez sans inquiétude, se hâta de dire Mitenka, qui voyait poindre dans la respiration fréquente et pénible du comte le signe précurseur d’une colère inévitable… J’avais oublié… vous allez les recevoir.
– Très bien, très bien, donne-les à la comtesse. Quel trésor que ce garçon! Dit le comte en le suivant des yeux; rien ne lui est impossible et c’est là ce qui me plaît, car après tout c’est ainsi que cela doit être.
– Ah! L’argent, l’argent, que de maux l’argent cause dans ce monde, et celui-là me sera bien utile, cher comte.
– Chacun sait, petite comtesse, que vous êtes terriblement dépensière,» reprit le comte. Et, après avoir baisé la main de sa femme, il rentra chez lui.
La comtesse reçut ses assignats tout neufs, et elle venait de les recouvrir soigneusement de son mouchoir de poche, lorsque la princesse Droubetzkoï entra dans sa chambre.
«Eh bien, mon amie? Demanda la comtesse légèrement émue.
– Ah! Quelle terrible situation! Il est méconnaissable et si mal, si mal! Je ne suis restée qu’un instant, et je n’ai pas dit deux mots.
– Annette, au nom du ciel, ne me refuse pas,» dit tout à coup la comtesse en rougissant et avec un air de confusion qui contrastait singulièrement avec l’expression sévère de sa figure fatiguée.
Elle retira vivement son mouchoir et présenta le petit paquet à Anna Mikhaïlovna. Celle-ci devina tout de suite la vérité, et elle se pencha aussitôt, toute prête à serrer son amie dans ses bras.
«Voilà pour l’uniforme de Boris!»
Le moment était venu, et la princesse embrassa son amie en pleurant. Pourquoi pleuraient-elles toutes deux? Était-ce parce qu’elles se trouvaient forcées de penser à l’argent, cette question si secondaire quand on s’aime! Ou peut-être songeaient-elles au passé, à leur enfance, qui avait vu naître leur affection, et à leur jeunesse évanouie? Quoi qu’il en soit, leurs larmes coulaient, mais c’étaient de douces larmes.
XVIII
La comtesse Rostow était au salon avec ses filles et un grand nombre d’invités: Le comte avait emmené les hommes dans son cabinet et leur faisait les honneurs de sa collection de pipes turques; de temps en temps il revenait demander à sa femme si Marie Dmitrievna Afrossimow était arrivée.
Marie Dmitrievna, surnommée «le terrible dragon», n’avait ni titre ni fortune, mais son caractère était franc et ouvert, ses manières simples et naturelles. Elle était connue de la famille impériale; la meilleure société des deux capitales allait chez elle. On avait beau se moquer tout bas de son sans-façon et faire circuler les anecdotes les plus étranges sur son compte, elle inspirait la crainte et le respect.
On fumait dans le cabinet du comte et l’on causait de la guerre qui venait d’être officiellement déclarée dans le manifeste au sujet du recrutement. Personne ne l’avait encore lu, mais chacun savait qu’il était publié. Le comte, assis sur une ottomane entre deux convives qui parlaient tout en fumant, ne disait mot, mais inclinait la tête à gauche et à droite, en les regardant et en les écoutant tour à tour avec un visible plaisir.
L’un d’eux portait le costume civil: sa figure ridée, bilieuse, maigre et rasée de près, accusait un âge voisin de la vieillesse, quoiqu’il fût mis à la dernière mode; il avait ramené ses pieds sur le divan, avec le sans-gêne d’un habitué de la maison, et aspirait bruyamment à longs traits et avec force contorsions, la fumée qui s’échappait d’une chibouque, dont le bout d’ambre relevait le coin de sa bouche. Schinchine était un vieux garçon, cousin germain de la comtesse. On le tenait, dans les salons de Moscou, pour une mauvaise langue. Lorsqu’il causait, il avait toujours l’air de faire un grand honneur à son interlocuteur. L’autre convive, jeune officier de la garde, frais et rose, bien frisé, bien coquet, et tiré à quatre épingles, tenait le bout de sa chibouque entre les deux lèvres vermeilles de sa jolie bouche, et laissait doucement échapper la fumée en légères spirales. C’était le lieutenant Berg, officier au régiment de Séménovsky, qu’il était sur le point de rejoindre avec Boris: c’était lui que Natacha avait appelé «le fiancé» de la comtesse Véra. Le comte continuait à prêter une oreille attentive, car jouer au boston et suivre la conversation de deux bavards, quand il avait l’heureuse fortune d’en avoir deux sous la main, étaient ses occupations favorites.
«Comment arrangez-vous tout cela, mon cher, mon très honorable Alphonse Karlovitch?» disait Schinchine avec ironie; il mêlait, ce qui donnait un certain piquant à sa conversation, les expressions russes les plus familières aux phrases françaises les plus choisies.
«Vous comptez donc vous faire des rentes sur l’État avec votre compagnie, et en tirer un petit revenu?
– Non, Pierre Nicolaïévitch, je tiens seulement à prouver que les avantages sont bien moins considérables dans la cavalerie que dans l’infanterie. Mais vous allez du reste juger de ma position…»
Berg parlait toujours d’une façon précise, tranquille et polie; sa conversation n’avait jamais d’autre objet que lui-même, et tant qu’un entretien ne lui offrait pas d’intérêt personnel, son silence pouvait se prolonger indéfiniment sans lui faire éprouver et sans faire éprouver aux autres le moindre embarras; mais, à la première occasion favorable, il se mettait en avant avec une satisfaction visible.
«Voici ma situation, Pierre Nicolaïévitch… Si je servais dans la cavalerie, même comme lieutenant, je n’aurais pas plus de 200 roubles par trimestre; à présent j’en ai 230…»
Et Berg sourit agréablement en regardant Schinchine et le comte avec une tranquille assurance, comme si sa carrière et ses succès devaient être le but suprême des désirs de chacun.
«Et puis, dans la garde je suis en vue, et les vacances y sont plus fréquentes que dans l’infanterie. Vous devez comprendre que 230 roubles ne pouvaient me suffire, car je fais des économies, et j’envoie de l’argent à mon père, continua Berg en lançant une bouffée de fumée.
– Le calcul est juste: «l’Allemand moud son blé sur le dos de sa hache,» comme dit le proverbe…»
Et Schinchine fit passer le tuyau de sa chibouque dans le coin opposé de sa bouche en jetant un coup d’œil au comte, qui éclata de rire. Le reste de la société, voyant Schinchine en train de parler, fit cercle autour d’eux. Berg, qui ne remarquait jamais la moquerie dont il pouvait être l’objet, continua à énumérer les avantages qu’il s’était assurés en passant dans la garde: premièrement un rang de plus que ses camarades; puis, en temps de guerre, le chef d’escadron pouvait fort bien être tué, et alors lui, comme le plus ancien, le remplacerait d’autant plus facilement qu’on l’aimait beaucoup au régiment, et que son papa était très fier de lui. Il contait avec délices ses petites histoires, sans paraître se douter qu’il pût y avoir des intérêts plus graves que les siens, et il y avait dans l’expression naïve de son jeune égoïsme une telle ingénuité, que l’auditoire en était désarmé.
«Enfin, mon cher, que vous soyez dans l’infanterie ou dans la cavalerie, vous ferez votre chemin, je vous en réponds,» dit Schinchine en lui tapant sur l’épaule et en posant ses pieds, par terre.
Berg sourit avec satisfaction et suivit le comte, qui passa au salon avec toute la société.
C’était le moment qui précède l’annonce du dîner, ce moment où personne ne tient à engager une conversation, dans l’attente de la zakouska5. Cependant la politesse vous y oblige, ne fût-ce que pour déguiser votre impatience. Les maîtres de la maison regardent la porte de la salle à manger et échangent entre eux des coups d’œil désespérés. De leur côté, les invités, qui surprennent au passage ces signes non équivoques d’impatience, se creusent la tête pour deviner quelle peut être la personne ou la chose attendue: est-ce un parent en retard, ou est-ce le potage?
Pierre venait seulement d’arriver, et s’était gauchement assis dans le premier fauteuil venu qui lui avait barré le chemin du milieu du salon. La comtesse se donnait toute la peine imaginable pour le faire parler, mais n’en obtenait que des monosyllabes, pendant qu’à travers ses lunettes il regardait autour de lui, en ayant l’air de chercher quelqu’un. On le trouvait sans doute fort gênant, mais il était le seul à ne pas s’en apercevoir. Chacun connaissait plus ou moins son histoire de l’ours, et cet homme gros, grand et robuste excitait la curiosité générale; on se demandait avec étonnement comment un être aussi lourd, aussi indolent, avait pu faire une pareille plaisanterie à l’officier de police.
«Vous êtes arrivé depuis peu? Lui demanda la comtesse.
– Oui, madame, répondit-il en regardant à gauche.
– Vous n’avez pas vu mon mari?
– Non, madame, dit-il en souriant mal à propos.
– Vous avez été à Paris il n’y a pas bien longtemps; ce doit être très intéressant à visiter?
– Très intéressant.»
La comtesse jeta un regard à Anna Mikhaïlovna, qui, saisissant au vol cette prière muette, s’approcha du jeune homme pour animer, s’il était possible, la conversation; elle lui parla de son père, mais sans plus de succès, et il continua à ne répondre que par monosyllabes.
De leur côté, les autres invités échangeaient entre eux des phrases comme celles-ci: «Les Razoumovsky… cela a été charmant!… Vous êtes bien bonne… la comtesse Apraxine…» lorsque la comtesse se dirigea tout à coup vers l’autre salon, et on l’entendit s’écrier:
«Marie Dmitrievna!
– Elle-même!…» répondit une voix assez dure.
Et Marie Dmitrievna parut au même instant.
À l’exception des vieilles femmes, les dames comme les demoiselles se levèrent aussitôt.
Marie Dmitrievna s’était arrêtée sur le seuil de la porte. D’une taille élevée, forte et hommasse, elle portait haut sa tête à boucles grises, qui accusait la cinquantaine, et, tout en affectant de rabattre sans se hâter les larges manches de sa robe, elle enveloppa du regard toute la société qui l’entourait.
Marie Dmitrievna parlait toujours russe.
«Salut cordial à celle que nous fêtons, à elle et à ses enfants! Dit-elle de sa voix forte qui dominait toutes les autres. – Que deviens-tu, vieux pécheur? Dit-elle en s’adressant au comte, qui lui baisait la main. – Avoue-le, tu t’ennuies à Moscou, il n’y a où lancer les chiens… Que faire, mon bon? Voilà! Quand ces petits oiseaux-là auront grandi, – et elle désignait les jeunes filles, – bon gré mal gré il faudra leur chercher des fiancés. – Eh bien! Mon cosaque, dit Marie Dmitrievna à Natacha, qu’elle appelait toujours ainsi, en la caressant de la main pendant que la petite baisait gaiement la sienne, – sans avoir peur… Cette fillette est un lutin, je le sais, mais je l’aime!»
Retirant d’un énorme «ridicule» des boucles d’oreilles en pierres fines, taillées en poires, elle les donna à la petite fille, toute rayonnante de joie et de plaisir, et, se retournant ensuite vers Pierre:
«Hé! Hé! Mon très cher, viens, viens ici, lui dit-elle d’une voix qu’elle s’efforçait de rendre douce et engageante; viens ici, mon cher.»
Et elle relevait ses larges manches d’un air menaçant…:
«Approche, approche! J’ai été la seule à dire la vérité à ton père, quand l’occasion s’en présentait; je ne vais pas te la ménager non plus, c’est Dieu qui l’ordonne.»
Elle se tut, et chacun attendit ce qui allait se passer après cet exorde gros d’orage:
«C’est bien, il n’y a rien à dire, tu es un gentil garçon!… Pendant que ton père est étendu sur son lit de douleur, tu t’amuses à attacher un homme de police sur le dos d’un ourson! C’est indécent, mon bonhomme, c’est indécent! Tu aurais mieux fait d’aller faire la guerre…»
Puis, lui tournant le dos et présentant sa main au comte, qui retenait à grand’peine un éclat de rire étouffé:
«Eh bien, à table, s’écria-t-elle, il en est temps, je crois!»
Le comte ouvrit la marche, avec Marie Dmitrievna. Venaient ensuite la comtesse au bras d’un colonel de hussards, personnage à ménager, car il devait servir de guide à Nicolas et l’emmener au régiment, Anna Mikhaïlovna avec Schinchine, Berg avec Véra, la souriante Julie Karaguine avec Nicolas; d’autres couples suivaient à la file tout le long de la salle, et enfin derrière toute la compagnie, marchant un à un avec les enfants, les gouverneurs et les gouvernantes. Les domestiques se précipitèrent sur les chaises, qui furent avancées avec bruit; la musique éclata dans les galeries du haut, et tout le monde s’assit. Les sons de l’orchestre ne tardèrent pas à être étouffés par le cliquetis des couteaux et des fourchettes, par la voix des convives et les allées et venues des valets de chambre. La comtesse occupait un des bouts de la longue table avec Marie Dmitrievna à sa droite, et Anna Mikhaïlovna à sa gauche. Le comte, placé à l’autre bout, avait Schinchine à sa droite et à sa gauche le colonel; les autres invités du sexe fort s’assirent à leur fantaisie, et, au milieu de la table, les jeunes gens, Véra, Berg, Pierre et Boris, faisaient face aux enfants, aux gouverneurs et aux gouvernantes.
Le comte jetait par intervalles un regard à sa femme et à son gigantesque bonnet à nœuds bleus, qu’il apercevait entre les carafes, les bouteilles et les vases garnis de fruits qui l’en séparaient, et s’occupait activement, sans s’oublier lui-même, à verser du vin à ses voisins. À travers les tiges d’ananas qui la cachaient un peu, la comtesse répondait aux coups d’œil de son mari, dont le front enluminé se détachait ostensiblement au milieu des cheveux gris qui l’entouraient. Le côté des dames gazouillait à l’unisson; du côté des hommes, les voix s’élevaient de plus en plus, et entre autres celle du colonel de hussards, qui mangeait et buvait tant et si bien, que sa figure en était devenue pourpre, et que le comte l’offrait comme exemple, aux autres dîneurs. Berg expliquait à Véra, avec un tendre sourire, que l’amour venait du ciel et n’appartenait point à la terre. Boris nommait une à une, à son nouvel ami Pierre, toutes les personnes présentes, en échangeant des regards avec Natacha, qui lui faisait vis-à-vis. Pierre parlait peu, examinait les figures qui lui étaient inconnues et mangeait à belles dents. Des deux potages qu’on lui avait présentés, il avait choisi le potage à la tortue, et depuis la koulibiaka jusqu’au rôti de gelinottes, il n’avait pas laissé passer un seul plat, ni refusé un seul des vins offerts par le maître d’hôtel, qui tenait majestueusement la bouteille enveloppée d’une serviette, et qui lui glissait mystérieusement à l’oreille:
«Madère sec, vin de Hongrie, vin du Rhin!»
Il buvait indifféremment dans l’un ou l’autre des quatre verres, aux armes du comte, placés devant, chaque convive, et il se sentait pris pour ses voisins d’une bienveillance qui ne faisait qu’augmenter à chaque rasade. Natacha regardait fixement Boris, comme les fillettes savent seules le faire quand elles ont une amourette, et surtout lorsqu’elles viennent d’embrasser pour la première fois le héros de leurs rêves. Pierre ne faisait nulle attention à elle, et cependant, à la vue de cette singulière petite fille qui avait des yeux passionnés, il se sentait pris d’une folle envie de rire.
Nicolas, qui se trouvait loin de Sonia, et à côté de Julie Karaguine, causait avec elle en souriant. Sonia souriait aussi, mais la jalousie la dévorait: elle pâlissait, rougissait tour à tour, et faisait tout son possible pour deviner ce qu’ils pouvaient se dire. La gouvernante, à l’air agressif, se tenait sur le quivive, toute prête à fondre sur celui qui oserait attaquer les enfants. Le gouverneur allemand tâchait de noter dans sa cervelle les mets et les vins qui défilaient devant lui, pour en faire une description détaillée dans sa première lettre à sa famille, et il était profondément blessé de ce que le maître d’hôtel ne faisait nulle attention à lui et ne lui offrait jamais de vin. Il dissimulait de son mieux, en faisant semblant de ne pas en désirer, et il aurait bien voulu faire croire que, s’il en avait accepté, ç’aurait été uniquement pour satisfaire une curiosité de savant.