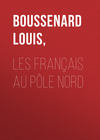Kitabı oku: «Les français au pôle Nord», sayfa 12
DEUXIÈME PARTIE
L'HIVERNAGE AU PAYS DU FROID
I
Lumière sans chaleur. – Comment le capitaine veut couper la banquise. – La scie. – Une découverte française. – Transport des forces par l'électricité. – La réversibilité des machines dynamo-électriques. – Organisation de l'appareil. – Les quinze premiers mètres. – En conseil. – Encore la dynamite. – Rudes labeurs. – Fureur d'un Alsacien. – Deux intrus. – Proposition des officiers de la Germania. – Refus formel.
Le jour polaire continue avec sa ténacité obsédante.
A minuit comme à midi, le soleil, que l'on dirait détraqué, tant sa permanence au milieu de l'azur céleste paraît une absurdité, verse des torrents d'éblouissantes lueurs.
Aussi loin que la vue peut s'étendre, tout scintille et flamboie.
Et pourtant, malgré cette incessante projection de lumière, à peine interrompue de loin en loin par la brume, le morne paysage conserve sa lugubre physionomie.
Sous ces ruissellements de clarté, on sent la douloureuse impression d'une chose morte.
Point d'arbres couverts d'opulentes frondaisons, point de fleurs aux délicats effluves, point de quadrupèdes folâtres, point d'oiseaux jaseurs, point d'insectes bourdonnants.
Partout des cristaux nus, frangés, déchiquetés, se découpant rigides et moroses sur le ciel d'un bleu cru. Et pour animer cet horizon d'où surgit un immense et glacial frisson, la silhouette balourde d'un ours, le soufflet d'un cétacé ou le brusque plongeon d'un phoque.
C'est l'été pourtant! mais l'été arctique, fait de lumière et non de chaleur.
En vain le soleil erre de longs mois au-dessus des régions boréales sur lesquelles il verse sans relâche des flots d'incandescence. Pareil lui-même à un astre gelé, en voie d'extinction, sa clarté ou rose, ou blanchâtre, anémique pour ainsi dire, éblouit, mais ne vivifie pas.
Et l'on sent, à travers cet été pendant lequel un habitant de la zone tempérée n'abandonnerait guère son foyer, la menace prochaine des froids mortels, des ténèbres affolantes de l'épouvantable hiver polaire.
Dans un mois, du 15 au 20 août, le pack, à peine désagrégé superficiellement, va reprendre sa ténacité de roc. Une épaisse couche de neige nivellera les dépressions et les protubérances. Un peu plus tard, avec l'apparition de la première étoile, s'éteindra ce faux-semblant d'existence.
Car le jour, même sans chaleur, c'est encore la vie!
Cependant, d'intrépides matelots, conscients des périls et des souffrances réservés par cet enfer aux audacieux qui l'osent affronter, s'efforcent déjà d'avancer plus loin encore: là où la bise est plus âpre, le froid plus dur, l'inconnu plus terrifiant.
En vain la banquise leur oppose la masse compacte de ses stratifications. Ils se ruent à l'assaut de l'infranchissable barrière avec cet élan farouche qui triomphe de l'obstacle ou brise l'instrument.
Hier la fête des patriotes, aujourd'hui le travail des explorateurs.
Les marins de la Gallia sont à l'œuvre, pendant que ceux de la Germania, sa rivale, n'en pouvant croire leurs yeux, les regardent stupéfaits.
La chose est pourtant bien simple, du moins à ce que prétend le capitaine d'Ambrieux. Le pack s'oppose au passage du navire. Eh bien! profitons des derniers beaux jours pour pratiquer un chenal. C'est-à-dire coupons d'une tranchée large de douze mètres trois kilomètres de glace.
C'est tout! Et c'est assez, n'est-ce pas?
Car ici, la glace n'offre plus, comme à la baie de Melville, une surface unie, d'une épaisseur assez faible, du moins relativement. C'est, au contraire, un redoutable amoncellement d'anciens glaçons amenés par la dérive, comprimés par le courant, soudés par le froid, et superposés de manière à mesurer, par places, trois et quatre fois l'épaisseur du pack proprement dit.
Qu'importe, d'ailleurs! En dépit de l'apparente insanité d'un tel projet qui fait penser à des fourmis essayant de saper une montagne, chacun s'est mis à la besogne, bravement.
Tout ce qui perce, coupe, rompt ou éclate, a été mis en réquisition. Haches, scies, couteaux à glace, tarières sont aux mains des matelots. Il s'agit de pratiquer à la main l'amorce du canal où doit pénétrer, au fur et à mesure de son exécution, la Gallia.
Quant à faire agir le taille-mer en acier, il n'y faut pas songer. L'éperon d'un cuirassé lui-même serait insuffisant.
La dynamite fournira d'excellents résultats, mais son emploi doit être réservé pour certains cas. Sous peine d'épuiser l'approvisionnement, il faut éviter le gaspillage, et ne recourir au précieux explosif que devant urgence absolue.
Mais, enfin, quel procédé rapide, et surtout efficace, pense donc employer le capitaine? Car en voyant les infimes parcelles enlevées à la main par les travailleurs, on ne peut supposer raisonnablement qu'il espère venir à bout de l'ennemi par ce moyen primitif.
Le capitaine veut tout simplement couper la banquise à la scie.
Mais, entendons-nous bien. Il ne s'agit point ici du fragile instrument dont se servent les menuisiers ou les charrons pour découper leurs planches. La scie à glace, dont les dents vont bientôt ronger le pack de la base au sommet, est une énorme bande d'acier, mesurant six mètres de hauteur, sur quatre-vingts centimètres de largeur.
Très bien! Voici l'instrument pourvu de dents formidables, longues de dix centimètres. Mais, où trouver un moteur? Probablement la machine du navire.
La machine, d'accord. Il ne faut pas oublier, pourtant, que la scie, ou plutôt les deux lames de la scie, doivent agir parallèlement à quinze, vingt, peut-être quarante mètres du bâtiment.
Comment actionner, à pareille distance, un tel engin?
Au moyen de l'électricité, parbleu!
L'électricité?.. sans doute: grâce à la découverte d'un éminent ingénieur français, Marcel Desprez, qui trouva en 1875 la transmission des forces par l'électricité.
A ce propos, une petite digression est ici nécessaire.
La découverte de Marcel Desprez part d'un principe qui peut se formuler ainsi: Fournissez du mouvement à une machine dynamo-électrique, et elle vous donnera de l'électricité; fournissez-lui de l'électricité, et elle vous donnera du mouvement.
On donne à cette propriété le nom de réversibilité, parce que les machines magnéto ou dynamo-électriques, qui toutes la possèdent, peuvent transformer le travail mécanique en électricité, ou inversement l'électricité en travail mécanique.
Supposons, maintenant, une machine dynamo actionnée par un moteur quelconque: gaz, chute d'eau, air comprimé, vapeur, etc. Sous l'influence du mouvement qu'elle reçoit, elle produit une certaine quantité d'électricité; d'où son nom de génératrice.
Mettons-la en communication par un fil de cuivre ou de fer avec une autre machine de même espèce. Aussitôt cette seconde machine, dite réceptrice, s'empare de l'électricité à elle transmise par le fil conducteur, et, chose étonnante, fournit, au lieu d'électricité, du travail mécanique ou plutôt restitue le travail mécanique développé par le moteur.
De façon que si ce moteur produit, par exemple, une force de cent chevaux, cette force, transformée en électricité par la génératrice, et transportée sous cet état, jusqu'à la réceptrice, redevient force, ou mouvement, susceptible d'être employé à un travail quelconque 7.
Cependant, la transmission ne s'opère pas intégralement. Il se produit, avec les machines actuellement employées, une perte qui atteint encore trente à trente-deux pour cent.
Mais, n'est-ce point merveilleux, de pouvoir expédier ainsi une force, quelque considérable qu'elle soit, par un simple fil, comme une dépêche, à une distance de cent, mille, dix mille mètres et plus!
En préparant son expédition polaire, le capitaine d'Ambrieux ne pouvait manquer de prévoir le cas où il devrait attaquer corps à corps d'énormes barrières de glaçons. Sachant combien sont limités et peu efficaces les moyens habituels, il avait songé, dès le principe, à mettre à profit la découverte de notre éminent compatriote.
Le travail de la machine, inutilisé jusqu'alors, parce qu'elle ne pouvait avoir d'action en dehors du navire, fournirait ainsi un appoint considérable.
Il avait donc acheté, jadis, deux dynamos du système Desprez, susceptibles de transporter, malgré leur peu de volume, une force de six chevaux, à telle ou telle distance.
Le moment est venu de recourir à ces puissants et ingénieux auxiliaires.
Déjà les charpentiers ont préparé les bigues devant supporter l'arbre de couche portant la roue qu'actionnera la réceptrice. Celle-ci est installée sur la glace. La génératrice est à bord, près du «petit cheval» qui va lui fournir le mouvement. Un fil de cuivre isolé sous une couche de gutta-percha les fait communiquer.
En outre, comme à chaque morsure de la scie l'appareil doit progresser d'autant, les bigues sont pourvues, inférieurement, de galets de bois leur permettant de rouler au fur et à mesure, à la condition, toutefois, que les protubérances de la banquise ne seront pas trop accentuées. Il faudra, dans ce cas, recourir, au préalable, à un nivellement sommaire.
Quant au mécanisme qui produira le mouvement de va-et-vient de la lame ou des deux lames, selon qu'on pourra les faire ou non agir simultanément, il est d'une extrême simplicité.
L'arbre de couche porte deux excentriques tournant chacun dans un cadre d'acier, fixé au sommet des deux scies.
Le mouvement de haut en bas et de bas en haut se produira ainsi directement, sans organes intermédiaires, sans complications, presque sans frottements.
Comme les lames, bien que notablement épaisses, risqueraient de se plier et peut-être, vu leur longueur, de se rompre pendant que s'opère le mouvement de haut en bas, le capitaine les a munies à la partie inférieure d'un poids assez lourd pour éviter les flexions latérales et leur donner une rigidité suffisante.
Ce rapide exposé de la situation indique suffisamment quels doivent être les tracas de l'organisateur et les fatigues des travailleurs.
Là-bas, à bord de la Germania toujours immobile et rogue comme un factionnaire prussien, on braque sur la Gallia une batterie de lorgnettes.
Les Allemands en sont pour leurs frais et leur curiosité déçue, car la première journée – c'est-à-dire ce qu'on appelle journée là-bas pendant l'été où il n'y a pas de nuit – se passe en préparatifs accomplis avec une hâte fiévreuse.
Après un repos vaillamment acheté, les travaux proprement dits commencent le 17 juillet, au quart de quatre heures.
Les bigues sont en place et leur mouvement de propulsion assuré par des poulies de renvoi. La génératrice et la réceptrice, reliées par le fil conducteur, sont prêtes à fonctionner. Une seule scie va être actionnée à titre d'essai. La lame, bien verticale, repose, les dents en avant, sur la surface qu'elle doit entamer. La partie inférieure, lestée comme il vient d'être dit, plonge dans l'eau à environ deux mètres.
Un coup de sifflet retentit. Fritz, la main sur le levier de mise en train, régularise doucement la distribution de vapeur et soudain les dynamos se mettent à tourner. En même temps la scie monte avec un raclement métallique, puis descend et remonte, en entamant le banc avec une singulière aisance.
Les matelots n'ont pas jusqu'alors bien compris l'intention du capitaine. Mais la démonstration pratique exécutée sous leurs yeux les édifie complètement.
Aussi, quelle joie, quand ils constatent l'incroyable puissance de l'engin qu'ils viennent d'improviser!
«Mâtin de nom de d'là! comme ça mord!.. s'écrie Constant Guignard.
– Qu'on dirait que c'te faillie glace est censément du beurre,» opine gravement son compatriote Courapied dit Marche-à-Terre.
Le va-et-vient de la scie s'opère avec une telle rapidité, qu'en moins d'un quart d'heure l'énorme bloc est sectionné sur une longueur de quinze mètres.
«Stop!» commande le capitaine.
Tout s'arrête en même temps, afin d'opérer un changement dans la direction de l'appareil.
Les bigues sont orientées un peu sur la gauche, de façon à permettre à la scie d'obliquer. Il faut, maintenant couper perpendiculairement à la première section pour détacher de la banquise l'avant de ce premier fragment. La lame obéit à l'impulsion, trace un arc de cercle d'environ douze mètres de diamètre, la largeur du futur chenal; et pour la seconde fois le commandement de: Stop!
Deuxième changement de direction pour revenir parallèlement au premier trait de scie, et achever la section entière du bloc.
Pour leur coup d'essai, les matelots, bien novices pourtant, se sont acquittés à merveille de cette tâche délicate, exigeant une attention de tous les instants et une précision absolue.
En effet, sous peine de laisser la scie fonctionner dans le vide, ils doivent, à chaque coup, faire mouvoir la poulie de renvoi qui entraîne l'appareil tout entier, l'avancer d'une quantité absolument égale au travail de la scie, ni trop, pour éviter une rupture, ni trop peu pour qu'elle morde efficacement.
Comme la réceptrice évolue sur la glace en même temps que les bigues, il faut également surveiller l'allongement progressif du fil conducteur, se garder de toucher aux dynamos sous peine d'être foudroyé, bref un apprentissage complet à improviser.
Enfin, un bloc de quinze mètres de long sur douze de large et quatre d'épaisseur est détaché.
Et maintenant, comment se débarrasser d'une pareille masse, mesurant plus de huit cents mètres cubes, en tenant compte des aspérités.
«Bah! disent entre eux les matelots, le capitaine doit avoir son idée.»
Sans doute!.. il en a même trois, avec l'embarras du choix.
Bien qu'il ait, en outre, le droit absolu d'ordonner, quitte à se tromper comme un simple mortel, il préfère, avant de rien entreprendre, tenir conseil avec le second, le lieutenant et le docteur.
«Ton avis, Berchou? dit le capitaine, sans préambule.
– Ma foi, capitaine, toute réflexion faite, je pense qu'il faut donner au canal une largeur double.
– Vingt-cinq mètres au lieu de douze.
– De cette façon, la goélette se rangeant contre un des bords pourra laisser couler les glaçons entraînés par les hommes avec des haussières.
– J'y ai pensé.
«Mais il est à craindre que plus tard, quand le canal aura une certaine longueur, ses bords ne se rapprochent sous la pression exercée latéralement par les deux tronçons de la banquise.
«Alors, les glaçons ne pourront plus s'écouler.
– Diable! Je n'avais pas songé à cela.
– Et vous, docteur?
– Moi, je me réserve.
– Et vous, Vavasseur?
– Moi aussi, capitaine.
– Ce premier procédé provisoirement éliminé, nous devrons, je crois, recourir à la dynamite, pour désarticuler chacun des blocs.
«Les fragments s'enfonceront totalement ou en partie, et ne gêneront peut-être pas trop la marche du navire.
«Il faudra donc tenter ce moyen, bien que la proximité relative des hommes et des appareils le rende périlleux.
– C'est vrai! ajoutent simultanément le second, le docteur et le lieutenant.
– A moins que… ajoute le capitaine.
«Eh! oui… c'est cela!
– Vous avez trouvé?
– Je le crois, mais laissez-moi mûrir ce projet qui fait face à toutes les exigences.
«Je veux vous en laisser la surprise.
«Pour l'instant, essayons de la dynamite.»
Afin de ne pas perdre de temps, cinq trous de mine furent forés et chargés sur le premier glaçon, pendant que la scie en découpait un second d'égales dimensions. Puis la lame retirée de la rainure, les bigues furent éloignées ainsi que la réceptrice.
L'explosion produisit bien moins d'effet que là-bas, à la baie de Melville, sur de jeunes glaces, moitié moins épaisses, et infiniment moins compactes.
Le bloc fut seulement désarticulé en gros fragments que la goélette dut écraser, pulvériser en détail, pour avancer seulement de quinze mètres.
Cependant, le résultat se trouvait acquis. Le procédé n'était pas défectueux, à la condition que la soute aux munitions renfermât un approvisionnement suffisant.
Et d'Ambrieux calculait qu'il lui faudrait au moins un millier de cartouches, en admettant, chose peu probable, que la banquise ne s'épaissirait pas, au centre.
Sinon, il faudrait augmenter le nombre des trous de mine.
Néanmoins, tout marcha très convenablement le premier jour, à ce point que le chenal mesurait soixante mètres de longueur, après un travail acharné de seize heures.
Soixante mètres, c'est là sans doute un résultat, étant donné surtout la nature de l'obstacle, et la multiplicité des opérations que nécessite l'entreprise.
Mais d'Ambrieux, pensant que le pack mesure environ trois kilomètres, il ne faudra pas moins de cinquante jours pour le couper entièrement. Encore, est-on sûr d'atteindre quotidiennement la moyenne de soixante mètres?
Même en l'atteignant, c'est un total de cinquante journées, pour arriver à la bordure septentrionale, si toutefois il ne survient pas d'accident.
Or, dans cinquante jours on sera exactement au 7 septembre, alors que les froids ont déjà repris avec intensité. A cette époque, les glaçons se forment rapidement sur les eaux libres, ceux qui viennent d'être coupés se ressoudent aussitôt, immobilisant la scie. Donc le chenal sera sans cesse obstrué, le sciage deviendra presque impossible.
Il faut à tout prix gagner du temps.
En conséquence, le capitaine décide que les travaux continueront jusqu'à nouvel ordre, sans interruption.
Le docteur, consulté sur la question d'hygiène, déclare que les matelots pourront supporter impunément ce surcroît de fatigue à la condition que leur ordinaire sera augmenté d'une demi-ration, et qu'ils feront le quart comme à bord.
C'est entendu.
Grâce à cette mesure et au prodigieux entrain du vaillant équipage, le chenal s'allonge, le 18, de cent mètres.
Le 19, on gagne cent dix mètres! La longueur totale est donc de deux cent soixante-dix mètres!
Mais aussi, que de difficultés, d'efforts et de fatigues!
Bah! on est Français, après tout, et on triomphe des difficultés par la constance, on aide aux efforts par une chanson, on nargue la fatigue par la gaîté.
Cependant, les Allemands, d'abord claquemurés comme des hiboux, commencent peu à peu à donner signe de vie.
On les voit sortir de leur trois-mâts, se promener sur la glace, patiner, faire courir leur traîneau, bref rompre insensiblement avec leur immobilité des premiers jours.
Ils ont même des tendances à s'approcher du chantier où les français travaillent à corps perdu.
«Diable m'emporte! grogne Fritz, le digne Alsacien qui ne mâche pas ses mots, les faillis chiens sont capables de venir se fourrer jusqu'au milieu de nous.
«Ah! mais, minute!
– Allons, mon camarade, un peu de calme, dit le second qui surveille la génératrice, et n'allez pas nous faire des histoires.
– Peuh! des histoires… je n'en demande qu'une seule…
«Fourrer cent kilos de dynamite dans les flancs à ce cachalot de malheur et y mettre le feu… dussé-je sauter avec lui.
– Diable! comme vous y allez!
– Que voulez-vous, moi, je me tourne les sangs, quand je vois ces corbeaux de Prusse…
«Et dire que je viens au pôle Nord pour me rencontrer avec eux.
«Tenez… quand je vous le disais…
– Ma parole! en voici deux qui se dirigent de ce côté.
– Eh bien! ils ont du toupet.
«Tonnerre! si j'étais à la place du capitaine, ce que je te les recevrais à coups de carabine!
– Mon vieux Fritz, encore une fois, du calme!
«Nous ne sommes pas en guerre… malheureusement!.. sans ça…
– A la bonne heure!
«Je sais bien que vous ne les aimez guère, vous qui leur avez si rudement travaillé le cœur, dans des temps.
– Ma foi! ça y est!.. les voici chez nous…
«Ils abordent le capitaine.
Correctement vêtus de flanelle bleu-marine, la tenue de bord adoptée généralement par les officiers de la marine marchande, deux personnages se sont approchés du commandant de la Gallia.
Celui-ci, qui n'est pas homme à autoriser des familiarités, ni à entamer des relations de voisinage, répond froidement à leur salut, et attend silencieusement.
«Herr capitaine, dit l'un d'eux, permettez-moi de venir vous rendre ici la visite que vous aviez bien voulu me faire à Fort-Conger, et de vous présenter le commandant de la Germania, herr capitaine Walther.
– Heureux et très honoré de faire votre connaissance, dit ce dernier, sans même attendre un mot de politesse.
«Et je suis très obligé à mon second, meinherr Vogel, d'opérer ce rapprochement entre des rivaux qui ne sauraient être des ennemis.»
Très ennuyé de l'incident, mais trop gentilhomme pour en laisser rien paraître, d'Ambrieux répond par une de ces banalités de bon ton qui dressent une insurmontable barrière entre des indifférents.
Puis il s'excuse de recevoir ainsi les visiteurs en plein air alléguant les travaux urgents qui exigent toute sa sollicitude.
«Mais, très honoré herr capitaine, répond Walther, nous serions désolés de vous causer le plus petit dérangement.
«Vous accomplissez là une œuvre de géant… une merveille d'audace et de patience…
– J'essaye tout simplement de passer, interrompt d'Ambrieux.
– Votre modestie, Très Honoré herr capitaine, est à la hauteur de votre mérite.
«Car tenter un pareil tour de force avec si peu de monde n'est pas à la portée de tous.
– Croyez-vous qu'en dépit du petit nombre de mes auxiliaires, je ne réussirai pas?
– Dites plutôt que je le crains!
– Pas possible!
– Sans doute! car si, comme il est permis de le supposer ou même de l'admettre, je voulais bénéficier, pour m'élever au Nord, de cette voie si intrépidement ouverte…
– Ah! très bien… je comprends alors l'intérêt qui vous inspire «l'œuvre de géant»…
«Je trace une route… je passe… suivez-moi si bon vous semble… libre à vous de profiter de notre ouvrage.
– Cependant, très honoré herr capitaine, je reconnais volontiers qu'il y aurait injustice à ne pas vous offrir une compensation.
– Monsieur, n'ayant jamais fait aucun négoce, j'ignore ce que peut être un salaire.
– Veuillez m'excuser si l'expression dont je me suis servi a rendu imparfaitement ma pensée.
«En ma qualité d'étranger, la langue française a des subtilités qui m'échappent.
– Où voulez-vous en venir?
– A vous faire une proposition.
– Une proposition?.. à moi?.. laquelle, s'il vous plaît?
– Mon intention, aussitôt le retour du chef de l'expédition, meinherr Pregel, étant de m'avancer dans votre canal, comme il y aurait, je le répète, injustice pour nous à être au profit, sans avoir été à la peine, j'ai l'honneur de mettre à votre service mon équipage tout entier pour aider le vôtre à couper le pack.
– Vos hommes!.. avec les miens!..
«C'est impossible, monsieur.
– Ils vous obéiraient comme à nous-mêmes… du reste, nous serions là.
– Encore une fois, c'est impossible.
«Mon œuvre est et doit rester exclusivement française.
«Pour cela, des Français seuls doivent y collaborer!
– Cependant, très honoré herr capitaine, veuillez considérer que nous passerons quand même après vous.
– Je le répète, vous êtes libres.
– Un dernier mot: Veuillez vous mettre à ma place.
«Si vous trouviez le chenal pratiqué dans la banquise par la Germania, en profiteriez-vous?
– Non!»