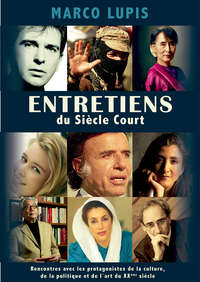Kitabı oku: «Entretiens Du Siècle Court», sayfa 5
Mireya Garcia
Impossible de pardonner
Le Chili, déjà agité par les conséquences de la contradictoire sentence londonienne sur Pinochet, avait été traversé par une nouvelle terrible qui avait contribué à faire monter dâun cran encore la tension générale, déjà vive, alors même que la réunion du Conseil de sécurité nationale, convoqué de toute urgence par le président Frei, était toujours en cours au Palais présidentiel de la Moneda . Grâce aux révélations de lâévêque de Punta Arenas, monseigneur Gonzales, on avait découvert un nouveau centre de détention illégale datant de la dictature militaire, où les restes de plusieurs centaines de desaparecidos avaient été identifiés.
Le centre de détention se trouvait à lâextrême nord du Chili, à cent dix kilomètres du chef-lieu Arica, dans une région désertique où lâon en soupçonnait lâexistence depuis longtemps. On était ainsi venu à savoir que la magistrature locale enquêtait sur le centre depuis plusieurs semaines, dans le secret le plus absolu. Malgré la discrétion observée sur lâaffaire par Juan Cristobal Mera, juge de la troisième section pénale dâArica, mais grâce aux déclarations du gouverneur local, Fernando Nuñez, on savait que les fosses communes se trouvaient dans une zone côtière du territoire de Camarones. Tout près du vieux cimetière de cette petite ville, que les autorités indiquaient comme étant âdâun accès facileâ.
« Il convient de préciser » avait promptement déclaré le gouverneur Nuñez aux journalistes « que les coordonnées géographiques ne sont pas très précises, mais nous savons que le juge sâest déjà assuré de lâexistence dâau moins deux fosses. Quoi quâil en soit, nous demanderons la présence du ministre Juan Guzan Tapia au moment de lâexhumation éventuelle des restes des desaparecidos ».
Les indications qui avaient permis de repérer ce centre de détention venaient de révélations de lâévêque Gonzalez, qui disait les avoir reçues « sous le secret de la confession », comme il lâavait lui-même déclaré. On ne savait pas encore clairement à combien de centres de détention se rapportaient ces informations.
Je décidai alors de creuser lâeffroyable réalité des desaparecidos chiliens, en rencontrant la leader de lâAssociation des familles des disparus.
*****
Emprisonnée, torturée, exilée. Mireya Garcia a perdu plus que sa jeunesse avec le coup dâÃtat de Pinochet. Son frère a disparu depuis plus dâun quart de siècle maintenant. Aujourdâhui vice-présidente de lâAssociation des familles des détenus âdesaparecidosâ, elle nâa jamais cessé de se battre pour la recherche de la Vérité.
Le lieu où, jour après jour, depuis des années maintenant, se réunissent ces mères, ces grands-mères, chacune avec son fardeau de douleur, chacune avec la photographie de son fils, de son frère, de son mari ou de son petit-fils disparu, est un petit immeuble bleu, proche du centre de Santiago. Les murs de la cour sont couverts de photos de desaparecidos ; pour chacun dâeux, une photo aux couleurs passées et une phrase qui répète la même question, indéfiniment : Donde estan ? « Où sont-ils ? ». Ponctuellement, la succession ininterrompue de photos et de questions toutes identiques est suspendue par une rose, par une fleur.
Quel souvenir avez-vous de ces années, du coup dâÃtat ?
Un souvenir très vague. Jâétais à la maison, et je me rappelle simplement avoir entendu des musiques militaires à la radio. Et puis plein dâhommes, en uniforme, dans les rues. Je nâarrivais pas encore à me rendre compte que, ce jour-là , lâHistoire de mon pays, le Chili, avait subi un coup très durâ¦
Quel âge aviez-vous alors ?
Jâappartenais à la jeunesse socialiste de Concepcion, une petite ville à quelques centaines de kilomètres au sud de Santiago. Je voulais faire des études, me marier, avoir une famille et des enfants⦠Mais tout sâest écroulé. Vite, trop vite. Aujourdâhui, jâarrive à parler de tout cela avec un calme relatif. Mais pendant des années, jâétais incapable de ré-évoquer ces jours-là . Même avec ma familleâ¦
Ils sont venus nous chercher un soir. Il nây avait que mon frère et moi à la maison⦠Jâai été arrêtée (si on peut parler dâarrestation) puis torturée. Pour être sincère, je nâarrive toujours pas à parler de ces humiliations aujourdâhui â¦
Je nâai plus revu mon frère. Plus tard, quand nous avons réussi avec ma famille à nous enfuir à lâétranger, au Mexique, jâai appris que Vicente avait définitivement disparu. Je me souviens comme dâune angoisse terrible de savoir quâil était peut-être encore vivant, quelque part, et que moi jâétais là , à des milliers de kilomètres, sans pouvoir rentrer au Chili, sans pouvoir le chercher, lâaider.
Câest à cette époque que vous avez eu lâidée de fonder cette association ?
Oui. Nous étions nombreuses, exilées au Mexique, à avoir des membres de nos familles que la dictature de Pinochet avait fait disparaître. Nous organisions des défilés dans les rues. Une arme bien faible, contre une dictature aussi féroce, mais au moins les gens ont commencé à sâintéresser à nous. Ils ont commencé à savoir.
Quand avez-vous pu rentrer au Chili ?
Il a fallu quinze ans. Et, aujourdâhui encore, je me sens exilée. Une exilée dans mon propre pays.
Quâavez-vous pu apprendre sur le sort de votre frère ?
Presque rien. Juste quâil a été déporté dans un centre de détention clandestin, un centre de torture, qui sâappelait Cuartel Borgoño et qui nâexiste plus aujourdâhui. Ils ont tout détruit au bulldozer, pour faire disparaître les traces, et les preuves.
Croyez-vous que lâon puisse attribuer toute la responsabilité à Pinochet ?
Non. Et câest le côté incroyable du Chili. Dans les archives des tribunaux, il y au moins une trentaine de procédures judiciaires ouvertes contre des généraux, des colonels, des politiques et de simples âouvriersâ de la mort, qui se sont rendus coupables de torture, dâassassinats et de violences de tout type. Mais le côté absurde de mon pays est que tout le monde sait que trois mille personnes au moins ont disparu dans le néant, alors que les tribunaux ne reconnaissent la disparition avérée que de onze dâentre elles. Câest comme si un pays tout entier savait, mais tournait la tête de lâautre côtéâ¦
Certains disent que la Justice nâest pas un concept universel, mais déterminé par le moment historique, les conditions dâun Ãtat⦠Vous êtes dâaccord ?
Non, moi je crois que la dignité, le respect et la justice sont des concepts universels. Sinon, pourquoi signer des déclarations solennelles en faveur des droits de lâhomme ou des traités contre la torture ?
Comment avez-vous vécu les péripéties de lâarrestation de Pinochet ?
Ãa a été une succession dâespoirs et de déceptions. Ce qui sâest passé à Londres a mis en évidence le fait que le Chili est toujours un pays profondément divisé. Dans lequel les militaires exercent encore un pouvoir fort, décisif, sur le plan des équilibres politiques et institutionnels. Dâun autre point de vue, jâai été presque stupéfiée. Pendant toutes ces années, Pinochet avait construit son impunité avec un soin presque maniaque. Il avait même fait changer la Constitution pour personne ne puisse lâatteindre. Et sâil nâest pas jugé à lâétranger, je suis sûre quâici, au Chili, Pinochet ne sera jamais conduit devant un tribunal. Jamais au Chili.
Que signifie le pardon, pour vous ?
Je crois que câest une question absolument personnelle, variable dâun individu à lâautre. Je suis incapable de pardonner les bourreaux de mon frère. Certains penseront que je suis vindicative. Ce nâest pas cela. Je ne cherche pas la vengeance.
Je veux seulement la Vérité.
9
Kenzaburô Ãé
Prix Nobel de littérature 1994
Le cri silencieux
Au printemps 2001, je me trouvais au Japon pour une série de reportages prévus depuis longtemps. Dans la neige dâun minuscule village de lâextrême nord du Japon, je regardais, emmitouflé, les gerbes de neige sale que soulevait, en sâéloignant rapidement, lâautobus fatigué qui mâavait emmené dans ces confins glacés de lâarchipel japonais, et ma tête résonnait de la phrase rendue célèbre par Bruce Chatwin : What Am I Doing Here ?
Comme lâa écrit Tiziano Terzani [11] : « Câest incroyable, mais les Japonais sont convaincus dâavoir tout sur leurs îles ». Jâallais en faire lâexpérience personnelle en rencontrant un charmant cultivateur dâail du district dâAomori, que tous considéraient comme un descendant direct de Jésus Christ⦠nippon ! [12] .
Quelques temps auparavant, jâavais eu le privilège dâinterviewer lâun des plus grands auteurs vivants du Japon contemporain, le prix Nobel de littérature Kenzaburô Ãé.
Lâauteur des âLettres aux années de nostalgieâ, et du âJeu du siècleâ, mâexpliqua pourquoi, dâaprès lui, le problème des Japonais contemporains était la recherche infructueuse du âsalut de lââmeâ.
*****
Depuis ses débuts en littérature, à lââge de vingt-deux ans, il ne sâest pas passé un mois sans que Kenzaburô Ãé, soixante-deux ans, ne travaille à un roman. Né en 1935 dans un petit village de lâîle de Shikoku, au sud-ouest du Japon, il est diplômé de lâuniversité de Tokyo, en littérature française. Dans ses Åuvres, il a abordé avec courage des thèmes comme la folie, la cruauté de lâhomme envers lâhomme, lâangoisse face à une réalité invivable, dans un style toujours direct, lucide, incisif. Jouant habilement des formes et des langages, utilisant une large gamme stylistique qui va du grotesque au conte en passant par le réalisme le plus impitoyable, lâauteur du Jeu du siècle a réussi à donner corps à des obsessions dans un face-à -face resserré avec ses propres fantômes et ses propres tourments. Et a construit des Åuvres telles que Dites-nous comment survivre à notre folie , où lâon ne peut jurer de rien, et où lâécriture se construit par à -coups et avec des surprises permanentes.
Narrateur sans pitié, quoique doté dâun humour profond, Kenzaburô Ãé défie et met durement à lâépreuve les nerfs du lecteur, jusquâaux limites du supportable.
« Jâai commencé par entrevoir la possibilité dâun nouveau type dâécriture, plus à même de définir la structure du roman contemporain. Le roman classique du XIX ème siècle, pensais-je, est rédigé à la troisième personne, parce quâelle peut analyser la psychologie de plusieurs personnages et permet de mieux comprendre notre époque. Jean-Paul Sartre, mon guide intellectuel, critiquait ce type dâécriture dans lequel lâauteur, dominant ses personnages et connaissant la psychologie de chacun dâentre eux, se propose au lecteur comme une espèce de Dieu. Jâavais moi aussi décidé dâécrire à la première personne, mais, en lisant et en réfléchissant, ces années-là , jâai compris quâen utilisant la structure à la première personne, le narrateur ne peut pas trouver lâensemble de lui-même. Câest pour cette raison que jâai commencé une nouvelle réflexion sur lâécriture à la troisième personne ».
Dans les grands écrivains du XX ème siècle, Ãé cite Thomas Mann et Robert Musil, et Günter Grass pour les contemporains. « Ils avaient prévu le déclin du roman du XX ème siècle et ont voulu créer un autre type dâécriture » assure-t-il « et un chef-dâÅuvre comme âL'homme sans qualité â de Musil en fait la preuve dâune manière pour le moins exaltante. En cette veille du XXI ème siècle, chacun sait quâil nâexiste plus de vision idéale capable de saisir le monde dans son intégralité. On ne croit ni en un Dieu au sens religieux traditionnel, ni en un dieu hégélien, ni même en un dieu marxiste. Lâhistoire de notre siècle montre quâil a été nécessaire de nous libérer de ces trois modèles. Je pense donc que le rôle de lâimagination dans une Åuvre narrative est dâessayer de proposer une vision dâensemble. Si mon Åuvre passée peut être comparée à un solo de piano, câest un quintette que je voudrais composer aujourdâhui ».
Cherchant ainsi un nouveau style personnel, Ãé souhaite pouvoir écrire un roman qui conclurait son existence : « Je nâai pas encore de trame définie, mais je voudrais écrire lâhistoire de personnes qui réfléchissent à la question de lââme en cette fin de siècle. Cette Åuvre serait la conclusion de ma vie et de mon Åuvre tout entière ».
Sâéchauffant et abandonnant un instant son apparence sévère et intransigeante, Ãé sâenthousiasme derrière les verres de ses grosses lunettes si japonaises, citant un livre de lâhistorien et théologien israélien Gershom Scholem, Sabbataï Tsevi , une biographie de celui que la mystique hébraïque de la fin du XVII ème siècle considérait comme le Messie. Alors que son mouvement prenait de lâampleur et que le jour de la transformation du monde approchait, Sabbataï, dénoncé par un rabbin polonais hostile à sa doctrine et obligé par un haut fonctionnaire ottoman à renier sa religion, sâétait converti à lâislam.
Dâaprès Ãé, lâinfluence du mouvement de Sabbataï Tsevi a été très forte. « Même après lâapostasie du âMessieâ, une part considérable des autorités religieuses et du peuple a conservé cette foi. Les disciples ont dépassé le maître » soutient-il. Lâéchec dâun mouvement, dâune foi, dâun crédo, sont précisément des thèmes qui reviennent souvent dans les romans dâÃé, depuis le Jeu du siècle jusquâà Les eaux me sont entrées jusquâà lââme. Selon Kenzaburô, lâécrivain qui « nâest pas un intellectuel avec un i majuscule, mais un sous-intellectuel émanant de la sous-culture », doit toujours garder un lien avec les événements sociaux. Et il doit les approfondir sur le plan historique avec lâobjectif de les analyser dans le contexte international.
« Ces dernières années » poursuit-il « cette problématique a fait sa réapparition, y compris dans mon pays. La secte Aum Shinrikyo , responsable de lâattentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo au printemps 1995, en est un exemple éclatant. La question est de savoir ce que feront les fidèles après lâéchec de ce mouvement. Et, en élargissant le champ dâobservation à un plan culturel plus vaste, on peut se demander comment vivront les gens après la disparition des courants idéologiques. Les Japonais ont toujours été attirés par lâirrationnel ; et câest précisément ce qui, dans le passé, à la veille de la seconde guerre mondiale, les a poussés sur la voie du nationalisme. Aujourdâhui encore, les jeunes sont en quête de mysticisme. Mais pendant le processus de modernisation, et en particulier pendant la période de croissance économique, les Japonais ont repoussé la tradition. Câest pourquoi, même si on peut pousser les fidèles à quitter les sectes comme Aum, il est impossible de leur dire où réside le salut de lââme. Et nâest-ce pas en cela que réside le problème de notre culture ? ».
Au lendemain de la mort de son ami Tôru Takemitsu, Ãé a commencé à écrire ce quâil appelle avec modestie ses âexercices de styleâ. Et il a lâintention de poursuivre, assure-t-il, en attendant de parvenir à exprimer de façon achevée la psychologie des personnages à la troisième personne : une enfant intelligente mais naïve ; une étrange jeune fille convertie ; un messie de notre temps et son prophète, cerveau de son mouvement. « Je me suis toujours pressé » conclut-il tranquillement. « Jâétais comme ces étudiants qui sâaffolent pour rendre leur copie avant la fin de lâépreuve. Maintenant, jâai la ferme intention de prendre tout le temps quâil me faut. Ou du moins celui qui me reste. Qui nâest plus très long ».
10
Benazir Bhutto
Le tragique destin dâune femme au pouvoir
Mon premier contact avec le sous-continent indien eut lieu en mai 1996. Jâétais arrivé à Hong Kong depuis moins dâun an et Panorama me demanda dâinterviewer le Premier ministre pakistanais, Benazir Bhutto. à cette période, les inquiétudes internationales vis-à -vis du développement du programme nucléaire de Karachi étaient très fortes, et la tension historique avec lâInde était extrême. Dans ce contexte international, lâinterview exclusive de Madame Bhutto fut un beau coup, en termes journalistiques.
Soumis à des mesures de sécurité draconiennes -elle vivait sous une menace permanente dâattentatsâ je rencontrai à Karachi une femme très belle, au charisme extraordinaire. Dotée dâun pedigree politique de premier plan. Fille aînée du Premier ministre déchu Zulfikar Ali Bhutto, et de Begum Nusrat Bhutto, sa mère, qui avait des origines kurdo-iraniennes. Son grand-père paternel sir Shah Nawaz Bhutto était en revanche sindhi , et lâune des figures-clef du mouvement indépendantiste pakistanais. Benazir prit ses fonctions de Premier ministre le deux décembre 1988, première femme à assumer de telles fonctions dans un pays musulman, puis fut réélue à ce poste le dix-neuf octobre 1993, après avoir été impliquée dans une série de scandales.
En novembre 1996, quelques mois après cette interview, elle fut destituée (pour la deuxième fois, cela sâétait déjà produit en 1990), renversée par les soupçons de corruption et surtout par les désinvoltes activités financières de son mari, Asif Ali Zardari, surnommé âMister dix pour centâ en raison des pots de vins quâil aurait exigés de nombreux hommes dâaffaires.
La turbulente carrière de Madame Bhutto, passée dans un premier temps par les rangs de lâopposition pakistanaise, se poursuivit à la présidence du Parti Populaire Pakistanais jusquâà fin 2007.
Le vingt-sept décembre 2007, alors quâelle intervenait dans une réunion publique organisée à Rawalpindi, à trente kilomètres à lâest de la capitale Islamabad, un kamikaze se fit exploser au milieu de la foule réunie pour lâécouter, tuant au moins vingt personnes.
Transportée à lâhôpital, Benazir Bhutto y mourut peu après de ses très graves blessures.
*****
Les Ãtats-Unis ont récemment accusé le Pakistan dâavoir acquis auprès de la Chine des matériels sophistiqués utilisés pour lâenrichissement de lâuranium. On soupçonne le Pakistan de préparer un essai nucléaire. Que répondez-vous ?
La Chine, comme le Pakistan, a décidé quâaucun matériel destiné à la production dâuranium enrichi ne peut être exporté ou importé. à la lumière de cette mesure, je crois que les Ãtats-Unis devraient mieux peser les informations en leur possession. Le programme nucléaire pakistanais répond à des objectifs civils. LâInde, au contraire, serait sur le point de réaliser des essais atomiques alors même que lâancien Premier ministre de New Delhi a déclaré quâil ne pouvait pas exclure lâaction nucléaire. Câest pour cela que jâai décidé dâécrire à Bill Clinton et à dâautres chefs dâÃtat, pour leur faire part de mes inquiétudes.
Quelles sont-elles ?
Si la communauté internationale ne conjuguait pas tous ses efforts pour conjurer un essai nucléaire de lâInde, les conséquences sur le sous-continent indien pourraient être tragiques. Jâespère que les prochains rapports indiqueront quâil sâest agi de bruits sans fondements. Ce serait une erreur de croire que le Pakistan peut accepter un chantage au nucléaire ou aux missiles de la part de lâInde.
Et votre réponse au pointage du missile tactique indien Prithvi ?
Il est déplorable quâà une époque de désarmement, il existe un programme indien pour des missiles à moyenne et longue portée. On sâexpose par là à un risque de conflits dans une zone qui va du Yemen au Détroit de Malacca. Si des missiles sont pointés vers Lahore ou Karachi, le Pakistan évaluera les mesures à adopter en réaction.
Une reprise du dialogue entre lâInde et le Pakistan est-elle possible ?
Câest le Cachemire qui est à lâorigine de la tension entre nos deux pays. Je souhaiterais trouver une solution, mais lâInde refuse toute discussion : dâaprès New Delhi, il nây a rien à discuter, parce que le Cachemire est Indien, et câest tout. Ces prémisses mettent fin à tout espoir de dialogue. Quoi quâil en soit, nous avons également proposé la médiation dâune tierce partie, en rappelant le fait que la question du Cachemire est un problème collectif, parce quâil peut mettre en péril la paix et la sécurité de la région tout entière. Enfin, en dernière instance, lâInde a proposé dâorganiser des élections libres au Cachemire. Ãlections qui ont été refusées par les groupes politiques locaux. Aucune solution négociée nâest possible sans lâaccord des populations.
Quelle est votre position sur le traité pour lâinterdiction des essais atomiques ?
Nous le soutenons, mais nous sommes préoccupés par le fait que lâInde essaie dâen retarder la signature en exigeant que soit dâabord mis en place un plan de désarmement international : il nâest pas réaliste de croire que le monde puisse mettre en Åuvre ce plan dans des délais courts.
Dâaprès certaines informations, il existe, tant en Inde quâau Pakistan, des courants politiques qui souhaitent faire exploser un engin atomique pour pouvoir ensuite adhérer au traité pour lâinterdiction des essais nucléaires en position de force, avec le statut de puissance nucléaireâ¦
Je crois quâil y a des faucons des deux côtés, dans mon pays comme de lâautre côté de la frontière. Personnellement, jâai toujours cru au désarmement, à la non-prolifération nucléaire et à la paix. Jâai fait tout mon possible, au Pakistan, pour bannir les préjugés ethniques et les sectarismes de tout type, ce que jâappelle la « culture de la Kalachnikov », celle de ceux qui se promènent avec une mitrailleuse en bandoulière pour résoudre leurs problèmes. Je souhaite que ni au Pakistan ni en Inde nâarrive jamais le jour où les faucons vaincront.
11
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.