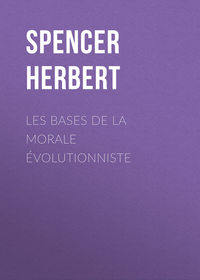Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Les bases de la morale évolutionniste», sayfa 11
CHAPITRE VIII
LE POINT DE VUE SOCIOLOGIQUE
48. Ce n'est pas pour la race humaine seulement, mais pour toutes les races, qu'il y a des lois du bien vivre. Étant donnés son milieu et sa structure, il y a pour chaque genre de créatures une série d'actions destinées par leurs genres, leurs degrés et leurs combinaisons, à assurer la plus haute conservation que permette la nature de l'être. L'animal, comme l'homme, a besoin de nourriture, de chaleur, d'activité, de repos, etc.; ces besoins doivent être satisfaits à certains degrés relatifs pour rendre sa vie complète. La conservation de sa race implique la satisfaction d'appétits spéciaux, sexuels et philoprogénitifs, dans des proportions légitimes. Par suite, on peut supposer pour les activités de chaque espèce, une formule qui (on pourrait développer cette idée) constituerait pour cette espèce un système de moralité. Mais un tel système de moralité aurait peu ou point de rapports avec le bien-être d'autres êtres que l'individu lui-même ou sa race. Un être inférieur étant, comme il l'est, indifférent aux individus de sa propre espèce, et ordinairement hostile aux individus des autres espèces, la formule de sa vie ne tiendrait aucun compte de l'existence de ceux avec lesquels il se rencontre, ou plutôt une telle formule impliquerait que la conservation de sa vie est en opposition avec la conservation de celle des autres.
Mais en s'élevant des espèces inférieures à l'être de l'espèce la plus élevée, l'homme, ou, plus strictement, en s'élevant de l'homme de la phase pré-sociale à l'homme de la phase sociale, la formule doit contenir un facteur additionnel. Bien qu'il ne soit pas particulier à la vie humaine sous sa forme développée, la présence de ce facteur est cependant, au plus haut degré, caractéristique de cette vie. Bien qu'il y ait des espèces inférieures qui montrent de la sociabilité dans une très large mesure, et bien que, dans la formule de leurs existences complètes, on ait à tenir compte des relations qui naissent de l'union, cependant notre propre espèce doit, à tout prendre, être distinguée comme ayant pour la vie complète une formule qui reconnaît spécialement les relations de chaque individu avec les autres en présence desquels et en coopération avec lesquels il lui faut vivre.
Ce facteur additionnel, dans le problème de la vie complète, est, en vérité, si important que les modifications de conduite qu'il a rendues nécessaires en sont venues à former une partie capitale du code de la conduite. Comme les inclinations héréditaires, qui se rapportent directement à la conservation de la vie individuelle, sont très exactement ajustées aux besoins, il n'a pas été nécessaire d'insister sur le fait qu'il est bon pour la conservation de soi-même de se conformer à ces inclinations. Réciproquement, comme ces inclinations développent des activités qui sont souvent en conflit avec les activités des autres, et comme les sentiments qui correspondent aux droits d'autrui sont relativement faibles, les codes de morale insistent avec force sur les empêchements d'agir qui résultent de la présence de nos semblables.
Ainsi, au point de vue sociologique, la morale n'est rien autre qu'une explication définie des formes de conduite qui conviennent à l'état de société, de telle sorte que la vie de chacun et de tous puisse être la plus complète possible, à la fois en longueur et en largeur.
49. Mais ici, nous rencontrons un fait qui nous empêche de placer ainsi en première ligne le bien-être des citoyens considérés individuellement, et nous oblige de mettre en première ligne le bien-être de la société considérée comme un tout. La vie de l'organisme social doit, en tant que fin, prendre rang au-dessus des existences de ses unités. Ces deux fins ne sont pas en harmonie à l'origine, et, malgré la tendance à les mettre en harmonie, elles sont encore partiellement en conflit.
A mesure que l'état social se consolide, la conservation de la société devient un moyen de conserver ses unités. La vie en commun s'est établie parce que, en somme, on a reconnu qu'elle était plus avantageuse pour tous que la vie dans l'isolement, et cela implique que maintenir cette combinaison c'est maintenir les conditions d'une existence plus satisfaisante que celle que les personnes unies dans cette combinaison auraient de toute autre manière. Par suite, la conservation de la société par elle-même devient un but prochain qui prend le pas sur le but dernier, la conservation de l'individu.
Cette subordination du bien-être personnel à celui de la société est cependant contingente: elle dépend de la présence de sociétés antagonistes. Tant que l'existence d'une société est mise en péril par les actes de communautés voisines, il reste vrai que les intérêts des individus doivent être sacrifiés à ceux de la communauté, autant que cela est nécessaire au salut de la communauté. Si cette vérité est manifeste, il est manifeste aussi, par voie de conséquence, que, lorsque cesse l'antagonisme social, cette nécessité de sacrifier les droits privés aux droits publics cesse aussi; ou plutôt les droits publics cessent d'être en opposition avec les droits privés. Le but dernier a toujours été de favoriser les existences individuelles, et, si ce but dernier a été subordonné à la fin prochaine de sauver l'existence de la communauté, la seule raison en a été que cette fin prochaine était une condition pour atteindre la fin dernière. Lorsque l'agrégat n'est plus en danger, l'objet final poursuivi, le bien-être des unités, n'ayant plus besoin d'être subordonné, devient l'objet immédiat de la poursuite.
Ainsi, nous avons à donner des conclusions différentes touchant la conduite humaine, suivant que nous avons affaire à un état de guerre habituel ou éventuel, ou à un état de paix permanent et général. Examinons ces deux états et ces deux sortes de conséquences.
50. Actuellement, l'homme individuel doit tenir compte, comme il convient, dans la conduite de sa vie, des existences d'autres êtres qui appartiennent à la même société, et en même temps il est quelquefois appelé à mépriser l'existence de ceux qui appartiennent à d'autres sociétés. La même constitution mentale ayant à satisfaire à ces deux nécessités est fatalement en désaccord avec elle-même, et la conduite corrélative, ajustée d'abord à un besoin, ensuite à l'autre, ne peut pas être soumise à un système moral qui soit bien conséquent.
Tantôt nous devons haïr et détruire nos semblables, tantôt les aimer et les assister. Employez tous les moyens pour tromper, nous dit l'un des deux codes de conduite, et l'autre nous dit en même temps d'être de bonne foi dans nos paroles et dans nos actes. Saisissez-vous de tout ce qui appartient aux autres, et brûlez ce que vous ne pouvez emporter est une des injonctions de la religion de la guerre, tandis que la religion de l'amitié condamne comme des crimes le vol et l'incendie. Tant que la conduite se compose ainsi de deux parts opposées l'une à l'autre, la théorie de la conduite reste confuse.
Il coexiste une incompatibilité analogue entre les sentiments qui correspondent respectivement aux formes de coopérations requises pour la vie militaire et pour la vie industrielle. Tant que les antagonismes sociaux sont habituels, et tant que, pour rendre efficace l'action contre d'autres sociétés, une grande soumission à ceux qui commandent est nécessaire, il faut pratiquer surtout la vertu de la fidélité et le devoir d'une obéissance implicite: le mépris de la volonté du chef est puni de mort. Mais lorsque la guerre cesse d'être chronique, et lorsque les progrès de l'industrie habituent les hommes à défendre leurs propres droits tout en respectant les droits d'autrui, la fidélité devient moins profonde, l'autorité du chef est mise en question ou même niée par rapport à diverses actions, à diverses croyances privées. Les lois de l'Etat sont bravées avec succès dans plusieurs directions, et l'indépendance politique des citoyens est bientôt regardée comme un droit qu'il est vertueux de défendre et honteux d'abandonner. Il arrive nécessairement que, dans la transition, ces sentiments opposés se mêlent d'une manière peu harmonieuse.
Il en est encore de même pour les institutions domestiques sous les deux régimes. Tant que le premier domine, il est honorable de posséder un esclave, et chez un esclave la soumission est digne d'éloges; mais, à mesure que le second se développe, c'est un crime d'avoir des esclaves, et l'obéissance servile excite le mépris. Il n'en est pas autrement dans la famille. La sujétion des femmes par rapport aux hommes, complète tant que la guerre est habituelle, mais adoucie à mesure que les occupations pacifiques en prennent la place, en vient peu à peu à être regardée comme injuste, et l'on proclame enfin l'égalité des sexes devant la loi. En même temps se modifie l'opinion touchant le pouvoir paternel. Le droit autrefois incontesté du père sur la vie de ses enfants est nié, et le devoir d'une soumission absolue à la volonté paternelle, longtemps affirmé sans réserve, se change en celui d'une obéissance renfermée dans des limites raisonnables.
Si la relation entre la vie d'antagonisme avec des sociétés étrangères et la vie de coopération pacifique au dedans de chaque société était une relation constante, on pourrait trouver quelque compromis permanent entre les règles opposées de la conduite appropriée aux deux manières de vivre. Mais, comme cette relation est variable, le compromis ne peut jamais être que temporaire. On tend toujours à une harmonie entre les croyances et les besoins. Ou bien les arrangements sociaux sont graduellement changés, jusqu'à ce qu'ils arrivent à être en harmonie avec les idées et les sentiments dominants; ou bien, si les conditions du milieu s'opposent à un changement des arrangements sociaux, les habitudes de vie qu'elles rendent nécessaires modifient les idées dominantes et les sentiments dans la mesure qu'il faut. De là, pour chaque genre et chaque degré d'évolution sociale déterminé par un conflit au dehors et l'union au dedans, il y a un compromis approprié entre le code moral de l'hostilité et le code moral de l'amitié: non pas, à la vérité, un compromis définitif, durable, mais un compromis de bonne foi.
Ce compromis, bien qu'il puisse être vague, ambigu, illogique, fait cependant autorité pour un temps. Car si, comme on l'a montré plus haut, le bien-être de la société doit prendre le pas sur le bien-être des individus qui la composent, pendant ces phases où les individus pour se sauver eux-mêmes doivent sauver leur société, un tel compromis temporaire entre les deux codes de conduite, par cela même qu'il pourvoit comme il convient à la défense extérieure en même temps qu'il favorise le plus qu'il est possible en pratique la coopération interne, contribue à la conservation de la vie au plus haut degré et obtient ainsi la sanction dernière. Par suite, les morales perplexes et inconséquentes dont chaque société et chaque époque nous montrent des exemples plus ou moins dissemblables, sont justifiées chacune en particulier comme étant approximativement les meilleures possibles dans les circonstances données.
Mais, par leurs définitions mêmes, de telles moralités appartiennent à une conduite incomplète, et non à la conduite entièrement développée. Nous avons vu que les ajustements d'actes à leurs fins qui, tout en constituant les manifestations extérieures de la vie, favorisent la continuation de la vie, tendent vers une certaine forme idéale dont s'approche maintenant l'homme civilisé. Mais cette forme n'est pas atteinte tant que continuent les agressions d'une société contre une autre. Il importe peu que l'obstacle au développement complet de la vie provienne de crimes de compatriotes ou de crimes d'étrangers; si ces crimes se produisent, l'état que nous avons défini n'existe pas encore. On arrive à la limite de l'évolution de la conduite pour les membres de chaque société, seulement lorsque, cette limite ayant été atteinte aussi par les membres d'autres sociétés, les causes d'antagonisme international prennent fin en même temps que les causes d'antagonisme entre individus.
Ayant reconnu ainsi, du point de vue sociologique, le besoin et l'autorité de ces systèmes de morale qui changent en même temps que les rapports entre les activités guerrières et les activités pacifiques, nous avons à considérer, du même point de vue, le système de morale propre à l'état où les activités pacifiques ne sont plus troublées.
51. Si, excluant toute idée de dangers ou d'obstacles provenant de causes extérieures à une société, nous nous appliquons à spécifier les conditions dans lesquelles la vie de chaque personne, et par suite de l'agrégat, peut être la plus grande possible, nous arrivons à certaines propositions simples qui, telles qu'elles sont ici posées, prennent la forme de truismes.
En effet, comme nous l'avons vu, la définition de cette vie, la plus haute qui accompagne la conduite complètement développée, exclut elle-même tout acte d'agression, non seulement le meurtre, l'attaque à main armée, le vol et généralement les offenses les plus graves, mais les moindres offenses, telles que la diffamation, tout dommage causé à la propriété et ainsi de suite. En portant directement atteinte à l'existence individuelle, ces actes causent indirectement une perturbation de la vie sociale. Les crimes contre les autres provoquent un antagonisme en retour, et, s'ils sont nombreux, l'association perd toute cohésion. Par suite, que l'on considère l'intégrité du groupe lui-même comme fin, ou que la fin considérée soit l'avantage définitivement assuré aux unités du groupe par la conservation de son intégrité, ou encore que l'avantage immédiat de ses unités prises séparément soit la fin considérée, la conséquence est la même: de pareils actes sont en opposition avec l'achèvement de la fin. Que ces inférences soient évidentes d'elles-mêmes et familières à tous (comme le sont à la vérité les premières inférences tirées des données de toute science qui arrive à la période déductive), ce n'est pas une raison pour nous de passer légèrement sur ce fait extrêmement important que, du point de vue sociologique, l'on voit les lois morales essentielles découler comme corollaires de la définition d'une vie complète se développant dans des conditions sociales.
Ce n'est cependant pas assez de respecter ces lois fondamentales de la morale. Des hommes associés qui vivraient séparément sans se faire tort les uns aux autres, mais sans s'assister non plus, ne recueilleraient de leur association aucun autre avantage que de vivre en société. Si, alors qu'il n'y a pas coopération pour des projets défensifs (ce qui est ici exclu par hypothèse), il n'y a pas non plus coopération pour la satisfaction des besoins, l'état social perd presque, sinon entièrement, sa raison d'être. Il y a des peuples, il est vrai, qui vivent dans une condition peu éloignée de celle-là, tels que les Esquimaux. Mais bien que ces hommes, n'ayant pas besoin de s'unir pour la guerre qui leur est inconnue, vivent de telle sorte que chaque famille soit essentiellement indépendante des autres, il se présente cependant des occasions d'agir en commun. En réalité, il est à peine possible de concevoir que des familles puissent vivre les unes à côté des autres sans jamais se donner un mutuel secours.
Néanmoins, que cet état existe réellement ou qu'on s'en rapproche seulement dans certains pays, nous devons ici reconnaître comme hypothétiquement possible un état dans lequel ces seules lois morales fondamentales soient suivies, pour observer, sous leurs formes simples, quelles sont les conditions négatives d'une vie sociale harmonique. Que les membres d'un groupe social coopèrent ou non, certaines limitations à leurs activités individuelles sont rendues nécessaires par leur association, et, après les avoir reconnues comme se produisant en l'absence de toute coopération, nous serons mieux préparés à comprendre comment on s'y conforme lorsque la coopération commence.
52. En effet, que les hommes vivent ensemble d'une manière tout à fait indépendante, en évitant seulement avec soin de s'attaquer, ou que, passant de l'association passive à l'association active, ils réunissent leurs efforts, leur conduite doit être telle que l'achèvement des fins par chacun ne soit au moins pas empêché. Il devient évident que, lorsqu'ils agissent en commun, non seulement il ne doit pas en résulter plus de difficulté, mais au contraire plus de facilité, puisque, en l'absence de ce résultat, à savoir de rendre une fin plus facile à atteindre, il ne peut y avoir aucune raison d'agir en commun. Quelle forme doivent donc prendre les empêchements mutuels quand la coopération commence? ou plutôt quels sont, outre les empêchements mutuels primitifs et déjà spécifiés, ces empêchements mutuels secondaires nécessaires pour rendre la coopération possible?
Un homme qui, vivant dans l'isolement, emploie ses efforts à la poursuite d'une fin, est dédommagé de cet effort en atteignant cette fin, et arrive ainsi à avoir satisfaction. S'il dépense ses efforts sans arriver à la fin voulue, il en résulte qu'il n'est pas satisfait. Etre satisfait, ne pas l'être sont la mesure du succès et de l'insuccès dans les actes par lesquels on soutient sa vie, puisque ce que l'on atteint au prix d'un effort est quelque chose qui directement ou indirectement favorise le développement de la vie, et par là compense l'effort; tandis que si l'effort n'aboutit pas, rien ne paye la dépense que l'on a faite, et la vie doit en souffrir en proportion. Que doit-il en résulter lorsque les hommes unissent leurs efforts? La réponse sera plus claire si nous prenons les formes successives de coopération dans l'ordre de leur complexité croissante. Nous pouvons distinguer comme coopération homogène: 1º celle dans laquelle des efforts égaux sont unis pour obtenir des fins semblables dont on jouira simultanément. Comme coopération non complètement homogène, nous pouvons distinguer: 2º celle dans laquelle des efforts égaux sont unis pour obtenir des fins semblables dont on ne jouira pas simultanément. Une coopération dont l'hétérogénéité est plus marquée est: 3º celle dans laquelle des efforts inégaux sont unis pour obtenir des fins semblables. Enfin arrive la coopération qui est décidément hétérogène: 4º celle dans laquelle des efforts différents sont unis pour obtenir des fins différentes.
La plus simple et la première de ces formes, dans laquelle des facultés humaines, de même nature et de même degré, sont unies pour la poursuite d'un bien auquel, lorsqu'il est obtenu, tous participent, est représentée par un exemple très familier dans la poursuite d'une proie par les hommes primitifs; cette forme la plus simple et la plus ancienne d'une coopération industrielle est aussi celle qui diffère le moins de la coopération guerrière; car les coopérateurs sont les mêmes, et les procédés, également destructifs de la vie, sont analogues de part et d'autre. La condition pour qu'une telle coopération puisse être continuée avec succès est que les coopérateurs partagent également les produits. Chacun pouvant ainsi se payer lui-même en nourriture pour l'effort dépensé, et en outre atteindre certaines fins désirées, comme d'entretenir sa famille, se trouve satisfait; il n'y a pas là d'agression de l'un contre l'autre, et la coopération est harmonique. Naturellement, le produit partagé ne peut être grossièrement proportionné aux efforts particuliers unis pour l'obtenir; mais les sauvages, comme cela doit être pour que la coopération soit harmonique, reconnaissent en principe que les efforts combinés doivent séparément rapporter des avantages équivalents, comme ils l'auraient fait s'ils avaient été séparés. Bien plus, au delà du fait de recevoir des parts égales en retour de travaux qui sont approximativement égaux, on s'efforce ordinairement de proportionner l'avantage au mérite, en assignant quelque chose de plus, sous la forme de la meilleure part ou du trophée, à celui qui a tué le gibier. Evidemment, si l'on s'éloigne trop de ce système de partager les avantages quand il y a eu partage d'efforts, la coopération cesse. Chaque chasseur préférera faire le mieux qu'il pourra pour son propre compte.
Passant de ce cas le plus simple de coopération à un cas qui n'est pas tout à fait aussi simple, – cas dans lequel l'homogénéité est incomplète-demandons-nous comment un membre d'un groupe peut être conduit, sans cesser d'être satisfait, à prendre de la peine pour atteindre un avantage dont, lorsqu'il sera atteint, un autre profitera seul? Il est clair qu'il peut le faire, à la condition que l'autre prendra dans la suite tout autant de peine pour qu'il puisse de même à son tour profiter de l'avantage qui en résultera. Cet échange d'efforts équivalents est la forme que prend la coopération sociale quand il n'y a encore que peu ou point de division du travail, excepté entre les deux sexes. Par exemple, les Bodos et les Dhimals «s'assistent mutuellement l'un l'autre, à l'occasion, soit pour construire leurs maisons, soit pour cultiver leurs champs.» Ce principe: Je vous aiderai si vous m'aidez, ordinaire dans les peuplades simples où les occupations sont de genre semblable et dont on se sert aussi à l'occasion dans des peuples plus avancés, est un principe par lequel le rapport entre l'effort et l'avantage n'est pas maintenu directement, mais bien indirectement. Car, tandis que les activités humaines, lorsqu'elles s'exercent séparément, ou s'unissent comme dans l'exemple donné plus haut, sont immédiatement payées de leur effort par un avantage, dans cette dernière forme de coopération, l'avantage obtenu par un effort s'échange contre un avantage semblable que l'on recevra plus tard, lorsqu'on le demandera. Dans ce cas comme dans le précédent, la coopération ne peut être maintenue que si les conventions que l'on a tacitement faites sont observées. Car si elles n'étaient pas habituellement observées, on refuserait ordinairement de rendre le service demandé, et chacun s'arrangerait de manière à agir pour son compte le mieux possible. Tous les avantages que peut donner l'union des efforts pour faire ce qui dépasse le pouvoir d'individus isolés, ne pourraient être obtenus. Ainsi, à l'origine, l'observation des contrats qui sont implicitement sinon expressément conclus devient une condition de la coopération sociale, et par suite du développement social.
De ces formes simples de coopération dans lesquelles les travaux que les hommes entreprennent sont du même genre, passons aux formes plus complexes dans lesquelles ces travaux sont de genres différents. Lorsque des hommes s'entr'aident pour bâtir des huttes ou pour abattre des arbres, le nombre des jours de travail donnés maintenant par l'un à l'autre est facilement balancé par un égal nombre de jours de travail donnés par l'autre au premier. Mais lorsque la division du travail commence, lorsqu'il vient à se faire des transactions entre l'un qui fabrique des armes et l'autre qui prépare des peaux pour servir de vêtements, ou entre celui qui cultive et celui qui pêche du poisson, il n'est facile de mesurer leurs travaux ni au point de vue de leurs quantités ni au point de vue de leurs qualités relatives; avec la multiplication des occupations qui implique les variétés nombreuses d'habileté et de puissance, il cesse d'y avoir quoi que ce soit qui ressemble à une équivalence manifeste entre des efforts intellectuels et des efforts physiques comparés les uns aux autres, ou entre leurs produits. Il en résulte que la convention ne peut pas être considérée comme toute faite, comme lorsqu'il s'agit d'échanger des choses de même genre: il faut l'établir expressément. Si A consent à ce que B s'approprie un produit de son habileté spéciale, à la condition qu'il lui soit permis de s'approprier un produit différent de l'habileté spéciale de B, il en résulte que, comme l'équivalence des deux produits ne peut pas être déterminée par une comparaison directe de leurs quantités et de leurs qualités, on doit bien s'entendre sur la quantité de l'un de ces produits, qui peut être prise en échange d'une certaine quantité de l'autre.
C'est donc par suite d'une convention volontaire, non plus tacite et vague, mais déclarée et définie, que la coopération peut se continuer harmonieusement, lorsque la division du travail s'est établie. Comme dans la coopération la plus simple, où des efforts semblables étaient unis pour assurer un bien commun, le mécontentement causé chez ceux qui, après avoir dépensé leurs peines, n'obtiennent pas leur part du bien, les porte à cesser toute coopération; comme dans une coopération plus avancée, qui consiste dans l'échange de travaux égaux de même genre fournis en différents temps, on se dégoûte de coopérer si l'on n'obtient pas l'équivalent de travail que l'on était en droit d'attendre; de même, dans cette coopération développée, si l'un manque de fournir à l'autre ce qui avait été ouvertement reconnu comme étant d'une valeur égale au travail ou au produit fourni, il en résulte que la coopération est entravée par le mécontentement. Evidemment, lorsque les antagonismes ainsi causés empêchent le développement des unités, la vie de l'agrégat est mise en danger par l'amoindrissement de la cohésion.
53. Outre ces dommages relativement directs, spéciaux et généraux, il faut noter des dommages indirects. Comme cela résulte déjà du raisonnement du précédent paragraphe, non seulement l'intégration sociale, mais encore la différenciation sociale est empêchée par la rupture du contrat.
Dans la deuxième partie des Principes de sociologie, on a montré que les principes fondamentaux de l'organisation sont les mêmes pour un organisme individuel et pour un organisme social, parce qu'ils sont composés l'un et l'autre de parties mutuellement dépendantes. Dans un cas comme dans l'autre, l'hypothèse d'activités différentes exercées par les membres composants est possible, à la condition seulement qu'ils profitent séparément à des degrés convenables des activités les uns des autres. Pour mieux voir ce qui en résulte par rapport aux structures sociales, notons d'abord ce qui en résulte par rapport aux structures individuelles.
Le bien-être d'un corps vivant implique un équilibre approximatif entre la perte et la réparation. Si les activités entraînent une dépense qui n'est pas compensée par la nutrition, le dépérissement s'ensuit. Si les tissus peuvent emprunter au sang enrichi par la nourriture des substances suffisantes pour remplacer celles que le travail a usées, la vigueur peut se maintenir, et, si le gain excède la perte, il en résulte un accroissement.
Ce qui est vrai du tout dans ses relations avec le monde extérieur n'est pas moins vrai des parties dans leurs relations entre elles. Chaque organe, comme l'organisme entier, se détériore par l'accomplissement de sa fonction, et doit se restaurer avec les matériaux qui lui sont apportés. Si la quantité des matériaux qui lui sont fournis par le concours des autres organes est insuffisante, cet organe particulier dépérit. S'ils sont en assez grande quantité, il peut conserver son intégrité. S'ils sont en excès, il peut s'accroître. Dire que cet arrangement constitue le contrat physiologique, c'est user d'une métaphore qui ne semble pas juste et qui est essentiellement exacte. Car les relations de structure sont réellement telles que, grâce à un système régulateur central, chaque organe est approvisionné de sang en proportion du travail qu'il fait. Comme on l'a marqué (Principes de sociologie, § 254), les animaux bien développés sont constitués de telle sorte que chaque muscle ou chaque viscère, quand il est appelé à agir, envoie aux centres vaso-moteurs, à travers certaines fibres nerveuses, une impulsion causée par son action; et alors, par d'autres fibres nerveuses, se produit une impulsion qui cause une dilatation de ses vaisseaux sanguins. C'est dire que toutes les autres parties de l'organisme, lorsqu'elles exigent conjointement un travail d'un organe, commencent aussitôt par le payer en sang. Dans l'état ordinaire d'équilibre physiologique, la perte et le gain se balancent, et l'organe ne change pas sensiblement. Si la somme de sa fonction est accrue dans des limites assez modérées pour que les vaisseaux sanguins de cette région puissent apporter une quantité de sang accrue dans la même proportion, l'organe se développe; outre qu'il répare sa perte par son gain, il fait un profit par le surplus de son activité; il est ainsi en état, grâce au développement de sa structure, de faire face à des demandes supplémentaires. Mais, si les demandes qui lui sont faites deviennent si grandes que les matériaux fournis ne puissent suffire à la dépense, soit parce que les vaisseaux sanguins de la région ne sont pas assez larges, soit pour une autre cause, l'organe commence à décroître par suite de l'excès de la perte par rapport à la réparation: il se produit alors ce que l'on appelle une atrophie. Or, puisque chacun des organes doit ainsi être payé en nourriture pour ses services par les autres, il s'ensuit que le balancement d'un équilibre convenable entre leurs demandes et leurs recettes respectives est requis, directement pour le bien-être de chaque organe et indirectement pour le bien-être de l'organisme. Car, dans un tout formé de parties mutuellement dépendantes, ce qui empêche l'accomplissement légitime du devoir d'une partie réagit d'une manière funeste sur toutes les parties.
Avec un changement convenable des termes, ces propositions et ces inférences sont vraies pour une société. La division sociale du travail, qui est parallèle à tant d'autres égards à la division physiologique du travail, lui est parallèle aussi à cet égard. Comme on l'a montré tout au long dans les Principes de sociologie (deuxième partie) chaque ordre de fonctionnaires et chaque ordre de producteurs, accomplissant séparément quelque action ou fabriquant quelque article non pour satisfaire directement à leurs besoins, mais pour satisfaire à ceux de leurs concitoyens en général qui sont occupés autrement, ne peuvent continuer à le faire qu'autant que les efforts dépensés et le profit qu'ils en retirent sont approximativement équivalents. Les organes sociaux, comme les organes individuels, restent stationnaires s'ils jouissent en des proportions normales des avantages produits par la société considérée comme un tout. Si les demandes faites à une industrie ou à une profession s'accroissent d'une manière inusitée, et si ceux qui y sont engagés font des profits excessifs, un plus grand nombre de citoyens s'adonnent à cette industrie ou à cette profession, et la structure sociale que leurs membres constituent se développe; au contraire, la diminution des demandes, et par suite des profits, ou conduit leurs membres à chercher d'autres carrières, ou arrête les accessions nécessaires pour remplacer ceux qui meurent, et la structure dépérit. Ainsi se maintient entre les forces des parties composantes la proportion qui peut le mieux produire le bien-être du tout.