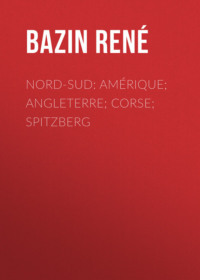Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Nord-Sud: Amérique; Angleterre; Corse; Spitzberg», sayfa 7
II
LA FORÊT. – UNE PROCESSION A CORTE
Les Corses qui ont des vacances les passent volontiers à Vizzavona. Un grand hôtel se dresse en face de la toute petite gare; le paysage est fait d'un ravin boisé qui descend en tournant et qui s'ouvre, et des nuages qui viennent par la trouée du col, tordus, tout blancs au-dessus des pins noirs, et tâtant la montagne avec leurs bords de ouate. On n'aperçoit aucun village; l'espace découvert est si étroit qu'une compagnie d'alpins n'y manœuvrerait pas à l'aise. La forêt règne, et les sentiers s'y perdent tout de suite. Je prends l'un d'eux, et, à moins de cent pas, je découvre la chapelle la plus rustique que j'aie jamais vue, toute construite avec des branches et des planches de bois brut, sans porte et même sans cloison qui la ferme en avant: une boîte mise debout. On y célèbre la messe en été. J'imagine les assistants agenouillés sur la mousse, appuyés au tronc des arbres, les ombrelles ouvertes, une clochette minuscule qui sonne, et le vent qui tient l'orgue tout le temps. Le sentier monte. J'arrive à la maison forestière, très joliment campée, dans la boucle d'une de ces belles routes de montagnes, où ceux qui passent, même pour le travail, ont l'air de figurants. Nous sommes au cœur de la forêt, dominés, de tous les côtés, par des cônes ou des rampes de peu d'élévation, sans une clairière et sans un pré. Les promenades sont incroyablement faciles. Jusqu'au soir, je parcours la forêt, et je la parcours encore le lendemain matin. Elle n'étonne pas; elle est fraîche; elle est silencieuse; elle est faite pour les vacances. Par moments, au creux des vallées, au bord des torrents, et, pour tout dire, partout où l'horizon est court, je me croirais dans les Vosges.
Des bois de pins Laricio succèdent à des perchis de hêtres. Et la saison n'est pas assez avancée, à cette altitude surtout, pour que les hêtres aient leurs feuilles, mais ils balancent déjà les bourgeons gonflés, vernis, qui collent aux doigts; les cimes, vues par masse et en travers, ont des reflets purpurins, et sous le couvert des grands arbres, des millions de petits hêtres, qui ont gardé la feuille d'automne, toute blonde, font la nappe de fougère. La couleur ne meurt pas dans les forêts. Quand elle tombe des branches, elle laisse à découvert, elle exalte en mourant la magnificence des colonnades de fûts qui montent ou qui descendent. J'ai vu, dans cette forêt de Vizzavona, des troncs de jeunes arbres transparents au soleil et veinés comme des agates.
J'ai vu des ruines aussi. Au tournant d'un lacet:
– Regardez, me dit mon ami V… le feu a passé par ici en août 1906. Incendie volontaire, bien entendu… Ah! c'est là le crime qui ruine la Corse, le crime toujours impuni, et autrement redoutable que la vendetta… Vous nous faites rire, vous autres continentaux, avec vos Matteo Falcone et vos Bellacoscia…
– N'en auriez-vous plus dans le maquis?
– Plus du tout. Nous serons obligés d'en mettre, pour en montrer aux ministres en voyage. Mais l'incendiaire, c'est autre chose. Regardez: voilà son œuvre!
Toute la pente, au-dessous de moi et en avant, a été ravagée. Sur plus de cinq cents mètres de profondeur, elle est hérissée de ceps d'arbousiers morts, d'un gris blanc, d'un gris de vieil ossement, et entre lesquels se lève, çà et là, le tronc pourri et rompu d'un hêtre, ou bien un pin ébranché, qui n'a plus de vivant qu'un plumet d'aiguilles. On dirait que des milliers de daims et de rennes ont été tués là, et que les massacres sont restés sur le sol, blanchis par le soleil et par la pluie. A la frontière du feu, les branches mortes, portées par des troncs vivants, font un bourrelet blond. Et ce cimetière d'arbres s'étend sur plus d'un kilomètre de longueur, jusqu'à cette barre de roches qui a rompu le fleuve de vent et de feu.
– Un peu au delà, me dit mon ami, vous trouverez d'autres coupes également détruites. Dans celles-là, l'incendie avait été allumé quinze jours plus tôt.
– Et jamais l'incendiaire n'est pris?
– La preuve est si difficile à faire? Et puis…
V… se mit à rire, et il me raconta, avec l'ironie ardente qui est la sienne, avec sa voix chaude, dont le rire même n'est qu'un éclat de passion, une histoire qui commençait ainsi: «Aux environs de Sartène, où j'habitais alors, le brigadier de gendarmerie était gros comme une tonne, mais il commandait quatre gendarmes plus maigres que des chats sauvages…»
En causant, ou plutôt l'un contant une des mille histoires de la forêt corse, et l'autre l'écoutant, nous arrivâmes au sommet d'un grand éperon aride qui se détachait de la montagne et commandait deux vallées. Mon ami m'indiqua du doigt, au-dessous du promontoire, quelques villas qui sont «l'amorce», paraît-il, d'une station d'été. Mais je regardais autre chose: le couloir montagneux qui s'allongeait à droite et à gauche, et au bout duquel, de chaque côté, s'épanouissait un paysage très lointain. J'étais placé comme au milieu du tube d'une lorgnette pointée sur des sommets distants de bien des lieues. Le sol le plus proche de nous était déjà d'un bel intérêt, par son relief pierreux et tourmenté, par l'absence à peu près complète, même au fond de la vallée, de parties planes et herbeuses, par sa végétation broussailleuse, crépelée, aromatique et tenace, dont je sentais monter jusqu'à moi le souffle tiède. Mais les montagnes d'horizon surtout me retenaient sur leurs pentes.
Elles me rappelaient celles que j'avais vues du haut de la Punta; elles étaient plus éclairées et je comprenais mieux ce qu'il y avait en elles de nouveau pour moi. Le velouté des lointains était doux et profond; l'air limpide laissait venir tous les reflets, même les petits; aucune culture appréciable ne rompait l'harmonie des surfaces inviolées: mais le secret de cette beauté de lumière devait être surtout dans la pâleur des branches et des feuilles du maquis, des oliviers, des bruyères, des cistes qui, à travers d'immenses espaces, transparaissaient dans le bleu de la brume, et la tissaient de rayons d'argent.
C'est là, je crois, une des merveilles du paysage corse, et les saisons n'y changent rien.
Je ne décrirai donc pas la descente de Vizzavona vers le plateau de Corte, bien qu'il y ait, d'un côté ou de l'autre du chemin de fer, des échappées de vue de tout point admirables, comme à Vivario et à Vecchio. J'avais quitté la forêt dans l'après-midi du vendredi saint, d'après le conseil de mon ami, qui me parlait ainsi:
– Ne vous attardez pas dans les futaies; ne faites pas trop votre cour aux maquis: vous les retrouverez. Il faut que nous soyons avant la nuit à Corte. Car la petite ville a, chaque année, deux processions fameuses, l'une le jeudi saint, qui porte le nom de bigorneau, granitola, à cause de l'itinéraire du cortège qui tourne sur lui-même, et la seconde le soir du vendredi saint. Celle-ci, le mortorio, la cérémonie de la mort, commence vers sept heures et demie du soir. Et, justement, nous assisterons à la sortie du grand Christ au tombeau, qui n'est porté à travers les rues que tous les cinq ou six ans.
Nous étions à Corte bien avant la tombée du jour. Imaginez une plaine oblongue, par hasard assez bien cultivée, enveloppée de montagnes. Corte appartient à cette espèce de villes que j'appellerais volontiers: villes coniques à citadelle. Aux deux tiers de la plaine, à l'ouest, se dresse un rocher, en pente raide de trois côtés, à pic du quatrième, qui est celui qu'on découvre en venant d'Ajaccio. De vieilles murailles, fleuries d'herbes, des magasins militaires, une caserne où loge un bataillon d'infanterie, couronnent la crête. Immédiatement au-dessous se pressent des maisons du XVe, du XVIe, du XVIIe siècles, quelques-unes encore nobles, toutes misérables, noires de poussière et de crasse, séparées par des ruelles ou par des escaliers que huit jours de pluie diluvienne ne suffiraient pas à nettoyer, et où coulent, stagnent, pourrissent, s'évaporent ou pénètrent dans le sous-sol déjà saturé, tous les liquides et tous les déchets que vous voudrez. Là on vend des chevreaux de lait, dépouillés et fendus comme des lapins; là s'étalent, au devant des boutiques noires, les légumes de la plaine; là grouillent les enfants, picore la volaille, errent des petits cochons en liberté, montent des ânes ployant sous un faix de bois mort aussi large que la chaussée. Le plus bel endroit et le seul palier de ce pignon de la ville, c'est, presque au sommet, une petite place rectangulaire, bordée d'un côté par la façade de l'église, des trois autres par des maisons assez hautes, d'un seul ton de poussière cuite au soleil, forum où fut parlée, discutée, acclamée, combattue, toute l'histoire de la cité, et d'où pendent quatre ruelles accrochées aux quatre angles. Quel cadre quand la procession, tout à l'heure, l'emplira de couleurs en mouvement! Je guette la sortie des fidèles qui montent, de plus en plus nombreux, et qui entrent dans l'église. Le jour décroît. En me promenant au pied des murailles de la citadelle, je vois presque toute la ville, les maisons nouvelles soudées aux anciennes et couvrant le bas de la colline, des vergers, quelques fabriques, la campagne que l'ombre gagne. Et, en même temps, des lumières s'allument partout; le dessin compliqué des rues flambe dans la nuit commençante; chaque étage de chaque maison a son cordon de lampions, ses transparents, ses flambeaux alignés sur les balcons, et les plus pauvres logis, ceux qui m'enveloppent, ne sont pas les derniers à se préparer; les fenêtres s'ouvrent, une main de femme dépose sur l'appui une lampe à pétrole ou une veilleuse, et la petite flamme brille avec les autres, et tremble au vent, et dit: Credo.
A sept heures et demie, la place de l'église, vue de haut, donne l'impression d'une cheminée assez obscure, où s'agiteraient, sans s'élever, des gerbes d'étincelles. J'y cours. Elle est débordante de foule. Toutes les Cortisiennes sont là, les vieilles et les jeunes; chacun porte une bougie et cherche à l'allumer à la bougie d'un voisin, au cierge d'un figurant; de proche en proche, les petites flammes se multiplient; on rit; on s'interpelle; je vois à chaque moment surgir de la pénombre et vivre en clarté un visage nouveau, deux mains qui se tendent, un buste qui se redresse, un groupe. J'admire la grâce et la souplesse de mouvements de beaucoup de ces jeunes filles et jeunes femmes qui sont souvent vêtues de noir et dont les châles tombent bien. Je me rappelle des promenades dans Venise. Je le dis à un vieux brave homme de Corte, qui me répond: «Ici, les femmes sont fines.»
Il a raison. Voici qu'elles se taisent, par degrés. La procession sort de l'église et coupe la place en diagonale; les enfants ouvrent la marche, accompagnés de trois pénitents blancs qui ont de grands bâtons à la main et qui font la police; ils chantent en langue corse: «Piange, peccatore, la morte del Redentore»; puis viennent les femmes, sur deux rangs, la bougie au poing; elles sortent, descendent, disparaissent en chantant, et d'autres les remplacent et passent à leur tour; on dirait que l'église, la place, les ruelles voisines, sont un écheveau humain, qui se dévide inépuisablement; enfin s'avancent les hommes, les pénitents blancs, visage découvert, souvent jeunes, à la fois très simples et très crânes, ce qui est charmant. Six d'entre eux portent, sur leurs épaules, le Christ au tombeau, une statue du Christ, en carton gris, grandeur nature, très réaliste, très émouvante et qui est conservée à Corte depuis le XVe siècle. Le Christ est couché dans un cercueil de bois; à ses pieds et de chaque côté de sa tête on a mis, par piété, un ornement qui doit être d'ancien usage, quatre pots où verdoie un semis de gazon; des bougies sont fixées sur le bord du tombeau, afin que toute la ville puisse voir le visage douloureux, les yeux fermés, les bras entr'ouverts jusque dans la mort. Tout de suite après le Crucifié s'avance l'Addolorata, statuette de demi-grandeur, vêtue comme une Cortisienne, et qui tient à la main gauche un mouchoir de batiste. Le clergé ferme la marche, et la procession descend par les ruelles, traverse la ville illuminée, respectueuse quand passe le cortège, et de nouveau bruyante dès qu'il a passé.
Une heure plus tard, je remontai, avec la procession, jusqu'à la petite place, tout en haut, et je fus témoin d'un spectacle qui n'était pas nouveau, assurément, pour les vieilles pierres des maisons et de l'église, mais qui renouait des coutumes depuis longtemps brisées. La foule était là, plus pressée encore qu'au départ; les têtes se touchaient; tous les balcons et toutes les fenêtres des façades avaient leur grappe de curieux; il faisait noir sur la place, chacun ayant soufflé sa bougie, et seul, le grand Christ au tombeau, posé sur des tréteaux devant la porte de l'église, gardait son auréole et éclairait une partie du peuple. Alors, au premier étage d'une maison, à gauche, au-dessus d'un café, un prêtre s'est montré dans l'encadrement d'une fenêtre. Il a fait un signe, et toute la foule s'est tournée vers lui. Il a parlé dix minutes, dans le grand silence; il a remercié, et un long applaudissement, énergique, lui a répondu: comme au temps où Paoli, peut-être à cette même fenêtre, haranguait ses compatriotes.
Le matin du samedi saint fut d'abord tout tranquille et ordinaire. Chacun travaillait, flânait, fumait, dormait à son habitude. Quelques hommes, un balai sur l'épaule, et chargés sans doute d'un balai public, inspectaient le boulevard et ne remuaient la poussière qu'après en avoir délibéré. Des jeunes filles se promenaient, deux ou trois ensemble, nonchalantes et dignes, sous les arbres municipaux, très saluées, voulant l'être, mais évitant parfois de poser leur regard, à cause du feu noir dont il brille. Tout à coup, les cloches se sont mises à sonner. Et aussitôt cent pétards ont éclaté autour de moi, dans la rue, sur les balcons, dans les corridors; des gamins ont allumé des fusées, des chandelles romaines, des soleils tournants et toutes sortes de pièces d'artifices dans la lumière du plein jour. Tout Corte a crépité pendant une heure. Les belles jeunes filles ont abordé une bande d'amies qui se promenaient, comme elles, dans le jardin clair et peuplé. Elles n'ont pas dit: «Bonjour», comme elles font d'habitude. Elles avaient la permission des cloches; elles ont dit: «Buone feste!»
III
BASTIA. – LE CAP CORSE
Il est difficile, quand on a seulement traversé une ville, de dire d'elle autre chose que ceci: elle est blanche; elle est grise; elle est bâtie sur une colline ou étalée en plaine; elle bruit ou elle dort. Dès qu'elle a un passé, une ville est pleine de mystère; elle a ses monuments non classés, quelquefois les plus émouvants; ses jours de beauté calme, ses heures de travesti; ses mœurs, son humeur et son ambition, qui n'est souvent qu'une jalousie. Je n'en sais pas tant sur Bastia. Mais j'ai vu qu'elle est capitale évidente et consciente, d'esprit vif et agité, industrieuse et peu aidée, habitée par une population fort mêlée, qui cherche des chefs d'entreprise, des hommes d'initiative, des inventeurs de richesse, et qui trouve surtout des fonctionnaires et des politiciens. Bastia voit la côte italienne ou la devine. Elle est à quatre heures de Livourne. Elle parle avec complaisance de cette voisine qui paie bien, avec laquelle le commerce est actif et pourrait être considérable. J'ai assisté au départ d'un lougre qui s'en allait caboter avec Caprara, Elbe, Monte-Cristo, les belles îles renflées et bleues sur la mer, qui sont en ligne devant Bastia. J'ai entendu dire à un importateur de grains: «Je vais souvent à Florence: nous y sommes un peu chez nous.» Et en entrant, près du vieux port, dans l'oratoire de la Conception, j'ai cru retrouver une église de Rome décorée pour la fête du saint. C'étaient les mêmes sculptures opulentes, noircies par le temps et par la fumée des cierges, et les mêmes pentes de damas rouge tendues sur les pilastres. Dès qu'on met le pied sur la terre de Corse, cette comparaison vient à l'esprit, et je l'ai notée déjà; elle vous suit et vous poursuit: mais à Bastia elle se précise, et l'Italie à laquelle on pense, c'est l'Italie fine, trafiquante et artiste.
– N'exprimez pas cette opinion devant des gens de la campagne, me dit mon ami N… vous pourriez le regretter. Appeler Italien un paysan corse, c'est l'offenser, et si vous avez le malheur de l'appeler Lucquois, vous le provoquez. Gardez-vous! Bien des violences n'ont pas eu d'autre cause.
Le soir même, j'avais la preuve que mon ami ne se trompait pas. C'était le soir de Pâques. Malgré le libeccio qui soufflait en tempête et qui rendait la route deux fois rude pour nos chevaux, nous montions vers le col de Teghime. Les collines se succédaient, de plus en plus hautes, rangées d'éperons superbes, tous orientés du côté de la mer. Ils portaient sur leurs flancs des terrasses plantées de vignes et soutenues par des murs, d'autres plantées d'orangers, d'autres d'amandiers ou d'oliviers, et l'épaisseur de la verdure croissait au bas des pentes. Nous regardions ce paysage dont les détails se multipliaient à mesure que nous montions, mais qui restait le même et magnifique: la mer à notre gauche, toute fouaillée et charruée par la bourrasque; une bande de terre inculte; l'étang de Biguglia immobile et terne comme du mercure oxydé; plus près de nous, la plaine, et, au delà, les montagnes qui se levaient. Et précisément à mi-montagne, en face de nous, à deux ou trois kilomètres, j'aperçus une flamme. Elle s'éteignit; une spirale de fumée tourna au-dessus du maquis et prit le vent; une tache cendrée apparut dans le vert, puis un point rouge qui grossit, puis des flammes, des flammes, des flammes qui galopèrent.
– Encore un incendie! fit mon ami N…
– Vous en parlez philosophiquement, lui dis-je. Moi, je suis furieux. Vos bergers sont des misérables. Pour faire brouter quelques chèvres, ils ruinent la Corse!
Mon ami ne répondit pas. Il avisa un homme qui descendait, poussé par le libeccio, l'arrêta, lui montra du doigt les lignes de feu coupées de bandes de fumée.
– Ils ont choisi leur temps: un soir de Pâques, un jour de vent. Qui est-ce qui a fait cela? Est-ce un Corse?
L'homme leva les épaules.
– Mais non, dit-il, vous le savez bien: ce sont tous des Lucquois, des Génois, des gens de rien.
Et il passa.
Le lendemain, je partais pour faire le tour du cap Corse. L'excursion se fait en trois jours. Grâce à de puissants appuis, – car je ne puis croire au simple hasard, – j'ai eu deux chevaux qui baissaient la tête et relevaient un pied dès qu'ils en avaient le loisir, mais qui trottaient aux côtes et aux descentes, et possédaient à fond, presque aussi bien qu'un bipède politique, l'art du tournant discret; j'ai eu un de ces landaus méditerranéens, chargés d'un sac d'orge à l'avant, d'une provision de foin comprimé à l'arrière, et qui veulent bien porter encore des voyageurs en surcroît; j'ai eu un cocher silencieux, buveur d'eau, habile à remplacer, dans le harnais, une pièce de cuir par une ficelle, et qui m'a remercié du pourboire. O Corse, tu es encore jeune, et je t'aime pour cette jeunesse!
Trois jours de voyage, et trois paysages bien différents: la côte orientale, le nez du cap, la côte de l'ouest.
Que de fois j'avais contemplé, sur les cartes, la figure de cette Corse, un ovale qui a une pointe en haut, très longue! Mes cartes ne valaient rien sans doute; le graveur avait cessé trop tôt de tracer ce point d'épine qui signifie: montagne; je m'imaginais que le bec de l'île était assez plat, qu'il ressemblait à l'épée de ce gros poisson qu'on nomme scie. Erreur complète! Le cap est une chaîne de montagnes, sans brisure, qui barre la mer sur une soixantaine de kilomètres. Mais la ligne des sommets demeure constamment éloignée de la rive orientale. De ce côté, l'inclinaison des terres est faible, les arêtes rocheuses sont peu élevées, les plages nombreuses; les petites vallées étroites se succèdent, désertes et incultes le plus souvent, avec un torrent au milieu, qui fait du bruit, des arbousiers penchés dessus, et une crique à l'embouchure, où les romarins fleurissent dans la pierraille, et pendent sur la mer en paquets de laine violette. La route suit le rivage. De loin en loin, un groupe de maisons de pêcheurs, une auberge, une chapelle, un bureau de poste; c'est le port de quelque gros village caché dans la montagne: Lavasina; Erbalunga, bâtie sur une presqu'île, les vieilles façades plongeant dans l'eau; Santa-Severa, qui est la marine de Luri, et dont les murs sont peints en bleu, en jaune, en rose sous la braise des tuiles; Macina, marine de Rogliano. Si vous allez jamais en Corse, si vous projetez surtout d'y passer une saison, retenez ce nom de Rogliano. Je l'écris à regret, parce que les beaux sites ne gagnent pas, d'habitude, à être connus; mais la vérité est plus forte. Elle m'oblige à dire que je n'ai pas vu, en Corse, de nid mieux fait pour le repos, de lieu de vacances plus souhaitable que ce Rogliano, trois villages bâtis sur trois éperons de montagne, au-dessus d'une conque verte, immense, toute en forêt et qui s'ouvre au loin sur la mer. Comment le maquis de Rogliano a-t-il échappé aux gardeurs de chèvres? je l'ignore, mais il est admirable, intact, épais, et le parfum de ses écorces et de ses fleurs souffle autour des maisons, qui sont blanches, et souvent belles. On a l'impression, en traversant les rues, en voyant les enfants qui jouent et les femmes qui lavent sous les grands oliviers, que la population est accueillante, riche et d'esprit vif.
– Ne vous étonnez pas, me dit quelqu'un. Les Capcorsiens sont des marins, des colonisateurs, des hommes qui courent le monde. Dans tous les villages vous remarquerez, comme ici, des maisons bien construites, des villas entourées de jardins et de vergers, et aussi des tombeaux élevés à grands frais au bord des routes. Si vous demandez: «A qui appartient ce domaine-ci? Et celui-là?» on vous répondra: «A Un Tel, un Américain.» Entendez par là un Corse qui a fait fortune dans l'Amérique du Sud, et qui est revenu ensuite se fixer au pays natal. Nos compatriotes sont extrêmement nombreux au Vénézuéla, où l'on trouve des villes, comme Carupano, uniquement habitées par des Corses, planteurs et marchands de café. Vous n'ignorez pas non plus que trente mille Corses vivent à Marseille. Je gagerais qu'une moitié d'entre eux est originaire du Cap.
L'enchantement de Rogliano dure jusqu'au point où nous franchissons les bords de l'immense coupe verte. Aussitôt après, tout change, les lignes, les couleurs, la température, l'odeur du vent. Nous sommes en plein nord. La mer est souveraine. Elle a déraciné, desséché, anémié le maquis; ailleurs elle l'empêche de naître; elle envoie son terrible mistral, le marino, fouiller les roches et les forer; les pierres sont usées, l'herbe manque sur de larges espaces où il suffirait d'un écran pour qu'elle poussât drue. Plusieurs de front, d'un même mouvement, des promontoires s'abaissent vers la mer, et terminent l'île de Corse. Au delà, séparé par un détroit toujours agité, il n'y a plus qu'un îlot, qui porte le phare et qui se nomme la Giraglia.
Le retour par la côte de l'ouest est la plus belle partie de l'excursion. Nous avons traversé, pour venir, les petits ports de la côte orientale. Maintenant nous suivons une route de corniche, tournante, audacieusement taillée dans le flanc des montagnes, à une hauteur qui varie entre cent et trois cent soixante mètres au-dessus de la mer. L'ampleur de l'horizon, l'éclat du moindre flot et de la moindre pierre des golfes qu'on domine, la très belle lumière qui court sous les branches et la très belle herbe qu'elle rencontre, le merveilleux village de Nonza, bâti sur une pyramide presque détachée de la côte, les bois, les cultures, cent raisons de cette sorte me font regretter non pas que Concarneau ait une colonie de peintres, mais que la Corse n'en ait pas une. Oui, les cultures, malgré la pente terrible, malgré le soleil, au milieu de ces masses de roches: les habitants ont fait des prodiges; partout où il a été possible d'établir, de suspendre des jardins aux flancs des falaises, ils ont taillé le rocher ou élargi les minces plates-formes naturelles, creusé des escaliers qui vont d'étage en étage, apporté de la terre, contenu le précieux humus à l'aide de petits murs, et enfin, dans ces cuves surchauffées, ils ont planté des cédratiers. La plupart des gros cédrats qui nous viennent par Marseille ont mûri sur le territoire fortement incliné de Morsiglia, de Pino ou de Nonza.
Dans un de ces villages, où je passe la nuit, un jeune homme, à la porte de l'auberge, chantonne un air triste. Je lui demande de chanter tout haut pour moi. «C'est, me dit-il en riant, la complainte de Tramoni, le célèbre bandit Sartenais. Mais je puis dire, si vous le préférez, la Berceuse, qui est aussi de Sartène, ou la Pipe, que m'a apprise Napoléo. – Non, je préfère le bandit.» Il se met à chanter, d'une voix qui n'est pas sauvage, et je note, pour les traduire, les derniers couplets:
«Je suis Tramoni, bandit pour mon malheur;… les gendarmes et mes ennemis sont conjurés pour me perdre, et chaque jour, pour moi, la tombe est ouverte.
»O mère chérie, pleure ton fils abandonné et seul en ce monde; ils lui ont interdit Sartène, et la vallée d'Ortolu, quand je l'aperçois de loin, me semble un monde nouveau.
»Je porte cent cartouches dans ma giberne, prêt à faire feu, à moins que le cœur ne me défaille; quant à me constituer prisonnier, jamais je ne le ferai; celui qui doit me tuer devra tirer à couvert.
»Si son abri n'est pas parfaitement sûr, si j'ai devant moi une figure d'homme, je veux lui rendre son coup de feu; n'est-ce pas la loi de nature? La mire de mon fusil, je la distingue bien, même par la nuit noire.»
Ce Napoléo, qui chante, avec un succès non épuisé, la chanson qu'il a composée sur la Pipe, est un des trois chanteurs ambulants les plus connus de la Corse. Il est jeune encore; on lui donne un sou pour sa peine; il voyage seul; ses deux émules, Stra et Magiotti, font souvent route ensemble, et s'accompagnent avec la guitare.
Je ne crois pas que cette poésie populaire soit bien riche. Les voceri ne sont pas complètement tombés en désuétude, et, dans les cantons reculés, surtout dans le sud, vers Sartène et Bonifacio, on peut entendre encore ces improvisations criées par des pleureuses professionnelles. Mais, si vous errez dans les villages, si vous savez revenir, c'est-à-dire si vous laissez aux bonnes chances le temps de naître, vous entendrez des paysans chanter en parties dans un café ou dans une grange. C'est une merveille.
J'ai entendu, dans une rue de Saint-Florent, un de ces concerts improvisés, ces voix contenues, chaudes, justes, qui reprennent une mélopée qu'invente le chef de chœur. Je vous souhaite la même fortune. Et d'ailleurs, même sans musique, Saint-Florent, par où se termine l'excursion du Cap, vaut mieux qu'un court passage. J'en dirai peu de choses, pour ne pas me répéter.
La petite ville est bâtie au fond d'un golfe, à la pointe de l'angle droit que forme le Cap avec les terres montueuses de l'île qui s'élargit, entre le chef et l'épaule. Sa plage reflète toute une file de vieilles maisons, qui vont dans la mer aussi loin qu'on peut y bâtir, douanes anciennes, j'imagine, logis de capitaines ou d'armateurs qui voulaient être les premiers à saluer les tartanes de Gênes ou de Marseille entrant à toutes voiles, poussées par le vent du nord. Les rues ont de l'imprévu, des détroits, des clairières, des ombres découpées, un air de famille noble, un peu gênée maintenant, mais qui se souvient. Je les ai visitées avec un homme intelligent, observateur, ancien maire du pays, qu'il connaît en administrateur, et qu'il aime en artiste. Il m'a conté l'histoire de sa ville, et le projet du grand Empereur qui voulut, un moment, établir là un port de guerre. M'ayant parlé du rêve, il me montra le port de la réalité, un lac enveloppé de prairies, de platanes, de tamaris, et que fréquentent des bandes de canards. Il me mena, à six cents mètres de la mer, sur la colline où s'élevait la cité primitive, dont il reste la cathédrale et quelques pans de murailles incrustés dans les façades de granges ou de porcheries. Et je vis, en même temps, la campagne montante, les blés, les prairies, les jachères toutes blanches d'asphodèles et les bois d'oliviers étagés en demi-cercle, par où j'allais gagner le défilé de Lancone et retrouver Bastia.