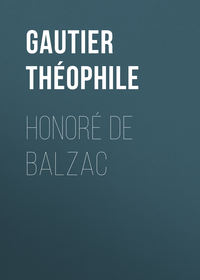Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Honoré de Balzac», sayfa 4
IV
Un des rêves de Balzac était l'amitié héroïque et dévouée, deux âmes, deux courages, deux intelligences fondues dans la même volonté. Pierre et Jaffier de la Venise Sauvée, d'Otway, l'avaient beaucoup frappé, et il en parle à plusieurs reprises. L'Histoire des Treize n'est que cette idée agrandie et compliquée: une unité puissante composée d'êtres multiples agissant tous aveuglément pour un but accepté et convenu. On sait quels effets saisissants, mystérieux et terribles il a tirés de ce point de départ dans Ferragus, La Duchesse de Langeais, La Fille aux Yeux d'Or; mais la vie réelle et la vie intellectuelle ne se séparaient pas nettement chez Balzac comme chez certains auteurs, et ses créations le suivaient hors de son cabinet d'étude. Il voulut former une association dans le goût de celle qui réunissait Ferragus, Montriveau, Ronquerolles, et leurs compagnons. Seulement il ne s'agissait pas de coups si hardis; un certain nombre d'amis devaient se prêter aide et secours en toute occasion, et travailler selon leurs forces au succès ou à la fortune de celui qui serait désigné, à charge de revanche, bien entendu. Fort infatué de son projet, Balzac recruta quelques affiliés qu'il ne mit en rapport les uns avec les autres qu'en prenant des précautions comme s'il se fût agi d'une société politique ou d'une vente de Carbonari. Ce mystère, très‐inutile du reste, l'amusait considérablement, et il apportait à ses démarches le plus grand sérieux. Lorsque le nombre fut complet, il assembla les adeptes et déclara le but de la Société. Il n'est pas besoin de dire que chacun opina du bonnet, et que les statuts furent votés d'enthousiasme. Personne plus que Balzac ne possédait le don de troubler, de surexciter et d'enivrer les cervelles les plus froides, les raisons les plus rassises. Il avait une éloquence débordée, tumultueuse, entraînante, qui vous emportait quoi qu'on en eût: pas d'objection possible avec lui; il vous noyait aussitôt dans un tel déluge de paroles qu'il fallait bien se taire. D'ailleurs il avait réponse à tout; puis il vous lançait des regards si fulgurants, si illuminés, si chargés de fluide qu'il vous infusait son désir.
L'association qui comptait parmi ses membres G. de C., L. G., L. D., J. S., Merle, qu'on appelait le beau Merle, nous, et quelques autres qu'il est inutile de désigner, s'appelait Le Cheval Rouge. Pourquoi Le Cheval Rouge, allez‐vous dire, plutôt que Le Lion d'Or ou La Croix de Malte? La première réunion des affiliés eut lieu chez un restaurateur, sur le quai de l'Entrepôt, au bout du pont de la Tournelle, dont l'enseigne était un quadrupède rubricâ pictus, ce qui avait donné à Balzac l'idée de cette désignation suffisamment bizarre, inintelligible et cabalistique.
Lorsqu'il fallait concerter quelque projet, convenir de certaines démarches, Balzac, élu par acclamation grand‐maître de l'Ordre, envoyait par un affidé à chaque cheval (c'était le nom argotique que prenaient les membres entre eux) une lettre dans laquelle était dessiné un petit cheval rouge avec ces mots: « Ecurie, tel jour, tel endroit; » le lieu changeait chaque fois, de peur d'éveiller la curiosité ou le soupçon. Dans le monde, quoique nous nous connaissions tous et de longue main pour la plupart, nous devions éviter de nous parler ou ne nous aborder que froidement pour écarter toute idée de connivence. Souvent, au milieu d'un salon, Balzac feignait de me rencontrer pour la première fois, et par des clins d'yeux et des grimaces comme en font les acteurs dans leurs aparté, m'avertissait de sa finesse et semblait me dire: « Regardez comme je joue bien mon jeu! »
Quel était le but du Cheval Rouge ? Voulait‐il changer le gouvernement, poser une religion nouvelle, fonder une école philosophique, dominer les hommes, séduire les femmes? Beaucoup moins que cela. On devait s'emparer des journaux, envahir les théâtres, s'asseoir dans les fauteuils de l'Académie, se former des brochettes de décorations, et finir modestement pair de France, ministre et millionnaire. – Tout cela était facile, selon Balzac; il ne s'agissait que de s'entendre, et par des ambitions si médiocres nous prouvions bien la modération de nos caractères. Ce diable d'homme avait une telle puissance de vision qu'il nous décrivait à chacun, dans les plus menus détails, la vie splendide et glorieuse que l'association nous procurerait. En l'entendant, nous nous croyions déjà appuyés, au fond d'un bel hôtel, contre le marbre blanc de la cheminée, un cordon rouge au col, une plaque en brillants sur le cœur, recevant d'un air affable les sommités politiques, les artistes et les littérateurs, étonnés de notre fortune mystérieuse et rapide. Pour Balzac, le futur n'existait pas, tout était au présent; l'avenir évoqué se dégageait de ses brumes et prenait la netteté des choses palpables; l'idée était si vive qu'elle devenait réelle en quelque sorte: parlait‐il d'un dîner, il le mangeait on le racontant; d'une voiture, il en sentait sous lui les moelleux coussins et la traction sans secousse; un parfait bien‐être, une jubilation profonde se peignaient alors sur sa figure, quoique souvent il fût à jeun et qu'il trottât sur le pavé pointu avec des souliers éculés.
Toute la bande devait pousser, vanter, prôner, par des articles, des réclames et des conversations, celui des membres qui venait de faire paraître un livre ou jouer un drame. Quiconque s'était montré hostile à l'un des chevaux s'attirait les ruades de toute l'écurie; Le Cheval Rouge ne pardonnait pas: le coupable devenait passible d'éreintements, de scies, de coups d'épingle, de rengaines et autres moyens de désespérer un homme, bien connus des petits journaux.
Nous sourions en trahissant après tant d'années l'innocent secret de cette franc‐maçonnerie littéraire, qui n'eut d'autre résultat que quelques réclames pour un livre dont le succès n'en avait pas besoin. Mais, dans le moment, nous prenions la chose au sérieux, nous nous imaginions être les Treize eux‐mêmes, en personne, et nous étions surpris de ne point passer à travers les murs; mais le monde est si mal machiné! Quel air important et mystérieux nous avions en coudoyant les autres hommes, pauvres bourgeois qui ne se doutaient nullement de notre puissance !
Après quatre ou cinq réunions, Le Cheval Rouge cessa d'exister; la plupart des chevaux n'avaient pas de quoi payer leur avoine à la mangeoire symbolique, et l'association qui devait s'emparer de tout fut dissoute, parce que ses membres manquaient souvent des quinze francs prix de l'écot. Chacun se replongea donc seul dans la mêlée de la vie, combattant avec ses propres armes, et c'est ce qui explique pourquoi Balzac ne fut pas de l'Académie et mourut simple chevalier de la Légion d'honneur.
L'idée cependant était bonne, car Balzac, comme il le dit de Nucingen, ne pouvait avoir une mauvaise idée. D'autres, qui sont parvenus, l'ont mise en œuvre sans l'entourer de la même fantasmagorie romanesque.
Désarçonné d'une chimère, Balzac en remontait bien vite une nouvelle, et il repartait pour un autre voyage dans le bleu avec cette naïveté d'enfant qui chez lui s'alliait à la sagacité la plus profonde et à l'esprit le plus retors.
Que de projets bizarres il nous a déroulés, que de paradoxes étranges il nous a soutenus, toujours avec la même bonne foi! – Tantôt il posait qu'on devait vivre en dépensant neuf sous par jour, tantôt il exigeait cent mille francs pour le plus étroit confortable. Une fois, sommé par nous d'établir le compte en chiffres, il répondit à l'objection qu'il restait encore trente mille francs à employer: « Eh bien! C'est pour le beurre et les radis. Quelle est la maison un peu propre où l'on ne mange pas trente mille francs de radis et de beurre? » Nous voudrions pouvoir peindre le regard de souverain mépris qu'il laissa tomber sur nous en donnant cette raison triomphale; ce regard disait: « Décidément le Théo n'est qu'un pleutre, un rat pelé, un esprit mesquin; il n'entend rien à la grande existence et n'a mangé toute sa vie que du beurre de Bretagne salé. »
Les Jardies préoccupèrent beaucoup l'attention publique, lorsque Balzac les acheta dans l'intention honorable de constituer un gage à sa mère. En passant en wagon sur le chemin de fer qui longe Ville‐d'Avray, chacun regardait avec curiosité cette petite maison, moitié cottage, moitié chalet, qui se dressait au milieu d'un terrain en pente et d'apparence glaiseuse.
Ce terrain, selon Balzac, était le meilleur du monde; autrefois, prétendait‐il, un certain crû célèbre y poussait, et les raisins, grâce à une exposition sans pareille, s'y cuisaient comme les grappes de Tokay sur les coteaux de Bohême. Le soleil, il est vrai, avait toute liberté de mûrir la vendange en ce lieu, où il n'existait qu'un seul arbre. Balzac essaya d'enclore cette propriété de murs, qui devinrent fameux par leur obstination à s'écrouler ou à glisser tout d'une pièce sur l'escarpement trop abrupt, et il rêvait pour cet endroit privilégié du ciel les cultures les plus fabuleuses et les plus exotiques. Ici se place naturellement l'anecdote des ananas, qu'on a si souvent répétée que nous ne la redirions pas si nous ne pouvions y ajouter un trait vraiment caractéristique. – Voici le projet: cent mille pieds d'ananas étaient plantés dans le clos des Jardies, métamorphosé en serres qui n'exigeraient qu'un médiocre chauffage, vu la torridité du site. Les ananas devaient être vendus cinq francs au lieu d'un louis qu'ils coûtent ordinairement, soit cinq cent mille francs; il fallait déduire de ce prix cent mille francs pour les frais de culture, de châssis, de charbon; restaient donc quatre cent mille francs nets qui constituaient à l'heureux propriétaire une rente splendide, – « sans la moindre copie, » ajoutait‐il. – Ceci n'est rien, Balzac eut mille projets de ce genre; mais le beau est que nous cherchâmes ensemble, sur le boulevard Montmartre, une boutique pour la vente des ananas encore en germe. La boutique devait être peinte en noir et rechampie de filets d'or, et porter sur son enseigne, en lettres énormes: « ANANAS DES JARDIES. »
Pour Balzac, les cent mille ananas hérissaient déjà leurs aigrettes de feuilles dentelées au‐dessus de leurs gros cônes d'or quadrillés sous d'immenses voûtes de cristal: il les voyait; il se dilatait à la haute température de la serre, il en aspirait le parfum tropical de ses narines passionnément ouvertes; et quand, rentré chez lui, il regardait, accoudé à la fenêtre, la neige descendre silencieusement sur les pentes décharnées, à peine se détrompait‐il de son illusion.
Il se rendit pourtant à notre conseil de ne louer la boutique que l'année suivante, pour éviter des frais inutiles.
Nous écrivons nos souvenirs à mesure qu'ils nous reviennent, sans essayer de mettre de la suite à ce qui n'en peut avoir. – D'ailleurs, comme le disait Boileau, les transitions sont la grande difficulté de la poésie, – et des articles, ajouterons‐nous; mais les journalistes modernes n'ont pas autant de conscience ni surtout autant de loisir que le législateur du Parnasse.
Madame de Girardin professait pour Balzac une vive admiration à laquelle il était sensible et dont il se montrait reconnaissant par de fréquentes visites, lui si avare à bon droit de son temps et de ses heures de travail. Jamais femme ne posséda à un si haut degré que Delphine, comme nous nous permettions de l'appeler familièrement entre nous, le don d'exciter l'esprit de ses hôtes. Avec elle, on se trouvait toujours en verve et chacun sortait du salon émerveillé de lui‐même. Il n'était caillou si brut dont elle ne fît jaillir une étincelle, et sur Balzac, comme vous le pensez, il ne fallait pas battre le briquet longtemps: il pétillait tout de suite et s'allumait. Balzac n'était pas précisément ce qu'on appelle un causeur, alerte à la réplique, jetant un mot fin et décisif dans une discussion, changeant de sujet au fil de l'entretien, effleurant toute chose avec légèreté, et ne dépassant pas le demi‐sourire: il avait une verve, une éloquence, et un brio irrésistibles; et, comme chacun se taisait pour l'écouter, avec lui, à la satisfaction générale, la conversation dégénérait vite en soliloque. Le point de départ était bientôt oublié et il passait d'une anecdote à une réflexion philosophique, d'une observation de mœurs à une description locale; à mesure qu'il parlait son teint se colorait, ses yeux devenaient d'un lumineux particulier, sa voix prenait des inflexions différentes, et parfois il se mettait à rire aux éclats, égayé par les apparitions bouffonnes qu'il voyait avant de les peindre. Il annonçait ainsi, comme par une sorte de fanfare, l'entrée de ses caricatures et de ses plaisanteries, – et son hilarité était bientôt partagée par les assistants. – Quoique ce fût l'époque des rêveurs échevelés comme des saules, des pleurards à nacelle et des désillusionnés byroniens, Balzac avait cette joie robuste et puissante qu'on suppose à Rabelais, et que Molière ne montra que dans ses pièces. Son large rire épanoui sur ses lèvres sensuelles était celui d'un dieu bon enfant qu'amuse le spectacle des marionnettes humaines, et qui ne s'afflige de rien parce qu'il comprend tout et saisit à la fois les deux côtés des choses. Ni les soucis d'une situation souvent précaire, ni les ennuis d'argent, ni la fatigue de travaux excessifs, ni les claustrations de l'étude, ni le renoncement à tous les plaisirs de la vie, ni la maladie même ne purent abattre cette jovialité herculéenne, selon nous un des caractères les plus frappants de Balzac. Il assommait les hydres en riant, déchirait allégrement les lions en deux, et portait comme un lièvre le sanglier d'Erymanthe sur son épaule montueuse de muscles. A la moindre provocation cette gaieté éclatait et soulevait sa forte poitrine, – elle surprenait même quelques délicats, mais il fallait bien la partager, quelque effort qu'on fît pour tenir son sérieux. Ne croyez pas cependant que Balzac cherchât à divertir sa galerie: il obéissait à une sorte d'ivresse intérieure et peignait en traits rapides, avec une intensité comique et un talent bouffe incomparables, les fantasmagories bizarres qui dansaient dans la chambre noire de son cerveau. Nous ne saurions mieux comparer l'impression produite par certaines de ses conversations qu'à celle qu'on éprouve en feuilletant les étranges dessins des Songes Drolatiques, de maître Alcofribas Nasier. Ce sont des personnages monstrueux, composés des éléments les plus hybrides. Les uns ont pour tête un soufflet dont le trou représente l'œil, les autres pour nez une flûte d'alambic; ceux‐ci marchent avec des roulettes qui leur tiennent lieu de pieds; ceux‐là s'arrondissent en panse de marmite et sont coiffés d'un couvercle en guise de toque, mais une vie intense anime ces êtres chimériques, et l'on reconnaît dans leurs masques grimaçants les vices, les folies et les passions de l'homme. Quelques‐uns, quoique absurdement en dehors du possible, vous arrêtent comme des portraits. On leur donnerait un nom.
Quand on écoutait Balzac, tout un carnaval de fantoches extravagants et réels vous cabriolaient devant les yeux, se jetant sur l'épaule une phrase bariolée, agitant de longues manches d'épithètes, se mouchant avec bruit dans un adverbe, se frappant d'une batte d'antithèses, vous tirant par le pan de votre habit, et vous disant vos secrets à l'oreille d'une voix déguisée et nasillarde, pirouettant, tourbillonnant au milieu d'une scintillation de lumières et de paillettes. Rien n'était plus vertigineux, et au bout d'une demi‐heure, on sentait, comme l'étudiant après le discours de Méphistophélès, une meule de moulin vous tourner dans la cervelle.
Il n'était pas toujours si lancé, et alors une de ses plaisanteries favorites était de contrefaire le jargon allemand de Nucingen ou de Schmucke, ou bien encore de parler en rama, comme les habitués de la pension bourgeoise de madame Vauquer (née de Conflans). – A l'époque où il composa Un Début dans la Vie sur un canevas de madame de Surville, il cherchait des proverbes par à peu près pour le rapin Mistigris, à qui plus tard, l'ayant trouvé spirituel, il donna une belle position dans La Comédie Humaine, sous le nom du grand paysagiste Léon de Lora. Voici quelques‐uns de ces proverbes: « Il est comme un âne en plaine. » « Je suis comme le lièvre: je meurs ou je m'arrache. » « Les bons comtes font les bons tamis. » « Les extrêmes se bouchent. » « La claque sent toujours le hareng; » et ainsi de suite. Une trouvaille de ce genre le mettait en belle humeur, et il faisait des gentillesses et des gambades d'éléphant, à travers les meubles, autour du salon. De son côté, madame de Girardin était en quête de mots pour la fameuse dame aux sept petites chaises du Courrier de Paris. L'on requérait quelquefois notre concours, et si un étranger fût entré, à voir cette belle Delphine peignant de ses doigts blancs les spirales de sa chevelure d'or, d'un air profondément rêveur; Balzac, assis sur les épaules dans le grand fauteuil capitonné où dormait d'habitude M. de Girardin, les mains crispées au fond de ses goussets, son gilet rebroussé au‐dessus de son ventre, dandinant une jambe avec un rhythme monotone, exprimant par les muscles contractés de son masque une contention d'esprit extraordinaire, nous accroupi entre deux coussins du divan, comme un thériaki halluciné; – cet étranger, certes, n'aurait pu soupçonner ce que nous faisions là, dans un si grand recueillement; il eût supposé que Balzac pensait à une nouvelle madame Firmiani, madame de Girardin à un rôle pour mademoiselle Rachel, et nous à quelque sonnet. Mais il n'en était rien. Quant au calembour, Balzac, bien que son ambition secrète fût d'y atteindre, dut, après des efforts consciencieux, reconnaître son incapacité notoire à cet endroit, et s'en tenir aux proverbes par à peu près, qui précédèrent les calembours approximatifs mis en vogue par l'école du bon sens. Quelles bonnes soirées qui ne reviendront plus! Nous étions loin alors de prévoir que cette grande et superbe femme, taillée en plein marbre antique, que cet homme trapu, robuste, vivace, qui résumait en lui les vigueurs du sanglier et du taureau, moitié hercule, moitié satyre, fait pour dépasser cent ans, s'en iraient sitôt dormir, l'une à Montmartre, l'autre au Père‐Lachaise, et que, des trois, nous resterions seul pour fixer ces souvenirs déjà lointains et près de se perdre.
Comme son père, qui mourut accidentellement plus qu'octogénaire, et se flattait de faire sauter la tontine Lafarge, Balzac croyait à sa longévité. Souvent il faisait avec nous des projets d'avenir. Il devait terminer La Comédie Humaine, écrire la Théorie de la Démarche, faire la Monographie de la Vertu, une cinquantaine de drames, arriver à une grande fortune, se marier et avoir deux enfants, « mais pas davantage; deux enfants font bien, disait‐il, sur le devant d'une calèche. » Tout cela ne laissait pas que d'être long, et nous lui faisions observer que, ces besognes accomplies, il aurait environ quatre‐vingts ans. « Quatre‐vingts ans! s'écriait‐il, bah! C'est la fleur de l'âge. » M. Flourens, avec ses consolantes doctrines, n'eût pas mieux dit.
Un jour que nous dînions ensemble chez M. E. de Girardin, il nous raconta une anecdote sur son père, pour montrer à quelle forte race il appartenait. M. de Balzac père, placé chez un procureur, mangeait suivant l'usage du temps à la table du patron avec les autres clercs. On servit des perdrix. La procureuse qui guignait de l'œil le nouveau venu, lui dit: « M. Balzac, savez‐vous découper? – Oui, madame, » répondit le jeune homme, rouge jusqu'aux oreilles; et il empoigna bravement le couteau et la fourchette. Ignorant tout à fait l'anatomie culinaire, il divisa la perdrix en quatre, mais avec tant de vigueur qu'il fendit l'assiette, trancha la nappe et entama le bois de la table. Ce n'était pas adroit, mais c'était fort: la procureuse sourit, et à dater de ce jour, ajoutait Balzac, le jeune clerc fut traité fort doucement dans la maison.
Cette historiette racontée semble froide, mais il fallait voir la mimique de Balzac imitant sur son assiette l'exploit paternel, l'air effaré et résolu à la fois qu'il prenait, la façon dont il saisissait son couteau après avoir retroussé sa manche et dont il enfonçait sa fourchette dans une perdrix imaginaire; Neptune chassant des monstres marins ne manie pas son trident d'un poing plus vigoureux, et quelle pesée immense il faisait! Ses joues s'en empourpraient, les yeux lui en sortaient de la tête, mais l'opération terminée, comme il promenait sur l'assemblée un regard de satisfaction naïve, cherchant à se voiler sous la modestie !
Au reste, Balzac avait en lui l'étoffe d'un grand acteur: il possédait une voix pleine, sonore, cuivrée, d'un timbre riche et puissant, qu'il savait modérer et rendre très‐douce au besoin, et il lisait d'une manière admirable, talent qui manque à la plupart des acteurs. Ce qu'il racontait, il le jouait avec des intonations, des grimaces et des gestes qu'aucun comédien n'a dépassés à notre avis.
Nous trouvons dans Marguerite, de madame de Girardin, ce souvenir de Balzac. C'est un personnage du livre qui parle.
« Il raconta que Balzac avait dîné chez lui la veille, et qu'il avait été plus brillant, plus étincelant que jamais. Il nous a bien amusés avec le récit de son voyage en Autriche. Quel feu! Quelle verve! Quelle puissance d'imitation! C'était merveilleux. Sa manière de payer les postillons est une invention qu'un romancier de génie pouvait seul trouver. « J'étais très‐embarrassé à chaque relais, disait‐il; comment faire pour payer? Je ne savais pas un mot d'allemand, je ne connaissais pas la monnaie du pays. C'était très‐difficile. Voilà ce que j'avais imaginé. J'avais un sac rempli de petites pièces d'argent, de kreutzers … Arrivé au relais, je prenais mon sac; le postillon venait à la portière de la voiture; je le regardais attentivement entre les deux yeux, et je lui mettait dans la main un kreutzer, … deux kreutzers, … puis trois, puis quatre, etc., jusqu'à ce que je le visse sourire. … Dès qu'il souriait, je comprenais que je lui donnais un kreutzer de trop … Vite je reprenais ma pièce et mon homme était payé. »
Aux Jardies, il nous lut – Mercadet, – le Mercadet primitif, bien autrement ample, compliqué et touffu que la pièce arrangée pour le Gymnase par d'Ennery, avec tant de tact et d'habileté. Balzac, qui lisait comme Tieck, sans indiquer ni les actes, ni les scènes, ni les noms, affectait une voix particulière et parfaitement reconnaissable à chaque personnage; les organes dont il dotait les différentes espèces de créanciers étaient d'un comique désopilant: il y en avait de rauques, de mielleux, de précipités, de traînards, de menaçants, de plaintifs. Cela glapissait, cela miaulait, cela grondait, cela grommelait, cela hurlait sur tous les tons possibles et impossibles. La Dette chantait d'abord un solo que soutenait bientôt un chœur immense. Il sortait des créanciers de partout, de derrière le poêle, de dessous le lit, des tiroirs de commode; le tuyau de la cheminée en vomissait; il en filtrait par le trou de la serrure; d'autres escaladaient la fenêtre comme des amants; ceux‐ci jaillissaient du fond d'une malle pareils aux diables des joujoux à surprises, ceux‐là passaient à travers les murs comme à travers une trappe anglaise, et c'était une cohue, un tapage, une invasion, une vraie marée montante. Mercadet avait beau les secouer, il en revenait toujours d'autres à l'assaut, et jusqu'à l'horizon on devinait un sombre fourmillement de créanciers en marche, arrivant comme les légions de termites pour dévorer leur proie. Nous ne savons si la pièce était meilleure ainsi, mais jamais représentation ne produisit un tel effet.
Balzac, pendant cette lecture de Mercadet, occupait, à demi‐couché, un long divan dans le salon des Jardies, car il s'était foulé le pied, en glissant comme ses murs sur la glaise de sa propriété. Quelque brindille, passant à travers l'étoffe, piquait la peau de sa jambe et l'incommodait. « La perse est trop mince, le foin la traverse; il faudra mettre une toile épaisse dessous, dit‐il en arrachant la pointe qui le gênait. »
François, le Caleb de ce Ravenswood, n'entendait pas raillerie sur les splendeurs du manoir. – Il reprit son maître et dit: le crin. « Le tapissier m'a donc trompé? répondit Balzac. Ils sont tous les mêmes. J'avais recommandé de mettre du foin! Sacré voleur! »
Les magnificences des Jardies n'existaient guère qu'à l'état de rêve. Tous les amis de Balzac se souviennent d'avoir vu écrit au charbon sur les murs nus ou plaqués de papier gris: « Boiseries de palissandre, – tapisseries des Gobelins, – glaces de Venise, – tableaux de Raphaël. » Gérard de Nerval avait déjà décoré un appartement de cette manière, et cela ne nous étonnait pas. Quand à Balzac, il se croyait littéralement dans l'or, le marbre et la soie; mais, s'il n'acheva pas Les Jardies et s'il prêta à rire par ses chimères, il sut du moins se bâtir une demeure éternelle, un monument « plus durable que l'airain, » une cité immense, peuplée de ses créations et dorée par les rayons de sa gloire.