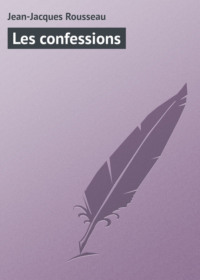Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Les confessions», sayfa 46
Les représentants, revenus de leur premier abattement, entreprirent une réponse, et s’en tirèrent passablement avec le temps. Mais tous jetèrent les yeux sur moi, comme sur le seul qui pût entrer en lice contre un tel adversaire, avec espoir de le terrasser. J’avoue que je pensai de même, et, poussé par mes anciens concitoyens, qui me faisaient un devoir de les aider de ma plume dans un embarras dont j’avais été l’occasion, j’entrepris la réfutation des Lettres écrites de la Campagne, et j’en parodiai le titre par celui de Lettres écrites de la Montagne, que je mis aux miennes. Je fis et j’exécutai cette entreprise si secrètement, que, dans un rendez-vous que j’eus à Thonon avec les chefs des représentants, pour parler de leurs affaires, et où ils me montrèrent l’esquisse de leur réponse, je ne leur dis pas un mot de la mienne, qui était déjà faite, craignant qu’il ne survînt quelque obstacle à l’impression, s’il en parvenait le moindre vent soit aux magistrats, soit à mes ennemis particuliers. Je n’évitai pourtant pas que cet ouvrage ne fût connu en France avant la publication; mais on aima mieux le laisser paraître que de me faire trop comprendre comment on avait découvert mon secret. Je dirai là-dessus ce que j’ai su, qui se borne à très peu de chose; je me tairai sur ce que j’ai conjecturé.
J’avais à Motiers presque autant de visites que j’en avais eu à l’Hermitage et à Montmorency; mais elles étaient la plupart d’une espèce fort différente. Ceux qui m’étaient venus voir jusqu’alors étaient des gens qui, ayant avec moi des rapports de talents, de goûts, de maximes, les alléguaient pour cause de leurs visites, et me mettaient d’abord sur des matières dont je pouvais m’entretenir avec eux. À Motiers, ce n’était plus cela, surtout du côté de France. C’étaient des officiers ou d’autres gens qui n’avaient aucun goût pour la littérature, qui même, pour la plupart, n’avaient jamais lu mes écrits, et qui ne laissaient pas, à ce qu’ils disaient, d’avoir fait trente, quarante, soixante, cent lieues pour venir voir et admirer l’homme illustre, célèbre, très célèbre, le grand homme, etc. Car dès lors on n’a cessé de me jeter grossièrement à la face les plus impudentes flagorneries, dont l’estime de ceux qui m’abordaient m’avait garanti jusqu’alors. Comme la plupart de ces survenants ne daignaient ni se nommer, ni me dire leur état, que leurs connaissances et les miennes ne tombaient pas sur les mêmes objets, et qu’ils n’avaient ni lu ni parcouru mes ouvrages, je ne savais de quoi leur parler: j’attendais qu’ils parlassent eux-mêmes, puisque c’était à eux à savoir et à me dire pourquoi ils me venaient voir. On sent que cela ne faisait pas pour moi des conversations bien intéressantes, quoiqu’elles pussent l’être pour eux, selon ce qu’ils voulaient savoir: car, comme j’étais sans défiance, je m’exprimais sans réserve sur toutes les questions qu’ils jugeaient à propos de me faire, et ils s’en retournaient, pour l’ordinaire, aussi savants que moi sur tous les détails de ma situation.
J’eus, par exemple, de cette façon, M. de Feins, écuyer de la Reine et capitaine de cavalerie dans le régiment de la Reine, lequel eut la constance de passer plusieurs jours à Motiers, et même de me suivre pédestrement jusqu’à La Ferrière, menant son cheval par la bride, sans avoir avec moi d’autre point de réunion, sinon que nous connaissions tous deux Mlle Fel, et que nous jouions l’un et l’autre au bilboquet. J’eus avant et après M. de Feins une autre visite bien plus extraordinaire. Deux hommes arrivent à pied, conduisant chacun un mulet chargé de son petit bagage, logent à l’auberge, pansent leurs mulets eux-mêmes, et demandent à me venir voir. À l’équipage de ces muletiers, on les prit pour des contrebandiers, et la nouvelle courut aussitôt que des contrebandiers venaient me rendre visite. Leur seule façon de m’aborder m’apprit que c’étaient des gens d’une autre étoffe; mais, sans être contrebandiers, ce pouvait être des aventuriers, et ce doute me tint quelque temps en garde. Ils ne tardèrent pas à me tranquilliser. L’un était M. de Montauban, appelé le comte de la Tour du Pin, gentilhomme du Dauphiné; l’autre était M. Dastier, de Carpentras, ancien militaire, qui avait mis sa croix de Saint-Louis dans sa poche, ne pouvant pas l’étaler. Ces messieurs, tous deux très aimables, avaient tous deux beaucoup d’esprit; leur conversation était agréable et intéressante; leur manière de voyager, si bien dans mon goût, et si peu dans celui des gentilshommes français, me donna pour eux une sorte d’attachement que leur commerce ne pouvait qu’affermir. Cette connaissance même ne finit pas là, puisqu’elle dure encore, et qu’ils me sont revenus voir diverses fois, non plus à pied cependant, cela était bon pour le début: mais plus j’ai vu ces messieurs, moins j’ai trouvé de rapports entre leurs goûts et les miens, moins j’ai senti que leurs maximes fussent les miennes, que mes écrits leur fussent familiers, qu’il y eût aucune véritable sympathie entre eux et moi. Que me voulaient-ils donc? Pourquoi me venir voir dans cet équipage? Pourquoi rester plusieurs jours? Pourquoi revenir plusieurs fois? Pourquoi désirer si fort de m’avoir pour hôte? Je ne m’avisai pas alors de me faire ces questions. Je me les suis faites quelquefois depuis ce temps-là.
Touché de leurs avances, mon cœur se livrait sans raisonner, surtout avec M. Dastier, dont l’air plus ouvert me plaisait davantage. Je demeurai même en correspondance avec lui, et quand je voulus faire imprimer les Lettres de la Montagne, je songeai à m’adresser à lui pour donner le change à ceux qui attendaient mon paquet sur la route de Hollande. Il m’avait parlé beaucoup, et peut-être à dessein, de la liberté de la presse à Avignon; il m’avait offert ses soins, si j’avais quelque chose à y faire imprimer: je me prévalus de cette offre, et je lui adressai successivement, par la poste, mes premiers cahiers. Après les avoir gardés assez longtemps, il me les renvoya en me marquant qu’aucun libraire n’avait osé s’en charger, et je fus contraint de revenir à Rey, prenant soin de n’envoyer mes cahiers que l’un après l’autre, et de ne lâcher les suivants qu’après avoir eu avis de la réception des premiers. Avant la publication de l’ouvrage, je sus qu’il avait été vu dans les bureaux des ministres, et d’Escherny, de Neuchâtel, me parla d’un livre de l’Homme de la Montagne, que d’Holbach lui avait dit être de moi. Je l’assurai comme il était vrai, n’avoir jamais fait de livre qui eût ce titre. Quand les Lettres parurent, il était furieux et m’accusa de mensonge, quoique je ne lui eusse dit que la vérité. Voilà comment j’eus l’assurance que mon manuscrit était connu. Sûr de la fidélité de Rey, je fus forcé de porter ailleurs mes conjectures, et celle à laquelle j’aimais le mieux m’arrêter fut que mes paquets avaient été ouverts à la poste.
Une autre connaissance à peu près du même temps, mais qui se fit d’abord seulement par lettres, fut celle d’un M. Laliaud, de Nîmes, lequel m’écrivit de Paris, pour me prier de lui envoyer mon profil à la silhouette, dont il avait, disait-il, besoin pour mon buste en marbre qu’il faisait faire par le Moine, pour le placer dans sa bibliothèque. Si c’était une cajolerie inventée pour m’apprivoiser, elle réussit pleinement. Je jugeai qu’un homme qui voulait avoir mon buste en marbre dans sa bibliothèque était plein de mes ouvrages, par conséquent de mes principes, et qu’il m’aimait parce que son âme était au ton de la mienne. Il était difficile que cette idée ne me séduisît pas. J’ai vu M. Laliaud dans la suite. Je l’ai trouvé très zélé pour me rendre beaucoup de petits services, pour s’entremêler beaucoup dans mes petites affaires. Mais, au reste, je doute qu’aucun de mes écrits ait été du petit nombre de livres qu’il a lus en sa vie. J’ignore s’il a une bibliothèque, et si c’est un meuble à son usage, et quant au buste, il s’est borné à une mauvaise esquisse en terre, faite par le Moine, sur laquelle il a fait graver un portrait hideux qui ne laisse pas de courir sous mon nom, comme s’il avait avec moi quelque ressemblance.
Le seul Français qui parut me venir voir par goût pour mes sentiments et pour mes ouvrages fut un jeune officier du régiment de Limousin, appelé M. Séguier de Saint-Brisson, qu’on a vu et qu’on voit peut-être encore briller à Paris et dans le monde par des talents assez aimables, et par des prétentions au bel esprit. Il m’était venu voir à Montmorency l’hiver qui précéda ma catastrophe. Je lui trouvai une vivacité de sentiment qui me plut. Il m’écrivit dans la suite à Motiers, et soit qu’il voulût me cajoler, ou que réellement la tête lui tournât de l’Émile, il m’apprit qu’il quittait le service pour vivre indépendant, et qu’il apprenait le métier de menuisier. Il avait un frère aîné, capitaine dans le même régiment, pour lequel était toute la prédilection de la mère, qui, dévote outrée, et dirigée par je ne sais quel abbé tartufe, en usait très mal avec le cadet, qu’elle accusait d’irréligion, et même du crime irrémissible d’avoir des liaisons avec moi. Voilà les griefs sur lesquels il voulut rompre avec sa mère, et prendre le parti dont je viens de parler, le tout pour faire le petit Émile.
Alarmé de cette pétulance, je me hâtai de lui écrire pour le faire changer de résolution, et je mis à mes exhortations toute la force dont j’étais capable: elles furent écoutées. Il rentra dans son devoir vis-à-vis de sa mère, et il retira des mains de son colonel sa démission, qu’il lui avait donnée, et dont celui-ci avait eu la prudence de ne faire aucun usage, pour lui laisser le temps d’y mieux réfléchir. Saint-Brisson, revenu de ses folies, en fit une un peu moins choquante, mais qui n’était guère plus de mon goût; ce fut de se faire auteur. Il donna coup sur coup deux ou trois brochures, qui n’annonçaient pas un homme sans talent, mais sur lesquelles je n’aurai pas à me reprocher de lui avoir donné des éloges bien encourageants pour poursuivre cette carrière.
Quelque temps après, il me vint voir, et nous fîmes ensemble le pèlerinage de l’île de Saint-Pierre. Je le trouvai dans ce voyage différent de ce que je l’avais vu à Montmorency. Il avait je ne sais quoi d’affecté, qui d’abord ne me choqua pas beaucoup mais qui m’est revenu souvent en mémoire depuis ce temps-là. Il me vint voir encore une fois à l’hôtel de Saint-Simon, à mon passage à Paris pour aller en Angleterre. J’appris là, ce qu’il ne m’avait pas dit, qu’il vivait dans les grandes sociétés, et qu’il voyait assez souvent Mme de Luxembourg. Il ne me donna aucun signe de vie à Trye et ne me fit rien dire par sa parente, Mlle Ségnier, qui était ma voisine, et qui ne m’a jamais paru bien favorablement disposée pour moi. En un mot, l’engouement de M. de Saint-Brisson finit tout d’un coup, comme la liaison de M. de Feins; mais celui-ci ne me devait rien, et l’autre me devait quelque chose, à moins que les sottises que je l’avais empêché de faire n’eussent été qu’un jeu de sa part: ce qui, dans le fond, pourrait très bien être.
J’eus aussi des visites de Genève tant et plus. Les De Luc père et fils me choisirent successivement pour leur garde-malade: le père tomba malade en route; le fils l’était en partant de Genève; tous deux vinrent se rétablir chez moi. Des ministres, des parents, des cagots, des quidams de toute espèce, venaient de Genève et de Suisse, non pas comme ceux de France, pour m’admirer et me persifler, mais pour me tancer et catéchiser. Le seul qui me fit plaisir fut Moultou, qui vint passer trois ou quatre jours avec moi, et que j’y aurais bien voulu retenir davantage. Le plus constant de tous, celui qui s’opiniâtra le plus, et qui me subjugua à force d’importunités, fut un M. d’Ivernois, commerçant de Genève, Français réfugié et parent du Procureur général de Neuchâtel. Ce M. d’Ivernois de Genève passait à Motiers deux fois l’an, tout exprès pour m’y venir voir, restait chez moi du matin au soir plusieurs jours de suite, se mettait de mes promenades, m’apportait mille sortes de petits cadeaux, s’insinuait malgré moi dans ma confidence, se mêlait de toutes mes affaires, sans qu’il y eût entre lui et moi aucune communion d’idées, ni d’inclinations, ni de sentiments, ni de connaissances. Je doute qu’il ait lu dans toute sa vie un livre entier d’aucune espèce, et qu’il sache même de quoi traitent les miens. Quand je commençai d’herboriser, il me suivit dans mes courses de botanique, sans goût pour cet amusement, et sans avoir rien à me dire, ni moi à lui. Il eut même le courage de passer avec moi trois jours entiers tête-à-tête dans un cabaret à Goumoins d’où j’avais cru le chasser à force de l’ennuyer et de lui faire sentir combien il m’ennuyait, et tout cela sans qu’il m’ait été possible jamais de rebuter son incroyable constance, ni d’en pénétrer le motif.
Parmi toutes ces liaisons, que je ne fis et n’entretins que par force, je ne dois pas omettre la seule qui m’ait été agréable, et à laquelle j’aie mis un véritable intérêt de cœur: c’est celle d’un jeune Hongrois qui vint se fixer à Neuchâtel, et de là à Motiers, quelques mois après que j’y fus établi moi-même. On l’appelait dans le pays le baron de Sauttern, nom sous lequel il y avait été recommandé de Zurich. Il était grand et bien fait, d’une figure agréable, d’une société liante et douce. Il dit à tout le monde, et me fit entendre à moi-même, qu’il n’était venu à Neuchâtel qu’à cause de moi, et pour former sa jeunesse à la vertu par mon commerce. Sa physionomie, son ton, ses manières, me parurent d’accord avec ses discours, et j’aurais cru manquer à l’un des plus grands devoirs en éconduisant un jeune homme en qui je ne voyais rien que d’aimable et qui me recherchait par un si respectable motif. Mon cœur ne sait point se livrer à demi. Bientôt il eut toute mon amitié, toute ma confiance; nous devînmes inséparables. Il était de toutes mes courses pédestres; il y prenait goût. Je le menai chez Milord Maréchal, qui lui fit mille caresses. Comme il ne pouvait encore s’exprimer en français, il ne me parlait et ne m’écrivait qu’en latin: je lui répondais en français, et ce mélange des deux langues ne rendait nos entretiens ni moins coulants, ni moins vifs à tous égards. Il me parla de sa famille, de ses affaires, de ses aventures, de la cour de Vienne, dont il paraissait bien connaître les détails domestiques. Enfin, pendant près de deux ans que nous passâmes dans la plus grande intimité, je ne lui trouvai qu’une douceur de caractère à toute épreuve, des mœurs non seulement honnêtes, mais élégantes, une grande propreté sur sa personne, une décence extrême dans tous ses discours, enfin toutes les marques d’un homme bien né, qui me le rendirent trop estimable pour ne pas me le rendre cher.
Dans le fort de mes liaisons avec lui, d’Ivernois, de Genève, m’écrivit que je prisse garde au jeune Hongrois qui était venu s’établir près de moi, qu’on l’avait assuré que c’était un espion que le ministère de France avait mis auprès de moi. Cet avis pouvait paraître d’autant plus inquiétant, que dans le pays où j’étais, tout le monde m’avertissait de me tenir sur mes gardes, qu’on me guettait, et qu’on cherchait à m’attirer sur le territoire de France, pour m’y faire un mauvais parti.
Pour fermer la bouche une fois pour toutes à ces ineptes donneurs d’avis, je proposai à Sauttern, sans le prévenir de rien, une promenade pédestre à Pontarlier; il y consentit. Quand nous fûmes arrivés à Pontarlier, je lui donnai à lire la lettre de d’Ivernois, et puis l’embrassant avec ardeur, je lui dis: «Sauttern n’a pas besoin que je lui prouve ma confiance, mais le public a besoin que je lui prouve que je la sais bien placée». Cet embrassement fut bien doux; ce fut un de ces plaisirs de l’âme que les persécuteurs ne sauraient connaître, ni les ôter aux opprimés.
Je ne croirai jamais que Sauttern fût un espion, ni qu’il m’ait trahi; mais il m’a trompé. Quand j’épanchais avec lui mon cœur sans réserve, il eut le courage de me fermer constamment le sien, et de m’abuser par des mensonges. Il me controuva je ne sais quelle histoire qui me fit juger que sa présence était nécessaire dans son pays. Je l’exhortai de partir au plus vite: il partit, et quand je le croyais déjà en Hongrie, j’appris qu’il était à Strasbourg. Ce n’était pas la première fois qu’il y avait été. Il y avait jeté du désordre dans un ménage: le mari, sachant que je le voyais, m’avait écrit. Je n’avais omis aucun soin pour ramener la jeune femme à la vertu, et Sauttern à son devoir. Quand je les croyais parfaitement détachés l’un de l’autre, ils s’étaient rapprochés, et le mari même eut la complaisance de reprendre le jeune homme dans sa maison; dès lors je n’eus plus rien à dire. J’appris que le prétendu baron m’en avait imposé par un tas de mensonges. Il ne s’appelait point Sauttern, il s’appelait Sauttersheim. À l’égard du titre de baron, qu’on lui donnait en Suisse, je ne pouvais le lui reprocher, parce qu’il ne l’avait jamais pris: mais je ne doute pas qu’il ne fût bien gentilhomme, et Milord Maréchal, qui se connaissait en hommes, et qui avait été dans son pays, l’a toujours regardé et traité comme tel.
Sitôt qu’il fut parti, la servante de l’auberge, où il mangeait à Motiers, se déclara grosse de son fait. C’était une si vilaine salope, et Sauttern, généralement estimé et considéré dans tout le pays par sa conduite et ses mœurs honnêtes, se piquait si fort de propreté, que cette impudence choqua tout le monde. Les plus aimables personnes du pays, qui lui avaient inutilement prodigué leurs agaceries, étaient furieuses; j’étais outré d’inclination. Je fis tous mes efforts pour faire arrêter cette effrontée, offrant de payer tous les frais et de cautionner Sauttersheim. Je lui écrivis, dans la forte persuasion non seulement que cette grossesse n’était pas de son fait, mais qu’elle était feinte, et que tout cela n’était qu’un jeu joué par ses ennemis et les miens: je voulais qu’il revînt dans le pays confondre cette coquine et ceux qui la faisaient parler. Je fus surpris de la mollesse de sa réponse. Il écrivit au pasteur, dont la salope était paroissienne, et fit en sorte d’assoupir l’affaire; ce que voyant, je cessai de m’en mêler, fort étonné qu’un homme aussi crapuleux eût pu être assez maître de lui-même pour m’en imposer par sa réserve dans la plus intime familiarité.
De Strasbourg, Sauttersheim fut à Paris chercher fortune, et n’y trouva que de la misère. Il m’écrivit en disant son peccavi. Mes entrailles s’émurent au souvenir de notre ancienne amitié; je lui envoyai quelque argent. L’année suivante, à mon passage à Paris, je le revis à peu près dans le même état, mais grand ami de M. Laliaud, sans que j’aie pu savoir d’où lui venait cette connaissance, et si elle était ancienne ou nouvelle. Deux ans après, Sauttersheim retourna à Strasbourg d’où il m’écrivit, et où il est mort. Voilà l’histoire abrégée de nos liaisons, et ce que je sais de ses aventures: mais, en déplorant le sort de ce malheureux jeune homme, je ne cesserai jamais de croire qu’il était bien né, et que tout le désordre de sa conduite fut l’effet des situations où il s’est trouvé.
Telles furent les acquisitions que je fis à Motiers, en fait de liaisons et de connaissances. Qu’il en aurait fallu de pareilles pour compenser les cruelles pertes que je fis dans le même temps!
La première fut celle de M. de Luxembourg, qui, après avoir été tourmenté longtemps par les médecins, fut enfin leur victime, traité de la goutte, qu’ils ne voulurent point reconnaître, comme d’un mal qu’ils pouvaient guérir.
Si l’on doit s’en rapporter là-dessus à la relation que m’en écrivit La Roche, l’homme de confiance de Mme la Maréchale, c’est bien par cet exemple, aussi cruel que mémorable, qu’il faut déplorer les misères de la grandeur.
La perte de ce bon seigneur me fut d’autant plus sensible, que c’était le seul ami vrai que j’eusse en France et la douceur de son caractère était telle, qu’elle m’avait fait oublier tout à fait son rang, pour m’attacher à lui comme à mon égal. Nos liaisons ne cessèrent point par ma retraite, et il continua de m’écrire comme auparavant. Je crus pourtant remarquer que l’absence, ou mon malheur, avait attiédi son affection. Il est bien difficile qu’un courtisan garde le même attachement pour quelqu’un qu’il sait être dans la disgrâce des puissances. J’ai jugé d’ailleurs que le grand ascendant qu’avait sur lui Mme de Luxembourg ne m’avait pas été favorable, et qu’elle avait profité de mon éloignement pour me nuire dans son esprit. Pour elle, malgré quelques démonstrations affectées et toujours plus rares, elle cacha moins, de jour en jour, son changement à mon égard. Elle m’écrivit quatre ou cinq fois en Suisse, de temps à autre, après quoi elle ne m’écrivit plus du tout, et il fallait toute la prévention, toute la confiance, tout l’aveuglement où j’étais encore, pour ne pas voir en elle plus que du refroidissement envers moi.
Le libraire Guy, associé de Duchesne, qui depuis moi fréquentait beaucoup l’hôtel de Luxembourg, m’écrivit que j’étais sur le testament de M. le Maréchal. Il n’y avait rien là que de très naturel et de très croyable; ainsi je n’en doutai pas. Cela me fit délibérer en moi-même comment je me comporterais sur ce legs. Tout bien pesé, je résolus de l’accepter, quel qu’il pût être, et de rendre cet honneur à un honnête homme qui, dans un rang où l’amitié ne pénètre guère, en avait eu une véritable pour moi. J’ai été dispensé de ce devoir, n’ayant plus entendu parler de ce legs vrai ou faux; et en vérité j’aurais été peiné de blesser une des grandes maximes de ma morale, en profitant de quelque chose à la mort de quelqu’un qui m’avait été cher. Durant la dernière maladie de notre ami Mussard, Lenieps me proposa de profiter de la sensibilité qu’il marquait à nos soins pour lui insinuer quelques dispositions en notre faveur. «Ah! cher Lenieps, lui dis-je, ne souillons pas par des idées d’intérêt les tristes, mais sacrés devoirs, que nous rendons à notre ami mourant. J’espère n’être jamais dans le testament de personne, et jamais du moins dans celui d’aucun de mes amis». Ce fut à peu près dans ce même temps-ci que Milord Maréchal me parla du sien, de ce qu’il avait dessein d’y faire pour moi, et que je lui fis la réponse dont j’ai parlé dans ma première partie.
Ma seconde perte, plus sensible encore, et bien plus irréparable, fut celle de la meilleure des femmes et des mères, qui déjà chargée d’ans et surchargée d’infirmités et de misères, quitta cette vallée de larmes pour passer dans le séjour des bons où l’aimable souvenir du bien qu’on a fait ici-bas en fait l’éternelle récompense. Allez, âme douce et bienfaisante, auprès des Fénelon, des Bernex, des Catinat et de ceux qui, dans un état plus humble, ont ouvert comme eux leurs cœurs, à la charité véritable; allez goûter le fruit de la vôtre, et préparer à votre élève la place qu’il espère un jour occuper près de vous! Heureuse, dans vos infortunes, que le ciel en les terminant vous ait épargné le cruel spectacle des siennes! Craignant de contrister son cœur par le récit de mes premiers désastres, je ne lui avais point écrit depuis mon arrivée en Suisse; mais j’écrivis à M. de Conzié pour m’informer d’elle, et ce fut lui qui m’apprit qu’elle avait cessé de soulager ceux qui souffraient, et de souffrir elle-même. Bientôt je cesserai de souffrir aussi; mais si je croyais ne la pas revoir dans l’autre vie, ma faible imagination se refuserait à l’idée du bonheur parfait que je m’y promets.
Ma troisième perte et la dernière, il ne m’est plus resté d’amis à perdre, fut celle de Milord Maréchal. Il ne mourut pas; mais, las de servir des ingrats, il quitta Neuchâtel, et depuis lors je ne l’ai pas revu. Il vit et me survivra, je l’espère: il vit, et, grâce à lui, tous mes attachements ne sont pas rompus sur la terre; il y reste encore un homme digne de mon amitié, car son vrai prix est encore plus dans celle qu’on sent que dans celle qu’on inspire; mais j’ai perdu les douceurs que la sienne me prodiguait, et je ne peux plus le mettre qu’au rang de ceux que j’aime encore, mais avec qui je n’ai plus de liaison. Il allait en Angleterre recevoir sa grâce du Roi, et racheter ses biens jadis confisqués. Nous ne nous séparâmes point sans des projets de réunion qui paraissaient presque aussi doux pour lui que pour moi. Il voulait se fixer à son château de Keith-Hall, près d’Aberdeen, et je devais m’y rendre auprès de lui; mais ce projet me flattait trop pour que j’en pusse espérer le succès. Il ne resta point en Écosse. Les tendres sollicitations du roi de Prusse le rappelèrent à Berlin, et l’on verra bientôt comment je fus empêché de l’y aller joindre.
Avant son départ, prévoyant l’orage qu’on commençait à susciter contre moi, il m’envoya de son propre mouvement des lettres de naturalité qui semblaient être une précaution très sûre pour qu’on ne pût pas me chasser du pays. La communauté de Couvet, dans le Val-de-Travers, imita l’exemple du gouverneur, et me donna des lettres de communier, gratuites, comme les premières. Ainsi, devenu de tout point citoyen du pays, j’étais à l’abri de toute expulsion légale, même de la part du prince: mais ce n’a jamais été par des voies légitimes qu’on a pu persécuter celui de tous les hommes qui a toujours le plus respecté les lois.
Je ne crois pas devoir compter au nombre des pertes que je fis en ce même temps celle de l’abbé de Mably. Ayant demeuré chez son frère, j’avais eu quelques liaisons avec lui, mais jamais bien intimes, et j’ai quelque lieu de croire que ses sentiments à mon égard avaient changé de nature depuis que j’avais acquis plus de célébrité que lui. Mais ce fut à la publication des Lettres de la Montagne que j’eus le premier signe de sa mauvaise volonté pour moi. On fit courir dans Genève une lettre à Mme Saladin, qui lui était attribuée, et dans laquelle il parlait de cet ouvrage comme des clameurs séditieuses d’un démagogue effréné. L’estime que j’avais pour l’abbé de Mably, et le cas que je faisais de ses lumières, ne me permirent pas un instant de croire que cette extravagante lettre fût de lui. Je pris là-dessus le parti que m’inspira ma franchise. Je lui envoyai une copie de la lettre, en l’avertissant qu’on la lui attribuait. Il ne me fit aucune réponse. Ce silence me surprit: mais qu’on juge de ma surprise, quand Mme de Chenonceaux me manda que la lettre était réellement de l’abbé, et que la mienne l’avait fort embarrassé. Car enfin, quand il aurait eu raison, comment pouvait-il excuser une démarche éclatante et publique, faite de gaieté de cœur, sans obligation, sans nécessité, à l’unique fin d’accabler au plus fort de ses malheurs un homme auquel il avait toujours marqué de la bienveillance, et qui n’avait jamais démérité de lui? Quelque temps après partirent les Dialogues de Phocion, où je ne vis qu’une compilation de mes écrits, faite sans retenue et sans honte. Je sentis, à la lecture de ce livre, que l’auteur avait pris son parti à mon égard, et que je n’aurais point désormais de pire ennemi. Je crois qu’il ne m’a pardonné ni le Contrat social, trop au-dessus de ses forces, ni La Paix perpétuelle, et qu’il n’avait paru désirer que je fisse un extrait de l’abbé de Saint-Pierre qu’en supposant que je ne m’en tirerais pas si bien.
Plus j’avance dans mes récits, moins j’y puis mettre d’ordre et de suite. L’agitation du reste de ma vie n’a pas laissé aux événements le temps de s’arranger dans ma tête. Ils ont été trop nombreux, trop mêlés, trop désagréables, pour pouvoir être narrés sans confusion. La seule impression forte qu’ils m’ont laissée est celle de l’horrible mystère qui couvre leur cause, et de l’état déplorable où ils m’ont réduit. Mon récit ne peut plus marcher qu’à l’aventure, et selon que les idées me reviendront dans l’esprit. Je me rappelle que dans le temps dont je parle, tout occupé de mes confessions, j’en parlais. très imprudemment à tout le monde, n’imaginant pas même que personne eût intérêt, ni volonté, ni pouvoir de mettre obstacle à cette entreprise: et quand je l’aurais cru, je n’en aurais guère été plus discret, par l’impossibilité totale où je suis par mon naturel de tenir caché rien de ce que je sens et de ce que je pense. Cette entreprise connue fut, autant que j’en puis juger, la véritable cause de l’orage qu’on excita pour m’expulser de la Suisse, et me livrer entre des mains qui m’empêchassent de l’exécuter.
J’en avais une autre qui n’était guère vue de meilleur œil par ceux qui craignaient la première: c’était celle d’une édition générale de mes écrits. Cette édition me paraissait nécessaire pour constater ceux des livres portant mon nom qui étaient véritablement de moi, et mettre le public en état de les distinguer de ces écrits pseudonymes que mes ennemis me prêtaient pour me décréditer et m’avilir. Outre cela, cette édition était un moyen simple et honnête de m’assurer du pain, et c’était le seul, puisque, ayant renoncé à faire des livres, mes Mémoires ne pouvant paraître de mon vivant, ne gagnant pas un sol d’aucune autre manière et dépensant toujours, je voyais la fin de mes ressources dans celle du produit de mes derniers écrits. Cette raison m’avait pressé de donner mon Dictionnaire de Musique, encore informe. Il m’avait valu cent louis comptant et cent écus de rente viagère, mais encore devait-on voir bientôt la fin de cent louis quand on en dépensait annuellement plus de soixante, et cent écus de rente étaient comme rien pour un homme sur qui les quidams et les gueux venaient incessamment fondre comme des étourneaux.
Il se présenta une compagnie de négociants de Neuchâtel pour l’entreprise de mon édition générale, et un imprimeur ou libraire de Lyon, appelé Reguillat, vint, je ne sais comment, se fourrer parmi eux pour la diriger. L’accord se fit sur un pied raisonnable et suffisant pour bien remplir mon objet. J’avais, tant en ouvrages imprimés qu’en pièces encore manuscrites, de quoi fournir six volumes in-quarto; je m’engageai de plus à veiller sur l’édition: au moyen de quoi ils devaient me faire une pension viagère de seize cents livres de France et un présent de mille écus une fois payés.