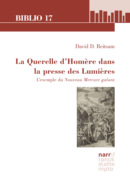Kitabı oku: «" A qui lira ": Littérature, livre et librairie en France au XVIIe siècle», sayfa 5
ANNEXES

BnF, Ms Rothschild 3149, f. 70 r.

BnF, Arsenal, Ms 4159, f. 287 r.

BnF Ms Rothschild 3149.
Publier sans imprimer : le défi des épistolières
Nathalie FREIDEL
Université Wilfrid Laurier
Les études récentes sur l’épistolarité féminine au XVIIe siècle l’ont amplement démontré : le consensus autour de la lettre comme « genre féminin » est en trompe-l’œil dans une période où très peu de correspondances de femmes sont publiées en réalité, où ce sont des épistoliers que l’on consacre et canonise (Balzac, Voiture, Bussy-Rabutin) et où, comme l’ont fait remarquer Elizabeth Goldsmith et Colette Winn1, l’art épistolaire, tel qu’il est défini et illustré par les manuels, est garanti exclusivement par une autorité masculine. Pourtant, lorsque la correspondance de Bussy est publiée en 1697, par les soins de sa fille, Louise-Françoise de Coligny, et de Bouhours2, on y découvre que ses correspondants sont pour beaucoup des correspondantes, dont les lettres sont incluses parmi celles de Bussy. Ce choix des premiers éditeurs, peu banal compte tenu de la réticence à imprimer qui caractérise la production épistolaire féminine, s’explique par la nature des manuscrits laissés par Bussy, qui prenait copie de sa correspondance (envoyée et reçue) pour composer la suite de ses mémoires3. Cette édition permet en particulier à ses contemporains de découvrir les premières lettres imprimées de Sévigné4. Certes, les épistolières demeurent dans l’anonymat car, comme le constate Ludovic Lalanne à propos des premières éditions françaises de cette correspondance : « on se borne presque partout à indiquer les noms propres par des initiales, qui même quelquefois sont fausses5 ». Il faut donc attendre l’édition en 6 tomes établie par ce dernier au tournant du XIXe siècle pour que la contribution des femmes à ce corpus épistolaire apparaisse dans toute son ampleur6. Alors qu’on ne s’est penché jusqu’ici qu’isolément sur le cas de quelques contributrices jugées plus douées ou plus intéressantes7, nous nous proposons d’observer la dynamique à l’œuvre dans le groupe des épistolières recrutées par Bussy dès les débuts de son exil, à partir de 1666.
Il s’agira tout d’abord de souligner l’importance d’un groupe féminin qui tend à s’organiser en réseau de soutien. Contrairement à une tradition critique qui a fait de ces échanges « une frivole conversation mondaine avec quelques dames8 », nous voyons dans l’entreprise qui consiste à transmettre les nouvelles de Paris et de la cour, voire à œuvrer en sous-main pour le retour en grâce de Bussy, une intéressante formule collaborative et clandestine, venant illustrer l’intuition de Janet Altman selon laquelle le XVIIe siècle verrait la constitution d’un « underground » de l’épistolaire féminin9. Nous nous intéresserons ensuite à la prise en compte de la littérarité de l’épistolaire dans le contrat implicite qui se met en place entre Bussy et ses correspondantes. À côté de la dimension pragmatique et informative, la fréquence des remarques et des commentaires stylistiques, ainsi que l’échange de nombreuses pièces en prose et en vers, font du commerce de lettres un véritable atelier d’écriture. A priori, le partenariat avec un homme que sa réputation de libertin n’a pas empêché d’entrer à l’Académie, sert les ambitions d’écrivaines amateures, manifestement conscientes de participer au travail d’archivage et de catalogage, par Bussy, d’ego-documents à léguer à la postérité10. Mais non contentes de contribuer à l’entreprise apologétique, les épistolières11 se montrent disposées à poursuivre l’œuvre de fiction scandaleuse, en donnant une suite au récit des amours malheureuses avec Mme de Montglas dont le premier épisode, « Histoire de Bussy et de Bélise », venait clore l’Histoire amoureuse des Gaules12.
Un comité de soutien féminin
Qui sont ces esprits intrépides qui, à peine le libertin mal repenti tiré de la Bastille et réfugié sur ses terres bourguignonnes, s’engagent dans une correspondance qui, pour beaucoup, se poursuivra tout au long de l’exil et de la vie de Bussy ? À première vue, on a affaire à un groupe hétérogène qui réunit des femmes de la haute et de la petite noblesse provinciale, des personnalités en vue comme la comtesse de Fiesque1, et d’autres plus discrètes, comme Mme de Scudéry2, dont le talent nous serait demeuré inconnu sans cette correspondance. Plusieurs générations sont confondues : la comtesse de Fiesque est née en 1619, la comtesse de Guiche et Mlle d’Armentières ont vingt-deux ans. Le cercle des muses galantes à la réputation sulfureuse – Mme de Gouville3, la comtesse de Fiesque –, côtoie celui des muses savantes – Mme de Scudéry, veuve et dévote –, des précieuses qui militent contre l’amour – Mlle Dupré –, et des indépendantes, réfractaires aux catégories – Mme de Sévigné.
On discerne toutefois des liens multiples et variés entre les correspondantes de la première heure. Liens familiaux d’abord : d’après Mireille Gérard, « la plupart des correspondants de Bussy en 1666 sont en fait de proches parents4 ». Moyennant la conception extensible de la notion de cousinage, l’épistolier peut s’estimer apparenté à des degrés divers à Sévigné, Fiesque, Gouville, Guiche et jusqu’à la Grande Mademoiselle. Dans ce réseau familial entendu au sens large se dessinent également d’étroits liens politiques : plusieurs épistolières font partie de l’entourage de Mlle de Montpensier – c’est le cas de Fiesque et de Scudéry – et ont été mêlées, comme Gouville, aux intrigues de la Fronde5. Myriam Tsimbidy, qui s’est penchée sur la correspondance de Bussy avec Mademoiselle, montre que des liens d’estime, voire d’amitié existaient entre eux6. En 1662, alors que la princesse est exilée à Saint-Fargeau après le refus du mariage portugais, Bussy lui adresse de véritables gazettes sur tous les événements de la cour. En 1666, dans l’entourage de cette princesse, on s’empresse donc de retourner la faveur en permettant à l’exilé de demeurer en contact avec le centre des nouvelles et en jouant les intermédiaires : Fiesque s’offre pour faire pression sur ceux qui travaillent au retour en grâce, Scudéry est en relation étroite avec Saint-Aignan, principal soutien de Bussy auprès de Louvois, et Dupré assure la liaison avec des personnalités du milieu lettré comme Conrart, Bouhours et Rapin.
Ensuite, la plupart des correspondantes sont liées d’amitié et se fréquentent assidûment. La « Comtesse » (de Fiesque) figure régulièrement dans les listes d’amis et de proches dont Sévigné transmet les compliments et les nouvelles à sa fille7. Bussy, quand il s’adresse à ce réseau amical, doit tenir compte du fait que ses interlocutrices se fréquentent au quotidien, sous peine de se faire gentiment moquer de lui :
Je me trouvai hier chez Mme de Montglas, qui avait reçu une de vos lettres, et Mme de Gouville une autre ; je croyais en trouver une chez moi. Mais je fus trompée dans mon attente, et je jugeai que vous n’aviez pas voulu confondre tant de rares merveilles.8
La plaisanterie, qui associe avec élégance le reproche et l’excuse, assure discrètement la promotion du groupe des correspondantes. Et tandis que Bussy doit fournir aux attentes de chacune, les épistolières s’associent aussi bien dans la lecture que dans l’écriture et l’expédition des lettres :
Je vous dirais que je n’ai point reçu ce paquet de votre part, dans lequel vous me mandez qu’il y avoit deux lettres de vos amies.9
Je vous assure, monsieur, que je vous ai écrit une grande lettre de l’hôtel de Sully : la duchesse vous fit même un compliment dans ma lettre et badinoit avec vous ; nous vous mandions toutes les nouvelles.10
J’arrive de la campagne de mon côté et notre cousine [de Fiesque] du sien. La première chose à quoi nous pensons, c’est à vous écrire et à vous prier d’envoyer chez moi prendre nos deux portraits […]. La comtesse dit qu’elle ne vous écrit pas mais que vous n’en êtes pas moins persuadée de son amitié. Entre vous deux le débat.11
Loin de n’être qu’une commodité postale, la tactique du tir groupé renforce l’avantage des épistolières, autorisant l’appel à témoin en cas de litige (lettres perdues, manque d’assiduité). Toute nouvelle recrue se recommande du groupe. Quand Mme de Scudéry prend l’initiative d’écrire à Bussy, elle met d’abord en avant la pression de ses amies – « Je crois qu’elles se sont imaginé que nous nous connoissions encore plus que nous faisons » –, puis déclare faire équipe avec Mlle Dupré, autre ennemie de la galanterie : « Nous sommes inséparables. C’est la meilleure amie que j’aie au monde12. » Enfin, son amitié pour Mme de Montmorency13 montre que des recoupements sont possibles entre le cercle des muses savantes et celui des muses galantes. Les lettres de Bussy doivent tenir compte de cette dynamique de groupe et du fait qu’une allocutaire peut en cacher une autre :
Pour Mlle de Vandy, je lui ai lu l’endroit de votre lettre où vous me mandez la manière dont vous feriez galanterie si vous étiez une dame : elle en a extrêmement ri. Enfin elle m’a prié de vous le mander et qu’elle était toujours votre servante.14
C’est donc bel et bien un réseau de soutien épistolaire féminin qui se forme et s’organise autour de l’exilé, dont il est d’abord question de conjurer la mort sociale. En retour, les épistolières aménagent habilement un régime de publicité acceptable car calqué sur des pratiques plébiscitées par la société honnête. Le groupe se porte garant de l’activité d’écriture individuelle, suspecte dans un domaine où les femmes ne sont pas les bienvenues. La circulation intense des lettres désigne un autre régime de publication, dont les produits sont privés certes du privilège officiel mais appréciés à leur juste valeur par une secte d’amateurs éclairés. Si Bussy est courtisé par les épistolières, c’est moins du fait de son aura galante que de sa capacité à « distribuer » leur production sous un label indépendant.
Un atelier d’écriture
Nathalie Grande note chez Mme de Scudéry, la correspondante la plus assidue de Bussy après Sévigné, la satisfaction visible de s’associer par lettres à « un homme recherché pour son esprit, son goût et son style1 ». Toutefois, l’émulation entre des épistolières qui doivent compter avec la concurrence nous paraît tout aussi décisive pour la dynamique de l’échange. L’étude de Laure Depretto sur l’écriture de l’information dans la correspondance de Sévigné a mis en lumière les mécanismes de la lettre de nouvelle et la concurrence sourde entre les épistoliers qu’elle implique dans le régime de sociabilité qui caractérise cette période2. De telles rivalités sont aisément repérables parmi les amies de Bussy qui se font fort de le tenir informé des dernières nouvelles de la cour et de la ville. Ainsi, Mme de Montmorency3 cultive un art consommé de la brève : « Le roi de Portugal a cédé sa femme et son royaume à son frère, ne sachant se servir ni de l’un ni de l’autre4. » Mais sur ce terrain, elle doit faire face à la concurrence de la comtesse de Fiesque : « il y a la plus grande gueuserie parmi les courtisans que vous ayez jamais vue. On parle fort de la paix, et on commence à la souhaiter, parce qu’on ne voit pas que la guerre serve de beaucoup5 » ; de Mlle Dupré : « Saint-Pavin est tombé en apoplexie ; il n’est pas encore bien guéri. M. de Racan a fait pis : il est mort6 » ; et de Mlle d’Armentières : « Le Tellier est inconsolable de la mort de sa fille. Il y a deux hommes ici qui sont morts de la peste. Si cela continue, je crois que j’irois en original dans votre galerie7 ». Les compliments de Bussy viennent alors récompenser les efforts des co-épistolières et souligner les réussites :
Au reste, Madame, vous me surprenez par les nouvelles que vous me mandez de la guerre : je suis assuré qu’il y a plus d’un officier général en France qui n’en parle ni qui n’en écrit pas si bien que vous […]. Je reçois encore des nouvelles d’ailleurs mais elles ne sont ni si bonnes ni si bien écrites que les vôtres.8
Les nouvellistes sont non seulement jugées sur la qualité des informations fournies mais aussi sur leur savoir-faire et leurs dons d’écrivaines. En outre, la compétition s’intensifie quand l’actualité fournit des occasions en or. On voit ainsi revenir à la charge des épistolières dont les soins s’étaient relâchés, au moment où l’affaire Lauzun et le feuilleton La Vallière font la une des gazettes à la main. En 1671, Montmorency quitte le style percutant de la brève dans lequel elle s’est illustrée pour expédier une série de relations brillantes. Or ces morceaux de bravoure interviennent au moment où la brillante Scudéry menace de supplanter ses concurrentes dans la course à l’information : « je crois que vous avez quelque correspondant mieux informé que je ne le suis, et que vous voulez vous épargner la peine de m’écrire si souvent9 ». Soupçons que Bussy s’efforce d’apaiser en redoublant d’éloges : « Il est vrai que j’ai d’autres correspondants que vous, mais personne ne me mande des nouvelles si sûres que les vôtres, et votre commerce m’est mille fois plus agréable que celui de qui que ce soit10. »
Toutefois, la logique de la compétition n’est jamais poussée jusqu’à l’élimination de la concurrence car l’expérience de l’écriture collective exige de la part des participantes une mise en commun des compétences. Cette visée collaborative est particulièrement visible dans la mise en œuvre du dit satirique sur lequel Bussy a bâti sa réputation d’écrivain et qui constitue également un des pivots de sa correspondance. Tout comme pour la chaîne informationnelle, l’entreprise satirique bénéficie du système de relais mis en place dans le réseau épistolaire. Dans une lettre de Mme de Montmorency, il est question d’une corniche qui aurait blessé Mme de Lafayette à la tête. La réplique plaisante de Bussy – « Si l’on peut vous dire une turlupinade, ce n’est pas la plus illustre tête que les corniches, et même les cornes, n’aient pas respecté11 » – recycle un bon mot de Sévigné dont il faisait les frais : « Mme d’Époisses m’a dit qu’il vous étoit tombé une corniche sur la tête qui vous avait extrêmement blessé. Si vous vous portiez bien et que l’on osât dire de méchantes plaisanteries, je vous dirais que ce ne sont pas des diminutifs qui font mal à la tête de la plupart des maris […]12. » La galanterie, dans sa version satirique aussi bien qu’honnête, est l’œuvre du groupe ; quand elle s’écrit, c’est collectivement ; d’où un effet de surenchère. La verve satirique des amies de Bussy étonne parfois par ses audaces, comme lorsque Montmorency commente la conduite du mari de Mme de M***, qui a donné au roi et au Parlement la lettre de sa femme à M. de R*** : « Ainsi, n’étant point cocu de chronique, au moins le sera-t-il de registre13. » Prenant le contre-pied des manuels épistolaires qui prônent la décence et la retenue, Bussy encourage ses troupes à passer outre :
A quoi me sert de savoir que M. de Gramont a dit quelque plaisanterie à madame de la Baume, si je ne sais ce que c’est ? Mais vous pourriez bien me le mander si vous vouliez prendre la peine d’envelopper la chose. Pour moi, je vous déclare qu’il n’y a ordure au monde que je ne vous dise, quand il s’en présentera occasion sans vous faire rougir. Paraphrasez donc un peu, madame, et me mandez le beau dit de M. de Gramont.14
Véritable atelier d’écriture satirique, la correspondance de Bussy constitue une occasion rare pour des femmes de s’exercer dans un genre dont elles sont plus souvent les cibles que les utilisatrices.
Enfin, les amies de Bussy composent une satire au sens étymologique du terme en agrémentant leurs lettres de créations de leur plume qui empruntent à tous les genres. On pourrait composer un recueil de pièces diverses, dans le goût du temps, avec les bouts-rimés que Dupré produit à la chaîne, le chef-d’œuvre héroï-comique que Montmorency compose sur l’altercation entre Mme de la Baume et Mlle du Mény sur le porche de l’église des Grands-Jacobins15, l’élégant portrait de Rapin par Scudéry ainsi que ses réflexions sur le thème de l’amitié. En faisant de sa correspondance un lieu privilégié de circulation des écrits féminins, Bussy fournit aux épistolières un antidote précieux à l’obstacle des convenances. Ainsi, lorsqu’il donne son accord à Dupré, qui souhaite montrer à Conrart les bouts-rimés qu’ils ont composés ensemble, c’est en expliquant que la « réputation d’écrire », si elle ne convient pas à l’honnête homme, a fortiori à l’honnête femme, est parfaitement acceptable entre amis :
Je consens que vous montriez mes amusements à M. Conrart. Si j’étois avec lui, je lui montrerois des choses plus sérieuses, quelque délicatesse que j’aie sur la réputation d’écrire que la plupart du monde donne fortement à un homme de qualité qui écrit pour s’occuper, comme à un auteur qui écrit pour être imprimé ; mais on ne doit rien avoir de caché pour un ami comme M. Conrart, qui sait faire des distractions.16
L’Histoire de Bussy et Bélise
Cependant, les correspondantes de Bussy n’ignorent pas que le pacte de circulation restreinte auquel il se réfère a été sérieusement ébranlé par le régime de diffusion de son œuvre satirique1. Il ne leur a pas échappé non plus qu’elles doivent en partie leur « élection » aux liens qui les unit à l’ancienne amante de Bussy, qu’il accuse de l’avoir trahi pendant sa prison. C’est donc en toute connaissance de cause qu’elles acceptent la mission risquée qui consiste à composer la suite de l’« Histoire de Bussy et de Bélise », première « saison » des amours de Bussy et de Mme de Montglas, sur laquelle se clôt l’Histoire amoureuse des Gaules. Tout commence par un concert de médisances, qui peut laisser penser qu’on va avoir affaire à un lynchage épistolaire semblable à celui dont la comtesse de Marans, alias Mélusine, fait les frais dans le réseau sévignéen en 1671. Mme de Montmorency affirme que son amitié ne mérite pas d’être comparée « à celle de qui vous savez » et encourage Bussy à lui envoyer « tous les petits vers que vous feriez sur elle2 ». La comtesse de Fiesque rapporte une retraite suspecte de Mme de Montglas « dans le plus misérable état du monde » et se vante d’avoir « dépétré » Bussy de sa « folle passion3 ». Dans un premier temps, nulle ne songe à contester la version de l’amoureux trahi : « C’est comme la dame que vous savez : si elle ne m’avoit fait qu’une escapade, comme celle à quoi elle étoit sujette, je ne m’en serois jamais guéri, mais le tour qu’elle m’a fait m’a entièrement dégagé4. » Cependant, d’objet du discours médisant, l’incontournable Montglas ne tarde pas à s’imposer comme la véritable destinataire des récriminations de Bussy, en figurant en tiers dans ses échanges avec ses amies. La correspondance fonctionne alors comme un forum où les anciens amants communiquent par amies interposées : « Je n’ai pas eu de ses nouvelles il y a fort longtemps. Je vous envoyai une de ses lettres il y a six semaines. Vous ne me mandez point que vous l’ayez reçue : tout ce que je sais d’elle, c’est qu’elle fait une assez triste vie5. » Montmorency se prête volontiers à la manœuvre, en permettant à Bussy de s’adresser à son ancienne maîtresse par son intermédiaire, puis en donnant la parole à Mme de Montglas dans un chef-d’œuvre de lettre à quatre mains :
Mon amie vient de lire ma missive et me prie de vous écrire encore quelque chose de plus impertinent ; mais cela m’est impossible, de la dernière impossibilité : c’est pourquoi je finis en vous assurant que nous vous désirons, que nous aurions volontiers noyé Madame de *** si vous aviez pu prendre sa place, et que pour vous voir, nous ferions de bon cœur un péché mortel. N’allez pas prendre cela de travers, mon cher, et vous imaginer des choses à quoi nous ne pensons pas.6
La réponse badine des épistolières aux invectives du « pauvre abandonné » nous incite à considérer avec précaution une posture qui n’a pas manqué de susciter l’étonnement des commentateurs7. Ne s’agit-il pas avant tout pour cet auteur à scandale de poursuivre, avec le concours des co-épistolières, la publication de ses amours malheureuses ? De fait, la riposte de la coalition féminine aux vers vengeurs de Bussy donne lieu à une sorte de concours poétique, chaque contributrice choisissant dans l’éventail des petits genres mondains celui qui lui convient le mieux :
Vous êtes encore trop en colère contre votre ancienne maîtresse. Ne vous y trompez pas : On voit toujours l’amour dans le dépit / Et jamais dans l’indifférence ; / Et quoiqu’enfin l’on fasse tant de bruit, / On aime encore plus qu’on ne pense. Votre colère cependant me divertit fort.8
Après avoir exprimé quelque réticence à traiter le sujet imposé, Scudéry se joint au concert en soulignant une fois de plus la dynamique de groupe et en composant un habile portrait de Bussy en héros de roman :
Mon Dieu ! que je vous trouve encore amant ! Vous ne sauriez vous taire de cette dame : on ne parle pas tant de ce qu’on n’aime pas ; avouez-le donc ; mais il n’est pas vrai que vous n’en parliez qu’à moi ; vous en avez écrit à mademoiselle Dupré. Je pense même que vous en parlez aux bois, aux échos et aux rochers, selon la louable coutume des amants.9
La clairvoyance de l’épistolière épingle ici la passion de Bussy moins pour son « Infidèle » que pour la publication de soi, qui préside à l’ensemble de son œuvre écrite. Elle s’attire alors un aveu révélateur des enjeux réels de l’affaire Montglas :
Vous croyez, dites-vous, que j’aime toujours la dame dont je ne me saurais taire : j’y consens ; pourvu que j’en parle, je ne me soucie guère de ce qu’on en pensera ; mais j’en parlerai en prose et en vers, et j’ai même quelque envie d’apprendre les langues étrangères pour être entendu de tout le monde.10
Loin de faire amende honorable après le scandale de l’Histoire amoureuse, Bussy renoue dans sa correspondance avec le registre mi-galant mi-satirique11 et le régime de publication mi-privé mi-public qui lui ont valu l’exil : même si les lettres ne sont pas imprimées, elles sont forcément appelées, comme toute correspondance du temps, à circuler au-delà du premier cercle de leurs auteurs. Dans ce but, il s’adjoint une équipe de collaboratrices prêtes à en assumer les risques pour bénéficier d’une occasion rare de joindre leurs dons d’écrivaines à une collection de lettres susceptible de témoigner pour la postérité, au même titre que la collection de portraits édifiée par Bussy à la même période.
La réticence des femmes face à l’impression, au XVIIe siècle, a fortiori dans un milieu aristocratique où de telles pratiques heurtent les convenances, n’implique pas qu’elles aient renoncé à l’ambition d’écrire. Dans ce contexte, l’épistolaire apparaît comme une voie d’accès privilégiée à l’écriture, moyennant un certain nombre de dispositifs : la formation en réseau, le partenariat avec un auteur masculin, le jeu de la concurrence, la dimension collaborative. C’est cet usage stratégique de l’épistolaire que l’on voit à l’œuvre dans le groupe d’écriture formé par les amies de Bussy et qui aboutit à la composition d’une œuvre collective. En exploitant un régime de circulation et de publication qui a fait le succès de l’Histoire amoureuse, les co-épistolières mettent leurs talents variés au service des amours malheureuses de l’exilé bourguignon en collaborant notamment à la création d’un Ovide travesti, réinterprétation satirique de la tradition des héroïdes.