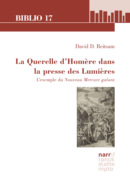Kitabı oku: «" A qui lira ": Littérature, livre et librairie en France au XVIIe siècle», sayfa 8
Copiste
Les papiers Brossette renferment une copie manuscrite du premier état de la première satire de Boileau, intitulée Contre les mœurs de la ville de Paris. « Cette satire est ici de la manière que l’auteur [Boileau] l’avait faite d’abord, et fort différente de celle qu’il a donnée au public », précise Brossette1. La particularité de cette copie manuscrite consiste dans l’ajout de notes et variantes. Dans son édition de 1716, Brossette avait limité sa présentation historique à la mention du nombre de vers supprimés par Boileau.

BmL Ms 6432 f° 532
À l’affût d’informations manuscrites ou imprimées, Brossette copiait avec soin les documents relatifs à ses enquêtes sur Boileau. Ainsi sa transcription de la lettre de Boileau à Antoine Arnauld forme également l’unique source manuscrite2. Mais Brossette ne se contentait pas de copier les manuscrits et d’amasser les documents, il menait aussi des recherches philologiques. De l’écriture du jeune avocat à la graphie hésitante du malade au soir de sa vie, l’avocat lyonnais n’avait pas cessé de copier et d’actualiser ses notes. Ses papiers, chargés de ratures et corrections, en disent long sur la qualité scientifique de ses enquêtes.
En outre, l’abbé Desmolets avait publié en 1726 une Épître inédite de Boileau à M. le Marquis de Termes3. Grand lecteur des périodiques, Brossette avait examiné ce poème attribué à Boileau : « Ceux qui la [épître] liront avec attention, et même avec beaucoup d’attention, conviendront qu’elle n’en est pas. […] Cette épître n’est point de M. Despréaux : on n’y reconnaît ni son génie, ni son style. C’est une imitation manquée et très manquée4. » L’avis de Brossette fut ensuite corroboré par le Journal des savants : « On croit avoir de bonnes raisons pour douter que cette épître pleine de lieux communs et d’endroits plats et bas soit de M. Despréaux, qui a conservé jusqu’à la fin de ses jours un esprit délicat et élevé5. » Plus de deux siècles plus tard, Émile Magne, savant bibliographe de Boileau, n’avait pas encore un avis arrêté sur ce sujet : « Cette épître, de tendance épicurienne, préconise de jouir de la vie et stigmatise l’avarice. L’auteur y parle de sa maison d’Auteuil et de la pension que lui sert Louis XIV. Excellente pièce qui paraît bien sortie de la plume de Boileau6. » L’enquête de Brossette sur l’épigramme, Contre Boyer et La Chapelle, offre une nouvelle illustration concernant sa méthode de travail :
À la première page d’une ancienne édition de Boileau, j’ai trouvé une épigramme [manuscrite] qu’il me semble qu’on attribue communément à M. Racine, et qui pourtant, dans ce volume, est donnée à M. Despréaux, et accompagnée de la réponse de l’auteur intéressé [La Chapelle]. Voici l’une et l’autre.7
Il s’agit d’une information factuelle notée par Brossette dans ses Mémoires. L’avocat lyonnais observe ensuite : « Cette réponse est très sûrement de M. La Chapelle, l’auteur des Amours de Catulle8. » Les remarques de Brossette, recueillies à la suite de son enquête, sont mentionnées par le biais d’astérisques. Autant d’ajouts, autant de surcharges qui expriment la permanence des recherches de l’avocat lyonnais : « L’Académie avait envie de faire le parallèle de Corneille et de Racine et de juger ce grand procès. Boileau voyant parmi eux des juges peu capables de décider fit cette épigramme9. » Brossette avait envisagé leur publication dans sa seconde édition des œuvres de Boileau10 :
J’ai inséré dans mon Boileau, l’épigramme que ce poète avait faite contre l’Académie :
Je consens que chez vous, messieurs, on examine, etc. ;
et je l’ai mise dans les mêmes termes que vous [L. Racine] me l’avez envoyée, car elle est beaucoup meilleure de cette façon que celle qu’on m’avait donnée.
Françoise Escal, éditrice des Œuvres complètes de Boileau dans « La Bibliothèque de la Pléiade », n’avait publié qu’une épigramme11 et avait renvoyé les autres versions en note. Quant à sa présentation historique de ces vers, elle s’avère à la fois incomplète et fautive. En effet, la première édition de cette épigramme ne fut pas publiée en 1735 par l’abbé Souchay dans son édition des Œuvres de Boileau, mais en 1726 dans les Saillies d’esprit12 de François Gayot de Pitaval.
Édition critique
L’éditeur lyonnais fréquentait la Bibliothèque du roi depuis de longues années. Ses enquêtes portaient aussi sur les traductions des œuvres de Boileau. De passage à Lyon, l’abbé Jean-Antoine Mezzabarba lui avait communiqué des traductions italiennes : « C’est la copie originale du traducteur qui me l’a donnée à Lyon1 », note Brossette sur le manuscrit de l’Ode sur la prise de Namur ; une traduction recherchée par Émile Magne : « Il nous a été impossible de rencontrer des renseignements sur cette traduction2. »
Les papiers Brossette, fabrique de ses éditions de Boileau, contiennent la transcription de ses entretiens avec le poète satirique, son neveu l’abbé Dongois et les érudits qui avaient contribué à ses éditions critiques. Ainsi Bernard de La Monnoye et Jean Boivin avaient participé aux travaux de l’édition de 1716 : « mercredi 21 [juin 1713]. L’après-midi j’ai été avec M. de La Monnoye qui a commencé à me donner ses corrections par écrits, sur mon commentaire des œuvres de Boileau3. » L’aide de Bernard de La Monnoye fut constante et précieuse autant pour la première édition des œuvres de Boileau, publiée en 1716, que pour la seconde édition en préparation dès 1718. Si le manuscrit de cette édition est perdu, il reste cependant des éléments épars susceptibles de nous renseigner sur la méthode suivie par Brossette :
Dans la nouvelle édition que je donnerai du Boileau, je me dispose à faire des augmentations et des retranchements considérables, et vous comprenez bien, que ces retranchements doivent tomber sur les pièces étrangères qui ont été insérées malgré moi dans les éditions précédentes. Je serai docile au conseil que vous me donnez sur ce qui concerne les Jésuites.4
Pour sa part, Jean Boivin avait également collaboré aux travaux de Brossette. « M. Despréaux a employé onze mois à composer cette Satire [XII], et trois ans à la corriger. C’est ce que M. Boivin m’a dit. Il voyait alors M. Despréaux presque tous les jours5. » Boivin s’était entretenu aussi avec Brossette à la Bibliothèque du roi au sujet de cette œuvre posthume de Boileau : « De jeudi 21 mai avant-midi. J’ai été à la Bibliothèque du roi voir M. Boivin bibliothécaire, à qui M. Despréaux avait confié sa Satire XIIsur l’équivoque, sur laquelle M. Boivin m’a donné les éclaircissements suivants6. » En réalité, la lecture critique de cette satire avait nécessité plusieurs séances de travail, puisque Boivin, garde de la Bibliothèque du roi, avait expliqué par le menu détail le contexte conflictuel de cette satire, Boileau aux prises avec les jésuites. Les matériaux de l’apparat critique de cette satire sont fournis par Boivin, professeur au Collège royal. Boivin, témoin de la fabrique de Boileau, avait retracé les faits avec des éclaircissements philologiques. Et Brossette ajoute7 :
À l’égard de la satire de l’Équivoque, je conviens que j’ai un peu excédé les droits du commentateur, non pas en expliquant les sentiments de M. Despréaux, car il est permis, ce me semble, à tout commentateur d’en user ainsi, mais en insinuant qu’il n’a pas eu dessein d’attaquer directement les jésuites, en quoi la répréhension est juste, quoiqu’il paraisse bien que je n’ai pas exigé que mes lecteurs prissent ma proposition au pied de la lettre.
Enfin, Brossette avait rencontré les adversaires de Boileau : « Le P. de Tournemine ne m’a pas parlé si avantageusement de M. Despréaux. Il m’a raconté l’origine de la brouillerie de M. Despréaux avec les jésuites, au sujet de l’extrait que les journalistes de Trévoux donnèrent de ses ouvrages8. » Ses investigations lui avaient permis d’identifier l’identité des journalistes des Mémoires de Trévoux, auteurs des articles virulents contre Boileau.

BmL Ms 6432 f° 26
La perte du manuscrit de la seconde édition des œuvres de Boileau n’est pas irrémédiable, puisque les papiers Brossette en conservent quelques bribes éparses. Ces notes manuscrites constituent la principale source de l’avocat lyonnais, il y puisait les informations publiées dans son apparat critique. Quant aux « archives du présent que sont les journaux9 », elles nous renseignent sur l’Avertissement de Brossette, rédigé pour sa nouvelle édition des œuvres de Boileau :
J’ai exactement corrigé mes anciennes remarques et j’en ai ajouté beaucoup de nouvelles, dont quelques-unes sont tirées ou des écrits mêmes de M. Despréaux, lesquels m’ont été remis par son ordre, après sa mort, ou d’autres sources équivalentes ; telles que sont, un projet de commentaire entrepris après le mien, et à mon exemple, par M. Le Verrier, ami particulier de l’auteur, et corrigé par lui en divers endroits ; un canevas de petites notes projetées par M. l’abbé Guéton, homme de lettres, et remplies par M. Despréaux ; un autre recueil de notes plus circonstanciées, que M. de La Chapelle, petit-neveu de M. Despréaux, avait écrites dans son exemplaire de Boileau.10
Assurément, Brossette ne néglige aucune source pour ses investigations. Si les notes de Le Verrier et l’abbé Guéton sont retrouvées et publiées, celles de La Chapelle sont perdues. À l’évidence, Brossette avait bénéficié de l’aide des proches et amis de Boileau. Les papiers Brossette contiennent les explications de Boileau communiquées de vive voix à l’avocat lyonnais ; une enquête poursuivie par ce dernier auprès de savants philologues :
Revillout, M. Lachèvre ont montré que Brossette ne mérite pas la défiance systématique que lui témoignait, avant Mesnard, Berriat-Saint-Prix. Il serait d’autant moins raisonnable de persévérer dans cette attitude réservée que nous ne sommes pas désarmés en face de Brossette. Sans doute, nous ne possédons pas les recueils manuscrits où il avait amassé les éléments de son commentaire ; cependant, la comparaison des renseignements consignés par lui dans le recueil que conserve la [Bibliothèque] Nationale, avec les notes de l’édition où ces renseignements ont été mis en œuvre, permet de se faire au moins une idée de la méthode de Brossette.11
Les papiers Brossette avaient permis la découverte d’aspects inédits de la longue vie de Boileau, un parcours intellectuel ponctué de virulentes polémiques. Devenu « vieux lion12 », Boileau partageait avec lui ses souvenirs, des faits souvent méconnus de ses éditeurs. Sa préface aux Œuvres posthumes de Gilles Boileau en est l’illustration :
Mon frère a traduit le quatrième livre de L’Énéide, cela n’est pas bon, et cet indomptable public ne l’a point goûté. La versification en est rude, ce n’est point l’esprit de Virgile : M. de La Fontaine qui savait son Virgile mieux que personne le disait bien. Cet ouvrage fut lu à feue Madame et à M. Ogier, ce fameux prédicateur, qui l’approuvèrent. J’en fis la préface où je fis tout ce que je pus par de grandes phrases pour faire valoir ces approbations. Tout cela n’a rien gagné sur le public, qui s’est obstiné à le laisser chez le libraire, comme le Virgile de Segrais qui y est demeuré ; il n’y avait qu’à le demander à Billaine.13
Brossette possédait dans sa bibliothèque un exemplaire annoté des œuvres de Gilles Boileau, une édition originale conservée à la Bm de Lyon sous la cote 317618. Brossette y avait noté à la suite de l’intitulé de cette préface : « Le libraire au lecteur14 », « par M. Boileau-Despréaux ». En conséquence, Claude Barbin n’était pas l’auteur de ce texte. Viennent ensuite deux notes manuscrites de Brossette, signalées par des astérisques : François Ogier et Madame Henriette d’Angleterre15. Toutes ces informations, communiquées de vive voix par Boileau à Brossette, figurent aussi dans les Mémoires de l’avocat lyonnais.
La maison d’Auteuil, lieu de rencontres de Boileau avec Boivin, Rollin, Pourchot, abbé d’Olivet, Brossette, Gibert, Mathieu Marais, rassemblait de jeunes hommes de lettres créatifs. Plus d’une décennie de savantes conversations et d’échanges intellectuels sur la poésie, la rhétorique, l’histoire, les arts en général, entre Boileau et un groupe formé d’avocats et professeurs de l’Université de Paris demeure méconnu des historiens de la littérature. Ainsi Balthasar Gibert, ami intime de Boileau16, avait bénéficié de son érudition pour ses travaux sur la rhétorique française17. Et Gibert ajoute : « Feu M. Boileau ne s’offensa point, qu’on [Gibert] lui montrât dans ses ouvrages un solécisme, qui y était depuis trente ans. C’est lui-même qui l’a publié, parce qu’il cherchait à se rendre utile18. » Outre sa capacité d’écoute, Boileau avait bénéficié de la collaboration de ses interlocuteurs d’Auteuil. Avec Jean Boivin, auteur de remarques sur le Traité du sublime, Boileau avait travaillé à la composition de Satire XII. Quant à son projet d’une nouvelle édition de ses œuvres, initié par ses soins, il fut l’une des principales occupations de Boileau jusqu’à son décès.

BmL Ms 6432 f° 10
Les manuscrits de Brossette recèlent bien plus que des matériaux de notes critiques : une multitude d’informations les plus diverses. Tous ces textes inédits sont susceptibles de jeter une lumière neuve sur Boileau et son époque. Enfin, Brossette fin lettré figure parmi les plus fidèles interlocuteurs du poète satirique ; il incarne l’exemple parfait de l’érudit « pour qui la conversation non seulement représentait un talent de société, mais encore faisait un peu fonction de journalisme19 ».
2. LE LIVRE ILLUSTRÉ
Les Métamorphoses illustrées au XVIIᵉ siècle : reconfigurations mondaines des modèles humanistes
Céline BOHNERT
Université de Reims Champagne-Ardenne
Les Métamorphoses illustrées en France à la Renaissance témoignent de la prégnance d’une pensée de la figure dans laquelle s’enracinent à la fois la lecture du poème d’Ovide et la conception des images qui l’accompagnent. Dans un très bel article, Trung Tran a exposé les enjeux liés à cette pensée de l’image (textuelle et iconique) comme figure lorsqu’elle s’applique au poème d’Ovide. Il montre que la lecture renaissante instaure une série de tensions
entre la fiction et ses allégorèses, la littéralité de l’histoire et sa figurabilité (sa capacité ou sa nécessité – ou non – de faire figure). Une telle dialectique se reporte alors naturellement sur l’image, la valeur dont elle est investie et, partant, la lecture qui doit en être faite […].1
De fait, « [i]l va sans dire que le subtil dialogue qui se noue entre fiction, gloses et images confère à ces dernières autre chose qu’une seule et simple valeur ornementale et illustrative2 ». Par principe, les humanistes admettent que l’image sensible fait sens, voire qu’elle mène vers un plus haut sens ; tout comme si, par sa seule présence, elle confirmait le pouvoir imageant du texte, la capacité des fictions mythologiques à renvoyer à des réalités historiques, cosmiques et morales. De même que le texte édité sans glose est comme dénaturé, proprement défiguré, l’image appelle une forme de déférence. Apposée au poème, elle en donne certes à voir le sens littéral et synthétise la fiction et ses suggestions par des effets sensibles. Mais il est admis qu’elle ne fait jamais que cela. A minima, elle est le support et l’occasion de discours sur les fables. Très souvent, elle devient un élément actif dans la fabrique du sens par le lecteur, invité à faire fonctionner un système de signes disposés dans et orchestrés par le livre. Ainsi, par exemple, certains dispositifs éditoriaux font-ils des séries gravées le pendant, au début de chaque segment narratif, des résumés ou des gloses qui le suivent. La profondeur de l’image relève, pour les acteurs du livre, de l’ordre de l’évidence. Pour autant, il est fort rare que les gravures fassent l’objet d’un commentaire explicite : si le principe de leur signifiance est admis, si leur seule présence contribue à renforcer la croyance dans la nature figurale du texte ovidien, il revient au lecteur, guidé notamment par la disposition des éléments sur la page, de prêter sens à ce qu’il voit.
Ce principe de figurabilité est à la fois servi et limité par la plasticité des images. On connaît la genèse de la première série française entièrement conçue pour les Métamorphoses, celle de Bernard Salomon. Dans la Métamorphose figurée de 1557, les images, composées d’après une paraphrase médiévale d’Ovide et des bois de diverses séries, sont glosées par des huitains attribués à Barthelémy Aneau : faites initialement pour accompagner une traduction nouvelle, qui n’a pas vu le jour, elles remplacent le texte d’Ovide, la traduction en image se substituant à la traduction vernaculaire3. Les gravures de Salomon, immédiatement copiées et largement diffusées, ont été insérées dans des dispositifs éditoriaux extrêmement variés. Deux ans après La Métamorphose figurée, ces bois tiennent le rôle de faire-valoir pour une réécriture du poème ovidien. Gabriele Simeoni change en effet la nature de l’entreprise, sous couvert d’une simple traduction du livre de Salomon : les poèmes qu’il compose pour La vita et metamorfoseo d’Ovidio, figurato & abbreviato in forma d’epigrammi, loin de traduire les ecphrases d’Aneau, affichent une dette directe envers Ovide. Ils mettent ainsi en valeur l’habileté de Simeoni. Ne dérivant plus des gravures, les textes entrent en concurrence avec elles et le livre offre au lecteur une double translation du poème, l’une poétique et l’autre imagée4. Les copies de Virgil Solis, elles, sont mises à profit de trois façons différentes par les mêmes éditeurs l’année de leur première publication : les bois de Solis illustrent une édition latine5, servent de support à des quatrains moraux6 et trouvent place dans un kaléidoscope pédagogique qui diffracte le texte ovidien pour infuser dans l’esprit des jeunes lecteurs des leçons de sagesse7. Ces trois ouvrages, dus à des disciples de Philippe Melanchthon, signalent la fécondité du poème ovidien aux yeux des membres de son réseau. Plus prosaïquement, les figures occupent la fonction de support mémoriel dans les éditions rhétoriques sans glose publiées à Paris, où elles deviennent un avatar des arguments du pseudo-Lactance8. Dans la Picta poesis ovidiana éditée par Nicolas Reusner enfin, elles structurent le jeu épigrammatique en ouvrant chaque série de courts poèmes qui juxtaposent des variations en droit indéfinies autour des figures mythologiques9. S’est ainsi constituée à la Renaissance une collection d’ouvrages illustrés, petites galeries ovidiennes unifiées par la notion de figure10.
La signifiance et la plasticité des images permettent cet éventail d’emplois qui orchestrent de manières variables le dialogue des signes iconiques et textuels. Mais cette plasticité signifie aussi que l’image résiste aux discours qui l’entourent, qu’elle s’y prête pour mieux y échapper : les gravures ne trouvent pas seulement leur fonction, elles acquièrent aussi une pluralité de sens dans leur articulation avec leur entourage textuel – d’autant que, comme au Moyen Âge, les formes du texte ovidien, de ses translations et de ses commentaires ne cessent de se modifier, dans le temps même où la philologie humaniste tend à stabiliser la leçon du poème. La circulation des images contribue à la ductilité des Métamorphoses. Même lorsque le contenu narratif ou exégétique reste globalement inchangé, les découpages typographiques se déplacent et ouvrent dans le texte un jeu propice à l’invention. Cette malléabilité est si grande que les notions de texte et d’œuvre telles que nous les concevons semblent imparfaitement appropriées au devenir des Métamorphoses au XVIe siècle : paraphrases, résumés et gloses forment un ensemble métamorphique placé sous le nom d’Ovide. Un ensemble mouvant et multiforme, à la fois accueillant – de nombreux mythes absents des Métamorphoses rejoignent ces corpus ovidiens – et rayonnant : des gravures quittent les terres ovidiennes pour entrer notamment dans le territoire des emblèmes où elles signifient encore autrement et souvent autre chose. Le livre apparaît ainsi comme l’appareil complexe qui organise les reconfigurations de cette constellation où circulent textes et images.
La question que nous examinerons ici est celle du devenir des modèles éditoriaux établis à l’âge humaniste à l’heure où les Métamorphoses sont proposées au public des honnêtes gens : ce bouleversement s’accompagne d’évolutions esthétiques, culturelles et matérielles dont Marie-Claire Chatelain a analysé les conséquences sur la réception d’Ovide, d’auctoritas savante devenu poète galant11. Il s’agit bien du devenir au XVIIe siècle des formes éditoriales renaissantes car plusieurs éléments tissent une nette continuité. Le remploi et la copie des séries gravées à la fin du XVIe siècle, elles-mêmes inspirées des bois de Bernard Salomon et de Virgil Solis, en particulier, induisent une stabilité iconographique : la nouveauté provient de variations à l’intérieur du modèle, de réinterprétations des thèmes ou de l’organisation de nouveaux rapports entre l’image et ses entours. Nous identifions ainsi deux familles de Métamorphoses en images : l’album ovidien et la traduction illustrée, qui se décline elle-même en trois espèces.